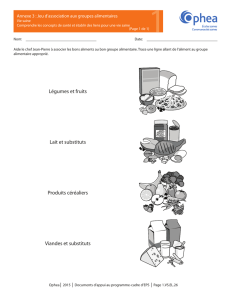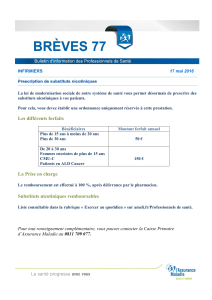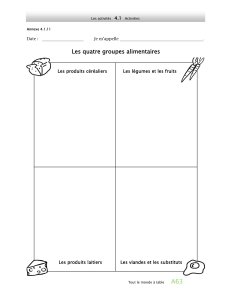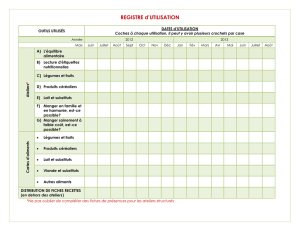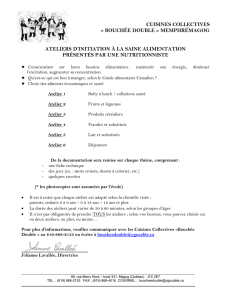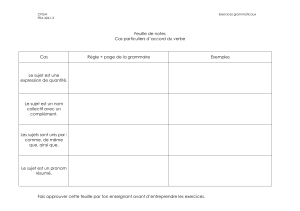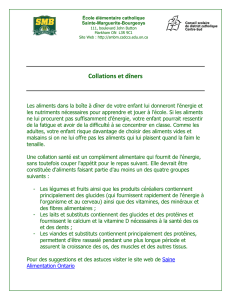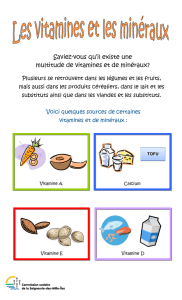2. Grammaire (M.-L. Elalouf) Le corrigé est en

2. Grammaire (M.-L. Elalouf)
Le corrigé est en caractères droits, les commentaires en italiques. J’ai suivi l’orthographe officielle
recommandée par l’Académie française depuis 1990. Le corrigé détaillé est plus développé que ce
que l’on attend du candidat.
QUESTION 1
Définition :
La notion de substitut relève de la grammaire textuelle. Le terme désigne un ensemble de procédés
linguistiques qui reprennent une même source sémantique et dont l’interprétation référentielle
dépend de leur mise en relation avec cette source. L’emploi de substituts contribue à la cohésion du
texte.
Quatre plans sont possibles ; le plan adopté par le candidat doit être précédé d’une introduction
justificative.
1er plan
La substitution peut s’effectuer par des moyens lexicaux ou grammaticaux. On parle de substitution
lexicale quand le substitut est un groupe nominal organisé autour d’un nom commun. On parle de
substitution grammaticale quand le substitut est un mot grammatical, reprenant un groupe nominal et
dans certains cas un nom.
1. La substitution lexicale
2. La substitution grammaticale
2e plan
La reprise d’une source sémantique fait appel à deux classes grammaticales :
• la classe du pronom : on parle alors de reprise pronominale (mais on notera que tous les pronoms
ne sont pas des substituts) ;
• la classe du nom, noyau du groupe nominal : on parle alors de reprise nominale.
1. La reprise pronominale
2. La reprise nominale
3e plan
On peut identifier dans ce texte deux chaines de référence, d’abord disjointes, puis réunies grâce à un
substitut au pluriel. Elles sont constituées de différents éléments sur le plan morphologique. On
présentera successivement chacune d’entre elles en caractérisant les différents substituts.
1. Les substituts de « Billy »
2. Les substituts de « le renard »
3. Le substitut de « Billy et le renard »
4e plan
On distingue trois types de substitution :
• le substitut est en relation de coréférence totale avec sa source sémantique : un enfant … l’enfant …
il ;
• le substitut est en relation de coréférence partielle avec sa source sémantique : un enfant … sa
main ;
• le substitut est en relation de disjonction référentielle avec sa source sémantique : un enfant … un
autre.
1. Coréférence totale
2. Coréférence partielle
Les plans 1 et 2 sont très proches mais non équivalents sur le plan terminologique. Le plan 4 ne se
rencontrera sans doute pas, d’autant que la coréférence partielle ne concerne qu’une occurrence (« sa
tête »), mais une remarque à ce sujet peut être valorisée. On développera le plan 3, sans doute le plus
choisi.

Références :
R. Tomassone, Pour enseigner la grammaire, p. 98-110. Paris, Delagrave, 2002,
M.-L. Elalouf in . Tomassone (dir.) : Grands repères culturels pour une langue, le français, pp 218-
19 & 234-35. Paris, Hachette, 2001.
3e plan : corrigé détaillé
On peut identifier dans ce texte deux chaines de référence, d’abord disjointes, puis réunies grâce à
des substituts au pluriel. Elles sont constituées de différents éléments sur le plan morphologique. On
présentera successivement chacune d’entre elles en caractérisant les différents substituts.
1. Les substituts de « Billy »
a- Les substituts lexicaux
• sa tête : le déterminant possessif indique la coréférence partielle entre la source sémantique Billy et
le groupe nominal sa tête.
b- Les substituts grammaticaux
Ce sont tous des pronoms personnels de 3e personne. Certains sont conjoints au verbe ; d’autres
apparaissent dans des groupes prépositionnels : ils sont disjoints.
• lui (l. 1) : les constructions quelqu’un retourne quelque chose dans sa tête et quelque chose vient à
l’idée de quelqu’un sont proches sémantiquement mais assignent une fonction différente au référent
humain, ce qui explique que lui reprenne sans ambigüité le sujet du premier paragraphe, Billy ,
malgré la présence entre eux du nom propre Joe.
• le (l. 2) : dans une subordonnée dont le sujet est le renard, expression à laquelle le pronom ne peut
coréférer.
• il (4 occurrences l. 2-4 et l. 12) : pronoms sujets assurant la continuité thématique (progression à
thème constant).
• lui (l. 4) : pronom de forme disjointe, coréférant au sujet il.
• lui (l. 11) : pronom de forme disjointe, ne coréférant pas au sujet celui-ci.
Par le nombre des substituts grammaticaux en alternance avec la répétition du nom propre et par la
progression thématique, Billy est le groupe dominant de ce passage.
2. Les substituts de « le renard »
La source sémantique est présentée comme identifiable par le lecteur (article défini + nom). On
suppose que le personnage a été introduit antérieurement dans le récit.
a- Les substituts lexicaux
• l’animal (l.3): le choix d’un hypéronyme renforce le topos de l’amitié entre un enfant et un animal
en laissant au second plan le caractère sauvage de celui-ci.
• du (de + le) renard (l. 11) : répétition lexicale assurant un parallélisme sémantique et syntaxique
entre l’enfant et l’animal.
b- Les substituts grammaticaux
• celui-ci (l. 11): le choix du pronom démonstratif permet la reprise immédiate de le renard et lève
une ambigüité.
• le (2 occurrences l. 11) : pronom conjoint ne pouvant coréférer au sujet Billy (le retint et non se
retint).
3. Les substituts de « Billy et le renard »
a- Les substituts grammaticaux
• ils (l. 10) : pronom sujet au pluriel assurant la continuité avec les deux paragraphes
précédents (progression à thème constant sur Billy dans le 1er §, sur le renard dans le 2e, sur l’enfant
et l’animal réunis dans le 3e). L’idée de nombre, marquée par le pluriel morphologique, est renforcée
par le quantificateur tous les deux qui combine trois déterminants et désigne un groupe identifié (les),
dénombrable (deux), pris dans sa totalité (tous).
1
/
2
100%