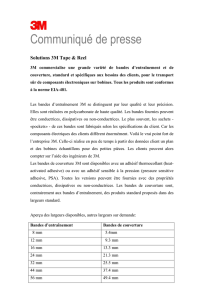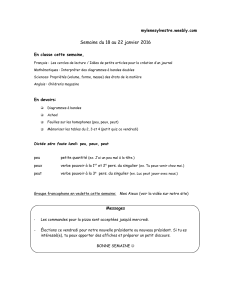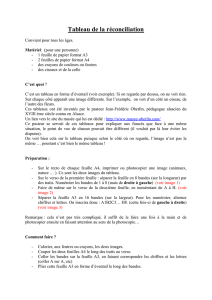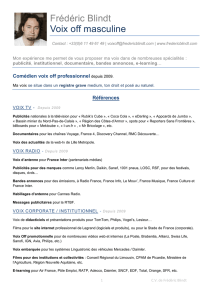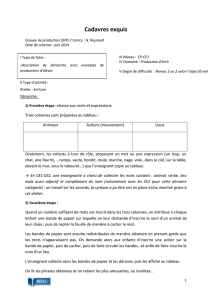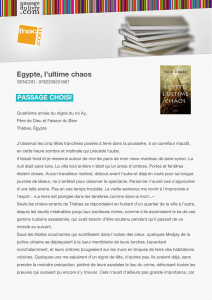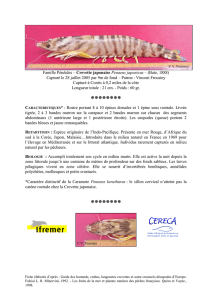Fratries, collatéraux et bandes de jeunes

5
5Fratries, collatéraux
et bandes de jeunes
Marwan Mohammed
Depuis le début des années 1990, les bandes de jeunes font un retour en
force sur la scène publique hexagonale. Dans l’arène médiatique, le phé-
nomène des bandes est réduit aux délits réels ou supposés (affaire du
RER B) qui lui assurent une visibilité cyclique. Ces groupes de jeunes ne
sont-ils pas soupçonnés d’avoir fomenté les émeutes de l’automne 2005 ?
Au hit-parade des « causes » du phénomène des bandes, la « démission
des familles » est en bonne place et derrière cette notion, c’est précisément
le « laxisme » des parents qui est visé. Ce lien entre relations familiales et
participation aux bandes de jeunes est au cœur de nos recherches doctora-
les. L’angle vertical (parents-enfants), amplement traité dans notre thèse
de sociologie donnera lieu à des publications ultérieures. Le texte suivant
questionne la place et le rôle spécifiques des germains ainsi que des colla-
téraux dans la participation à l’univers des bandes. Nos recherches nous
ont permis de distinguer trois temps dans le processus de participation aux
bandes de jeunes1.
Bien avant l’intégration symbolique à ces collectifs et l’adoption de
conduites déviantes, l’analyse des trajectoires révèle des similitudes dans
les calendriers. Pour résumer, cela commence par des ruptures dans le
cadre scolaire, d’abord les résultats, puis des tensions disciplinaires avec
1. Germains : frères et sœurs de même sang. Collatéraux : il s’agit ici des autres acteurs
(cousins, cousines, proches de la famille) qui partagent des relations horizontales (même géné-
ration) dans l’espace domestique. Bande : ce terme désigne les collectifs juvéniles informels
inscrits dans une dynamique conflictuelle avec leur environnement, qui se différencient
d’autres groupes de jeunes par des conduites déviantes et délinquantes fréquentes, même si ces
dernières ne sont pas leur raison d’être [Mohammed 2004]. L’ensemble des bandes d’un terri-
toire donné gravite autour d’un pôle des sociabilités déviantes (pôle déviant) qui se distingue
dans les quartiers populaires français d’autres pôles normatifs (scolaire, militant, religieux,
cultures urbaines…), ainsi que de l’ensemble des jeunes non visibles dans l’espace public.
Cette recherche a été menée à Villiers-sur-Marne (94) essentiellement dans la ZUS des Hautes-
Noues. De nombreuses données statistiques concernant le quartier sont commentées dans
l’article de Dominique Lorrain [2006].

LES BANDES DE JEUNES. DES « BLOUSONS NOIRS » À NOS JOURS
98
l’institution et les parents. Pendant cette période, le statut du « pôle dé-
viant » (avec sa vision clivée du monde et ses conduites spécifiques) passe
progressivement d’un élément de l’écologie locale à une alternative perti-
nente et compensatrice aux déclassements scolaires et familiaux. Dans un
second temps, généralement pendant la période du collège, l’éventualité
devient réalité et la bande structure un quotidien conflictuel avec la socié-
té. Enfin, le dernier temps, en aval, est celui de la prise de distance et de la
conversion symbolique à d’autres pôles de sociabilités (si ce n’est pour
une minorité la poursuite d’une carrière criminelle plus individualisée ou
bien l’impasse de la « clochardisation » [Mauger 2003]). L’importance du
rôle des germains se situe essentiellement (mais pas exclusivement) en
amont, dans la construction de la légitimité symbolique des conduites dé-
viantes et dans la préparation aux rugueuses relations de rue.
La question est donc fortement circonscrite : les logiques fraternelles à
l’œuvre au sein des familles populaires qui n’ont pas au moins un de leurs
membres dans ces bandes de jeunes (c'est-à-dire la majorité d’entre elles)
sont ignorées. L’approche est ethnographique et s’intéresse avant tout aux
modalités pratiques. L’accent est mis sur la dimension de la socialisation,
notamment les logiques domestiques de promotion et de légitimation des
conduites typiques des bandes de jeunes dans les milieux populaires.
« Chaque germain s’inscrit ainsi dans un réseau de relations qu’il contri-
bue à former en même temps que celui-ci représente le creuset dans lequel
il se construit en forgeant son identité, son accession au statut de sujet par
l’expérience de l’altérité » [Buisson 2003, p. 130]. L’approche que je pri-
vilégie ici consiste donc à appréhender les fratries « comme des ensembles
configurationnels, au sein desquels, la trajectoire propre à chaque membre
se définit en rapport avec celle des autres » [Rosental 1995, p. 134]. Ce
type de configuration nécessite pour Norbert Elias l’existence d’« une in-
terdépendance en tant qu’alliés, mais aussi en tant qu’adversaires »
[Elias 1991, p. 157].
0LES FRATRIES : UN OBJET D’ÉTUDE SECONDAIRE ET HÉTÉROGÈNE
Si l’on considère que la littérature française sur les bandes de jeunes a
globalement inexploré la question familiale [Mohammed 2003] et que la
sociologie de la famille – avant tout centrée sur les aspects conjugaux (al-
liances, séparations, rôles) et verticaux (filiation, transmission, solidarités,
échanges) – manifeste un intérêt réduit et récent pour les relations frater-
nelles [Buisson 2003, Spire 1998, Théry 1996], il n’est pas étonnant que la
question spécifique des rapports entre les relations horizontales (germains
et collatéraux) et la participation aux bandes juvéniles soit ignorée.
Les relations fraternelles ont d’abord été développées par les anthropo-
logues et la psychanalyse. L’anthropologie a mis en avant le fait que les

FRATRIES, COLLATÉRAUX ET BANDES DE JEUNES 99
relations fraternelles prennent des formes historiques et sociales plurielles,
en rappelant que ces configurations ne prennent sens qu’à travers
l’intelligence de leur contexte d’expression. L’analyse des liens de germa-
nité prend d’abord acte du tabou de l’inceste dans la fratrie [Héritier
1994]. Ce tabou crée du lien social en imposant aux familles des relations
exogènes au groupe initial. « L’abandon des droits sexuels sur la sœur crée
le lien social, d’où l’extrême attention qu’ont portée toutes les sociétés à la
question des rapports frère-sœur, soit en tenant séparés les principaux inté-
ressés, soit en privilégiant la proximité et la solidarité, mais de manière à
éviter la promiscuité » [Widmer 1999, p. 4]. Ainsi, l’étude des systèmes de
parenté par les ethnologues constitue le cadre initial des recherches en la
matière. Dans de nombreuses sociétés, la fratrie est associée à un système
de rôle et de statut. L’aîné est considéré comme un support domestique et
éducatif de première importance par ses parents, ce qui en retour, lui per-
met de bénéficier d’une autorité et d’un pouvoir non négligeables. En ou-
tre, ces solidarités dans les registres éducatifs et domestiques se prolongent
sous des formes plus horizontales avec l’âge adulte. « Les germains déve-
loppent, en effet, des attentes normatives fortes les uns par rapport aux
autres, qui seront déterminantes dans la suite de leur existence » [Widmer
1999, p. 2]. Ces relations prennent sens dans des contextes spécifiques. En
période de pénurie, la solidarité fraternelle est connectée aux stratégies de
survie : « à l’âge de 3 ans, un enfant partage automatiquement sa subsis-
tance avec un germain plus jeune et, à l’âge de 6 ans, il renoncera souvent
à manger, s’il n’y a pas assez pour son germain » [Watson-Gegeo, Gegeo
1989, p. 61]. Les anthropologues insistent donc sur le don et les liens de
réciprocité. L’activité économique et le quotidien mobilisent bien souvent
les liens de germanité. Ce sont les principes d’unité et de solidarité qui
cadrent ce type d’expérience familiale qui prend sens dans la valorisation
du groupe : « la jalousie et la compétition entre germains sont relativement
peu fréquentes dans les sociétés ethnologiques » [Widmer 1999, p. 5].
La confrontation des postures anthropologiques et psychanalytiques sur
la question des fratries donne à voir des dissonances significatives. Dans
les premières, de nombreux travaux font état du caractère secondaire des
relations négatives (jalousies, conflits, concurrences) entre des germains
avant tout perçus par leurs pratiques de coopération. De son côté,
l’approche psychanalytique tend à inverser la perspective en privilégiant
l’étude des conflits fraternels qui naissent du complexe œdipien. Les fra-
tricides de Romulus sur Remus et d’Abel par Caïn sont les paraboles fré-
quemment convoquées d’une approche qui met essentiellement l’accent
sur les rivalités. Dans cette perspective, l’horizontalité des relations frater-
nelles paraît indissociable des rapports parallèlement entretenus avec les
parents. Notons par ailleurs, que dans les approches d’obédience psycha-
nalytique, ces mécanismes s’insèrent dans la structure psychique des per-

LES BANDES DE JEUNES. DES « BLOUSONS NOIRS » À NOS JOURS
100
sonnalités. L’inimitié qui marque les rapports entre frères et sœurs pro-
viendrait de la barrière que chacun représente dans l’appropriation des
figures parentales de sexe opposé [Gayet 1993]. Dans ce modèle, l’aîné
subit une frustration particulière avec l’arrivée d’une concurrence pour
l’accès à l’amour et la disponibilité adultes. D’autres logiques de ce type
sont relevées par Widmer comme la « latéralisation des conflits parentaux
(…), à savoir que le conflit avec le frère est une manière de vivre un
conflit avec le père (…), la frustration se déchargeant plus facilement sur
ce rival accessible » [Widmer 1999, p. 10]. L’approche psychanalytique
assure ainsi une place centrale aux multiples formes de rivalités et tend à
percevoir la fratrie comme un étage conflictuel des relations familiales.
Cette polarisation négative entre germains incite donc ces derniers à re-
chercher des identifications extérieures au cadre fraternel2.
À partir du début des années 1980, de nouvelles voies analytiques
émergent par le biais de l’approche psychosociologique [Bank, Kahn
1982], en rupture franche avec le paradigme du conflit3 jugé trop réduc-
teur. Le lien de germanité est appréhendé à travers l’ensemble des facettes
et des contradictions qui le composent. Ainsi, la réciprocité est articulée à
la compétition, la solidarité au détachement individuel. L’horizontalité du
lien de germanité s’enrichit d’un catalogue de sentiments positifs. Le vi-
rage théorique se situe notamment dans la prise en compte de certaines
spécificités du lien fraternel au sein du cadre familial (créneau émotionnel,
codes, loyauté, intimité), à travers la déconnexion croissante du lien paren-
tal à celui de germanité [Widmer 1999].
Qu’en est-il des sociologues ? Leur silence est étonnant sur les fratries.
Ni les études sur la famille4, ni la production contemporaine sur la cons-
truction des identités ne s’y attardent. Cette situation est d’autant plus sur-
prenante que comme l’avance Claude Dubar [2000] – l’un des spécialistes
français sur cette question – la « crise » des identités s’enracine dans les
dynamiques familiales contemporaines.
Les relations fraternelles ont peu de place dans les sciences sociales
qui, mise à part la conjugalité, privilégient la verticalité du rapport de filia-
tion. Historiquement, la fratrie perçue à travers le prisme des individuali-
tés, émerge en Occident avec le modèle bourgeois de vie familiale (au
2. Notons tout de même que certains travaux de psychanalyse remettent en cause
l’universalité de cette approche axée sur le conflit. Ils reconnaissent une « certaine indépen-
dance des relations fraternelles par rapport aux parents, et admettent que la rivalité pour
l’amour n’est pas un schème universel » [Widmer 1999, p. 11]. Ces relations peuvent donc être
complémentaires : « agression du frère frustrateur ou de son substitut et constitution de groupes
de solidarité entre frustré et frustrateur » [Cahn 1962, p. 152].
3. Pour une synthèse de ces travaux et de leurs apports, se référer à Widmer [1999].
4. Un « épiphénomène d’une sociologie globale de la famille » [Spire 1998, p. 28]. Pour une
synthèse critique et récente des travaux sur l’objet « fratrie », la lecture des trois premiers cha-
pitres de l’ouvrage de Monique Buisson [2003] est particulièrement stimulante.

FRATRIES, COLLATÉRAUX ET BANDES DE JEUNES 101
début du XVIe siècle selon Philippe Ariès [1973]). Le lien fraternel étant
jusqu’alors abordé à travers l’angle juridique au sein duquel le droit
d’aînesse tend à structurer les relations. « Dans une famille soumise aux
impératifs de la transmission héréditaire, les rapports entre frères et sœurs
sont marqués par la dépendance des cadets à l’égard de l’aîné, ils sont
soumis à la logique de l’intérêt » [Cicchelli-Pugeault, Cicchelli 1998,
p. 79]. Progressivement, les évolutions juridiques concernant l’héritage,
ont considérablement affaibli la régulation statutaire du lien de germanité.
Du point de vue du droit actuel, ce lien se résume à « l’interdit pour un
frère et une sœur de contracter mariage, l’absence légale d’obligation ali-
mentaire entre membres de la fratrie et l’espérance d’hériter d’un germain
décédé sans postérité si celui-ci n’a pas exhérédé ses frères et sœurs de la
succession » [Buisson 2003, p. 15-16].
Le thème de « l’héritage » est toutefois encore très présent, en témoigne
la place qu’il occupe dans l’un des rares chapitres dédié à la fratrie dans la
littérature théorique récente [Attias-Donfut, Lapierre, Segalen 2002]. De
même, les relations entre frères et sœurs sont encore fortement différen-
ciées selon la position de naissance et le sexe [Buisson 2003, Langevin
1994], ce qui reflète une survivance des logiques statutaires. De ce point
de vue, les théories individualistes de la famille [Singly 1996] sont en ten-
sion permanente avec les recherches qui mettent en avant la persistance,
voire l’amplification des solidarités familiales [Pitrou 1978] à travers des
systèmes d’échanges entre frères et sœurs qui fluctuent aux différents âges
de la vie (généralement, les aînés aident plus que les suivants, les filles
aident plus que les garçons). Les mutations récentes et rapides des formes
familiales ont par ailleurs contribué à l’émergence d’un intérêt particulier
(et spécifique) sur les fratries de familles recomposées [Poittevin 2003].
1LA TAILLE ET LE RANG : MORPHOLOGIES DES FRATRIES
ET DÉVIANCES COLLECTIVES
Comme cela est noté infra, la sociologie française des bandes de jeunes
n’a pas véritablement abordé le volet familial du phénomène. Lorsqu’elle
l’a fait, l’angle parental et vertical a toujours été favorisé. Ces travaux ont
cependant « défriché » le terrain en proposant un certain nombre de pistes
intéressantes. Ainsi, Philippe Robert et Pierre Lascoumes [1974] nous
invitent à distinguer les parents et la fratrie comme deux espaces
d’investigation distincts du groupe familial. Cette opposition se décline en
deux perspectives : d’un côté l’impact des perturbations du couple parental
sur le niveau de déviance et de l’autre, la préparation normative qu’exerce
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
1
/
26
100%