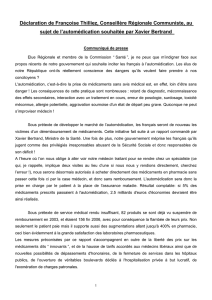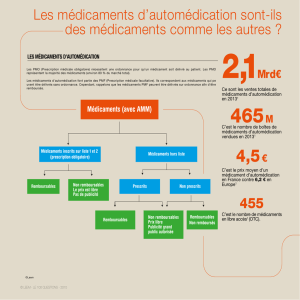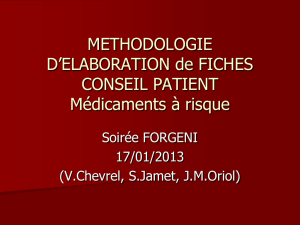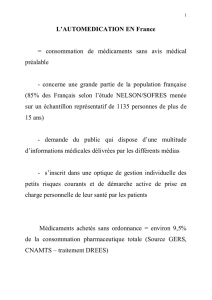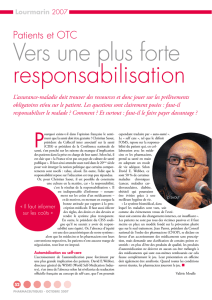Chapitre 1 - La Revue du Praticien

Chapitre 1
Prescription médicamenteuse
1. Automédication :
Patrice Queneau, Christian Ghasarossian
2.
Polymédication : Christian Ghasarossian, Patrice Queneau
3.
Médicaments à prescription particulière :
Aurélie Daumas,
Patrick Villani, Bernard Gay
4.
Gestion de l’observance : Alain Moreau, Patrice Queneau
5.
Éducation thérapeutique du patient : Jean-Louis Demeaux,
Jean-Philippe Joseph, Louis Sibert
6.
Iatrogénie et pharmacovigilance : Marc Vidal, Gilles Bouvenot,
Patrice Queneau

Chapitre 1. Prescription médicamenteuse/ 1
Thérapeutique en médecine générale
21
Automédication
Patrice Queneau, Christian Ghasarossian
Points clés :
• L’automédication est un fait de société qui ne peut être négligé.
• Il faut distinguer l’automédication « sauvage », prise anarchique
de médicaments ou de traitements non validés, et la prise de
« spécialités d’automédication » adaptées à un usage sans contrôle
médical obligatoire.
• Le médecin doit prendre en compte l’automédication et notamment :
– la connaître en interrogeant systématiquement le patient,
– prendre en compte les interactions potentielles entre médicaments
prescrits et automédication,
– rechercher l’automédication méconnue lors de la survenue
de tout nouveau symptôme.
• Le médecin doit toujours conseiller son patient et l’éduquer à une
automédication dans le respect du « bon usage » du médicament.
1. Introduction
Il existe une tendance de la société
menant à une autonomisation de la prise
en charge de sa santé par chacun sans
l’avis d’un médecin. Ce souhait de société
se heurte à des difficultés multiples : for-
mation insuffisante des médecins et des
autres soignants à ce type de traitement ;
coût de l’achat des médicaments d’automé-
dication ; dangers potentiels de celle-ci ; flou
de la législation. Il est permis de « rêver » à
une automédication efficace et bien tolérée,
facilement accessible au patient, qui devrait
pouvoir repérer en pharmacie le médicament
capable de faire régresser un symptôme (mal
de tête, douleur gastrique, diarrhée) en toute
sécurité.
L’actuel « flou » dans la législation rend
difficile le positionnement de la vraie auto-
médication par rapport à des médicaments
déremboursés ou à des médicaments en
vente libre ne correspondant pas aux ob-
jectifs de l’automédication. L’information
donnée au patient sur ces médicaments doit
être objective et positive, sans dénigrement
systématique ni incitation inconsidérée.
Le prix des médicaments d’automédica-
tion est un problème. Certains sont actuel-
lement plus chers que les médicaments
de prescription, ce qui, évidemment, peut
inciter le malade à préférer aller consulter
son médecin, même pour une affection
bénigne, plutôt que d’acheter directement
les médicaments. Une politique positive
d’automédication devrait probablement
passer par une révision de la politique des
prix. À titre d’exemple, le lopéramide, anti-
diarrhéique, existe en tant que spécialité
d’automédication sous la forme d’Imossel®,
lequel se trouve être sensiblement plus cher
(prix libre fixé par le pharmacien, avec des
variantes importantes : moins de 3,50 € à
plus de 5,50 €) que l’Imodium
®
, spécialité de
prescription et remboursée par la Sécurité
Sociale (4,18 € pour 20 gélules de lopéra-
mide dosé à 2 mg).
2. Définition
L’automédication correspond à la prise
d’un médicament en l’absence de pres-
cription médicale. C’est un comportement
fréquent, « à la mode », beaucoup de

Thérapeutique en médecine générale
22
Automédication
personnes considérant aujourd’hui que
la prise d’un médicament ne requiert pas
nécessairement un avis médical. Dans le
meilleur des cas, l’automédication concerne
la prise de spécialités d’automédication :
médicaments ayant l’AMM et adaptés au
traitement personnel de certains troubles
mineurs (douleurs, céphalées, fièvre, toux
sèche, diarrhée) ou de situations clairement
définies (contraception d’urgence, aide à
la désaccoutumance du tabac), sans le re-
cours nécessaire au conseil d’un médecin.
Cependant, la notion d’automédication peut
aussi concerner la prise intempestive de
médicaments anciens gardés dans l’armoire
à pharmacie familiale et antérieurement
prescrits à soi-même (pour la même ou pour
une autre maladie) ou à un tiers. L’automédi-
cation peut concerner aussi des traitements
non médicamenteux (bracelets de cuivre) ou
le recours à des pratiques charlatanesque
diverses.
Des précautions doivent être prises
pour que cette automédication puisse se
développer dans le respect de la Santé
Publique. Une difficulté majeure est l’ab-
sence de définition officielle des spécialités
d’automédication. Ce concept n’apparaît
pas dans le Code de la Santé Publique. Il
n’y a pas de définition spécifique des spé-
cialités de prescription médicale faculta-
tive (PMF) : elles représentent, par défaut,
toutes les spécialités ne présentant pas
les critères d’inscription sur une des listes
susmentionnées. En l’absence de définition
claire, l’ambiguïté persiste. En pratique, la
spécialité d’automédication est essentiel-
lement définie comme une spécialité sans
prescription médicale obligatoire et non
remboursable.
De même dans la réglementation euro-
péenne en vigueur (directive 2004/27/CE,
modifiant la directive 2001/83/CE, article
71, §1), les médicaments sont soumis à pres-
cription médicale lorsqu’ils :
– « sont susceptibles de présenter un
danger, directement ou indirectement,
même dans des conditions normales d’em-
ploi, s’ils sont utilisés sans surveillance
médicale ;
– ou sont utilisés souvent, et dans une
très large mesure, dans des conditions anor-
males d’emploi et que cela risque de mettre
en danger directement ou indirectement
la santé ;
– ou contiennent des substances ou des
préparations à base de ces substances, dont
il est indispensable d’approfondir l’activité
et/ou les effets indésirables ;
– ou sont, sauf exception, prescrits par
un médecin pour être administrés par voie
parentérale ».
Cette directive définit dans son article sui-
vant (article 72) les médicaments non soumis
à prescription médicale comme « ceux qui
ne répondent pas aux critères énumérés »
précédemment. La définition des produits à
prescription médicale facultative (PMF) est
donc une définition par défaut.
C’est l’autorité d’enregistrement qui,
en délivrant l’autorisation de mise sur le
marché, décide du statut du médicament.
Il ressort de la directive précitée que
les produits PMF sont des produits dont la
toxicité est modérée, y compris en cas de
surdosage et d’emploi prolongé, et dont
l’emploi ne nécessite pas a priori un avis
médical.
Certaines spécialités sont « hors liste »
mais souvent prescrites car rembour-
sables. Par exemple, certaines spécialités
contenant du paracétamol sont rembour-
sables, d’autres non. Cette complexité est
mal comprise par les patients et par les
médecins.
Certains médicaments sont restés pres-
crits durant des décennies (bien que de
manière non obligatoire) et remboursés.
Il a pu arriver que, à la suite d’une nou-
velle évaluation du Service Médical Rendu
par la Commission de Transparence, un
déremboursement ait été décidé. Ces
médicaments initialement conçus pour
la prescription médicale ne sont pas obli-
gatoirement adaptés à l’automédication.
Or, certains professionnels déclarent que
ce déremboursement les ferait automati-
quement entrer dans le cadre de l’automé-
dication. Il y a là une ambiguïté majeure
non résolue.

Chapitre 1. Prescription médicamenteuse/ 1
Thérapeutique en médecine générale
23
3. Épidémiologie
Qui s’automédique ?
Tout le monde ou presque, s’automé-
dique et ce à tout âge :
– dès la première enfance, où la mère est
le prescripteur ;
– à l’âge adulte, où elle augmente avec les
décennies pour concerner plus de 50 % des
personnes de plus de 65 ans et représenter
jusqu’à 50 % des prises médicamenteuses
chez les personnes âgées.
Les femmes s’automédiqueraient peut-
être davantage que les hommes.
Interviendraient en outre :
– le niveau d’éducation : l’automédica-
tion serait plus fréquente en cas d’études
supérieures ;
– le revenu et la catégorie socioprofes-
sionnelle : elle serait plus fréquente chez
les cadres, les professions libérales et les
personnes ayant des revenus élevés que
chez les exploitants agricoles, les ouvriers
et les personnes ayant de faibles revenus.
Cependant, l’automédication est globa-
lement assez imprévisible et il est difficile
d’anticiper les comportements des patients
à l’égard de cette pratique.
Une enquête de l’institut CSA-TMO pour
le compte de la DGS en 2002, montre que
70 % des personnes ont pris un médica-
ment conservé dans la pharmacie familiale
au cours des 12 derniers mois et 66 % ont
acheté plus d’une fois un médicament sans
ordonnance.
Quel marché pour l’automédication ?
Pour les antalgiques (aspirine et paracé-
tamol surtout), ce pourcentage serait le plus
élevé surtout chez les malades souffrant de
douleurs rhumatologiques et post-trauma-
tiques. Une situation à part est représentée
par la migraine, qui justifie, sur les conseils
du médecin, la prise, dès l’aura de la crise,
du traitement adéquat.
Le marché mondial de l’automédication
était de l’ordre de 48,6 milliards de dol-
lars en 1997, soit 16 % du marché mondial
total des médicaments. Il concerne pour
90 % l’Europe et l’Amérique du Nord
(Etats-Unis et Canada). En France, le
marché du médicament d’automédication
(médicament en vente libre et non rembour-
sable) représentait en 2004, 359 millions
d’unités vendues (environ 13 % du marché
total des médicaments en volume — contre
40 % aux USA — et 5 % de leur chiffre
d’affaires).
En 2010, il avait progressé à 420 millions
d’unités vendues et 14,1 % du marché en
volume. La particularité de la situation fran-
çaise est que 80 % des produits à Prescrip-
tion Médicale Facultative (PMF) reste rem-
boursable. Les données précitées n’incluent
pas les achats par Internet, difficilement
évaluables mais en importante croissance
(exemple du Viagra®).
4. Les « spécialités
d’automédication »
Une spécialité d’automédication pos-
sède une AMM. Elle a été définie comme
« hors liste », ne requérant pas de pres-
cription médicale obligatoire. Le pharma-
cien peut la délivrer sans ordonnance.
Bien entendu, il se doit de conseiller expli-
citement le patient, plus encore peut-être
que lors de la délivrance des médicaments
de prescription. Une spécialité d’automé-
dication peut usuellement (en l’absence
d’interdiction définie par l’AMM) faire
l’objet de publicité grand public (radio,
télévision, publications). Elle ne fait pas
l’objet d’un remboursement par les orga-
nismes sociaux.
Modalités destinées à assurer le respect
de la Santé Publique
Idéalement, une spécialité d’automédi-
cation devrait supposer :
– un choix de substance active dont le
rapport bénéfice/sécurité est particulière-
ment favorable ;
– un choix d’indications claires que
chaque citoyen devrait pouvoir aisément
comprendre et repérer ;
– un conditionnement (boîtage conte-
nant le nombre d’unités) adapté à une durée
déterminée et limitée de traitement ;

Thérapeutique en médecine générale
24
Automédication
– une information claire et compréhen-
sible apportée par la notice de condition-
nement. Cette information doit préciser :
• les symptômes de la maladie à traiter,
• les doses de médicament à utiliser,
ainsi que la durée du traitement,
• le moment où les symptômes doivent
avoir rétrocédé,
• les symptômes qui font que, le cas
échéant, l’automédication doit être inter-
rompue et qu’il est indispensable d’avoir
recours à un médecin. Par exemple,
une diarrhée peut être traitée pendant
48 heures par une spécialité d’automé-
dication, mais si elle ne cède pas dans ce
délai, si elle s’accompagne de vomisse-
ments ou de selles sanglantes ou puru-
lentes, si elle s’accompagne de fièvre, il
est impératif de demander au plus vite
un avis médical (risque de déshydratation
ou d’autres complications).
Ainsi, les indications des spécialités d’auto-
médication doivent être bien précisées, afin
que l’absence de recours initial à un avis médi-
cal induise un minimum de risques pour le ma-
lade, ces risques procédant pour l’essentiel :
– d’un éventuel retard de diagnostic et
de traitement adapté ;
– d’effets indésirables liés au médicament
lui-même (exemple : l’aspirine peut faire sai-
gner, comme tous les anti-inflammatoires non
stéroïdiens, y compris ceux faiblement dosés et
présentés comme des antalgiques de palier I).
Cependant, si le concept et le statut des
spécialités d’automédication est bien pré-
cisé dans de nombreux pays, avec accès
direct pour le consommateur : OTC (over
the counter : au dessus du comptoir), il reste
aujourd’hui encore imprécis en France.
5. Dangers potentiels
de l’automédication :
rôle du médecin
et du pharmacien
Les dangers sont liés :
– au possible « masquage » de symp-
tômes par des médicaments et donc au
retard de diagnostic ;
– aux possibles interactions médicamen-
teuses ;
– aux effets indésirables de ces traite-
ments.
Rôle du médecin :
Il doit reconnaître le fait social de l’auto-
médication, mettre le patient en confiance
et lors de toute consultation l’interroger sur
les médicaments pris en automédication,
sans le culpabiliser : « Avez-vous pu éviter
de prendre d’autres médicaments que ceux
prescrits ? » ou encore « Avez-vous l’habi-
tude de prendre des médicaments autres
que ceux prescrits ? ».
Le cas échéant, il peut et doit conseiller
l’automédication bien conduite d’un patient
qui le désire. Il est indispensable :
– d’interroger sur les interactions médica-
menteuses possibles entre les médicaments
prescrits et l’automédication ;
– d’interroger sur la recherche d’auto-
médications lors de la survenue de tout
nouveau signe clinique : s’agit-il de l’effet
indésirable d’un traitement ou d’une auto-
médication ?
– de signaler tout effet indésirable obser-
vé lors d’automédications dans le cadre de
la pharmacovigilance.
Rôle du pharmacien :
Il est central en raison de son interaction
directe avec le patient lors de la délivrance
des médicaments.
Le pharmacien doit interroger le patient
sur les autres traitements qu’il pourrait
prendre par ailleurs et identifier d’éven-
tuelles interactions médicamenteuses. Le
renouvellement éventuel de l’achat par
le patient est un moment privilégié pour
l’interroger sur la bonne tolérance du trai-
tement et l’intérêt de le poursuivre.
6. Principales indications
de l’automédication
Il s’agit, pour l’essentiel (par ordre dé-
croissant d’utilisation obtenu à partir d’un
sondage grand public) :
– céphalées : paracétamol, aspirine,
AINS faiblement dosés en ibuprofène ou
kétoprofène ;
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%