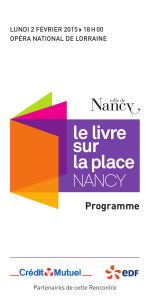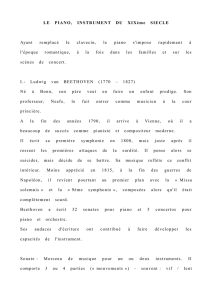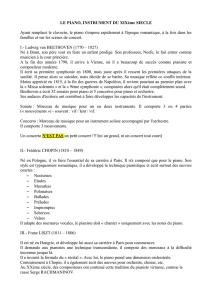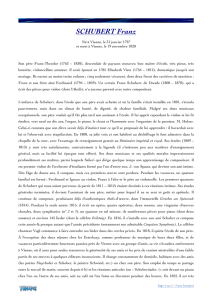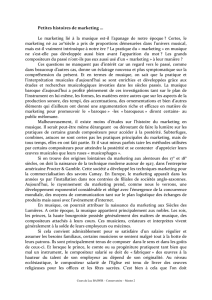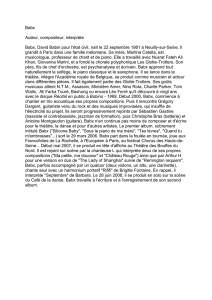Téléchargez le programme (PDF 3,5 Mo)

PROGRAMME
Pallavi Mahidhara
Vendredi 14 octobre 2016
Salle Molière 18 quai de Bondy 69005 LYON
Saison 2016 - 2017
V
irtuoses
Les
P
iano
du
Avec en première partie Léa Hurpeau
Saison 2016 –2017
Concerts à 20h00

2
PROGRAMME
ENTRACTE
Léa Hurpeau (piano)
Joseph HAYDN (1732 - 1809)
Sonate n° 59 en mi bémol majeur Hob XVI : 49
1
er
Mouvement : Allegro
Emmanuel CHABRIER (1841 – 1894)
Scènes pittoresques
N° 10 Scherzo-Valse
Frédéric CHOPIN (1810 - 1849)
Barcarolle en fa dièse majeur Opus 60
Franz LISZT (1811 - 1886)
Six Grandes Etudes pour piano d’après Paganini S 141
n° 1 en sol mineur Préludio (Andante).
n° 2 en mi bémol majeur (Andante – Andante capriccioso).
n° 3 en sol dièse mineur « La Campanella » (Allegretto).
n° 4 en mi majeur (Vivo).
n° 5 en mi majeur « la Chasse » (Allegretto).
n° 6 en la mineur (Quasi presto).
Jean-Sébastien BACH (1685 - 1750) / Johannes BRAHMS (1833 – 1897)
Chaconne de la Partita pour violon seul en ré mineur BWV
1004 (transcription pour piano main gauche).
Franz SCHUBERT (1797 – 1828)
4 Impromptus D 899 (Opus 90)
n° 1 en ut mineur (Allegro molto moderato)
n° 2 en mi bémol majeur (Allegro)
n° 3 en sol bémol majeur (Andante)
n° 4 en la bémol majeur (Allegretto)
Pallavi Mahidhara (Piano)

3
N
ée en avril 2002 à Lyon, Léa commence la musi-
que par l’étude de l’alto avec Denis Masson puis, à
l’âge de six ans, elle débute de piano sous la direction
de Yolande Kouznetsov. Elle entre au CRR de Lyon
dans la classe d’Anne-Elisabeth Tauleigne, puis elle est
prise en troisième cycle dans la classe de Philippe Soler.
Elle participe à de nombreuses auditions. En 2014, dans
le cadre du projet « De l’autre côté du miroir », elle ac-
compagne l’ensemble Lug Double Reed Band dirigé
par Olivier Hue, et joue également ses transcriptions
pour deux pianos de pièces de Bartók et Schumann avec
son frère Pierre-Emmanuel. En 2015, elle joue aux
Confluences de Lyon pour un "Flashmob" autour de
Star Wars. La même année, pour le festival Happy
Hands, elle joue à la Maison de la Musique et de la
Danse puis en 2016 au Palais Saint-Jean.
Elle participe régulièrement aux épreuves du Grand
Concours International de Piano de Lyon dans les caté-
gories piano deux mains, pianos quatre mains et musi-
que de chambre. Elle est finaliste de ce concours.
Si Haydn porte l’image d’un musicien affable et spiri-
tuel, auteur particulièrement prolifique on oublie parfois
(tant cela parait évident) son côté novateur. Lorsqu’il
naît en 1732 le monde musical est alors régi par le cou-
rant baroque où J.S Bach compose ses partitas pour
clavier (neuf ans avant ses fameuses Variations Gold-
berg) et Händel ses grands oratorios comme Ezio ou
Sosarme.
H
aydn deviendra (avec Mozart et le jeune Beetho-
ven) l’un des fondateurs du mouvement Classique vien-
nois Le Classicisme viennois qui durera de la mort de
Bach en 1750 aux prémices du Romantisme vers 1820).
Haydn mènera durant toute la seconde moitié du 18
ème
siècle le courant Classique à son apogée. Il sera un des
artisans de la réforme de la musique Baroque et mourra
seulement quinze ans avant l’émergence du courant
Romantique. Il sera l’un des premiers compositeurs à
essayer de nouvelles formations musicales équilibrées
comme le quatuor à cordes ou à composer des œuvres
instrumentales comme les sonates basées sur des struc-
tures à la fois plus élaborées et moins dispersées que les
suites de danses utilisées dans la musique baroque.
Haydn composera 62 sonates formées de deux, trois ou
quatre mouvements et introduira de façon régulière
dans ses œuvres instrumentales (sonates), de musique
de chambre (quatuors à cordes, trios…) ou de musique
orchestrale (symphonies, concertos…) la « forme so-
nate » basée sur l’exposition d’un ou deux thèmes qui
seront développés dans la partie centrale avant d’être
finalement réexposés à l’identique et résumés dans une
coda.
Grâce à Haydn, la Musique Classique abandonne pro-
gressivement l’esthétique Baroque en allant vers plus de
subtilité et de finesse. Elle obéit à des règles à la fois
plus strictes mais plus simples que la Musique Baro-
que :
- l’Harmonie cède progressivement le pas à la Mélodie.
- l’usage de la basse continue tend à disparaître, les
tournures musicales alambiquées du Baroque font place
à des harmonies plus simples et plus directes.
- le contenu musical abandonne l’esprit pour le senti-
ment en accentuant le contraste et la tension dramatique
des nouvelles compositions.
- la structure même des œuvres et la période classique
verra la prédominance de la forme sonate où plusieurs
thèmes se côtoient, sont exposés, développés puis réex-
posés - soit en s’affrontant, soit en se conjuguant.
Léa HURPEAU va nous donner un parfait exemple de
ce classicisme viennois à la fois raffiné et structuré.
La 59
ème
sonate de Haydn a été composée en 1789 est
dédiée à son amie Marianne von Genzinger. Elle illustre
parfaitement ce glissement progressif du Baroque vers
le Classicisme. Ce mouvement au tempo modéré est
particulièrement riche sur le plan thématique et bien
qu’il soit typique du classicisme viennois il ne renie pas
totalement l’héritage du passé. On trouve çà et là quel-
ques traits à l’écriture polyphonique et aux accents ba-
roques notamment au début du développement. Haydn
utilise subtilement des motifs relativement semblables
pour unifier tout le mouvement. On remarque aussi
l’emploi de quatre notes répétées qui font penser au
début de la cinquième symphonie de Beethoven (le fa-
meux thème du destin). Haydn joue aussi avec ce thème
en l’interrompant à la fin de l’exposition pour mieux le
reprendre dans le développement.
L
e style employé est tout autre avec le Scherzo-
Valse d’Emmanuel Chabrier. Tout comme Liszt dans sa
jeunesse, Chabrier avait la réputation d’un musicien
exubérant et divertissant doublé d’un pianiste ébourif-
fant et briseur de clavier. Cependant au-delà de ce cli-
ché (certes non dénué de tout fondement), Chabrier
composait des œuvres extrêmement poétiques et délica-
tes et savait se montrer un coloriste raffiné. Ami de
Verlaine et des plus célèbres peintres impressionnistes
comme Manet, Chabrier a passé une grande partie de sa
vie au ministère de l’intérieur avant d’épouser une car-
rière de compositeur professionnel. Ecrit en 1881 le
Scherzo-Valse termine un recueil de dix pièces pour
piano intitulé « les Scènes pittoresques ».
Le Scherzo-Valse est une pièce virtuose typique de cet
esprit français à la mode en cette fin de dix-neuvième
siècle, même si Chabrier avait pour modèles Chopin,
Schumann et Wagner. Par son caractère volubile et
emporté le Scherzo Valse atteint très rapidement une
grande notoriété à l’instar d’España (dont Camille Che-
villard a fait une impressionnante transcription pour
piano) ou de la Bourrée Fantasque. Quatre pièces par-
ticulièrement représentatives des Scènes Pittoresques
(Idylle, Danse villageoise, Sous-bois et Scherzo-Valse)
seront orchestrées par Chabrier et données en avant
première à Angers fin 1888.

4
C
’est la première fois
que la pianiste indo-
américaine Pallavi MA-
HIDHARA se produit à
Lyon.
Elle débute ses études à la Levine
School of Music à Washington DC
auprès de Julian Martin, puis elle
sort diplômée du Curtis Institute of
Music de Philadelphie en 2010 avec
un baccalauréat en musique « Piano
Performance », comme une élève de
Ignat Solzhenitsyn. Elle a reçu
des leçons et masterclasses de
grands maîtres tels que Richard
Goode, Mitsuko Uchida, Pascal Ro-
gé, Ferenc Rados, Leon Fleisher,
Fou T'song, Menahem Pressler et
Naum Grubert.
Depuis 2010, elle se perfectionne
d’une part à Madrid, à l’Ecole Supé-
rieure de Musique Reine Sofia au-
près de Dimitri Bashkirov, et d’autre
part, à la Hochschule für Musik
Hans Eisler de Berlin, auprès d’El-
dar Nebolsin.
Avant de remporter le 2
ème
Prix du
Concours de Genève en 2014, elle a
déjà brillé dans de nombreux
concours nationaux et internatio-
naux : 2
ème
Prix du Concours Proko-
fiev de Saint-Pétersbourg, 4
ème
Prix
et Prix Spécial au Concours UNISA
de Pretoria. Elle participe à de nom-
breux festivals et académies, tels que
Marlboro, Santander, Prussia Cove,
Verbier ou Aspen, ainsi qu’en Inde
au Sangat Chamber Music Festival.
Elle a déjà donné de nombreux
concerts avec orchestre aux USA, en
Russie, en Afrique du Sud, en Amé-
rique du Sud ou en Chine.
Connue pour sa polyvalence artisti-
que, Pallavi MAHIDHARA combine
une maturité musicale hors du com-
mun à une technique étonnante, et
une présence scénique charismati-
que. Très éclectique, elle n’hésite
pas en avril 2011, à rejoindre
le batteur Questlove de "The Roots"
et le chanteur Keren Ann pour un
concert fusionnant la musique classi-
que avec le hiphop, le jazz, et le
folkpop au Festival International des
Arts de Philadelphie.
Elle a collaboré avec l'ensemble
multi-Grammy Award-winning,
"Eighth Blackbird", pour des
concerts en Double Sextet de Steve
Reich. En Novembre 2008, elle a
donné à plusieurs reprises les Oi-
seaux Exotiques de Messiaen avec
le Curtis 20/21 Contemporary En-
semble.
En 2004, elle crée une œuvre pour
piano composée par l’un des
plus grands compositeurs de musi-
que de film indien, Vanraj Bha-
tia. Ce travail, intitulé « Fantasia and
Fugue in C », est basé sur l'épopée
indienne, le Mahabharata.
Extrêmement fière de son héritage
indien, Palavi MAHIDHARA œuvre
pour combler le fossé entre les musi-
ques classiques occidentales et
orientales.
Pour son concert lyonnais, si Pallavi

5
qui reprend le thème initial. A partir
de la seizième variation Bach com-
pose toute la section centrale en
mode majeur (il ne reviendra au
mode mineur qu’à partir de la vingt-
sixième variation). Par son enver-
gure et sa fantaisie, la Chaconne de-
meure un des sommets absolus de la
musique.
La Chaconne de Bach a été immé-
diatement admirée et adoptée par ses
contemporains mais aussi par tous
les mélomanes et musiciens des
XIX
ème
et XX
ème
siècles. JS Bach
avait lui-même ouvert la voie de la
transcription de son œuvre en l’a-
daptant au luth. A cette époque, la
propriété intellectuelle sur une œu-
vre n’était que pure chimère et il
était fréquent que les musiciens
s’approprient des thèmes (voire des
pièces entières) écrites par d’autres.
Bach lui-même a utilisé des thèmes
composés par d’autres musiciens
comme Buxtehude, Marcello ou Vi-
valdi. Il fut suivi en, cela, par de
nombreux compositeurs célèbres
comme par exemple Mozart qui uti-
lisa dans sa prime jeunesse des com-
positions de Schrötter ou de CPE
Bach pour composer ses premiers
concertos pour piano. En ce qui
concerne la Chaconne, trois musi-
ciens majeurs en ont effectué des ar-
rangements ou des transcriptions :
Robert Schumann qui se contenta
d’ajouter une partie de piano à la
partie originale pour violon. Sa dé-
marche peut s’expliquer par les ha-
MAHIDHARA interprète des com-
positeurs très connus, son pro-
gramme n’en demeure pas moins ex-
trêmement original compte tenu des
œuvres choisies, réservant une place
de choix aux transcriptions.
P
allavi MAHIDHARA débutera
son récital par la transcription trop
rarement jouée de la Chaconne de la
deuxième Partita pour violon seul de
JS Bach qui présente la particularité
d’être écrite pour la seule main gau-
che.
Dans sa Partita Bach reprend la
trame traditionnelle constituée par
quatre mouvements de danses tradi-
tionnelles (Allemande – Courante –
Sarabande – Gigue) avant d’en ad-
joindre une cinquième : Une Cha-
conne aux dimensions monumenta-
les, dont la durée égale à elle seule
les quatre autres mouvements réunis.
Bach rend hommage aux danses
alors populaires en Europe, avec
l’Allemagne (allemande), la France
(courante), l’Espagne (sarabande),
l’Ecosse (gigue) et l’Italie
(chaconne).
La Chaconne allie de façon idéale
une richesse polyphonique à une
technique absolument transcendante
qui utilise toutes les difficultés vio-
lonistiques connues à l’époque.
Composée en trois parties, elle cons-
titue un cycle de trente courtes varia-
tions basées sur une figure harmoni-
que de huit mesures revenant de fa-
çon obsessionnelle, et d’une coda
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%