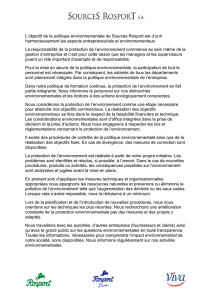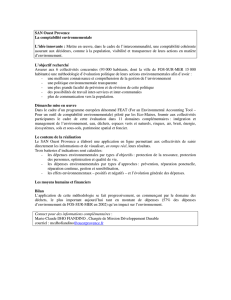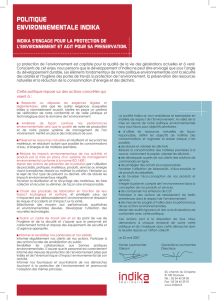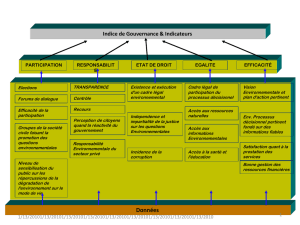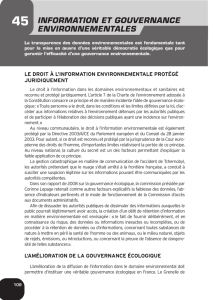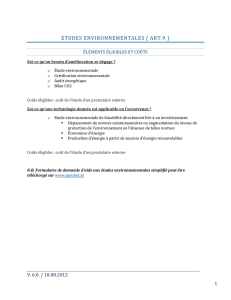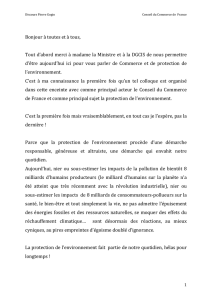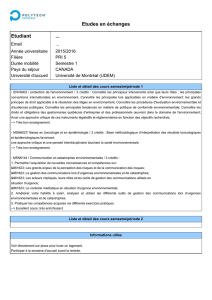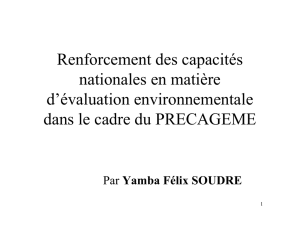COMPTABILITÉ ENVIRONNEMENTALE

Comptabilités
environnementales
par J. RICHARD
1

C’est au début des années 1970 que les tous premiers travaux de comptabilité
environnementale apparaissent ; en comptabilité nationale, les Américains Nordhaus et
Tobin avec leur ouvrage « Is growth obsolete ? ( la croissance est-elle obsolete ? » (1971)
marquent le point de départ d’une série de tentatives de réforme des indicateurs du PIB
(Produit intérieur Brut) ; en comptabilité d’entreprise, le Suisse Müller-Wenk avec son
essai « Ökologische Buchhaltung, eine Einführung » (Comptabilité écologique, une
introduction), publié à St Gallen en 1972, peut être considéré comme le pionnier de la
littérature mondiale en ce domaine. Cette période des années 1970 est, on le sait, (déjà)
marquée par une réflexion sur les limites de la croissance (c’est le titre du rapport « dit
Meadows » de 1972 du Club de Rome) et la nécessité d’une meilleure prise en compte du
capital humain dans l’entreprise.
Par la suite, la littérature en comptabilité nationale environnementale restera dominée par
les publications de l’école américaine (voir notamment celles de Cobb and Cobb sur « The
Green National Product (le produit national vert)» et de Cobb, Halstead and Rowe sur le
GPI (Guenuine progress Indicator), malgré certaines percées européennes méconnues
(voir infra). Par contre, la littérature en comptabilité d’entreprise environnementale se
développera plutôt en Europe (et tout particulièrement en Europe continentale) avec,
notamment, les publications des Français Labouze, Christophe, Antheaume, du Suisse
Schaltegger et des Anglais Gray et Bebbington .Il faut toutefois souligner qu’une littérature
très importante a également émergé au Japon et aux Indes mais la barrière de la langue
joue un rôle dissuasif.
En dépit de ces publications, la littérature en ce domaine reste pauvre. Pauvre
quantitativement, mais riche intellectuellement : les rares ouvrages qui traitent de la
question témoignent d’un foisonnement d’idées révélateur d’une matière en pleine
gestation. Il est d’ailleurs parfois difficile de s’y retrouver dans la « jungle » des
comptabilités environnementales ne serait-ce sans doute que parce que le concept
d’environnement n’est pas immédiat ( Prieur , 2004, p. 6) et que le traitement de ce
nouveau champ comptable pose de redoutables problèmes. Pour essayer d’y voir un peu
plus clair, nous proposons une classification- type des comptabilités environnementales
(figure 1-ci après), qui nous servira de trame pour exposer la diversité des solutions
proposées. Elle est basée sur l’utilisation de 7 critères principaux permettant de juger la
nature d’un système d’information environnementale. La présentation de ces critères
constituera la première partie de cet article ; la seconde sera dévolue à l’examen de
quelques comptabilités environnementales particulièrement intéressantes.
I – Critères de classification et typologie des comptabilités environnementales
Les sept critères proposés sont le sens de la relation avec l’environnement (1), la
dimension de l’environnement (2), le mode de conservation du capital (3), la dimension
spatiale de l’information (4), le degré de détail des informations (5), le type de valorisation
des données (6) et le concept de résultat (7).
1.1. Le sens de la relation avec l’environnement
Toute comptabilité est liée à un point de vue d’un acteur dominant qui impose sa vision
propre. On peut, avec Schaltegger (et alii) distinguer deux visions fondamentalement
différentes de cette comptabilité : une vision « Extérieur–Intérieur » et une vision
2

« Intérieur– Extérieur ».
* La vision Extérieur-Intérieur (EI) cherche à savoir quels sont les impacts de
l’environnement (extérieur) sur l’organisation (intérieur)
Selon cette vision, l’organisation n’est « concernée » par l’environnement que dans la
mesure où des règles s’imposent à elle (règles définies par une institution externe ou que
l’entreprise s’impose) quant à la préservation de l’environnement et qui débouchent sur
une sanction pécunière. Cette vision est celle de la comptabilité financière (ou
manageriale) traditionnelle : l’environnement n’existe que si son impact sur l’entreprise
change le résultat des capitalistes. On peut dès lors se demander en quoi ce type de
vision peut-il déboucher sur une quelconque comptabilité environnementale ! La réponse
est qu’il y aura bien une (certaine) comptabilité environnementale si l’entreprise isole au
sein de la comptabilité traditionnelle les impacts qu’elle « reçoit » de l’environnement.
Supposons par exemple qu’une entreprise doit payer une amende pour pollution ; si cette
amende est noyée dans les frais généraux, il n’y aura pas de comptabilité
environnementale ; si, par contre, elle est enregistrée dans une rubrique spécifique
« charges environnementales », on pourra parler de comptabilité environnementale
traditionnelle ou de comptabilité environnementalement différenciée (comme le propose
Schaltegger). Selon cette vision, le seul capital à conserver reste le capital privé (ou
financier) des capitalistes1. Nous parlerons donc pour notre part, d’une « comptabilité
privée environnementalement différenciée ou de comptabilité environnementale
chrématistique, pour reprendre la terminologie qu’Aristote uitilise pour qualifier la gestion
de la richesse privée (Richard 2008)»
* La vision Intérieur-Extérieur (IE) cherche à connaître tous les impacts de l’organisation
sur l’environnement. Pour prendre un langage emprunté aux économistes le but n’est
plus seulement de chiffrer les « internalités », c’est-à-dire les dommages à
l’environnement mis à la charge du capital privé, mais aussi de tenir compte des
externalités (dommages non remboursés) de façon à connaître le dommage total fait à
l’environnement. Normalement, selon cette vision, il n’est plus possible de s’en tenir à la
conception traditionnelle de la conservation du capital privé : un capital
« environnemental » (voir infra) doit également faire valoir ses droits à conservation, ce qui
correspond à une extension considérable de la conception classique de la conservation du
capital (financier) telle qu’elle a été proposée par Hicks (1948). Cette comptabilité
environnementale est donc a priori très différente de la précédente ; nous lui donnerons le
nom de « comptabilité environnementale écologique et humaine ». Le choix de ces deux
derniers attributs va être justifié ci-après.
1.2. La dimension de l’environnement
Il est traditionnel d’opposer deux conceptions de la dimension environnementale
•selon une conception restrictive, l’environnement se limite au milieu naturel dans
lequel évolue l’organisation ; dans ce cas la comptabilité environnementale non
privée (vision intérieur-extérieur) devient une comptabilité essentiellement
écologique avec pour seul objectif nouveau le maintien du capital fourni par la
nature (capital naturel). Cette conception est généralement celle des ouvrages
1 Historiquement il n’y a pas eu pratiquement d’exception à cette règle : les comptabilités
soviétique et chinoise, par exemple, retiennent comme base de calcul le capital de la bureaucratie
d’État même si celle-ci affirme gérer un capital « public ».
3

intitulés « comptabilité verte ».
•Cependant, dans une conception extensive, l’environnement de l’organisation peut
non seulement comprendre la nature mais aussi les hommes qui contribuent à son
fonctionnement ; dans ce cas, la comptabilité environnementale non privée se voit
pour mission de conserver à la fois un capital naturel et un capital humain. On
pourra alors parler de comptabilité environnementale écologique et humaine. On
notera que la philosophie de cette forme de comptabilité sociale n’a rien à voir avec
la problématique qui animait (dans les années 60-70) le courant dit de la
comptabilité des « ressources humaines ». A l’époque, il s’agissait essentiellement
d’adapter la comptabilité privée financière pour permettre de mieux mettre en
évidence les coûts liés à la fonction du personnel, notamment par une activation
des investissements sociaux effectués par l’organisation. Dans le cas de la
comptabilité environnementale-humaine il ne s’agit pas seulement de mesurer les
dépenses sociales effectuées par l’organisation mais surtout d’apprécier les coûts
du capital humain fourni à l’entrée dans l’organisation (masse des coûts antérieurs
d’éducation primaire, secondaire et supérieure notamment) et d’évaluer la capacité
de l’organisation à maintenir ce capital en état de bon fonctionnement (Richard
2008).
• Si l’on veut se référer aux deux piliers traditionnels du développement durable, le
pilier écologique et le pilier social, seule une conception englobante paraît de mise.
C’est ce que nous supposerons dans les développements suivants.
1.3. Le mode de conservation du capital
Dans le contexte de la comptabilité privée « environnementalement » différenciée, la
conservation du capital se réduit à la conservation du capital privé.
Dans le contexte de la comptabilité environnementale écologique et humaine, la
situation devient beaucoup plus complexe car il faut en principe maintenir trois types
de capitaux : non seulement le capital privé mais également le capital naturel et le
capital humain.
Les écrits des économistes (Daly, 1973, 1921) montrent qu’il existe deux modèles de
conservation du capital naturel (que nous étendrons ici au capital humain) :
-selon le modèle « faible » on admet qu’il peut y avoir une substitution du capital
financier au capital naturel : autrement dit la conservation du capital est globale ;
-selon le modèle « fort » on refuse au contraire en principe l’idée d’une
substituabilité du capital financier au capital naturel ; dans ce cas il faut
impérativement et séparément conserver le capital financier, le capital naturel et le
capital humain ).
Daly a démontré que la substituabilité du capital financier au capital naturel conduit à
des aberrations et a souligné la priorité absolue du maintien du capital naturel comme
base du développement humain. Daly a également montré que l’obtention d’une
soutenabilité forte passe par la détermination de standards physiques (limites) de
consommations de matières ou de pollution (émissions), à ne pas dépasser sous peine
de porter atteinte à la soutenabilité (forte) du capital. L’existence ou non de ces
standards constitue un élément-clef de l’identification des comptabilités
environnementales écologiques « fortes ». On peut à cet égard distinguer deux types
de comptabilités environnementales fortes plus ou moins évoluées :
-les comptabilités qui déterminent des stocks de capital naturel minimaux et qui
4

s’orientent donc vers l’élaboration de bilans normés,
-les comptabilités environnementales qui se limitent à la détermination de
consommations (émissions) limites et qui ne visent qu’à l’obtention de comptes de
flux ou comptes de résultats environnementaux.
1.4. La dimension spatiale de l’information (micro-macro)
La subdivision de la comptabilité en comptabilité micro-économique (ou comptabilité
d’organisations) et comptabilité macro-économique2 (ou comptabilité nationale) est ancrée
dans la pratique, la théorie et l’enseignement : il est assez rare que des liens soient établis
entre ces comptabilités.
On retrouve cette séparation en comptabilité environnementale ; il existe, on l’a dit, un
riche courant de comptabilité nationale environnementale ; en général ce courant est
largement ignoré des auteurs spécialisés en comptabilité environnementale d’entreprise
(et vice versa) ; ainsi Schaltegger et Müller(1996),qui citent pourtant une abondante
littérature d’économistes, ne traitent pratiquement pas du cas des comptabilité nationales
Cette césure ne se justifie pas en comptabilité environnementale, pour trois raisons
principales :
-premièrement, l’environnement est un problème global où les problèmes micro et
macro-économiques sont inextricablement liés ;
-deuxièmement, au fur et à mesure où la responsabilité environnementale des
entreprises s’accroît, la dimension macro-économique de leur comptabilité s’étend :
ainsi les organisations tendent de plus en plus à développer la technique des
analyses de cycle de vie qui ont une vocation macro-économique (voir infra) ;
-troisièmement, de nombreuses idées développées par des macro-économistes
environnementaux, sont applicables à l’échelle micro-économique (voir le cas de
BSO ci-après).
Ces raisons nous conduisent à mener de front l’étude des comptabilités
environnementales macro et micro-économiques.
1.5. Le degré de détail des informations
Il est traditionnel, en comptabilité d’entreprise, de distinguer une comptabilité analytique
(ou de gestion) et une comptabilité générale. La comptabilité environnementale n’échappe
pas à cette partition : on pourra donc parler de comptabilités environnementales générales
et de comptabilités environnementales analytiques et ceci aussi bien au niveau faible ou
fort qu’au niveau micro ou macro-économique.
Schaltegger et Müller ajoutent une troisième comptabilité, la comptabilité fiscale, mais il
nous semble préférable de traiter de ce type de comptabilité à l’occasion de l’examen des
types d’évaluation. Il faut cependant souligner dès maintenant qu’un même « phénomène
environnemental » pourra être traité de façon très différente selon les deux (ou trois)
comptabilités.
1.6. Le type de valorisation des données
2 On peut aussi faire ressortir un troisième terme qui serait une comptabilité méso-économique
dont la comptabilité des groupes (ou consolidation) constituerait l’un des éléments
fondamentaux ; nous utiliserons ici, pour simplifier, une partition duale.
5
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
1
/
14
100%