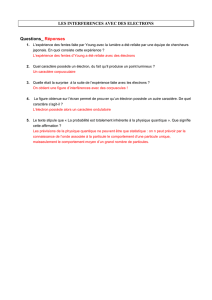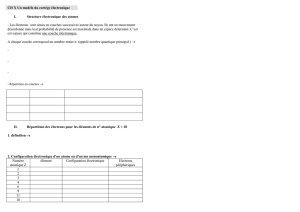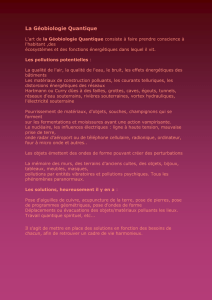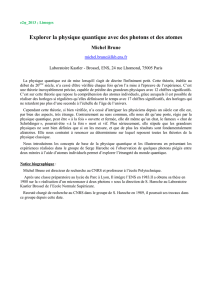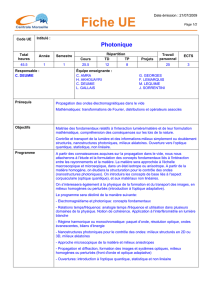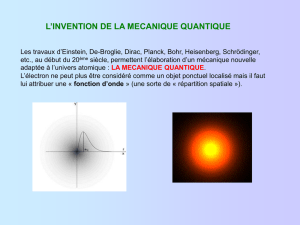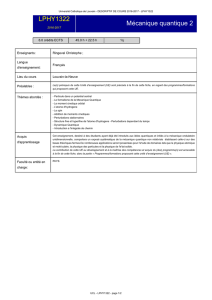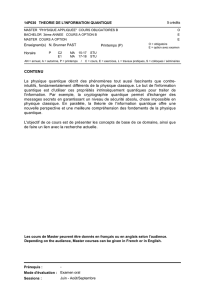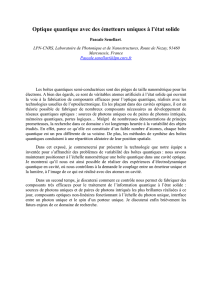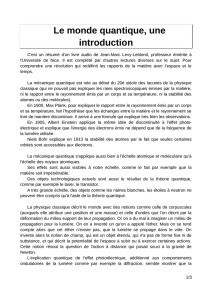Mémoires de sciences - Espace Culture - Lille 1

L’enseignement de la physique ne fait nulle référence
à l’histoire
L’enseignement de la physique présente cette discipline
comme étant achevée et dogmatisée. Il affirme comme vérités
les pertinences constatées, apprend à appliquer les lois aux-
quelles la nature est censée obéir, forme à l’utilisation d’outils
– qu’ils soient mathématiques ou appareils de mesures. Nulle
place, en général, à l’éducation à la pensée scientifique. Nulle
trace de l’histoire des voies que celle-ci a empruntées pour
parvenir aux savoirs actuels. Cette manière d’enseigner pos-
sède la qualité de former à l’utilisation de savoirs concrets,
mais la faiblesse de se limiter aux conclusions actuelles, placées
au sein de disciplines étroites et étanches, sans vision générale.
Ces caractéristiques de l’enseignement ne concernent que
les sciences. L’enseignement de la philosophie se réduit à
peu près à son histoire ; celui de la littérature convoque les
grands auteurs. L’éducation musicale s’appuie sur l’écoute
des œuvres majeures des grands compositeurs... Mais qui,
parmi les scientifiques, a lu un paragraphe, un seul, des
œuvres des pères fondateurs de la physique ? Certes, un
effort considérable peut être nécessaire pour pénétrer les
formalisations mathématiques, les logiques internes utilisées
à diverses époques. Mais, surtout, la science fait des décou-
vertes, se rature, se corrige, se précise, alors que l’art et la litté-
rature créent des œuvres et atteignent « d’emblée les sommets,
d’un coup d’aile » 1…
Copernic est dépassé : pourquoi lirait-on son monde fermé
et ses épicycles. Galilée est dépassé : une bille sans frottement
ne parcourt pas une trajectoire circulaire. Newton est
dépassé : la gravité n’est pas l’action constante de Dieu sur le
monde. Laplace est dépassé : le temps et l’espace de la phy-
sique ne sont plus absolus. Maxwell est dépassé : le champ
ne se mathématise pas comme des roues et des pignons,
l’éther a été chassé de l’explication. Pourquoi les lirait-on ?
L’oubli est constitutif de la science. Il est impossible de
garder la mémoire de toutes les errances. La positivité de la
science l’oblige à nier son passé. Rien de tel en art, un chef
d’œuvre existe une fois pour toutes. Dante ne dépasse pas
1 Victor Hugo, L’art et la science, Paris, éd. Actes Sud, 1985.
Homère. Manet n’efface pas Michel-Ange. Ils sont ailleurs. La
nouveauté radicale marquerait donc la différence entre les
connaissances scientifiques et les autres formes de connais-
sances humaines.
L’enseignement de la quantique porte la trace de son
histoire
Pourtant, par exception, l’enseignement de la quantique et
sa vulgarisation portent la trace du passé, de toutes ces
ratures faites par ses Pères fondateurs, alors qu’elles sont effa-
cées des travaux scientifiques contemporains. Cent dix ans
après sa naissance, cette discipline n’a pas trouvé son mode
d’enseignement et de diffusion, ce qui lui confère son
étrangeté et explique l’incompréhension dont elle souffre.
Que trouve-t-on dans les manuels ? Que les atomes sont formés
par des électrons, des protons, des neutrons ; la lumière par
des photons. Que ces électrons, protons, neutrons, photons
sont des « particules quantiques », qui sont « à la fois des
ondes et des corpuscules ». On lit aussi : « toute particule
quantique de matière possède son antiparticule » ; « on ne
peut connaître à la fois la position et la quantité de mouve-
ment d’un électron : l’observation perturbe le système » ;
« notre connaissance est limitée par le principe d’incertitude
d’Heisenberg »…
Toutes ces affirmations, et bien d’autres, sont inexactes. Ce
sont les ratures contenues dans les œuvres des fondateurs,
Einstein, Bohr, De Broglie, Heisenberg, Pauli, Schrödinger,
Dirac. Ces hommes ont une formation en mécanique, que
l’on appelle aujourd’hui « classique ». Cette mécanique ne
distingue que deux objets, les ondes, continues en extension,
continues en nombre, et les particules, discrètes en nombre,
discrètes en extension. Ces Pères fondateurs ont aussi à leur
disposition l’optique dans ses formalisations indépendantes
de la théorie de Maxwell, la thermodynamique, l’électroma-
gnétisme, qui usent de statistiques. Ils découvrent des effets
nouveaux qui les surprennent, n’entrent pas dans les cadres
de leur éducation et qu’ils tentent d’expliquer peu à peu en
faisant appel à des notions qui ne remettent pas fondamen-
talement en cause leurs certitudes.
En 1900, sans s’en rendre compte, Planck introduit la quanti-
Histoire des sciences et formation scientique :
à propos de la quantique
Professeur émérite, Laboratoire SCité, Université Lille 1
Par Bernard MAITTE
Le 12 décembre 2012, Raffaele Pisano et Aleandro Nisati ont organisé un workshop par téléconférence entre le CERN et
le laboratoire SCité de Lille 1 au sujet de l’événement détecté par le CERN, compatible avec l’existence du boson de Higgs.
À cette occasion, je suis intervenu pour évoquer l’enseignement de la physique et notamment celui de la Quantique.
10
mémoires de sciences : rubrique dirigée par Rémi Franckowiak et Bernard Maitte / LNA#63 LNA#63 / mémoires de sciences : rubrique dirigée par Rémi Franckowiak et Bernard Maitte

fication de l’énergie lumineuse émise par un « corps noir ».
En 1905, Einstein est amené à introduire des « grains de
lumière » pour expliquer cette émission. Cette audace au
sein d’un électro-magnétisme uniquement décrit alors
en termes d’ondes lui permet de rendre compte du seul
effet photo-électrique. En 1913, Bohr donne un schéma de
l’atome qui parle de résonateurs, d’orbites, d’états station-
naires… En 1924, après la caractérisation du « photon »,
Louis de Broglie remarque que la lumière est décrite comme
étant à la fois ondes et corpuscules, alors que la matière est
uniquement corpuscules. Pour rétablir la beauté dans la
physique, il associe à toute particule une onde. Matière et
lumière deviennent à la fois ondes et corpuscules, « tigre et
requin » dira omson. En 1931, Dirac établit une équation
relativiste décrivant l’électron et introduit la notion d’anti-
particule.
En énonçant toutes ces conjectures, les Pères fondateurs
établissent des passerelles entre la mécanique « classique » et
ce qu’ils découvrent. Leurs travaux marquent l’étape indis-
pensable de la continuité entre ce qui est devenu la physique
nouvelle et celle qui la précédait. Pour cela, ils n’ont pas
introduit de noms nouveaux – ou peu –, pas d’objet physique
différent. Les électrons et les photons sont « à la fois » ondes
et corpuscules.
Des notions dont l’enseignement doit être revisité
Ces ratures continuent à être enseignées comme des concepts
alors que toutes ces notions ont été revisitées et réinterprétées
depuis. Par exemple, les « particules quantiques » sont discrètes
en nombre, continues en extension, non localisées : elles ne
sont ni ondes, ni corpuscules : pour éviter toute confusion,
il serait pertinent de les désigner par un nom nouveau : les
quantons. Au dualisme de la physique classique succède
le monisme quantique 2. Le positron est dit antiparticule
de l’électron : même masse, charge opposée ; de fait, il est
le symétrique de l’électron, comme ma main droite l’est
de ma main gauche. Appelle-t-on celle-ci une « anti-main
droite » ? Un changement de terminologie éviterait de nom-
breuses confusions. Les atomes ne répondent pas à la
description enseignée : ils sont formés d’un noyau, d’électrons
et de ce qui le fait tenir ensemble, le champ électromagné-
tique, c’est-à-dire les quantons de ce champ, qui s’appellent
justement des photons. Les échanges de photons entre le
noyau chargé et les électrons chargés assurent la cohésion
de l’atome. Les photons, de masses nulles, sont donc aussi
substantiels que les électrons et les protons qui en ont une.
La notion de substance s’élargit.
2 Jean-Marc Lévy-Leblond, De la matière, relativiste, quantique, interactive,
Paris, éd. du Seuil, Traces écrites, 2006.
Les traces de l’histoire dont témoignent les appellations et
les notions qui sont utilisées dans l’enseignement et dans la
vulgarisation brouillent, on le voit, la compréhension des
conceptions modernes. Affirmant ceci, j’ai l’air de justifier
que l’enseignement des sciences se réduise à la transmission
des normes actuelles. Et pourtant, je soutiens que l’histoire
des sciences doit faire partie intégrante de l’enseignement
des sciences. Contradiction ? Non, si l’on veut bien admettre
que cet enseignement ne peut se réduire à un dressage et à
la disciplinarisation des savoirs actuels.
Former à l’exercice de la pensée scientique
Je conçois l’enseignement des sciences comme devant être
une éducation à la pensée scientifique, une pensée vivante
qui porte en elle sa propre capacité de contestation : le recours
à l’expérience. Une pensée qui apprend à poser des pertinences
comprises entre des limites de validité. Une pensée qui est
une œuvre collective, s’enrichit de « l’autre », ne saurait
donc être ni universelle, ni hégémonique. Comment initier
à cette pensée féconde ? En étudiant comment les hommes
qui nous ont précédé ont pensé, hésité, échangé, reculé…
sans souvent formuler ces « lois » qui leur sont aujourd’hui
attribuées, maintenant que la décantation s’est effectuée.
Les travaux du passé ne sont pas périmés : les approches
modernes permettent de les re-visiter, d’en établir les limites
de validité. La mécanique newtonienne est totalement
incluse dans la Relativité, la Quantique ne l’est pas. Les
théories successives ne sont pas des poupées russes qui
s’empilent les unes dans les autres et, même lorsqu’elles le
sont, leurs domaines de validité sont exploitables : il est plus
qu’inutile de décrire la trajectoire d’une fusée au moyen de
la Relativité ! Apprenons à penser... et aussi à analyser com-
ment une logique, comment les réductions que nous opérons,
comment les questions que nous posons dépendent de la
culture, de la société, d’une époque.
La science réussit parce qu’elle est réductionniste. Comme
elle est réductionniste, elle n’a pas réponse à tout. Mieux
vaut essayer de poser de nouvelles questions que d’apporter
des réponses à des questions qui se révéleront mal posées.
Voici le sens que renferme l’étude de l’histoire de la pensée
scientifique.
mémoires de sciences : rubrique dirigée par Rémi Franckowiak et Bernard Maitte / LNA#63
11
1
/
2
100%