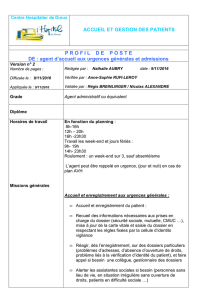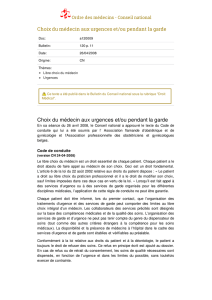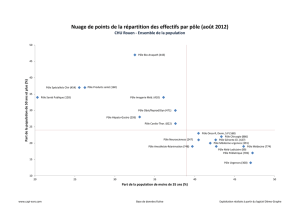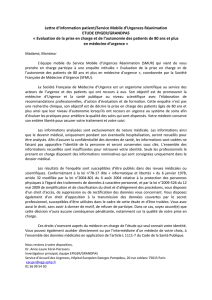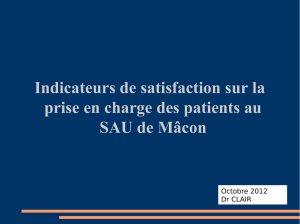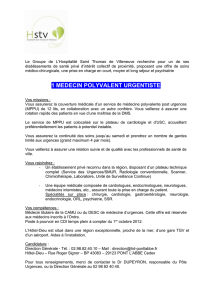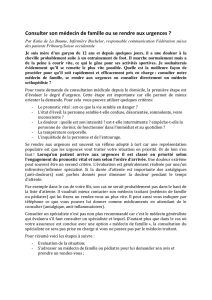la prise en charge medicale dans les services d`urgence - I

1
B
Bo
on
n
d
de
e
c
co
om
mm
ma
an
nd
de
e
n
n°
°
L
LM
M
I
I9
94
4.
.0
01
1
S
SO
OC
CI
IO
OL
LO
OG
GI
IE
E
D
DE
E
L
LA
A
S
SA
AN
NT
TE
E
L
LA
A
P
PR
RI
IS
SE
E
E
EN
N
C
CH
HA
AR
RG
GE
E
M
ME
ED
DI
IC
CA
AL
LE
E
D
DA
AN
NS
S
L
LE
ES
S
S
SE
ER
RV
VI
IC
CE
ES
S
D
D’
’U
UR
RG
GE
EN
NC
CE
E
P
PE
ED
DI
IA
AT
TR
RI
IQ
QU
UE
E.
.
R
RA
AP
PP
PO
OR
RT
T
D
D’
’E
EN
NQ
QU
UE
ET
TE
E
p
pa
ar
r
F
Fr
ré
éd
dé
ér
ri
iq
qu
ue
e
C
CH
HA
AV
VE
E
M
Mo
ot
ts
s
c
cl
lé
és
s
:
: Urgences, santé, interactions, territoire, patients, accès aux soins, prise
en charge médicale.
T
Th
hè
èm
me
e
:
: les facteurs locaux, individuels et organisationnels influant sur le
déroulement de la rencontre entre patients et service d’urgence.
Université Paris X-Nanterre, Ecole d’Architecture de Paris-Belleville
Laboratoire IPRAUS
78, rue Rébeval, 75019 Paris
D
DE
EC
CE
EM
MB
BR
RE
E
2
20
00
02
2

2
T
TA
AB
BL
LE
E
D
DE
ES
S
M
MA
AT
TI
IE
ER
RE
ES
S
TABLE DES MATIERES ....................................................................................................................................................2
INTRODUCTION..................................................................................................................................................................4
L’ACCES AUX SOINS, EGALITE ET VARIATIONS.................................................................................................................4
CADRE DE L’ETUDE...............................................................................................................................................................5
LES CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE...............................................................................................................................6
I. ARRIVER AUX URGENCES ..................................................................................................................................9
ORGANISATION DU SERVICE ................................................................................................................................................9
LE PUBLIC DES URGENCES..................................................................................................................................................10
II. MOTIFS ET STRATEGIES DES FAMILLES .................................................................................................16
LES ADMISSIONS : UN SAS..................................................................................................................................................16
STRATEGIES ET PROCESSUS DE PRESENTATION DES ENFANTS AUX URGENCES..........................................................22
III. LA PERSPECTIVE DU SERVICE......................................................................................................................29
LA DOUBLE CONTRAINTE...................................................................................................................................................29
INTER-PERCEPTIONS DES ACTEURS...................................................................................................................................31
VOCATION ET SATISFACT ION PROFESSIONNELLE............................................................................................................38
IV. L’ESPACE-TEMPS DES URGENCES ...............................................................................................................41
L’ESPACE..............................................................................................................................................................................41
LE TEMPS DE L’URGENCE...................................................................................................................................................43
DECOUPAGE DE LA PRISE EN CHARGE EN SEQUENCES...................................................................................................46
FACTEURS DE REGULATION DES SEQUENCES..................................................................................................................48
VARIABILITE DE LA PRESENCE MEDICALE AUTOUR DU PATIENT..................................................................................49
V. LA PRISE EN CHARGE, DE L’ALERTE AU SOIN .....................................................................................51
LE TIERS INCONTOURNABLE..............................................................................................................................................51
SORTIR DE LA CRISE OU Y ENTRER....................................................................................................................................53
COMMUNICATION ET PRISE EN CHARGE...........................................................................................................................54
PRATIQUER...........................................................................................................................................................................56
INTERROGER, REPONDRE, COMMUNIQUER......................................................................................................................58
VI. ARTICULATION AUX AUTRES ACTEURS EN SANTE...........................................................................61
ORIENTATION ET ARTICULATION A D’AUTRES SERVICES..............................................................................................61
LA CRISE DU LOGEMENT.....................................................................................................................................................62
CONCLUSION......................................................................................................................................................................64

3
ANNEXE 0 ..............................................................................................................................................................................66
BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE DES OUVRAGES CITES........................................................................................................66
ANNEXE1 ...............................................................................................................................................................................68
AVERTISSEMENT..................................................................................................................................................................68
PRESENTATION DE L’APPROCHE........................................................................................................................................68
TRAVAUX DE REFERENCE...................................................................................................................................................69
ANNEXE 2 ..............................................................................................................................................................................70
QUELQUES DESCRIPTIONS ET ETUDES DE CAS.................................................................................................................70

4
I
IN
NT
TR
RO
OD
DU
UC
CT
TI
IO
ON
N
L’accès aux soins, égalité et variations
L’organisation des soins relève en France essentiellement du service public, ce qui la
rend particulière et la situe dans un cadre contrôlé par des institutions.
Droits à la Sécurité Sociale, pluralité d’une offre d’assurance maladie
complémentaire, Carte Maladie Universelle, Aide Médicale, libre accès de tous aux
services d’urgences et droit universel à requérir l’intervention des sapeurs-pompiers
et du SAMU forment un filet social devant garantir l’accès le plus large au système
de santé, en particulier en situation d’urgence.
La possibilité de ne pas avancer les frais consécutifs à la fréquentation de ces
services et de s’y présenter sans avoir à justifier ni de sa couverture maladie ni de
son identité facilite leur fréquentation par l’ensemble de la population, y compris la
plus démunie, la plus précaire, la plus vulnérable, non seulement sur un plan médical
mais aussi social, économique et légal.
Or, permanence, continuité des soins, universalité de la prise en charge, accessibilité
des services de soins et stratégies d’intervention varient selon différents facteurs
spatiaux, sociaux, conjoncturels et circonstanciels, d’une région, mais aussi d’un
quartier à un autre.
Même lorsque l’offre de soin est quantitativement suffisante et correctement répartie,
il n’en découle pas mécaniquement que les personnes se présentent spontanément
aux services prévus par l’institution, s’adaptent aux normes édictées par les
systèmes de soins et les professionnels, y obtiennent la prise en charge ou le
secours qu’ils étaient venus chercher.
Ainsi, face à un système de santé organisé et en partie standardisé, le déroulement
de la relation de soin varie néanmoins, d’un patient et d’un établissement de soin à
un autre.
La variation interindividuelle et inter-hospitalière des conditions de prise en charge
remet-elle en question la problématique de l’égal accès au soin ou exprime-t-elle le
cadre empirique où cette égalité s’exerce, collectivement construit et redéfini par le
jeu permanent des rencontres qui s’y déroulent ? Qu’est-ce qui fait varier les
conditions d’expérimentation et d’exercice de la prise en charge, dans un service
ouvert à tous par principe et fonction, dont les urgences sont l’expression même ?
Le cas des urgences se distingue d’une réflexion sur la prise en charge hospitalière
dans la mesure où s’y ajoutent des contraintes spécifiques.
L’engorgement des services d’urgences, c’est-à-dire l’admission d’un nombre de
patients plus grand à l’instant T que le service ne peut en absorber, la coexistence
du grave et du bénin, de l’urgent et du stable, mais également les difficultés de
communication entre l’usager et le praticien, le désengagement professionnel de
certaines spécialités et le manque d’effectif, soignant en particulier, signalent une
imparfaite adéquation entre besoins et offre de soin.

5
Cadre de l’étude
Si le système de santé, en France, repose sur certains principes intangibles, en
particulier l’égalité des soins, l’accès aux soins pour tous et la continuité du service
public de santé, les conditions de la prise en charge ne sont pas linéaires, ni pour les
professionnels ni pour le public des services de santé. Dans le système hospitalier,
les caractéristiques structurelles entraînent des écarts importants, notamment en
effectifs et en moyens, d’un hôpital à l’autre. Pénurie de personnel soignant, de
chirurgien, fermeture de lits faute d’effectifs, augmentation des patients et gel des
recrutements marquent certains établissements et les amènent à devoir composer
avec des contraintes plus lourdes ici qu’ailleurs.
Le constat est posé de différences de conditions d’exercice, imputables à des
facteurs structurels.
Les aspects structurels, administratifs et économiques sont une réalité bien connue
des acteurs en santé. Ils forment à la fois leur cadre et leurs conditions d’exercice.
Mais les facteurs structurels ne sont pas les seuls qui suscitent des variations sur les
conditions de la prise en charge.
Une population plurielle
Fréquenter les urgences indique a priori une crise avec laquelle il faut composer.
Face à un événement morbide, au surgissement d’un problème de santé chez
l’enfant, les familles s’adaptent et consentent des efforts variables selon leurs
ressources. Le choix même des urgences, le moment et le motif de leur fréquentation
s’intègrent dans un contexte microsociologique (familial professionnel, économique,
culturel, résidentiel etc.) différent d’un patient à l’autre. En d’autres termes,
différentes situations se font jour, selon les circonstances d’irruption du problème
médical, les ressources et les stratégies du « groupe du patient ». Ce groupe
comprend l’ensemble des accompagnants c’est-à-dire ceux qui amènent le patient,
ceux qui lui rendent visite, ceux qui viennent le chercher, ceux qui entrent en contact
avec le service à son sujet. Il peut s’agir de la famille, mais aussi de tiers qui l’ont
accompagné (passants, responsables scolaires ou parascolaires, police, pompiers,
SAMU…).
La dimension familiale est particulièrement présente aux urgences pédiatriques et
influe sur le déroulement de la prise en charge et du suivi.
Un service à l’activité élastique
Du côté des urgences, le nombre de visites ne cesse d’augmenter, beaucoup plus
vite que n’augmentent les moyens et les effectifs des services. Au sein des services,
ce sont quelques professionnels, répartis en médecins, infirmiers et aides soignants
aux rôles peu échangeables, qui doivent s’arranger d’un public très divers auquel il
faut s’adapter et d’un volume de patients ponctuellement problématique.
La rencontre de deux contextes variables
La rencontre entre les professionnels et le public met en présence deux contextes
qui se redéfinissent l’un l’autre. Ainsi, lorsqu’un patient arrive aux urgences, le
télescopage de ces deux contextes forme un cadre à géométrie variable qui entoure
la relation de soin et la prise en charge.
Une prise en charge dynamique
Les urgences attirent des populations extrêmement variées, pour des motifs et des
niveaux de gravité très divers. La relation de soin y est soumise à une double
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
1
/
74
100%