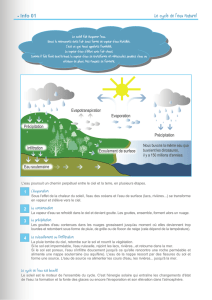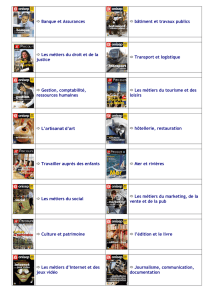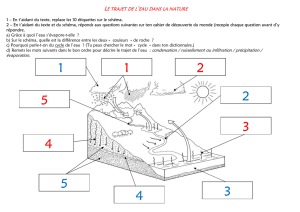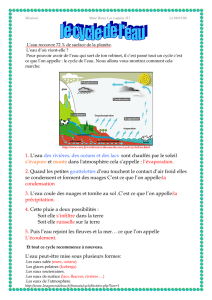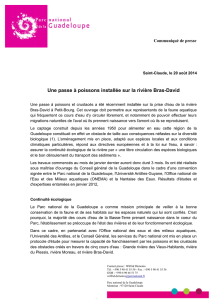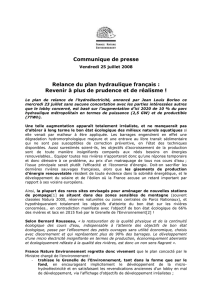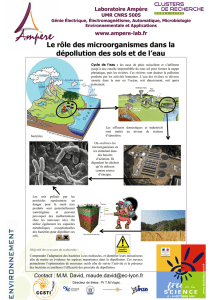Les rivières de Seine-Aval - Agence de l`Eau Seine Normandie

17
CHAPITRE 2
Les rivières
de Seine-Aval
I Contexte physique
Le secteur Seine-Aval s’étend pour sa plus grande partie sur
les formations crayeuses perméables du Crétacé supérieur,
avec des recouvrements moins perméables sur ses marges :
boutonnière du Bray, sables du Perche et de Fontainebleau.
Le réseau hydrographique se différencie nettement selon les
terrains en place. Sur la craie, roche perméable et fissurée qui
favorise l’infiltration par rapport au ruissellement, le réseau
hydrographique est très lâche. Il structure un paysage carac-
téristique composé de plateaux (Caux, Lieuvin, Pays d’Ouche,
Roumois, plateaux du Neubourg et de Saint-André, Thymerais,
Vexin), entrecoupés de vallées bien marquées, drainées par les
rares cours d’eau, largement creusées aux temps géologiques
par des fleuves beaucoup plus puissants. Le réseau secondaire
pérenne est inexistant mais les vallons secs, car trop peu pro-
fonds pour drainer la nappe de la craie, sont nombreux.
Le linéaire de cours d’eau pérennes est d’environ 3 000 km pour
17 000 km2, soit une densité très faible, inférieure à 0.2 km/km2
(elle est proche de 1 en Basse-Normandie).
Les plateaux crayeux sont recouverts d’une couche plus ou
moins discontinue d’argile à silex provenant de la décalcification
du substrat par les eaux acides, et de limons éoliens (lœss) très
fertiles et relativement perméables, déposés au quaternaire. Ces
formations superficielles modulent localement la perméabilité.
Elles sont ponctuées de points d’infiltration rapide (bétoires)
témoignant d’une forte activité karstique. La craie n’affleure que
dans les deux principales vallées (Seine, Eure), où elle forme
de grandes corniches. Les flancs des vallées sont tapissés de
dépôts argilo-limoneux issus des plateaux, alors que les fonds
des vallées humides les plus larges sont comblés par des
alluvions plus grossières (sables, graviers et cailloux), parfois
organisées en terrasses successives.
La boutonnière du Pays de Bray est une structure anticlinale
originale. Dans cette dépression résultant de l’érosion,
affleurent les terrains marno-calcaires du Crétacé inférieur
et du Jurassique supérieur, moins perméables que la craie
érodée. Les cours d’eau qui y prennent leur source (Béthune,
Epte, Andelle) ont un cours amont caractérisé par un chevelu
hydrographique plus dense.
Dans le Perche, les craies glauconieuses peu perméables sont
recouvertes par les sables argileux du Cénomanien (sables du
Perche), qui renferment des petites nappes. Les cours d’eau
du sud de la Seine (la Risle, l’Eure et ses affluents l’Iton et
l’Avre) prennent naissance dans la forêt du Perche, véritable
château d’eau au chevelu assez dense et aux nombreux étangs.
Bon nombre de ces ruisseaux disparaissent quand ils abordent
les craies fissurées du pays d’Ouche. Les quelques rivières
pérennes présentent des pertes partielles (Risle) ou totales
(Guiel, Iton, Meuvette…) car elles sont alors en position
perchée par rapport à la nappe de la craie (cf p.19 échanges
nappe-rivière).
À l’est, les hauts bassins de la Drouette et de la Vesgre se situent
dans le massif forestier des Yvelines sur les sables argileux
de Fontainebleau, secteur également parsemé d’étangs et de
petits rus. La Voise draine la nappe des calcaires de Pithiviers,
de moindre puissance que la nappe de la craie.
1 - Géologie et réseau hydrographique
Ph
. 2 - La craie affleure dans la vallée de la Seine, formant de hautes corniches.

18
3 - Facteurs climatiques
2 - Les rivières de Seine-Aval
2 - Physico-chimie des eaux de rivière
Les rivières de la craie, alimentées essentiellement par la
nappe et peu soumises aux aléas du ruissellement, ont une
composition physico-chimique stable et sont naturellement
de bonne qualité. Leur température est peu élevée, avec une
faible amplitude entre l’hiver et l’été (entre 6 et 18 °C) du fait
des apports importants d’eau souterraine dont la température
est voisine de 10°C, de l’écoulement rapide (0.3 à 0.5 m/s) et
de la faible durée du transit entre la source et l’embouchure
(pour les petites rivières du moins). L’écoulement turbulent
en faciès lotique et la température basse favorisent une bonne
oxygénation.
Fraîches, bien oxygénées, bicarbonatées calciques, les rivières
de la craie ont, dans les conditions naturelles et en dehors des
pollutions, de fortes capacités biogéniques. Au voisinage des
émergences de la craie et pour autant que les eaux de nappe
soient exemptes de nitrates et d’orthophospates, les eaux
de rivière ont un niveau trophique faible. Dès qu’elles sont
enrichies en nutriments, leur productivité est forte.
La région doit à son climat océanique des précipitations assez
abondantes et bien réparties (150 à 220 jours par an), avec un
maximum en automne et hiver (60 % de la pluviométrie annuelle
moyenne). Les écarts thermiques sont modérés. La nébulosité
moyenne importante et la douceur des températures limitent
l’évapotranspiration.
La pluie efficace (différence entre les précipitations et
l’évapotranspiration) est donc relativement élevée, proche de
100 % de la pluie incidente en automne et en hiver quand les sols
sont nus, environ 50 % sur l’année. Cette situation moyenne doit
toutefois être modulée. La pointe du Caux, plus directement
exposée aux influences océaniques, est nettement plus arrosée
que le sud du secteur Seine-Aval, où la tendance continentale
s’accuse (plus de 1000 mm de précipitations annuelles à Bolbec
contre 500 mm dans le Drouais). La température jouant dans
le même sens, le bilan en termes de pluie efficace s’étage du
nord-ouest au sud-est selon un gradient ombrothermique assez
accusé, la lame de pluie efficace étant 4 fois plus élevée sur la
pointe du Caux que dans le Thymerais. Ces valeurs moyennes
fluctuent également dans le temps. En période humide (2000-
2001 par exemple), la pluie efficace peut atteindre 2 à 3 fois la
valeur moyenne et approcher zéro en période déficitaire (1975-
1976 par exemple).
Les eaux sont riches en sels minéraux
résultant de la dissolution des carbonates
dans des équilibres complexes, notamment
entre les ions Ca++ (90 à 110 mg/l), CO3
--,
HCO3
- (250 à 320 mg/l), équilibres régis par
le dioxyde de carbone biogénique (photo-
synthèse) et atmosphérique en solution. Sont
présents à l’état de trace dans la nappe de la
craie : F, K, Na, Ptot , NH4+. NO3- est présent de
manière très variable de 0 à 80 mg/l (la limite
pour l’adduction d’eau potable est de 50 mg/l),
ainsi que PO43-(0.02 à 0.2 mg/l), ce qui mon-
tre l’incidence des activités de surface.
Composition moyenne
des eaux de rivière
issues de la craie
Température 12 ° C
HCO3
- 298 mg/l
Ca++ 92 mg/l
pH 7 à 8.5
SiO2
-- 11 mg/l
Conductivité 484 ,us/cm
4 - Ruissellement, infiltration, régime des cours d’eau
La pluie efficace alimente l’hydrosystème continental. Une partie
ruisselle et est collectée en surface par le réseau hydrographique
temporaire ou permanent (fossés, talwegs, rus et cours d’eau),
une autre est stockée dans le sol et constitue notamment la
réserve utilisable par les plantes (RFU de l’ordre de 60 à 90 mm).
Enfin, une partie percole dans le sous-sol et recharge les
nappes. Sur les craies, c’est à dire sur la plus grande partie du
secteur, l’infiltration l’emporte normalement largement sur le
ruissellement (sur un bassin crayeux non perturbé, en moyenne
85 % de la pluie efficace s’infiltre et 15 % ruisselle), avec pour
conséquence un réseau hydrographique sans chevelu, alimenté
essentiellement par le drainage du grand réservoir souterrain
(de l’ordre de 500 000 m3/km2). Toutefois, l’augmentation crois-
sante des surfaces imperméabilisées et l’évolution des prati-
ques culturales modifient les bilans hydriques actuels vers un
ruissellement accentué sur la plupart des bassins (cf. p. 25).

19
La nappe s’écoule au travers de la craie poreuse à des vitesses
de quelques centimètres par heure en suivant la topographie et
fournit la majeure partie du débit des cours d’eau, par diffusion
au travers de la couche d’alluvions plus ou moins perméable
ou par des émergences ponctuelles, sources de débordement
(Crevon, Cailly), vauclusiennes ou artésiennes (Durdent, Eure,
basse vallée de l’Iton). Ce cheminement demande de quelques
semaines à plus d’un an. A cette circulation lente se surajoute
une circulation rapide par le réseau karstique, qui peut faire
gonfler rapidement le débit des sources après un épisode
pluvieux. Mais, globalement, la restitution des eaux météoriques
aux rivières est largement tamponnée, différée et prolongée.
Du fait de la complexité du réseau karstique, les bassins
hydrogéologiques peuvent différer notablement des bassins de
surface. Par le jeu des échanges souterrains, il arrive que des
cours d’eau soient alimentés par des sources dont les débits
sont sans rapport avec la topographie locale. Ainsi la Veules,
petit fleuve de 2 km de long seulement, a un important débit,
pratiquement constant toute l’année : débit d’étiage 480 l/s,
module 520 l/s !
Bassin versant Station de
référence
Pluie
mm
Pluie efficace
mm
Sortie à la station
mm
Avre Muzy 628 133 116
Epte Fourges 764 220 217
Iton Normanville 679 167 112
Risle Pont Authou 755 209 195
L’écart entre la pluie efficace et la sortie mesurée au limnigraphe tient aux incertitudes
et aux exportations hors bassin du fait de l’homme (prélèvement des sources de
l’Avre pour l’alimentation de la région parisienne, estimé à 19 mm) ou aux transferts
souterrains (Risle vers Iton, Iton vers Eure).
Les graphiques comparent les variations d’entrée, de sortie et de stock pour le bassin
de l’Iton à la station limnigraphique de Normanville, qui commande un bassin versant
amont de 1052 km2.
On observe que 1982-1987 a été une longue période de déstockage de la nappe,
les pluies efficaces sont inférieures aux débits sortants. On constate également
un important accroissement des stocks dans les années 1977-1981, puis de 1996 à
2001. La piézométrie a alors atteint des niveaux très élevés, qui se sont traduits
par des débordements de la nappe et la réapparition de ruisseaux dans des vallons
généralement secs.
Données extraites d’une étude menée par le BRGM sur le département de l’Eure.
"ILANHYDRIQUEL)TONÌ.ORMANVILLE
MM
MM
%NTRÏEPLUIEEFFICACEANNUELLE
3ORTIEDÏBITANNUEL
3TOCKAGEANNUEL
2ECHARGEANNUELLEMM
0LUIEANNUELLEMM
RECHARGE
Échanges rivière - nappe
Selon la configuration hydrogéologique, il arrive que la rivière ne draine
plus la nappe mais l’alimente, si son lit n’est pas colmaté. Ce cas est
fréquent dans le Pays d’Ouche.
2 - Les rivières de Seine-Aval

2 - Les rivières de Seine-Aval
20
En raison de son passage sur un sous-sol de nature différente,
la rivière peut devenir perchée. Le cours d’eau n’étant alors
plus alimenté par la nappe, dont il est déconnecté, les débits
sont constants, voire diminuent si le colmatage du lit et des
berges n’est pas suffisant. C’est le cas général à la limite des
départements de l’Orne et de l’Eure : le cours du Guiel est
interrompu sur 3 km, l’Iton devient partiellement souterrain
entre Damville et Glisolles, la Risle peut perdre dans le secteur
de Grosley la moitié de son débit en étiage, ces eaux ressortant
dans le secteur de Beaumont-le-Roger ou vers le bassin de
l’Iton. Sur ces sections de rivière perchées, une attention
particulière doit être apportée aux opérations de curage, pour
ne pas accroître les pertes par un décolmatage intempestif.
Fluctuations saisonnières
La recharge de la nappe se fait généralement d’octobre à
mars par infiltration de l’eau de pluie au travers du sous-sol.
D’avril à septembre, la majorité de l’eau de pluie est absorbée
par la végétation, la nappe n’est plus alimentée, sa hauteur
diminue. Sa décharge continue assure toutefois aux rivières un
débit régulier lentement décroissant, avec un étiage faiblement
marqué, de septembre à novembre généralement, pour autant
que leurs lits soient suffisamment enfoncés pour drainer
effectivement la nappe, et avec des nuances locales.
Le coefficient mensuel de
débit (rapport des débits
moyens mensuels au module)
témoigne aussi de la diver-
sité des régimes. On voit que
sur les rivières de la craie, ce
coefficient reste très proche
de 1, alors qu’il est très va-
riable à Saumont-la-Poterie
dans le Pays de Bray.
5 - Étiages et crues
Les étiages
Sur les rivières de la craie, le soutien de la nappe tamponne
les variations climatiques et assure des étiages peu marqués.
L’étiage peut être sévère pour les rivières ou sections de
rivières qui drainent des nappes de faible puissance (sables
du Perche, sables de Fontainebleau) ou qui sont en position
perchée par rapport à la nappe de la craie, comme les rivières
issues du Perche dans leur traversée du pays d’Ouche
(Risle, Guiel, Charentonne, Iton, Avre). C’est, d’une manière
générale, également le cas sur la partie sud du bassin, où les
précipitations efficaces sont modestes (cf. carte p.18) et où,
en dehors du drain principal, la plupart des talwegs latéraux
sont à sec presque en permanence.
Les très bas débits peuvent provoquer différentes altérations :
échauffement de l’eau, dilution insuffisante des polluants,
eutrophisation, désoxygénation et suroxygénation (par excès
de photosynthèse), atteintes aux biocénoses et stress pour
les peuplements piscicoles. Des mesures de limitation de
l’utilisation de l’eau sont alors nécessaires pour garantir
l’intégrité biologique des milieux (maintien d’un débit réservé).
Dans des biefs artificiels particulièrement concernés par les
bas étiages, le maintien fonctionnel de certains ouvrages peut
être utile pour assurer un niveau d’eau minimal.
Les crues
Trois types de phénomènes, qui peuvent se produire
conjointement, doivent être distingués : les débordements de
nappe, les crues de rivière et les coulées boueuses.
Ph.
3 - L‘Iton sec à Gaudreville-la-Rivière.
Les diagrammes ci-dessus comparent les hydrogrammes d’une rivière de
la craie et d’une rivière du Pays de Bray.
A Gournay-en-Bray, la rivière est alimentée uniquement par les eaux
de ruissellement. La vidange de la nappe d’accompagnement est très
faible et l’action régulatrice de la craie inexistante. L’étiage est sévère
et chaque épisode pluvieux provoque la multiplication du débit par 2
ou 3. Dès l’automne, les mois humides sont marqués par une succession
de crues brutales.
A Touffreville au contraire, la vidange de la nappe est très régulière.
A la reprise des précipitations, la réponse est rapide mais sans accident,
les rapports entre les débits extrêmes n’ont pas dépassé trois.

21
Les débordements de nappe
Après une succession d’années où la recharge de la nappe
est excédentaire, son toit s’élève, ainsi que celui de la nappe
alluviale d’accompagnement qui affleure alors dans les zones
les plus basses. Comme il est illusoire d’espérer se prémunir
contre cet aléa par des endiguements, seule la mise en œuvre
d’une politique de prévention peut limiter les risques.
Le toit de la nappe peut également recouper le lit des vallées
sèches et ainsi alimenter des cours d’eau temporaires. Ce phé-
nomène a pris une grande ampleur entre 1998 et 2001, quand les
nappes ont atteint leur plus haut niveau depuis 50 ans.
Ph. 4 - Écoulement exceptionnel par émergence de la nappe, inhabituellement
haute en 2001, sur le plateau près d’Étrépagny, dans un talweg habituellement
sec.
Ph
. 5 -
A l’entrée de l’agglomération chartraine, la Prairie de Luisant, zone
humide heureusement préservée, joue pleinement son rôle de tampon lors des
crues en stockant un grand volume d’eau.
Les crues de rivière
Les rivières de la craie ont un régime régulier. Les débits de
crue décennale ne dépassent guère 5 fois le module (2.7 pour la
Durdent à Vittefleur, 2.6 pour l’Iton à Normanville). Sur l’amont
des bassins versants de l’Epte, de l’Andelle et de la Risle, ce
rapport peut atteindre 30 à 40, ce qui reste modeste comparé à
d’autres régimes hydrologiques.
Sur les grandes rivières (Eure, Avre, Iton, Risle, Epte, Andelle),
une conjonction d’épisodes pluvieux sur les sous-bassins amont
peut générer une onde de crue et provoquer des débordements
à l’aval. Il est possible d’en limiter les effets par un système
d’annonce de crue optimisant la gestion coordonnée des
ouvrages, et surtout par la création de zones de ralentissement
dynamique ou de stockage dans le lit majeur en favorisant la
rétention partout où elle est possible. Cette approche, qui
demande de relativiser les enjeux locaux pour privilégier
une approche solidaire et de bassin, est encore très rare.
Il est indispensable de poursuivre et de parachever la mise
en place des PPR-inondation et de développer une politique
d’aménagement des lits majeurs visant à identifier, préserver
et restaurer les zones d’expansion des crues.
Le volume et surtout l’intensité des crues tendent à s’accroître du fait
de l’augmentation du ruissellement et de l’accélération des transferts,
imputables au retournement des prairies, à l’imperméabilisation, au
drainage et à la déstructuration croissante des sols. Les temps de
concentration se réduisent et les débits de pointe augmentent. La nappe,
moins bien alimentée, se vidange plus vite. Maintenir fonctionnelles
les zones naturelles d’expansion des crues permet de tamponner et
d’écrêter efficacement les crues.
Crue : Période pendant laquelle un cours d’eau présente des débits très
supérieurs aux valeurs moyennes. Au-delà du débit de « plein bord »,
la rivière déborde de son lit mineur et occupe sa plaine d’inondation,
ce qui est un événement naturel et nécessaire. L’hydrogramme de crue
permet d’interpréter la réponse du bassin relativement à un épisode
pluvieux.
L’intensité d’une crue est déterminée statistiquement par sa période de
retour (crue décennale, vingtennale, cinquantennale, centennale).
2 - Les rivières de Seine-Aval
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
1
/
14
100%