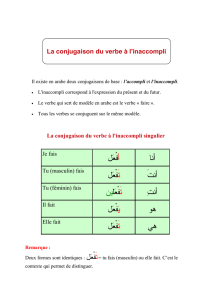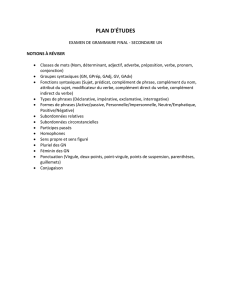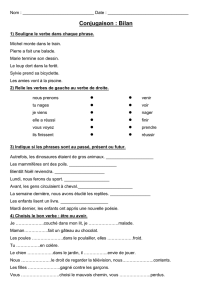LE SYSTEM VERBAL DU WOLOF Par Eric Church

LE SYSTEM VERBAL DU WOLOF
Par Eric Church
Documents Linguistiques No 27,
Département de linguistique Générale
de la Faculté des Lettres
et des Sciences Humaines de Dakar.
Université de Dakar
1981

i
ABREVIATIONS ET SIGNES CONVENTIONNELS
A - verbe d'action
aff. - affirmatif
ben. - bénéfactif
C ~ circ. - circonstanciel adverbial
CN - circonstanciel nominal
E - verbe d'état
E.C. - emphatique du complément
E.S. - emphatique du sujet,
E.V. - emphatique du verbe
énon. - énonciatif.
imp. - impératif
impers. - impersonnel
Inacc. ~ In ~ I - inaccompli
ind. - indicatif
inj. - injonctif
loc. - locatif
M.E. - en relation mutuellement exclusive
min. - mode minimal du verbe
nég. - négatif
N. - nom
obl. - obligatif
O ~ obj. - pronom objet
ON - objet nominal
opér. - opérateur
p. ex. - par exemple
pp. - personne du pluriel
ps. - personne du singulier
pers. - pronom personnel
plur. - pluriel
prés. - présentatif
pron. - pronominal
prop. temp. - proposition temporelle
R. C. - en relation contrastive
réfl. - réfléchi
sfx. - suffixe
sing. - singulier
S ~ suj. - sujet pronominal
SN - sujet nominal
vb. ~ V - thème verbal
vtf. - verbatif
Ø - zéro
* (devant une forme) - forme inacceptable
? (devant une forme) - forme douteuse
Dans les citations de la publication les cent et les quinze cents mots les plus fréquents de la langue wolof:
narr. - narratif (= mode minimal)
perf. - perfectif (= énonciatif)

ii

1 Nous entendons ici par Cayor la région s'étend de Pire- Goureye au sud à Ndande au nord et Darou-Moussty
à l'est
2 Cf. Bibliographie, Ouvrages spécifiques.
3 Le risque de dénaturer ainsi la langue semble plus théorique que réel. En anglais, la nasale de ink "encre" est
toujours prononcée vélaire, bien que l'anglais soit écrit depuis plus de 500 ans ; de leur côté, les Grecs ont toujours
prononcé une nasale dans les mots comme 'egkauston "encre", malgré la transcription par la vélaire g.
1
CHAPITRE I
INTRODUCTION
1. 1. Cette étude du verbe wolof est le fruit du contact quotidien que nous avons eu avec cette langue
pendant quinze ans, dont cinq passés dans le Cayor. L’étude est essentiellement descriptive et
synchronique, bien que, pour déterminer la valeur de certains signifiants, nous ayons eu parfois recours
aux premières grammaires de la langue. Le wolof présenté est, dans une large mesure, celui qui sert de
"koiné", mais nous nous sommes constamment reféré au dialecte que nous connaissons le mieux, à savoir
celui du Cayor1.
1. 2. Nous avons pris comme point de départ les pages 1-63 du Parler du Dyolof de Serge
Sauvageot2, c'est-à-dire les matériaux contenus dans son introduction, sa phonologie, qui est très
complète, et son introduction à la grammaire. Le lecteur voudra bien s'y reporter.
1. 3. Il nous a semblé bon d'utiliser l'orthographe arrêtée par décret plutôt que l' alphabet phonétique
international. L'utilisation de l'orthographe officielle, assez satisfaisante dans son ensemble, facilitera la
lecture de cette étude pour le lecteur, non verse dans la transcription linguistique.
1. 4. Pour ce qui est du découpage des mots, nous avons projet de la commission consultative pour
le découpage des mots en wolof. En ce qui concerne l'harmonie vocalique, nous avons préféré situer la
question sur le plan phonologique plutôt que sur le plan phonétique. En wolof, la voyelle d'un suffixe
dérivatif ou d'un inflexionnel est influencée par le degré d'ouverture de la voyelle du thème auquel il est
suffixé. La marque -ee de l'accompli dans la proposition temporelle, la marque du passé -oon, la marque
de l'impératif -al, le suffixe de réciprocité -e, sont soumis à cette règle :
bu demee/ñëwéé quand il part/viens
demoon/ñëwóón s'il était parti/venu
demal/ñëwël pars/viens
laale/gisé se toucher/se voir
Du fait que la fermeture de la voyelle du suffixe dépend entièrement de la fermeture de la voyelle qui le
précède, elle n'a aucune valeur phonologique. Nous avons donc uniformément transcrit ces suffixes avec
des voyelles ouvertes3. Si l'on transcrivait d'une façon purement phonétique, on risquerait une confusion
sur le plan pratique
fasam ak bëyëm son cheval et sa chèvre
jaayal ma te jëndël ma vends et achète pour moi
rootle te yenulé aider à puiser et à mettre sur la tête
xaritoo gën xuloo s'aimer est mieux que se disputer.
1. 5. La monème a qui se trouve entre un verbe opérateur et le thème indépendant est phonétiquement
lié au verbe opérateur. Il provoque le relâchement de toute occlusive réalisée implosée.: gëj/gëja ñëw “ne
pas depuis longtemps/ne pas venir depuis longtemps” et la fusion des voyelles : metti/mettee muñ
“pénible/pénible à supporter”. Cependant le monème a est lié grammaticalement au thème indépendant.

4 Cf. Bibliographie, Ouvrages spécifiques
5 Cf. Bibliographie, Ouvrages spécifiques.
6 Cf. Bibliographie, Ouvrages spécifiques.
7 Cf. Bibliographie, Ouvrages spécifiques.
2
Nous avons décidé de le transcrire comme l'a fait la commission dans la texte donné en illustration. de
sas propositions : naa jéema buurati “que je m'efforce de me conduire en roi encore”.
1.6. En préparant cette étude, nous avons souvent consulté Le Parler du Dyolof de Serge Sauvageot.
S’il nous est arrivé d'interpréter les données de la langue autrement que lui, il n'en reste pas moins que
son ouvrage s'est avéré très utile, ainsi que les encouragements qu'il nous a donnés dans les années
1962/1964, lorsque nous commençions à étudier la langue wolof. Nous lui en sommes très reconnaissant.
Nous avons souvent consulté le petit manuel de Stewart4, qui s'est révélé utile, ainsi que l'excellente étude
de Mme. Grelier5. Nous, avons lu et consulté la Grammaire de Wolof Moderne de Pathe Diagne6, et plus
récemment, le mémoire de maîtrise de Mme Boury Tounkara, que nous n'avons eu entre les mains qu'au
moment où notre étude avait presque atteint sa forme définitive. Signalons enfin que nous n'avons pas
jugé nécessaire d'achever le chapitre projeté sur les co-verbes comme ne coyy "être très rouge", l'étude
de Mamadou Guèye ayant paru pendant sa préparation7.
1. 7. Notre dette est grande à l'égard des nombreuses personnes qui nous ont aidé dans l'apprentissage
du wolof : Maguette Fall, ainsi que nombre d'amis cayoriens, Cheikh Niane et, plus récemment, Momar
Sylla. Notre participation aux débats de la commission pour le lexique wolof-français, dont nous étions
membres, nous a apporte de précieux enseignements. Nos remerciements vont à Madame Arame DIOP,
qui nous a souvent fait profiter de ses conseils, surtout en ce qui concerne la phonétique ; à Jean-Doneux,
qui, sans ménager son temps, a accepté de discuter avec nous des problèmes les plus variés ; à André
Wilson, qui a bien voulu lire et commenter les premières ébauches de notre travail ; ainsi qu'à Monsieur
Omar Ka, du C.L.A.D., qui a bien voulu compléter les recherches que nous avions commencées sur les
pronominaux dans les principales régions wolofphones. Surtout, nous sommes profondément
reconnaissant envers Mme Geneviève N'Diaye, qui a dirigé ce travail avec une grande patience et qui,
par ses conseils et ses encouragements, nous a permis de le mener à bien. Toute notre reconnaissance va
également à notre épouse, Eithne, qui a assuré la frappe des premières versions de notre travail et sans
la collaboration et le soutien de laquelle il n'aurait pu être mené à son terme. Enfin, que nos collègues
des missions évangéliques trouvent ici l'expression de notre gratitude pour le concours qu'ils nous ont
apporté et l'intérêt sincère qu'ils n'ont cessé de nous témoigner ; c'est en effet au cours du travail concret
de traduction en wolof des Saintes Ecritures que nous avons pris conscience de la complexité du verbe
wolof et que nous avons pu comprendre l'organisation du système.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
 149
149
 150
150
 151
151
 152
152
 153
153
 154
154
 155
155
 156
156
 157
157
 158
158
 159
159
 160
160
 161
161
 162
162
 163
163
 164
164
 165
165
 166
166
 167
167
 168
168
 169
169
 170
170
 171
171
 172
172
 173
173
 174
174
 175
175
 176
176
 177
177
 178
178
 179
179
 180
180
 181
181
 182
182
 183
183
 184
184
 185
185
 186
186
 187
187
 188
188
 189
189
 190
190
 191
191
 192
192
 193
193
 194
194
 195
195
 196
196
 197
197
 198
198
 199
199
 200
200
 201
201
 202
202
 203
203
 204
204
 205
205
 206
206
 207
207
 208
208
 209
209
 210
210
 211
211
 212
212
 213
213
 214
214
 215
215
 216
216
 217
217
 218
218
 219
219
 220
220
1
/
220
100%