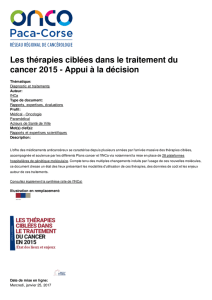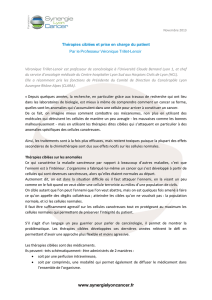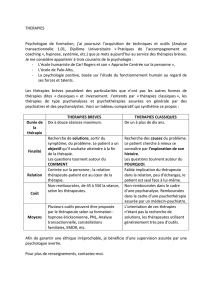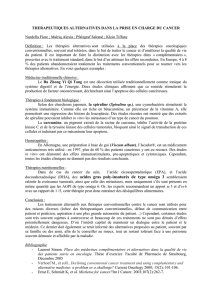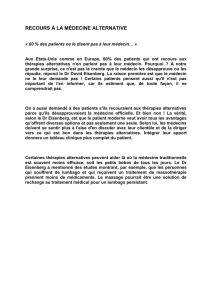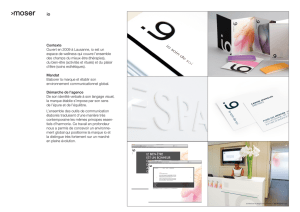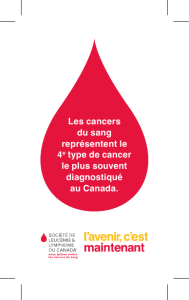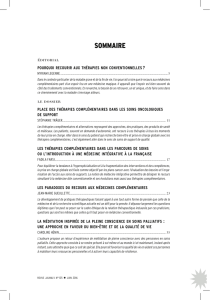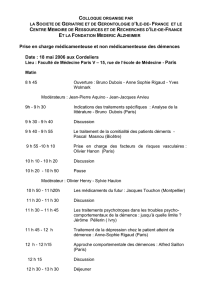Progrès en biologie moléculaire et thérapies ciblées : enjeux

ARTICLE ORIGINAL / ORIGINAL ARTICLE DOSSIER
Progrès en biologie moléculaire et thérapies ciblées : enjeux psychiques
Progress in Molecular Biology and Targeted Therapies: the Psychological Challenges
Z. Nevière · P.E. Brachet · F. Joly
Reçu le 2 juillet 2015 ; accepté le 10 octobre 2015
© Lavoisier SAS 2015
Résumé Les progrès en biologie moléculaire et les traite-
ments par thérapies ciblées ont révolutionné la prise en
charge des cancers. Ces traitements diffèrent des chimiothé-
rapies cytotoxiques classiques en agissant sur une ou plu-
sieurs cibles moléculaires impliquées dans l’oncogenèse.
Ces molécules ont des effets secondaires spécifiques, dont
certains peuvent agir sur les fonctions thymiques. Certaines
thérapies ciblées, comme les antiangiogéniques oraux,
engendrent souvent un état de fatigue profond et peuvent
avoir un effet direct sur le psychisme en affectant la cogni-
tion et la mémoire. Des effets secondaires d’ordre psychia-
trique ont aussi été rapportés mais restent anecdotiques.
Délivrées souvent sous forme orale, ces thérapies modifient
l’implication et l’autonomie du patient dans son traitement
ainsi que la représentation qu’il a de sa maladie et peuvent
avoir un retentissement psychique indirect. De même, ces
traitements sont donnés sur de longues périodes, et la gestion
chronique des effets secondaires comme les troubles diges-
tifs et cutanés devient rapidement difficile sur le plan psy-
chologique. Pour un nombre croissant de ces nouvelles thé-
rapies, l’indication de traitement est fondée sur la recherche
d’une anomalie moléculaire qui ne sera retrouvée que pour
un nombre restreint de patients induisant souvent des espoirs
déçus de la part des patients. De manière contemporaine aux
progrès de la biologie moléculaire, les thérapies ciblant des
mutations constitutionnelles impliquent de nouvelles problé-
matiques entrecroisant oncogénétique, nécessité thérapeu-
tique et contraintes techniques. Ainsi, dans ce contexte
scientifique nouveau, le patient est souvent déstabilisé par
un parcours de plus en plus complexe de sa prise en charge.
Mots clés Cancer · Psychologies · Cognition · Anti-VEGF
Abstract Advances in molecular biology and treatment with
targeted therapies have improved treatments of cancers.
These treatments differ from conventional cytotoxic chemo-
therapy by acting as one or more molecular targets involved
in tumorigenesis. These molecules have created new medical
issues concerning their particular impact on the psyche.
Some targeted therapies, such as antiangiogenesis, often
create a deep state of fatigue and can have a direct effect
on the psyche, affecting cognition and memory. Psychiatric
side effects have also been reported but are anecdotal. Often
delivered orally, these therapies alter the involvement and
patient autonomy in its treatment, and the representation he
or she has of his or her disease. Moreover, these treatments
are given over long periods, and chronic management of side
effects such as digestive and skin problems quickly becomes
psychologically difficult. For a lot of these emergent thera-
pies, treatment administration is based on the presence of
molecular alteration that is highlighting only in a small num-
ber of patients, inducing disappointed hopes. Contempora-
rily to advances in molecular biology, therapies targeting
constitutional mutations involve new issues intersecting can-
cer genetics, medical necessity, and technical constraints. So
in this new scientific landscape, patient is often destabilized
by a more and more complex medical management.
Keywords Cancer · Psychology · Cognition · Vascular
endothelial growth factor
P.E. Brachet (*) · F. Joly (*)
Service de recherche clinique,
centre de lutte contre le cancer François-Baclesse,
3, avenue du Général-Harris,
F-14000 Caen, France
e-mail : [email protected].fr,
Z. Nevière (*) · P.E. Brachet · F. Joly
Département d’oncologie médicale,
centre de lutte contre le cancer François-Baclesse,
3, avenue du Général-Harris,
F-14000 Caen, France
e-mail : [email protected]
P.E. Brachet · F. Joly
CHU, côte de Nacre, Caen, France
P.E. Brachet
Inserm U1199, université de Basse-Normandie, Caen, France
F. Joly
Inserm U1086, université de Basse-Normandie, Caen, France
Psycho-Oncol. (2015) 9:209-213
DOI 10.1007/s11839-015-0539-x

Introduction
Environ 355 350 nouveaux cas de cancers sont découverts
chaque année en France [1]. Même si la survie des patients
s’est nettement améliorée dans les situations de cancers
localisés grâce au dépistage et aux innovations thérapeu-
tiques, le pronostic reste réservé en cas de maladie méta-
statique. Dans ces situations, l’objectif des traitements est
palliatif et consiste en l’allongement de la survie en tentant
de préserver la qualité de vie. Ces dernières années, grâce
aux progrès de la recherche en biologie moléculaire, de
nouveaux traitements ciblés agissant sur des éléments clés
de l’oncogenèse sont apparus. Ces traitements, dont l’uti-
lisation est parfois conditionnée à la présence d’altération/
mutation spécifique, agissent en inhibant des protéines
impliquées dans des processus comme l’angiogenèse, la
prolifération ou la survie cellulaire. Ils ont permis l’amé-
lioration de la survie de patients en situation avancée au
prix de nouvelles toxicités. Cependant, si ces traitements
font naître de nombreux espoirs, ils ont fait apparaître
de nouvelles problématiques, notamment psychiques via
l’apparition de fatigue, de troubles cognitifs, de troubles
de l’humeur, ou en modifiant la représentation qu’ont les
patients de leur maladie.
Ces traitements médicamenteux ciblés ne sont apparus
qu’au dernier quart du XX
e
siècle avec la découverte du tamo-
xifène qui a révolutionné la prise en charge du cancer du sein
métastatique. Les innovations ultérieures sont survenues de
nombreuses années plus tard dans le domaine de l’hémato-
logie. L’ATRA, le rituximab et l’imatinib ont révolutionné la
prise en charge respectivement de la leucémie promyélocy-
taire, des lymphomes B et de la leucémie myéloïde chro-
nique, et restent un standard de traitement.
De nombreuses autres thérapies ciblées ont ensuite été
découvertes (hormonothérapies, anti-VEGF, anti-EGFR,
immunothérapies…) dans des domaines aussi variés que
les cancers hématologiques, du rein, de l’ovaire, de la peau,
etc. Le nom des thérapies les plus utilisées, leurs indications,
leurs principales cibles et leurs principales toxicités sont
reportés dans le Tableau 1. Ces traitements peuvent être
administrés par voie parentérale, mais également par voie
orale, ce qui peut générer des problématiques d’observance.
Ces nouvelles thérapies améliorent le pronostic des
patients, mais ne permettent généralement pas la guérison
Tableau 1 Nom commercial, Dénomination commune internationnale (DCI), indications, cibles et effets secondaires des principales
thérapies ciblées.
DCI Nom
commercial
Cibles Principales indications Principales toxicités
Trastuzumab Herceptin
®
Anti-HER2 Cancer du sein HER2+ [2],
cancer de l’estomac HER2+,
cancer du poumon HER2+
Troubles cardiaques, allergies
Rituximab MabThera
®
Anti-CD20 Lymphome B Allergies, déficit immunologique
Erlotinib Tarceva
®
Anti-EGFR Cancers bronchiques métastatiques
mutés pour l’EGFR [3]
Atteintes cutanées et les troubles
gastro-intestinaux
Cetuximab Erbitux
®
Anti-EGFR Cancer colorectal métastatique
non RAS muté [4]
Fissures des extrémités, éruption
cutanée, acné
Sunitinib Sutent
®
Anti-VEGF Cancer du rein métastatique,
GIST non résécable [5]
HTA, protéinurie, leucopénie,
anémie, thrombopénie, troubles
thyroïdiens
Vemurafenib Zelboraf
®
Anti-BRAF Mélanome BRAF muté, cancer
bronchique BRAF muté, cancer
de l’estomac BRAF muté
Réactions d’hypersensibilité,
Réactions cutanées, Allongement
de l’intervalle QT
Sorafenib Nexavar
®
C- ou B-Raf, VEGF-R2
ou R3, PDFGβ,Flt3etc-Kit
Cancer hépatocellulaire non
résécable ou métastatique
Toxicités dermatologiques,
Hypertension, Hémorragies,
Infarctus du myocarde,
Allongement du QT
Everolimus Affinitor
®
Anti-mtor Cancer du rein, mélanome…Stomatites, rash, fatigue, diarrhées
Imatinib Glivec
®
Anti-ckit GIST Troubles des phanères
210 Psycho-Oncol. (2015) 9:209-213

en situation métastatique. Ces traitements ne sont pas
dépourvus de toxicité, autant au niveau somatique que psy-
chique, et leur caractère chronique peut avoir un impact psy-
chologique important.
Impact des thérapies ciblées sur la cognition
et les affects
Troubles cognitifs
Outre de multiples effets secondaires digestifs, cutanés, car-
diovasculaires, les thérapies ciblées peuvent induire des
troubles cognitifs comme cela a déjà été décrit avec la chi-
miothérapie. Ces troubles dénommés chemobrain ou chemo-
fog associent perte de mémoire, troubles de concentration et
peuvent avoir un impact sur la qualité de vie.
De manière analogue, les thérapies ciblées peuvent être
responsables d’une altération des fonctions cognitives ou
de l’apparition de troubles psychiatriques. Ces effets ont
été rapportés avec les antiangiogéniques, mais restent mal-
heureusement mal évalués.
Ces troubles cognitifs seraient induits par l’inhibition du
vascular endothelial growth factor (VEGF) qui joue un rôle
important dans la neurogenèse et la biologie du système ner-
veux central. Ainsi, ces troubles ont été observés avec le
bevacizumab, le sorafenib et le sunitinib [6,7] et pourraient
concerner plus de 30 % des patients.
Troubles thymiques
Des troubles psychiatriques ont été rapportés en relation
avec les thérapies ciblées, mais ils ont été mal explorés.
Cependant, dans les quelques études les rapportant, ils ne
semblent pas fréquents (RCP produits). Un syndrome
dépressif est retrouvé chez 5 % des patients traités par suni-
tinib, dont moins de 0,5 % de dépressions sévères. Cet effet
est peu rapporté pour les autres thérapies ciblées. La physio-
pathologie de cet effet secondaire est mal étudiée.
Des troubles psychotiques ont également été décrits sous
sunitinib mais restent exceptionnels et seraient en rapport
avec une diminution de VEGF au niveau du cortex préfron-
tal comme cela est le cas chez des patients schizophrènes.
Dans l’étude de Noal et al. [Fatigue, quality of life and
cognitive functions in metastatic kidney cancer patients with
antiangiogenic treatment (ESMO 2010) Ann Oncol 21
(Suppl 8): Abstr 950], évaluant les effets cognitifs et psy-
chiatriques du sunitinib chez des patients traités pour un can-
cer du rein, très peu de troubles thymiques avaient été
observés.
Ces troubles psychiques sont difficiles à évaluer pour plu-
sieurs raisons. Premièrement, il peut être difficile de faire la
part des choses entre les troubles cognitifs et psychologiques
liés au caractère chronique et incurable de la maladie, et les
effets psychiques directs des thérapies ciblées. Deuxième-
ment, ces troubles sont mal appréciés par les oncologues
qui se concentrent sur des problèmes plus somatiques. Cela
suggère l’importance de réaliser des études prospectives de
grande échelle pour évaluer ces troubles psychiques chez les
patients atteints de cancer mais également de sensibiliser les
oncologues aux conséquences psychiques de leurs traite-
ments. Troisièmement, les patients sont généralement
enthousiastes à l’idée de bénéficier d’une thérapie ciblée,
ce qui peut masquer ou minimiser certains effets psychiques.
Enfin, même si ce n’est pas spécifique au traitement oncolo-
gique par thérapies ciblées, la survie des patients reste
modeste et ne permet pas d’apprécier correctement les
potentiels effets psychiques à long terme.
Impact psychologique d’un traitement au long
cours
Tout d’abord, de nombreuses thérapies ciblées ont des effets
secondaires somatiques (généraux, digestifs ou muqueux
notamment), dont la chronicité peut avoir un impact réel
sur le psychisme des patientes. Pour exemple, certaines
molécules peuvent entraîner des diarrhées ou des mucites,
dont la prise en charge spécialisée permet d’atténuer l’inten-
sité. D’autres toxicités comme la fatigue sont majorées par le
traitement ciblé, ce qui a un fort impact psychologique sans
que des traitements symptomatiques efficaces puissent être
prescrits. La fatigue est d’ailleurs une cause fréquente d’arrêt
de traitement par les patients. Ces manifestations peuvent
entraîner après plusieurs semaines une lassitude du patient
vis-à-vis de ce traitement, voire se compliquer par l’appari-
tion de symptômes de tonalité dépressive ou d’une négli-
gence. Ils sont souvent à l’origine de négociation d’arrêt ou
de pause thérapeutique par le patient.
Ces effets psychologiques sont à dépister rapidement afin
de ne pas altérer la qualité de vie du patient de manière trop
importante et pour pouvoir garder une adhésion au
traitement.
Observance reflet du vécu existentiel de la maladie
En augmentant la survie globale, les différents traitements et
notamment les thérapies ciblées transforment l’image du
cancer de maladie foudroyante à une maladie chronique.
En effet, les thérapies ciblées sont, pour une majorité, utili-
sées par voie orale : voie préférée dans 90 % des cas [8] par
les patients lorsque le choix se présente. Ce schéma théra-
peutique incite le patient à se responsabiliser et à devenir
plus acteur de sa prise en charge. Il éloigne aussi les patients
des structures hospitalières et de l’autorité médicale.
Psycho-Oncol. (2015) 9:209-213 211

Ces deux changements principaux influencent les phéno-
mènes dits de coping.Lecoping correspond aux différents
phénomènes émotionnels et d’adaptation de l’individu qu’u-
tilise le patient pour appréhender un facteur de stress. Ils
entraînent des modifications du comportement du patient
qui devient plus évitant face à sa maladie et au monde médi-
cal ainsi que les représentations qu’il a de sa maladie.
Cependant, l’observance, résultant du « vécu existentiel
de la maladie » [9], varie de manière inversement propor-
tionnelle à cet épuisement thérapeutique et cette négligence.
Peu d’études relatent l’observance des thérapies ciblées.
Waterhouse et al. [10] montrent une observance supérieure
à 95 % pour le tamoxifène. Néanmoins, Bleret [11] note une
décroissance de l’observance en fonction du temps de traite-
ment. Actuellement, des schémas de traitements séquentiels/
intermittents sont de plus en plus évalués pour préserver la
motivation des patients sans pénaliser leur survie.
Impact social des thérapies
En plus de modifier les représentations internes des patients
et selon notre propre expérience, les thérapies ciblées à tra-
vers leur administration orale changent aussi la représenta-
tion du cancer pour les proches des patients. Soigner un can-
cer comme on soignerait une hypertension, par comprimés,
tend à minimiser la gravité de la maladie, en ne poussant pas
le patient ou sa famille vers les questionnements sur le pro-
nostic. Et pourtant, ce questionnement paraît souvent exis-
tentiel pour le cheminement intellectuel du patient et de ses
proches.
Ces thérapies sont utilisées à différentes étapes de la prise
en charge du patient. Mais c’est lorsqu’elles arrivent en
deuxième partie, voire en fin de parcours, que cette remise
en question, notamment nécessaire lorsque arrive l’arrêt des
soins puis la fin de vie, est moins anticipée par le patient et sa
famille. La prise de conscience de la gravité de la situation
est alors plus brutale et plus difficilement acceptable.
Dans ce même sens, lorsque la maladie évolue, que l’au-
tonomie des patients se dégrade, les visites régulières dans
des services hospitaliers de jour ou de semaine du fait de
traitements intraveineux permettent des évaluations plus sys-
tématiques et plus rapprochées du patient par les différents
corps médicaux et paramédicaux (médecins, infirmières,
aides-soignants, assistants sociaux, psychologues…). Ces
différents temps sont réduits lorsque les patients sont vus,
de manière plus espacée par un médecin, seulement en
consultation.
Par ailleurs, la prise de traitements oraux facilite l’organi-
sation de vie du patient. Lorsque les effets secondaires ne
sont pas trop importants, une reprise du travail à temps plein
ou à temps partiel peut être envisagée. Cette demande, par-
fois spontanée de la part de patients, utilisant le travail
comme échappatoire psychologique, est plus difficilement
envisagée par une partie des patients, tirant secondairement
bénéfice du statut de « malade chronique ».
Génétique constitutionnelle comme cible
thérapeutique et conséquence
Plus récemment, de nouvelles problématiques entremêlant
intérêt thérapeutique et oncogénétique sont apparues. Par
exemple, l’arrivée sur le marché depuis fin 2014 des nou-
velles molécules anti-PARP, comme l’olaparib, dans le trai-
tement des cancers de l’ovaire en rechute présentant une
mutation somatique et/ou germinale du gène BRCA, repré-
sente une amélioration thérapeutique sans précédent dans
cette localisation [12].
Dans cette situation, il est nécessaire de réaliser rapide-
ment une enquête génétique afin de déterminer si la présence
de la mutation n’est présente uniquement au niveau soma-
tique ou aussi au niveau constitutionnel. Un dilemme appa-
raît alors entre bénéfice thérapeutique et devoir d’informa-
tion rapide et urgent sur les risques personnels et familiaux
du fait d’une mutation. La consultation d’oncogénétique
nécessitant temps et réflexion du fait de toutes les implica-
tions psychologiques internes et intrafamiliales qui en
découlent : culpabilité, choc comparable à l’annonce d’un
cancer.., contraste avec la nécessité d’une mise en place
rapide d’une thérapie anticancéreuse.
L’impact psychologique de ces thérapies ciblées touche
alors non seulement les patients, mais aussi leur famille proche.
Implication psychologique des contraintes
techniques
Dans ce contexte où la génétique, qu’elle soit constitutionnelle
ou somatique, prend une part importante dans la prise en charge
thérapeutique des patients en conditionnant l’accès à certains
traitements, le nombre de demandes d’analyses explose.
Avec cette augmentation, les plateformes techniques de
génétique doivent répondre de plus en plus rapidement à
des demandes de recherches mutationnelles hétérogènes
pour un nombre croissant de patients. Mais les capacités
des plateformes en termes de main-d’œuvre, de financement
ou de technique ne se développent pas aussi rapidement.
Une recherche mutationnelle peut prendre de quelques
jours à plusieurs mois, en fonction de la nature de la recher-
che, de la disponibilité des techniques nécessaires et du flux
de la demande.
Les patients ne sont pas informés de ces délais techniques
avant d’y être confrontés. Ces délais restent mal acceptés,
créant un stress psychologique et une anxiété importante.
De plus, l’image futuriste des recherches biomoléculaires
entraîne une attente importante de la part du patient : d’une
212 Psycho-Oncol. (2015) 9:209-213

part, l’impression d’être pris en charge de manière person-
nelle, en ciblant « leur » maladie, d’autre part l’impression
d’accéder à des thérapies d’allure plus innovante et efficace.
Malheureusement, tous n’accèdent pas à ces traitements,
et leur efficacité n’est pas toujours optimale. L’adhésion aux
traitements plus « classiques » est alors mise en cause, dété-
riorant ainsi la tolérance et l’espoir du patient vis-à-vis de
celui-ci.
Conclusion
Les thérapies ciblées ont donc un impact direct et un impact
indirect sur la psyché du patient. Troubles cognitifs, troubles
thymiques, mais surtout fatigue ponctuent la vie des patients
sur des périodes de traitement de plus en plus longues. Néan-
moins, ces traitements ont des conséquences sur le vécu des
patients vis-à-vis de leur maladie, ce qui peut influer sur leur
observance et leur adhésion aux soins. Ces phénomènes doi-
vent être connus et anticipés pour éviter en outre l’inobser-
vance thérapeutique, mais également pour rester en phase
avec une maladie qui reste grave.
Au-delà de ces effets psychologiques, les effets directs sur
la cognition et/ou le comportement doivent être mieux
explorés afin d’améliorer les connaissances sur ce sujet mais
également afin de mieux ajuster nos traitements.
Au-delà de l’aspect du médicament en lui-même, de la
prise en charge oncogénétique et de ses limites techniques
naît une anxiété importante.
Et alors que nos connaissances commencent à évoluer
pour les thérapies ciblées, un nouveau type de traitement
émerge déjà, avec de nouveaux effets secondaires, de nou-
velles nécessités techniques et de nouvelles implications
psychiques pour le patient : l’immunothérapie.
Liens d’intérêts : les auteurs déclarent ne pas avoir de liens
d’intérêts.
Références
1. Institut national du cancer (2013) Les cancers en France
édition 2013
2. Slamon DJ, Leyland-Jones B, Shak S, et al (2001) Use of chemo-
therapy plus a monoclonal antibody against HER2 for metastatic
breast cancer that overexpresses HER2. N Engl J Med 344:783–92
3. Herbst RS, Prager D, Hermann R, et al (2005) TRIBUTE: a
phase III trial of erlotinib hydrochloride (OSI-774) combined
with carboplatin and paclitaxel chemotherapy in advanced non-
small-cell lung cancer. J Clin Oncol 23:5892–9
4. Bokemeyer C, Bondarenko I, Makhson A, et al (2009) Fluorou-
racil, leucovorin, and oxaliplatin with and without cetuximab in
the first-line treatment of metastatic colorectal cancer. J Clin
Oncol 27:663–71
5. Motzer RJ, Hutson TE, Tomczak P, et al (2007) Sunitinib versus
interferon alfa in metastatic renal-cell carcinoma. N Engl J Med
356:115–24
6. Van der Veldt AM, van den Eertwegh AJM, Hoekman K, et al
(2007) Reversible cognitive disorders after sunitinib for advanced
renal cell cancer in patients with preexisting arteriosclerotic leu-
koencephalopathy. Ann Oncol 18:1747–50
7. Mulder SF, Bertens D, Desar IME, et al (2014) Impairment of
cognitive functioning during sunitinib or sorafenib treatment in
cancer patients: a cross sectional study. BMC Cancer 14:219
8. Liu G, Franssen E, Fitch MI, Warner E (1997) Patient preferences
for oral versus intravenous palliative chemotherapy. J Clin Oncol
15:110–5
9. Duverger (2015) Observance, adolescence et maladie chronique :
la place du psychiatre [Internet, cited 2015 Jun 17]. Available
from: http://psyfontevraud.free.fr/pedopsychiatrie/journees-ado-
lescent/actes2002.pdf#page=45
10. Waterhouse DM, Calzone KA, Mele C, Brenner DE (1993)
Adherence to oral tamoxifen: a comparison of patient self-
report, pill counts, and microelectronic monitoring. J Clin Oncol
11:1189–97
11. Bleret V (2015) L’observance au traitement de longue durée : le
cas particulier de l’hormonothérapie adjuvante du cancer du sein
[Internet, cited 2015 Jun 17]. Available from: http://orbi.ulg.ac.
be/bitstream/2268/73647/1/adherence%20to%20long-term.pdf
12. Oza AM, Cibula D, Benzaquen AO, et al (2015) Olaparib com-
bined with chemotherapy for recurrent platinum-sensitive ovarian
cancer: a randomised phase 2 trial. Lancet Oncol 16:87–97
Psycho-Oncol. (2015) 9:209-213 213
1
/
5
100%