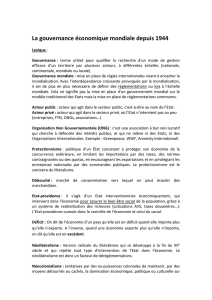Mondialisation et environnement : avancées et contraintes

1
Mondialisation et environnement : avancées et contraintes
Nadia DORBANE Epouse NASRI
Université Mouloud MAMMERI de Tizi-Ouzou
Faculté des Sciences Commerciales, Economiques et de Gestion
Mots clés : Mondialisation, environnement, Algérie, libre échange, ressources naturelles.
Résumé :
Depuis les années 80, l’économie mondiale est devenue de plus en plus intégrée. Trois
facteurs ont contribué à cette évolution : la baisse des barrières tarifaires et non tarifaires au
commerce international, les progrès réalisés dans les moyens de communication et les
technologies d’information, la réduction des freins à l’investissement direct étranger. Ces
facteurs ont contribué à la baisse des coûts des transactions internationales, et en l’occurrence
l’augmentation des échanges internationaux.
Cette croissance de l’économie mondiale ne sera pas sans effet sur l’environnement
étant donné que l’activité économique (la production et l’investissement) puise ses ressources
dans l’environnement et y rejette les déchets et rebuts.
L’impact environnemental de la mondialisation s’avère difficile à déterminer. La
mondialisation qui provoque de multiples phénomènes économiques : le développement des
échanges, la spécialisation internationale, la délocalisation de la production, le transfert
technologique, le renforcement de la concurrence ; dont les conséquences sur l’environnement
sont ambivalentes. C’est en raison de cette complexité de la relation entre ces deux
phénomènes et l’intérêt qu’ils suscitent que nous avons travaillé sur la question.
L’objectif de cette contribution n’est pas d’analyser l’ensemble des enjeux de la
mondialisation, mais de se focaliser sur la relation entre la mondialisation et la protection de
l’environnement. Est-ce que les modalités contemporaines de la mondialisation sont
susceptibles de nuire à l’environnement ou au contraire de le protéger ? Quels sont les
instruments et les moyens de gestion de l’environnement dans le contexte de la
mondialisation, notamment pour les pays en voie de développement, et quelles en sont la
portée et les limites ?
Les travaux réalisés, les débats académiques et politiques dans ce domaine ont montré
que la réalité est bien complexe étant donné que la mondialisation est un phénomène

2
contradictoire, qui comporte à la fois des aspects positifs et des aspects négatifs sur
l’environnement.
En 1993, dans le cadre du débat sur l’ALENA, G. GROSSMAN et A. KRUGER ont
distingué trois effets de la mondialisation. Un effet dit d’échelle selon lequel le libre échange
provoque l’augmentation de la production, phénomène nuisible à l’environnement. Un effet
dit de composition à travers la spécialisation internationale de la production, selon la théorie
du libre échange, cette spécialisation permettra une meilleure utilisation des ressources
naturelles. Un effet dit technique, c’est-à-dire, la libéralisation des échanges permet la
généralisation des techniques de production avancées moins polluantes. Selon ces deux
auteurs, l’impact environnemental du libre échange dépond au cas par cas de l’importance
relative de chacun de ces trois effets.
Cette communication se propose ainsi de mettre à l’épreuve ce nouveau paradigme à
travers le cas algérien. L’Algérie en plein transition économique et environnementale depuis
les années 90. Il convient donc de savoir comment ce pays arrive t-il à gérer cette transition.
Dans un contexte actuel de concurrence et de compétitivité internationale, notamment
en terme d’attractivité des investissements étrangers, l’Algérie pratique t-il le dumping
environnemental afin d’être compétitif ? La législation environnementale est-elle
contraignante ou avantageuse à la libéralisation des échanges ?qu’en est t-il de la politique
environnementale en Algérie ?
Nous analyserons dans une première partie, comment l’expansion des échanges
internationaux peut contribuer à la protection de l’environnement ou au contraire à sa
destruction. Dans la seconde partie, nous montreront que la mise en place d’une politique
environnementale nationale adéquate est une condition sine qu’a non à la réduction des effets
négatifs de la mondialisation sur l’environnement et permettra au contraire d’en tirer profit.
Pour faire cette analyse, nous nous appuierons, dans la mesure du possible, sur les statistiques
publiées par les institutions nationales et internationales chargées du commerce international
et de la protection de l’environnement.
Introduction
Au cours des dernières années, l’économie mondiale est devenue de plus en plus
intégrée. Trois facteurs principaux y ont contribués : les progrès réalisés des les moyens de
communication et d’information (NTIC), la réduction des barrières tarifaires et non tarifaires
au commerce international, la réduction des freins à l’investissement directs étrangers.
Cette croissance économique mondiale s’est accompagnée d’une dégradation
environnementale dont les effets sont irréversibles : l’épuisement des ressources naturelles, la
pollution, la déforestation, le réchauffement climatique, etc.
De nombreuses analyses économiques considèrent que la protection de
l’environnement relève de la responsabilité des gouvernements en mettant en œuvre des
politiques publiques environnementales, qui assureraient correctement l’internalisation des

3
coûts sociaux de la dégradation environnementale par le processus de production et de
consommation.
L’objectif de cette contribution n’est pas d’analyser l’ensemble des enjeux de la
mondialisation, mais de se focaliser sur la relation entre la mondialisation et la protection de
l’environnement. Est-ce que les modalités contemporaines de la mondialisation sont
susceptibles de nuire à l’environnement ou au contraire de le protéger ? Quels sont les
instruments et les moyens de gestion de l’environnement dans le contexte de la
mondialisation, notamment dans les pays en voie de développement (PVD) tels que l’Algérie,
et quelles en sont la portées et limites ?
Les travaux réalisés, les débats académiques et politiques sur cette question ont montré
que la réalité est bien complexe du faite que la mondialisation est un phénomène
contradictoire qui présente à la fois des effets positifs et des effets négatifs sur
l’environnement. Est-il possible de maîtriser ces effets contradictoires ?
Nous analyserons dans une première partie, comment l’expansion des échanges
internationaux peut contribuer à la protection de l’environnement ou au contraire à sa
destruction. Dans la seconde partie, nous montrerons que la mise en place d’une politique
environnementale nationale voire même internationale est une condition inéluctable à la
réduction des effets négatifs de la mondialisation sur l’environnement et permettra au
contraire d’en tirer profit.
I-Mondialisation : une chance pour l’environnement ?
I-1- Impact de la mondialisation sur l’environnement
Comme nous l’avons souligné déjà souligné, les conséquences de la mondialisation
sur l’environnement sont ambivalentes dans le sens où cette controverse a partagé les auteurs
en deux catégories. Les libéraux, qui soutiennent la mondialisation et prônent que celle-ci ne
se traduit pas seulement par la libre circulation des marchandises et des capitaux, mais
également par des échanges technologiques. Avec l’ouverture des économies, les entreprises
locales ou nationales vont pouvoir importer des technologies environnementales propres et
plus performantes. Les économistes de gauche (les altermondialistes) considèrent la
mondialisation comme source, entres autres, de problèmes environnementaux.
Il est vrai que, le plus souvent, la croissance économique et le commerce international
sont perçus comme étant des menaces pour l’environnement. Du coup, la libéralisation des
échanges et l’expansion de ceux-ci paraissent comme peu compatible avec la préservation de
l’environnement.
Les travaux réalisés dans ce domaine ont montré que la réalité est bien complexe étant
donné que la mondialisation est un phénomène contradictoire, qui comporte à la fois des
aspects positifs et des aspects négatifs sur l’environnement.

4
En 1993, dans le cadre du débat sur l’ALENA, G. GROSSMAN et A. KRUGER ont
distingué trois effets de la mondialisation : effet d’échelle, effet de composition et effet
technique.
L’effet d’échelle correspond au fait que la libéralisation des échanges et
l’accroissement de l’activité économique conduisent inévitablement à une pression forte sur
l’environnement. L’augmentation de la production nécessite plus d’inputs et gérèrent plus de
déchets et d’émissions polluantes. Il s’agit là d’un effet négatif.
L’effet de composition est lié à la spécialisation de production de chaque pays induite
par le commerce international. Celle-ci peut être considérée de manière positive comme
négative. Cet effet se base sur la théorie du commerce international inspirée de la loi des
proportions des facteurs de production, qui stipulent que les pays doivent se spécialiser dans
la production du bien qui requière le facteur dont ils sont relativement les mieux dotés. Ainsi,
un pays avec bonne « dotation en environnement » et qui s’ouvre aux échanges internationaux
devra se spécialiser dans la production de biens polluants.
Cet effet renvois à l’idée de paradis de pollution ou encore le havre de pollution1. Les
industries les plus polluantes choisiraient de se localiser dans les pays où la réglementation
environnementale est plus laxiste. Cependant, les études empiriques ne semblent pas
confirmer cette hypothèse. Grossman et Krueger ont montré dans l’un de leurs articles que la
libéralisation des échanges entre les Etats-Unis et le Mexique dans les années 80 et 90, dans le
cadre d’ALENA, ne s’est pas accompagnée d’une délocalisation des industries polluantes2.
D’autant plus que les industries les plus polluantes sont généralement les plus capitalistes et
que ce sont les pays développés qui sont relativement les mieux dotés en capitaux. Ainsi, ce
risque reste encore restreint.
On peut donc penser que les PVD n’ont pas particulièrement d’avantages comparatifs
dans la production des biens polluants.
Enfin l’effet technique de la libéralisation sur l’environnement est double. Car,
premièrement, la libéralisation des échanges et les investissements directs étrangers (IDE)
peuvent être l’objet de la diffusion et de transfert de technologies plus propres et plus
respectueuses de l’environnement. Deuxièmement, l’augmentation du revenu provoque par la
libéralisation des échanges peut permettre un accroissement de la demande pour un
environnement plus propre. L’effet technique doit donc conduire à une meilleure protection
de l’environnement. A titre d’exemple, Stéphanie MONJON et Julien HANOTEAU ont
montré dans leur article « … qu’en Côte d’Ivoire, au Mexique et au Venezuela, les unités de
production étrangères dans les secteurs de la chimie, de la raffinerie, du bois et des machines
non électriques sont significativement plus efficaces énergétiquement ou utilisent des
procédés plus propres que les installations nationales »3.
1 Stéphanie MONJON et Julien HANOTEAU, « Développement, croissance et environnement : Mondialisation et
environnement », in cahiers français, n°337, mars-avril 2007.
2 Idem.
3 : Stéphanie MONJON et Julien HANOTEAU, op cité, page 38.

5
Selon ces deux auteurs, l’impact environnemental du libre échange dépond au cas par
cas de l’importance relative de chacun de ces trois effets.
A l’heure actuelle, les principales études économétriques n’ont pas pu démontrer que
la mise en place d’accords de libre échange, comme ALENA, a augmenté la pollution dans les
PVD. De plus les résultats des études empiriques ne permettent pas d’établir un lien
significatif entre une plus grande ouverture au commerce international et le niveau de
pollution1.
Certains auteurs ont essayé de déterminer une relation richesse et environnement. La
première est par Gene GROSSMAN et Alan KRUEGER, qui ont mis en relation le revenu par
habitant les indicateurs environnementaux.
L’augmentation de la production et la croissance économique induites par l’extension
de la libéralisation des échanges permettent :
- d’enrichir la population et les entreprises qui deviennent donc davantage soucieuse
de l’environnement, considéré comme un bien supérieur.
- de dégager des excédents de revenus susceptibles d’être alloués à la protection de
l'environnement ;
- de découvrir de nouvelles technologies capables de permettre une utilisation
rationnelle des ressources naturelles ; ce qui tend à limiter l'augmentation de la
pollution, voire à la faire diminuer.
Sur cette base, ces économistes avancent que la croissance est nuisible à
l’environnement jusqu’à ce que soit atteint un certain niveau de revenu par habitant, et qu'au-
delà les effets favorables à l’environnement deviennent dominants. Ils ont montré qu’il existe
une relation en U inversé entre la richesse d’un pays et le niveau de dépollution. Cette relation
est nommée la courbe environnementale de Kuznets, représentée ci-dessous.
Figure n°01 : La courbe environnementale de Kuznets
Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Effets_du_commerce_international_sur_l%27environnement, consulté le
01/08/2012.
1 KHODJO-KOMNA Koyo, « Commerce et input indésirable. Quelques éléments en faveur d’une efficience
technique dans les pays du Maghreb et le proche Orient », in Synthèse du colloque « Mondialisation et
développement durable : les effets économiques, sociaux et environnementaux de l’ouverture commerciale »,
organisé par UNECA, avril 2008, page38.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
1
/
14
100%