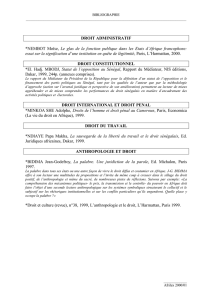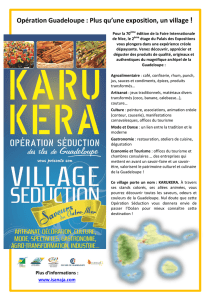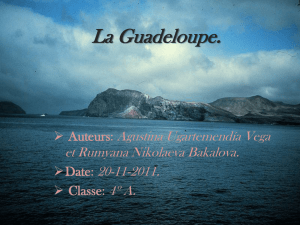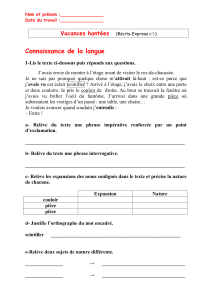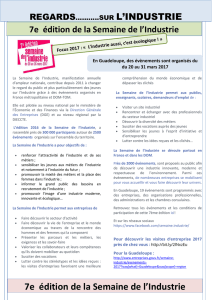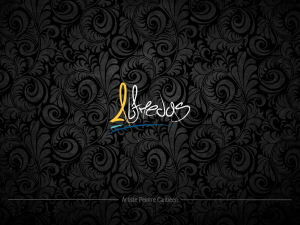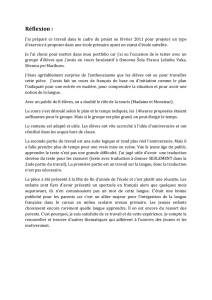le théâtre de maryse condé

MARYSE CONDÉ
PALABRE SPÉCIAL
aryse Condé, ro-
mancière et dra-
maturge guade-
loupéenne, en-
seigne actuellement à Columbia
University, New York. Auteure de
sept pièces, toutes portées à la scène,
dont certaines en anglais par le Ubu
Repertory Theatre à New York : Dieu
nous l’a donné (1971-1972), La
mort d’Oluwémi d’Ajumako (
1973), Le morne de Massabielle
(1974), Les 7 voyages de Ti Noël
(1987), Pension les Alizés (1988),
An tan revolisyon (1991), Comédie
d’amour (1993) 1.
Cet entretien à bâtons rompus
avec Maryse Condé sert de point
de départ à une réflexion sur sa
dramaturgie qui pourrait nous
amener très loin car l’auteure y
aborde les questions clés de son
travail, questions que nous n’avons
pas eu le temps d’approfondir ici.
Le lecteur y trouvera des allusions
sur le rapport entre le texte écrit et
son énonciation, sur la probléma-
tique intertextuelle et la manière
dont certains metteurs en scène
et dramaturges américains ou bri-
tanniques ont laissé des traces sur
son travail. Elle soulève également
les problèmes posés par la tra-
duction vers l’anglais : la diffi-
culté de traduire l’ironie, les
conséquences d’un changement
de milieu culturel sur la réception
de l’œuvre jouée. Des questions
concernant l’intervention du créo-
le, ainsi que la traduction, l’adap-
tation et la dynamique transcul-
turelle sont fondamentales pour
comprendre son théâtre puisqu’el-
le habite aux États-Unis et que son
public le plus important la
connaît uniquement à travers la
voix du (de la) traducteur (trice).
Autant d’éléments qui ouvrent
des pistes de recherche et fournis-
sent la matière de réflexion sur le
modèle d’un théâtre translinguis-
tique.
LE THÉÂTRE
DE MARYSE CONDÉ
Entretien de Maryse Condé avec le Pr Alvina Ruprecht,
Professeur Émérite Université Carleton, Ottawa, Canada*.
M
* New-York, lundi 23 février
1998
1 - Cet entretien a paru dans
l’Internationl Journal of
Francophone Studies, v.2, n.1
(1999), p. 51-61.
147
147
L’Arbre à PalabresN° 18 Janvier 2006

MARYSE CONDÉ
PALABRE SPÉCIAL
Maryse Condé : J’ai écrit
Dieu nous l’a donné, La Mort
d’Oluwémi Ajumako et Le Morne
de Massabielle, première version,
celle qu’on a jouée à Puteaux en
1972, avant de faire des romans
parce que je croyais que le théâtre
était plus à la portée de mes pos-
sibilités. Je me suis mise à écrire
des romans quand j’ai eu un peu
plus confiance en moi.
Alvina Ruprecht : Le théâtre
vous a-t-il permis d’exprimer
quelque chose que le roman ne per-
mettait pas ?
M. C. : C’est peut-être cela
aussi. À l’époque, j’étais très mili-
tante. Je pensais que le théâtre était
le meilleur moyen d’avoir une por-
tée immédiate sur le spectateur.
C’était quand même ridicule de
croire que j’arriverais à dialoguer
avec le public par le moyen d’une
pièce en français, sur un modèle
européen, écrite d’une façon soli-
taire. Je n’avais pas encore compris
que le théâtre doit être une forme
de création collective entre une
troupe, un metteur en scène éven-
tuel et un auteur. J’étais dans un
leurre dont je ne me rendais pas
compte moi-même.
Mes premières pièces étaient
beaucoup plus écrites. Je pense
surtout à La Mort d’Oluwémi
d’Ajumako, qui était jouée en
Afrique. Elle avait une langue que
je ne ferais plus parce que mainte-
nant je chercherais plutôt à rendre
le son de la parole.
A. R. : Vous êtes devenue plus
consciente du travail du metteur en
scène ?
M. C. : Je suis devenue beau-
coup plus consciente du travail de
l’acteur, de ce que c’est que dire un
texte qu’on n’a pas écrit. Il fallait
que le texte colle à la personnalité
de l’acteur. Je me suis rendu
compte que je devais être plutôt à
l’écoute de cet acteur, me modeler
sur ce qu’il aurait pu dire. C’est
l’acteur qui m’influençait beau-
coup plus que le metteur en scène.
A. R. : Des acteurs de manière
générale ou certains acteurs ?
M. C. : Je me suis mise à ima-
giner les textes dans la bouche de
certains acteurs. Un acteur que
j’admirais beaucoup était un
Gambien qu’on appelait James
Campbell, qui d’ailleurs n’a pas eu
une carrière extraordinaire mais
qui avait une sorte de génie du di-
re et de transformer ce qu’il disait.
J’ai commencé à beaucoup écrire
en pensant à lui. C’était un fan-
tasme. Je l’entendais en train de
prononcer mes mots, mes phrases
et cela m’amenait à modifier la fa-
çon dont elles étaient conçues.
Cet acteur avait des qualités de
grandeur et de bouffonnerie. En
148
148
L’Arbre à Palabres N° 18 Janvier 2006

MARYSE CONDÉ
PALABRE SPÉCIAL
fait, en le regardant jouer j’ai com-
pris l’absurdité de séparer la tragé-
die de la comédie. J’ai vu com-
ment l’acteur était plastique et fi-
nalement j’ai eu envie de faire des
textes qui pourraient se prêter à lui
et dont il ferait ce qu’il voulait.
A. R. : Quelle pièce est sortie de
cette prise de conscience ?
M. C. : Je pourrais dire que
Pension les Alizés était écrite en
pensant à lui : le personnage du
Haïtien qui était à la fois séduisant
et veule. Aussi une pièce que
j’avais traduite et adaptée qui s’ap-
pelait Jeu pour deux tirée d’un tra-
vail du jamaïcain Trevor Rhone.
A. R. :Votre première pièce Le
Morne de Massabielle n’a jamais
été publiée ?
M. C. : Non, tout simple-
ment parce que j’ai perdu le texte.
Il n’est resté que le texte en anglais
parce que mon mari (Richard
Philcox) l’avait traduit, et quand
Françoise Kourilsky (Ubu
Repertory Theater) a monté la piè-
ce à New York, 2c’était en tra-
duction, donc je ne suis pas reve-
nue au texte français.
A. R. : Comme les premières
pièces représentaient votre côté
militant, est-ce que Le Morne de
Massabielle est aussi une œuvre en-
gagée ?
M. C. : C’est-à-dire, la pre-
mière version était engagée, mais
après, la pièce a changé de ton.
Elle est devenue une comédie sa-
tirique sur les méfaits du tourisme
dans le quartier de Massabielle, un
quartier populaire de Pointe-À-
Pitre.
A. R. :Comment avez-vous re-
çu ces traductions ?
M. C. : Une traduction est
toujours un peu pénible sauf
quand il s’agit d’un de mes ro-
mans, où je n’ai pas l’impression
d’entendre ma propre voix dans le
texte traduit. Mais au théâtre,
parfois je ne m’entendais plus.
J’entendais des sons qui étaient
peut-être harmonieux, c’était
peut-être bien fait, mais je sentais
que ce n’était pas vraiment moi. Je
crois qu’il faut accepter cette tra-
hison/traduction qui est faite pour
des gens qui ne peuvent pas vous
appréhender dans votre propre
langue. Par exemple, dans tout ce
que j’écris, il y a une distanciation
ironique mêlée à la tendresse.
Évidemment, l’ironie en français
ne passe pas bien dans un texte an-
glais.
A. R. : La Comédie d’Amour
était une expérience nouvelle ?
M. C. :Oui. On me repro-
chait d’écrire des livres que le
grand public n’aime pas toujours.
2 - Françoise Kourilsky, direc-
trice artistique du Ubu
Repertory Theater, le seul
théâtre professionnel à jouer
les œuvres de la francophonie
africaine et antillaise aux Etats-
Unis. Le Ubu Rep, qui a
ouvert ses portes à New York
en 1982, avait pour mission
de faire connaître aux
Américains le répertoire des
œuvres dramatiques contem-
poraines d’expression fran-
çaise.
149
149
L’Arbre à PalabresN° 18 Janvier 2006

MARYSE CONDÉ
PALABRE SPÉCIAL
Alors j’avais envie de me rappro-
cher du peuple et surtout de faire
rire. On me disait toujours que
mes livres étaient tristes.
Finalement c’était grâce à la trou-
pe T.T.C.+ Bakanal de José
Jernidier, que j’ai pu montrer un
côté de moi que les gens ne
connaissaient pas. Quand j’ai vu la
pièce et que j’ai entendu les rires,
c’était comme un coup de fouet. Je
suis arrivée à amuser les gens et
c’était important.
A. R. :Cette situation familia-
le a quand même, un fond assez sé-
rieux.
M. C. :Ah oui ! C’est une
pièce grave, seulement elle était
jouée en farce mais c’est ainsi que
les gens avaient envie de la recevoir
et c’est comme cela qu’elle a fonc-
tionné. Mais il est évident que je
n’ai pas pensé que le public rirait
aux endroits où ils ont ri. Quand
on a joué la pièce aux États-Unis
en français, il y avait des gens qui
ont fait la réflexion : mais ce n’est
pas une comédie.
A. R. : Le public guadeloupéen
l’a comprise autrement.
M. C. : Mais les Guadelou-
péens l’ont vue avec la troupe de
José Jernidier et les gens riaient
avant même d’avoir entendu les
acteurs parler par le simple fait
qu’il s’agissait des acteurs de la
troupe de Jernidier qui avaient
l’habitude de jouer des farces po-
pulaires ; le public était déjà dans
le mode comique. Les Américains
ne connaissaient pas ces acteurs
et donc ils étaient beaucoup plus
sensibles au texte. Pour eux, le tex-
te n’était pas toujours à se rouler
par terre. Au contraire, parfois,
dans les rapports entre les sœurs,
il y avait beaucoup de cruauté,
beaucoup de tendresse aussi. Je
me rappelle, par exemple, quand
la veuve disait : Je veux un homme
qui m’aime, en Guadeloupe les
gens se marraient alors que les
Américains ont accueilli cette ré-
plique dans le silence parce que
c’est quand même un désir légiti-
me.
A. R. : Avez-vous tenu compte
d’autres formes de théâtre en
Guadeloupe ou ailleurs ? Parfois
vous évoquez le Boulevard français
ou vous êtes-vous inspirée des séries
télévisuelles ? Actuellement, la télé-
vision laisse ses traces importantes
sur le théâtre de manière générale.
M. C. : La télévision, surtout
la sitcom nord américaine où le ri-
re est direct et les situations sont
claires, faciles à élucider, faciles à
retenir.
A. R. :Y a-t-il des traces du
Vaudeville français ?
M. C. : Pas tellement.
150
150
L’Arbre à Palabres N° 18 Janvier 2006

MARYSE CONDÉ
PALABRE SPÉCIAL
Comédie d’Amour était calquée sur
la comédie américaine où tout le
monde se réconcilie à la fin. Le pu-
blic guadeloupéen a l’habitude de
ce genre de scène.
A. R. : Le fait que tout se pas-
se dans la cuisine autour de la table
est très curieux parce qu’il existe une
convention du théâtre québécois, un
théâtre de cuisine où tout se passe
dans la cuisine autour de la table,
au sein de la famille ouvrière ou pe-
tite bourgeoise. Je pense aux Belles-
sœurs de Michel Tremblay. Est-ce
que le théâtre joué dans la cuisine est
une situation devenue une des
conventions d’un certain théâtre
guadeloupéen ?
M. C. :Non, et puis, il faut
dire que je ne connais pas telle-
ment le théâtre guadeloupéen. Je
connais surtout le théâtre d’Aimé
Césaire, le théâtre martiniquais.
Par contre, je pensais beaucoup
aux œuvres anglaises, le théâtre
kitchen sink des Angry Young Men,
Arnold Wesker, John Osborne, le
théâtre britannique des années
1960 qui met en scène la vie quo-
tidienne de la classe ouvrière.
Leur théâtre est plus cruel alors
que moi, j’ai un peu édulcoré le
côté cruel. Il ne faut pas oublier
non plus que Comédie d’Amour a
été un peu inspiré par une pièce de
Neil Simon, Brighton Beach
Memoirs, que j’avais vue à Londres
avec mon mari et que j’ai trouvée
extraordinaire. C’était l’exemple
d’un théâtre populaire que je re-
cherchais parce qu’il touchait tout
le monde mais dont le dialogue, le
décor et la mise en scène étaient
très raffinés.
A. R. : Une partie de votre
pièce est en créole, ce qui a dû atti-
rer le public guadeloupéen. Pour le
public de Washington, avez-vous
supprimé le créole ?
M. C. : Complètement,
c’était entièrement en français.
A. R. :Vous avez changé les ni-
veaux de langue selon les interlocu-
teurs ?
M. C. :Non, c’est parce que
ce n’est pas moi qui ai fait les par-
ties en créole. La pièce était écrite
en français avec des indications
scéniques qui proposaient aux ac-
teurs d’improviser en créole.
Quelquefois, j’étais un peu mé-
contente de voir qu’ils avaient trop
créolisé le texte, qu’ils avaient mis
des plaisanteries créoles, là où je ne
m’y attendais pas. Des blagues
qu’ils ont ajoutées ont tiré le texte
un peu vers le bas.
A. R. : La production aux
États-unis était différente dans ce
sens-là ?
M. C. : La réception de la piè-
ce était différente. Elle était ac-
151
151
L’Arbre à PalabresN° 18 Janvier 2006
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%