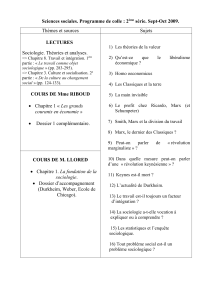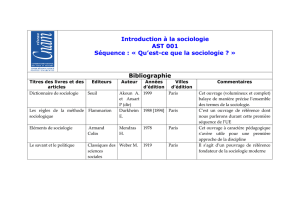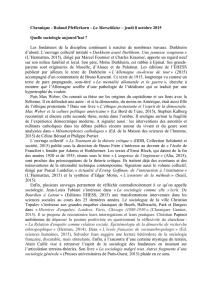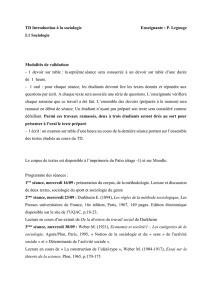Master d`ergologie, 2009-2010. Cours Dominique Efros II

1
Master d'ergologie, 2009-2010. Cours Dominique Efros
A
PPROCHE DE LA SOCIOLOGIE POUR L
’
ERGOLOGIE
I-
H
ERITAGES POUR UNE SCIENCE DES ASSOCIATIONS HUMAINES
........................... 3
1)
U
NE SCIENCE POUR CONNAITRE PAR L
’
OBSERVATION DIRECTE
.......................................... 3
a) Louis Villermé .............................................................................................................. 3
b) Frédéric Le Play ........................................................................................................... 4
c) Emile Cheysson ............................................................................................................ 6
2)
U
NE SCIENCE AU SERVICE DE L
’
EMANCIPATION HUMAINE
.................................................. 6
a) Saint-Simon .................................................................................................................. 6
b) Comte ........................................................................................................................... 7
c) Proudhon ....................................................................................................................... 8
d) Marx ........................................................................................................................... 10
II-
C
RISE MORALE
,
ANOMIE ET SOLIDARITE SOCIALE
............................................ 12
1)
D
IVISION DU TRAVAIL SOCIAL ET INTERDEPENDANCE
...................................................... 12
a) Les formes de solidarité .............................................................................................. 12
b) Interdépendance et évolution des sociétés .................................................................. 13
2)
E
TUDIER LES
«
FAITS SOCIAUX
»
POUR EXPLIQUER LA SOCIETE
........................................ 14
a) La connaissance des faits sociaux ............................................................................... 15
b) Analyse statistique et questions de méthode .............................................................. 16
3)
U
NE SOCIOLOGIE DES NORMES ET DE L
’
INTEGRATION
...................................................... 18
III-
H
IERARCHIES SOCIALES
,
CLASSEMENTS ET CATEGORISATION
........................ 20
1-
S
TATUTS SOCIAUX ET MOBILITE SOCIALE
......................................................................... 20
a) La distinction entre statut assigné et statut acquis ...................................................... 20
b) La dynamique des classes sociales ............................................................................. 21
c) La stratification sociale ............................................................................................... 23
2)
C
ATEGORISATIONS ET PRINCIPES DE CLASSEMENT
........................................................... 24
a) La hiérarchie statutaire de Warner .............................................................................. 24
b) Les catégories de la population active française ........................................................ 25
IV-
D
ESENCHANTEMENT
,
MODERNISATION ET RATIONALISATION
........................ 27
1)
R
ATIONALISATION ET MODERNISATION DES SOCIETES
..................................................... 27
a) Protestantisme et capitalisme ...................................................................................... 27
b) Transformations de la vie sociale et de l’humanité .................................................... 28
2)
C
OMPRENDRE
«
L
’
ACTION SOCIALE
»
POUR CONNAITRE LA VIE COLLECTIVE
................... 30
a) La connaissance des activités sociales ........................................................................ 30
b) Analyse compréhensive et idéal-type ......................................................................... 31
3)
U
NE SOCIOLOGIE DES REGLES ET DE LA NEGOCIATION
..................................................... 33

2
a) Les organisations modernes ........................................................................................ 33
b) Dysfonctionnements bureaucratiques et incapacité acquise ....................................... 34
c) Cercles vicieux bureaucratiques et zones d’incertitude .............................................. 35
V-
I
NTERACTIONS ET FABRICATION DES NORMES SOCIALES
.................................. 37
1)
P
RAGMATISME ET ECOLOGIE HUMAINE
............................................................................. 37
a) Homme, environnement et significations ................................................................... 37
b) Espaces, territoires et mobilité.................................................................................... 38
c) L’enquête par « participation empathique » ............................................................... 38
2)
L’
INTERACTIONNISME SYMBOLIQUE
................................................................................. 39
a) Théorie a priori ou théorie fondée ?............................................................................ 39
b) La fabrique quotidienne de l’ordre social ................................................................... 41
c) Rituel, étiquetage et ordre négocié ............................................................................. 42
3)
P
ARADOXE DE L
’
OBSERVATEUR ET OBSERVATION PARTICIPANTE
.................................... 45
a) L’observateur observé ................................................................................................ 45
b) Faire soi-même l’expérience de ce que vivent les autres ?......................................... 47
VI-
L’
ANALYSE SOCIOLOGIQUE DU TRAVAIL
........................................................ 48
1)
L
E TRAVAIL ET SA SOCIOLOGIE
......................................................................................... 48
a) Une activité humaine générique devenue marchandise .............................................. 48
b) Une activité collective qui déborde le cadre de sa réalisation .................................... 49
c) Un acte technique et un acte social ............................................................................. 50
2)
S
UBORDINATION SALARIALE ET SATISFACTION DES BESOINS
........................................... 52
a) Les formes de rémunération ....................................................................................... 52
b) Transformations de la signification du salaire ............................................................ 54
c) Fluctuations et ambiguïtés de la relation salariale ...................................................... 54
3)
Q
UALIFICATIONS ET COMPETENCES
.................................................................................. 56
a) Division du travail, technique et travail humain ......................................................... 56
b) Qualification des postes de travail ou qualification par la formation ? ...................... 57
c) Négociation des qualifications et outils de gestion ..................................................... 58
d) Des qualifications « tacites » aux compétences ........................................................ 61
VII-
S
OCIOLOGIE
,
SCIENCE ET POLITIQUE
............................................................. 65
1) Les relations entre individus et société ....................................................................... 65
2) Les relations entre production de connaissance et action politique............................ 66
3) Les relations entre producteurs de savoirs .................................................................. 68
4) Les relations entre disciplines et méthodes ................................................................ 69
A
NNEXE
1 –
E
VOLUTIONS DANS LA COMPOSITION DU SALARIAT
.......................................... 71
A
NNEXE
2
–
A
PROPOS DU TERME
«
COMPETENCES
» ........................................................... 77
A
NNEXE
3 –
R
EPERES SUR QUELQUES OUVRAGES
«
CLASSIQUES
» ...................................... 80
A
NNEXE
4
-
B
IBLIOGRAPHIE INDICATIVE DU COURS
............................................................. 82

3
I-
H
ERITAGES POUR UNE SCIENCE DES ASSOCIATIONS HUMAINES
Etymologiquement, le mot « sociologie » est composé de « socius » qui signifie « associé » en latin et
de logos qui signifie « parole, discours, raison » en grec. La sociologie est donc un discours, une
analyse conceptuelle, une connaissance des associations humaines, des façons de s’organiser pour
faire quelque chose à plusieurs ou pour vivre ensemble.
Les premières traces écrites de réflexion sur l'organisation de la vie collective en société datent de la
Grèce ancienne (- 400 et - 300 avant notre ère) avec des philosophes comme Platon (La République)
et Aristote (Ethique à Nicomaque, La Politique). Les régimes politiques, la démocratie, la cité idéale
ou le "bien-vivre ensemble" sont au cœur de leur réflexion. La sociologie, comme toutes les sciences
humaines et sociales, est issue de la philosophie. Il y a des auteurs dont elle revendique explicitement
l’héritage comme Machiavel (Le Prince, 1516), Hobbes (Le Léviathan, 1651), Montesquieu (De
l’esprit des lois, 1748), ou encore Rousseau (Du contrat social, 1762).
Montesquieu proposait de découvrir les lois qui régissent les êtres car tous les « êtres » ont leurs
propres lois, qu’il s’agisse de Dieu, du monde, des bêtes ou des hommes. Il veut décrire « ce qui est »,
et non « ce qui devrait être ». L’église catholique condamnera cette conception attribuant un certain
pouvoir à la raison humaine, le livre de Montesquieu aura néanmoins du succès. L’idée de « contrat
social » n’en était pas moins révolutionnaire ; elle s’est imposée peu à peu entre le XVI
ème
siècle et le
XVIII
ème
siècle. Elle a fait l’objet de diverses interprétations sur la nature humaine et les raisons de
justifier l’intervention de l’Etat dans les relations entre les hommes. Pour Hobbes, « l’homme est un
loup pour l’homme », et il faut que l’Etat puisse garantir la sécurité de chacun ; pour Rousseau,
l’homme est naturellement bon mais ce sont les inégalités sociales qui causent les problèmes et qui
nécessitent des lois.
L’objectif de connaître méthodiquement et « logiquement » la société résulte de l’idée que la raison
humaine est le moteur essentiel du progrès humain, idée qui s’impose au XVIII
ème
siècle. Au XIX
ème
siècle, le projet de construire une « science » de la société va prendre corps. Selon les pays, la
sociologie en tant que discipline académique naîtra à la fin du siècle (Etats-Unis) ou au tout début du
XX
ème
siècle (France, Allemagne). En France, elle sera marquée par un double héritage ; d’une part les
enquêtes sociales et le souci d’analyser le « réel » et d’autre part, « la question sociale », soit la
question de la misère ouvrière et des inégalités sociales.
1) Une science pour connaître par l’observation directe
Au XIX
ème
, avec l’essor industriel, les premières grandes enquêtes systématiques effectuées pour
décrire « la condition ouvrière » et la pauvreté apparaissent. L’étude sociologique du travail leur doit
beaucoup, comme l’économie, le droit, l’ergonomie. La pauvreté est un problème récurrent dans
l’histoire, mais ce n’est plus seulement une affaire de « charité chrétienne », cela devient une question
de gouvernement public qu’on désigne globalement sous l’expression de « la question sociale ». La
Révolution française a proclamé l’égalité et le droit au travail et pourtant la situation des classes
ouvrières urbaines aux débuts de la révolution industrielle en France (1820-1840) est préoccupante,
des révoltes commencent à éclater (les canuts à Lyon en 1830). La « question sociale » assimile la
thématique du travail à celle de la « misère morale et matérielle » des ouvriers. Mais pour que les
pouvoirs publics puissent agir, il faut qu’ils aient une meilleure connaissance des réalités.
a) Louis Villermé
En 1829, les « Annales d’hygiène publique et de médecine légale » alertent les médecins sur leur
rôle dans « le dialogue singulier avec les malades » et dans « l’organisation sociale et les maux

4
sociaux ». En 1832, l’académie des sciences morales et politiques est créée. Deux ans plus tard, elle
sollicite une réflexion sur « la misère » (sa nature, ses signes, ses causes) ; c’est dans ce cadre qu’une
étude sera commandée à Louis Villermé (1762-1863). C’est un médecin, membre de l’académie, que
l’on rattache au courant du « catholicisme social » de l’époque qui marqua durablement une partie du
patronat français.
L’enquête de Villermé, « Tableau de l’état physique et moral des ouvriers employés dans les
manufactures de coton » (1840) dénonce la misère et les conditions de vie ouvrières. Son objectif était
d’établir un « tableau », une « représentation fidèle » des situations de travail et de vie des ouvriers.
Pour cela il fera une enquête exhaustive, il ira parler avec des ouvriers et observer leur travail dans les
ateliers de fabrication. Il ira même jusqu’à décrire par le détail les opérations de travail selon le type de
métier à tisser, remarquant que les femmes sont plus souvent postées devant des métiers mécaniques,
les métiers traditionnels « à bras » demandant plus de force physique (TS93). Ses travaux vont inspirer
la première loi sociale réglementant le travail, la loi de 1841 relative au travail des enfants : pas
d’embauche avant l’âge de huit ans et pas plus de huit heures de travail par jour jusqu’à l’âge de douze
ans ; entre douze et seize ans, pas plus de douze heures par jour entrecoupées de repos.
Les médecins ne sont pas les seuls à se préoccuper de la condition ouvrière, certains ingénieurs
polytechniciens, comme Frédéric Le Play (1806-1882), vont aussi contribuer à la connaissance de la
situation des ouvriers.
b) Frédéric Le Play
Frédéric Le Play était ingénieur des mines. Il est aussi rattaché au courant du « catholicisme social » et
en général, on le présente comme un « traditionaliste réformateur ». Avant 1848, il a été proche de
Saint-Simon et connaît Fourier ; il se dit lui-même « franchement socialiste », opposant farouche au
socialisme collectiviste. Il veut contribuer à la recherche d’une organisation du travail favorable aux
classes « souffrantes » en aidant à structurer des « institutions » qui présideraient à l’organisation du
travail. Il milite pour que « les droits des propriétaires des terres et des capitaux » ne soient pas
inconciliables avec « la protection dont la classe ouvrière ne saurait se passer ». Après 1848, il semble
qu’il ait relégué ce socialisme au profit du christianisme et d’une position plus « traditionaliste ». Il
deviendra conseiller d'Etat puis sénateur sous Napoléon III. Le Play oppose l’action volontaire des
patrons à l’intervention de l’Etat et c’est au nom du principe de « patronage » qu’il refusera l’idée de
fixer légalement un minimum de salaire. Il privilégie les liens sociaux traditionnels (famille, église,
métier) sur les liens contractuels et préconise de renforcer les structures familiales en tant que
structures sociales de base.
L’objectif de Le Play était de créer une science d’observation directe au service d’une « philosophie
positive » afin de trouver la relation entre condition de vie ouvrière et institutions présidant à
l’organisation du travail. Après 1848, il conservera son souci de la description détaillée de formes
d’organisations économiques et sociales, mais il expliquera finalement les différences par la
prévoyance/imprévoyance des familles et par la nature des engagements qui lient les ouvriers aux
« maîtres » (forcé, volontaire permanent ou momentané)
1
. La méthode leplaysienne d'étude des
familles dans les milieux ouvriers est basée sur des enquêtes directes et des séries de « monographies »
regroupées dans « Les ouvriers européens » (1855) et « Les ouvriers des deux mondes » (1857-1885).
Le Play a expérimenté l’usage et la fabrication de statistiques sur l’industrie (de 1834 à 1847) mais il
en a conclu que ce procédé d’investigation est moins approprié à une « science concrète » que la
monographie. La monographie, à l’interface des conditions économiques, géographiques et
sociales, répond à la diversité des procédés industriels ; elle fait entrer la réalité sociale dans le champ
de l’étude scientifique, elle décrit les conditions sociales dans lesquelles vivent les ouvriers en se
basant sur l’analyse des budgets des familles ouvrières.
1
Françoise Arnault, « Frédéric Le Play. De la métallurgie à la science sociale », Presses Universitaires de Nancy, 1993.

5
Le Play définit la monographie, comme « l’étude d’un groupement social localisé sous ses différents
aspects » (famille, village, atelier, ville …). Pour établir la monographie d’un charpentier parisien,
d’un paysan des Hautes Pyrénées ou encore d’un mineur d’or en Californie, les enquêteurs ont une
série invariable de questions à poser :
Quel travail effectuez-vous et comment ? Quelles sont vos habitudes ? Quels sont vos revenus et
comment les dépensez-vous ? Comment êtes-vous logé ? Meublé ? Quels sont les livres de votre
bibliothèque ? Comment vous nourrissez-vous ? Quelles sont vos distractions ? Vos aspirations ?
Dans chaque monographie, les données récoltées sont présentées selon un plan standard en 4 parties :
1) Définition du lieu, de l’organisation industrielle de la famille : Etat du sol de l’industrie et de la
population (dans la commune d’habitation de la famille) ; état civil de la famille (nombre de
personnes, liens de parenté, âge) ; religion et habitudes morales (fréquentation de l’église, amour du
travail, disposition à l’épargne …) ; hygiène et service de santé (maladies) ; rang de la famille
(ouvrier- propriétaire, journalier-agriculteur, compagnon …).
2) Moyens d’existence de la famille : Propriétés (immeuble, argent, animaux, outils et machines) ;
subventions (glanage divers, libéralités du patron, instruction gratuite des enfants …) ; travaux et
industries (travail principal et secondaire du père, de la mère, travail des enfants, industrie familiale
comme un jardin ou un poulailler).
3) Mode d’existence de la famille : Aliments et repas (nombre de repas quotidiens et composition,
modes de cuisson, consommation d’alcool) ; habitation, mobilier, vêtements (inventaires exhaustifs) ;
récréations (loisirs ou plaisirs).
4) Histoire de la famille : Phases principales de l’existence (histoire de la trajectoire de vie du père et
de la mère, histoire de leur famille) ; mœurs et institutions assurant le bien-être physique et moral de la
famille (l’avenir de la famille, son épargne et les institutions de prévoyance auxquelles elle peut avoir
accès)
2
.
Le Play est l’un des principaux précurseurs d’une « science sociale » empirique. C’est l’observation
qui différencie à ses yeux la science des doctrines non scientifiques, doctrines qui donnent lieu à
d’interminables débats et ne trouvent pas à s’appliquer. Comme les sciences de la nature, la
connaissance sociale doit se baser sur l’observation. Les « faits » peuvent se saisir avec des procédés
moins précis qu’en physique, par contre ils doivent être appréciés d’après des règles morales. Il n’y a
pas de science sociale sans morale. Ces règles morales sont celles qui sont reconnues dans tous les
« peuples civilisés » et on les repère à partir d’indices « généralement acceptés » (ex : le respect et le
soin donné aux vieillards est un indice de bien-être de la famille).
L’action du gouvernement doit procéder par réformes successives et non par révolution, puisque les
problèmes sociaux considérés comme problèmes scientifiques ne peuvent se résoudre que
progressivement. De plus, « l’harmonie sociale demande que les classes dirigeantes soient aussi des
classes éclairées », donc que les patrons deviennent savants, d’où la création de la Société d’économie
sociale, fondée par Le Play en 1856. Outre la création de la Société d’économie sociale, Le Play
fondera aussi un mouvement politique (les « Unions pour la paix » en 1874) et une revue (« La
Réforme sociale » en 1881) ; il aura une grande influence sur les propagandistes de l’organisation du
travail de la fin du XIX
ième
et du début du XX
ième
siècle.
Ces enquêtes ont contribué au vote de lois sociales et à la création d’institution publique pour étudier
les situations sociales et plus particulièrement la condition ouvrière, de la même façon que le tableau
de Villermé a suscité des débats et le vote de la première loi sociale sur la durée du travail des enfants
en 1841. Marx et Engels ont puisé dans son enquête pour conduire leur propre réflexion sur la
révolution industrielle. Les études de Le Play restent marquées par une conception du monde ouvrier
centrée sur les métiers tels qu’ils se sont structurés dans le système féodal, conception qui inspirera
aussi l’action du régime de Vichy en matière de travail.
2
« Ouvriers des deux mondes », Recueil d’études publiées par la Société d’Economie Sociale sous la direction de Frédéric Le
Play à partir de 1856, A l’enseigne verdoyante éditeur, 1983, diffusion Armand Colin, 336 pages.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
1
/
83
100%