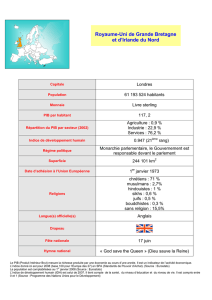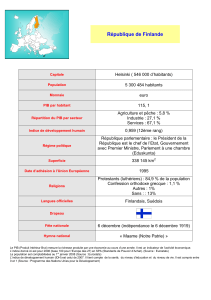Année scolaire 2012-2013 ÉPREUVE COMPOSÉE

Année scolaire 2012-2013 ÉPREUVE COMPOSÉE CORRIGE
Partie 1 : Mobilisation des connaissances
Question 1 (3 points) : Comment un déficit public se creuse-t-il en période de récession ?
Déficit public : déficit budgétaire + déficit sécurité sociale.
Récession : Ralentissement économique qui prend la forme d'une diminution du PIB ou de sa quasi-stagnation
(ex : 2009). Une récession provoque une hausse du chômage.
L’effet du stabilisateur automatique : le déficit budgétaire et public lié à un pic de récession se creuse
mécaniquement, les dépenses progressent (ex : les dépenses sociales liées à la hausse du chômage) mais surtout
les recettes diminuent (ex : les impôts rentrent moins biens dans les caisses, notamment ceux qui dépendent de
l’activité économique comme IR ou IS). Cependant l’accroissement du déficit vient soutenir la demande
défaillante et exerce un effet contracyclique.
L’effet des politiques de relance : La relance vise à rétablir l'expansion et le plein emploi en accroissant la
demande globale, principalement au moyen de la politique budgétaire. Keynes propose que l'Etat finance une
politique d'investissements publics autonome (Ex : grands travaux) par des dépenses budgétaires
supplémentaires qui accroissent le déficit.
Ces dépenses doivent engendrer une hausse plus importante de la production et des revenus grâce à l'effet
multiplicateur.
Question 2 (3 points) : En matière de développement durable, quelle différence fait-on entre soutenabilité forte et
soutenabilité faible ?
Le développement durable (ou soutenable) qualifie un développement permettant de répondre aux besoins des
générations présentes sans compromettre les besoins des générations futures.
Pour les partisans de la soutenabilité faible, il s’agit de transmettre aux générations futures le même stock de
capital global composé de 4 sortes de capitaux substituables, dont le capital naturel. Conséquence, le capital
naturel peut être substitué à d’autres formes de capital (humain, social, technique qui incorpore de nouvelle
technologie) . Dans ce cas c’est à l’Etat (capital institutionnel) de favoriser la substitution entre les différents
types de capitaux, par exemple en soutenant les changements technologiques qui économisent la nature ou en
éduquant les individus au DD.
En revanche pour les partisans de la soutenabilité forte les effets de substitution entre capitaux sont nuls ou
marginaux et le capital naturel est complémentaire des autres car :
les ressources naturelles sont irremplaçables et il convient de léguer aux générations futures un
environnement préservé.
Il existe un effet rebond (paradoxe de Jevons), qui annule les effets de substituions liés au capital.
Conséquence, Les mesures en faveur du DD restent insuffisantes par rapport à l’enjeu… En fait c’est la société de
croissance qui n’est ni souhaitable ni soutenable ! Ils préconisent donc plutôt la croissance zéro, voir la
décroissance des activités qui utilisent les ressources naturelles et la croissance de celle qui incorpore une forte
utilité sociale…
Partie 2 : Étude d'un document
Question (4 points) : Vous présenterez ce document puis montrerez que nous sommes passés des 30 glorieuses aux
30 piteuses.
Ce document « Évolution annuelle du PIB déflaté des États-Unis et de la France » d'Olivier Berruyer et publié
en 2011 est un diagramme en bâtons mesurant pour chaque année (de 1960 à 2010 en abscisse) le taux de
croissance en % du PIB aux ÉU et en France. À cela est ajouté, une courbe représentant la moyenne décennale du
taux de croissance pour chacun des deux pays. Les données sont issues des travaux de l'Insee.
Le PIB est l'indicateur qui mesure la production de richesses monétaires au cours d'une période et sur un
territoire (somme des valeurs ajoutées).

Déflaté signifie que l'évolution des prix (évolution de la valeur d'ue monnaie) a été déduite de l'évolution du PIB
=> PIB en volume ou PIB réel.
On constate que la croissance économique (au sens de Perroux) francaise et dans une moindre mesure
étasunienne connait deux périodes :
Une période de forte croisance de 1960 à 1980 ou le TCAM du PIB est élevé : la croissance francaise est de 6% en
moyenne par an dans la décénie 60, et encore de 4% en moyenne par an dans la décenie 70. Notons qu’aux EU
cette croissance est moins forte, respectivement de 3% puis 2% en moyenne par an.
Les cycles de croissance sont plus élevé sur la période : par exemple en France de 1962 à 1965, l’accélération de
la croissance est de 1 point (phase A du cycle : expansion), l’ augmentation du PIB passe de 5% environ à plus de
6% alors que de 1965 à 1968 le ralentissement de la croissance est de presque 2 points (phase B du cycle :
récesssion) , la hausse du PIB passe de 6% à un peu plus de 4%.
Cette période est appellée « 30 glorieuses » cad les 30 années de croissance forte d’après guerre,
particulièrement en France.
Une période de faible croissance de 1980 à 2010 où le TCAM du PIB est relativment faible : ainsi la croissance
francaise passe à 2.5% en moyenne par an sur la décénie 80, puis à 2% en moyenne par an sur la décenie 90 et
même à 1.5% en moyenne par anseulement sur la décénie 2000. Aux EU cette croissance anuelle moyenne reste
à 2% durant les décénies 80 et 90 et tombe à 1% environ durant la décenie 2000.
Les cycles de croissance sont moins élevé sur cette période. Par exemple en France de 1996 à 2000, la
croissance s’accélère, elle passe de 1% environ à presque 4% (2 points de moins que dans le cycle 62-68) alors
que de 2000 à 2003 la croissance ralentit, elle passe de 4% à 1% environ (également 2 points de moins que dans
le cycle 62-68).
Des pics de recession apparaissent même à partir de 1975 (-1%) qui marque la rupture dans le rythme de
croissance à long terme : Il en est ainsi en France en 1991 (-1.5%) ou encore en 2009 (-3%).
Cette période est appellée « 30 piteuses », cad 30 année de croissance faible depuis les années 80.
Attention : le passage des 30 glorieuses aux 30 piteuses, marqué par la diminution de la hauteur des cycles, et la
diminution de la croissances économique moyenne décénales est moins significatif pour les EU que pour la France.
Partie 3 : Raisonnement s'appuyant sur un dossier documentaire
Sujet (10 points) : A l’aide du dossier documentaire et de vos connaissances, vous montrerez que le PIB ne peut être
considéré comme une mesure adéquate du bien-être.
INTRODUCTION
Si l’on regarde l’impact des effets de la pollution sur le PIB, plus on pollue plus on est riche ! En effet, la
dégradation de la santé liée à la pollution, la dépollution elle-même contribue à faire croitre l’activité
économique…
Donc le PIB mesure mal le bien-être, et l’augmentation du PIB/ha, qui mesure l’augmentation du niveau de vie,
mesure mal la hausse du bien-être, le mieux vivre.
PIB : agrégat qui mesure la création de richesses dans une économie, il est égale à la sommes des VA
Bien être (collectif) : bien vivre, qualité de vie, bonheur d’une population. On peut le mesurer de manière
subjective par la satisfaction d’une population par rapport à ces conditions de vie.
Cf : indice de vivre mieux, doc 2
Le PIB prend très mal en compte de la dimension humaine et environnementale du bien-être.
I – LE PIB PREND TRES MAL EN COMPTE LA DIMENSION HUMAINE DU BIEN ETRE
A - Le PIB ne mesure pas « la vie bonne »
Le PIB mesure les richesses matérielles crée à partir d’un travail rémunérée. C’est un indicateur quantitatif qui
permet de mesurer le niveau de vie mais pas la qualité de vie, « la vie bonne ».
Donc la croissance ne contribue pas nécessairement à l’amélioration du bien-être :
en ne prenant pas en compte la dimension humaine et environnementale du développement : temps libre,

travail domestique et bénévolat, santé, éducation.
en générant des aspects négatifs, le mal développement : inégalités, chômage, insécurité.
Illustration : Doc1
B - Le paradoxe d’Easterlin
Selon le paradoxe d’Easterlin, le bonheur individuel est subjectif et n’augmente avec le revenu par tête que
jusqu’à un certain seuil.
Illustration, Doc 2 : Corrélation entre l’Indice de « vivre mieux » et le PIB/ha jusqu’à 15 000$ environ
(Turquie/Pologne), puis plus de corrélation nette : comparaison Etats-Unis/Danemark (ou même Canada Suède)
C - L’IDH mesure le développement humain
L'IDH a été construit en 1991 par le PNUD et se veut être une mesure du développement humain, au sens où les
besoins fondamentaux seraient couverts.
L’IDH prend en compte les richesses matérielles mesurées par le RNB/ha (dérivée du PIB/Ha)… mais pas
seulement. Il tient compte de dimension plus qualitative du bien-être tel le niveau de santé et d’instruction d’une
population.
II - LE PIB PREND TRES MAL EN COMPTE DE LA DIMENSION ENVIRONNEMENTALE DU BIEN ETRE
A -La comptabilité nationale ne prend pas en compte l'évolution du « capital naturel »
Le PIB compte positivement les ponctions des ressources naturelles non reproductibles car c’est une comptabilité
de flux en non de stock. Exple : extraction du pétrole, des métaux….
Le PIB ne prend pas en compte les ponctions excessives des ressources naturelles reproductibles, ou leur
dégradation en raison de leur caractère de biens communs (rivalité et non excluabilité). Cela entraine une
érosion de la biodiversité. Ex : Surpêche.
B - Les dégâts liés à la pollution sont mal pris en compte…
Les dégâts liés à la pollution ne sont pas prise en compte dans le PIB et les dépenses de protection de la nature
qui y sont liées sont aussi enregistrées positivement ! La pollution représente ainsi une externalité négative.
Illustration, Doc 3: La dégradation des biens communs tel l’air, la terre ou encore l’eau, liée à des catastrophes
industrielles n’est pas prise en compte dans le calcul du PIB, ou alors positivement quand on répare les dégâts :
reconstruction et dépollution des sites, soins aux personnes atteintes par les pollutions. De ce point de vue les
catastrophes industrielles contribuent à la croissance économique… mais pas au bien être !
C - Le PIB vert tente d’inclure la problématique environnementale
De nouveaux indicateurs agrégés tentent d’intégrer les préoccupations sociales et écologiques aux indicateurs
économiques.
Le PIB "vert" ou « Indice de Progrès Véritable » (IPV) a été élaboré aux E.U et cherche à ajouter les valeurs
estimées de certains facteurs de bien-être et retrancher les coûts estimés des principaux dommages sociaux et
écologiques associés à notre mode de croissance.
CONCLUSION
Le PIB ne peux pas être considérer comme une mesure adéquate du bien-être. Ainsi, de nouveaux indicateurs
permettent de mieux prendre en compte la dimension humaine et environnementale du bien vivre.
Cependant notre modèle de croissance est-il compatible avec un développement durable ?
PLAN ALTERNATIF :
I – Le PIB ne prend pas en compte un grand nombre d’échange non marchand qui contribuent au bien être
II – Le PIB prend en compte des dimensions négatives de la croissance qui réduisent le bien-être.
1
/
3
100%