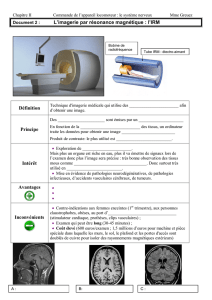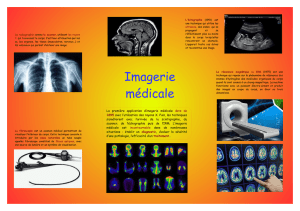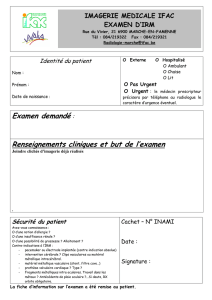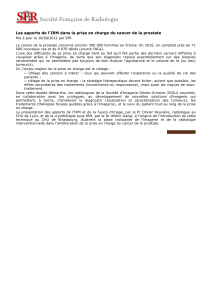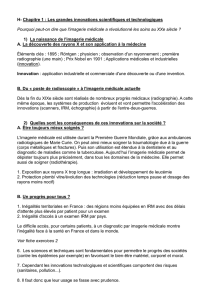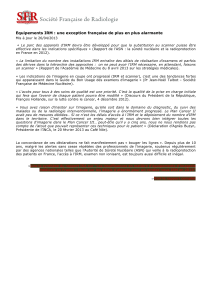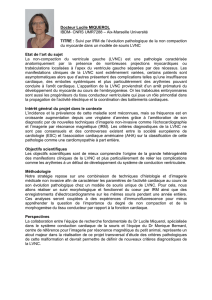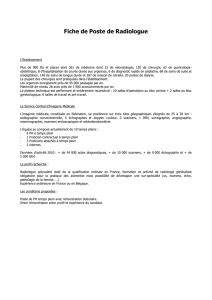IMAGERIE DES URGENCES EN NEURO

J. Neuroradiol.
, 2004,
31
, 291-300
© Masson, Paris, 2004
Monographie
IMAGERIE DES URGENCES
EN NEURO-OPHTALMOLOGIE
F. HERAN
(1)
, M. SCHAISON-CUSIN
(2)
, M. WILLIAMS
(1)
, J.D. PIEKARSKI
(1)
(1) Service d’Imagerie, Fondation A. de Rothschild, 25 rue Manin, 75019 Paris.
(2) Neuro-ophtalmologiste, Fondation A. de Rothschild, , 25 rue Manin, 75019 Paris.
R
ÉSUMÉ
L’imagerie par résonance magnétique (IRM) permet le diagnostic de la plupart des troubles visuels (baisse de la vision,
anomalies du champ visuel) et de l’oculomotricité. Elle est réalisée en urgence dans certains cas : diplopie douloureuse avec
mydriase, évocatrice d’anévrisme symptomatique comprimant le III, syndrome de Claude Bernard-Horner douloureux, très
évocateur d’une dissection carotidienne. Le scanner en urgence garde quelques indications : baisse de l’acuité visuelle post
traumatique, hémianopsie latérale homonyme d’apparition brutale. Certains troubles, à symptomatologie insidieuse, néces-
sitent également une imagerie en urgence, en raison de leurs implications thérapeutiques : il s’agit des cécités monoculaires
transitoires (dissection ou sténose carotidienne), des baisses visuelles progressives, (compression du nerf optique), des baisses
douloureuses de l’acuité visuelle (névrite optique), des hémianopsies bitemporales (lésion chiasmatique).
La précision de la demande clinique permet le choix de la modalité et du protocole d’imagerie et en améliore la valeur
diagnostique.
Mots-clés :
IRM, neuro-ophtalmologie, trouble visuel, oculomotricité, urgence.
S
UMMARY
Imaging of neuro-ophthalmological emergencies
MRI often is mandatory in the diagnostic work-up of visual loss, visual field alterations and oculomotor problems. It is
performed emergently in patients with painful diplopia associated to mydriasis, to exclude aneurysm, or in patients with painful
Horner syndrome to exclude dissection of the internal carotid artery. CT scan in emergency remains useful in case of acute
lateral hemianopsia or acute post traumatic visual loss. Progressive neuro-ophthalmological symptoms may require imaging
examination in a short delay to define the therapeutic strategy: monocular transient blindness (dissection or carotid stenosis),
progressive visual loss (optic nerve compression), bitemporal hemianopsia (optic chiasm lesion), painful visual loss (optic
neuritis). A very precise clinical indication is helpful for the choice of imaging protocol and to improve its diagnosis value.
Key words:
MR, neuro-ophthalmology, visual impairment, oculomotricity, emergency.
INTRODUCTION
L’imagerie, largement dominée par l’IRM, joue
un rôle essentiel dans le diagnostic de la plupart des
affections neuro-ophtalmologiques. Le tableau cli-
nique va orienter le type d’examen d’imagerie et son
degré d’urgence. Les situations cliniques nécessitant
une imagerie en urgence sont rares. En revanche, de
nombreuses pathologies, en l’absence de prise en
charge thérapeutique rapide, peuvent entraîner des
séquelles graves. Elles justifient la réalisation rapide
d’une imagerie devant certains troubles d’apparition
progressive. C’est typiquement le cas des baisses de
l’acuité visuelle progressives négligées. A l’inverse,
certains tableaux cliniques très inquiétants ne néces-
sitent pas d’imagerie en urgence, mais une prise en
charge thérapeutique d’emblée. Les baisses brutales
de l’acuité visuelle révélant une maladie de Horton
en sont un exemple.
La conduite à tenir devant les pathologies neuro-
ophtalmologiques rencontrées en pratique courante
est proposée suivant un plan pratique, fondé sur la
présentation clinique habituelle du patient et séparé
en deux chapitres distincts : les atteintes visuelles, et
les troubles de l’oculomotricité [11].
LES ATTEINTES VISUELLES
Une baisse de l’acuité visuelle et un déficit du
champ visuel sont les deux symptômes cliniques
révélateurs d’une atteinte des voies optiques. Ils
peuvent être unis ou bilatéraux, isolés ou associés.
À partir de la rétine, les voies optiques s’orga-
nisent autour de deux systèmes. L’un, central,
maculaire, assure la discrimination visuelle. L’autre,
périphérique, gère la perception de l’espace. De la
rétine au cortex occipital, les neurones visuels sont
groupés de telle sorte que l’on retrouve à chaque
niveau anatomique un agencement des fibres si
précis que devant une symptomatologie visuelle
ou campimétrique, il est théoriquement possible
d’affirmer la topographie lésionnelle.
Baisse de l’acuité visuelle (BAV)
Une BAV est liée soit à une lésion maculaire, soit
à une atteinte du contingent maculaire à l’intérieur des
voies rétino-corticales optiques. C’est l’ophtalmolo-
giste qui élimine les causes oculaires de BAV (cata-
racte, iritis, maculopathie). Une BAV doit être
analysée par l’ophtalmologiste, en monoculaire après
correction optique optimale, de loin et de près. De
loin, elle est notée habituellement en dixièmes au
moyen d’échelles de lettres, de chiffres. De près, elle
Tirés à part :
F. H
ÉRAN
, à l’adresse ci-dessus.
e-mail : [email protected]
© 2017 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 20/04/2017 Il est interdit et illégal de diffuser ce document.

292
F. HERAN et al.
est chiffrée en fonction du score de lecture, le plus sou-
vent au moyen de l’échelle de Parinaud (P2, P3, P4…).
BAV unilatérale
Plusieurs tableaux cliniques sont rencontrés, ils
vont orienter le choix de l’imagerie, son urgence et
la prise en charge thérapeutique.
Dans un contexte traumatique
[16], la BAV peut
être immédiate, liée à une lésion directe du nerf
optique : compression ou embrochement du nerf par
une esquille osseuse, étirement voire section du nerf.
La BAV peut être retardée : œdème post trauma-
tique du nerf optique, constitution d’un hématome
des gaines du nerf. Un scanner orbitaire sans injec-
tion, avec des coupes en haute résolution, doit être
réalisé en urgence (idéalement dans les 3 heures) à
la recherche d’une fracture orbitaire, et en particu-
lier de fragments osseux lésant le nerf optique.
L’IRM peut mettre en évidence un hématome des
gaines du nerf optique, soupçonné sur le scanner,
traduisant une contusion. On peut également obser-
ver un hypersignal en T2 du nerf optique, témoi-
gnant de sa souffrance (contusion directe, œdème).
La récupération est très variable. Le traitement, ana-
logue à celui des contusions médullaires, repose sur
les corticoïdes à fortes doses en cas de contusion, et
sur une éventuelle décompression chirurgicale.
Une cécité monoculaire transitoire (CMT)
est une
BAV d’installation rapide, en quelques secondes,
aboutissant à une cécité totale. Elle est indolore, tran-
sitoire, dure moins d’une heure dans l’immense majo-
rité des cas [1]. Elle peut se répéter toujours du même
côté avec un rythme variable, plusieurs fois par
semaine ou par jour. La CMT a souvent un déclen-
chement positionnel très évocateur de son origine
hémodynamique. Elle est due à une ischémie brutale
temporaire du globe, et son caractère totalement
réversible et de courte durée la rapproche des acci-
dents ischémiques transitoires cérébraux. Elle peut
toucher l’artère centrale de la rétine (ACR), l’artère
ophtalmique ou les artères ciliaires courtes. Elle est
liée, dans la grande majorité des cas, à une sténose
serrée de l’artère carotide homolatérale à l’origine
d’embols fibrino-cruoriques ou d’une baisse du flux
sanguin en aval de la sténose. Le bilan doit être réa-
lisé en urgence et recherchera une surcharge athéro-
mateuse de l’artère carotide ou une dissection chez le
sujet jeune. En outre, le bilan d’imagerie (IRM, Echo-
doppler) appréciera le retentissement cérébral de la
CMT. L’examen ophtalmologique peut retrouver des
signes directs d’atteinte vasculaire au fond d’œil
(embolie, occlusion d’une branche de l’ACR). L’exa-
men neurologique recherche des signes en faveur
d’une ischémie dans un autre territoire. Le traitement
dépend essentiellement du degré de sténose. Une sté-
nose serrée de l’artère carotide (supérieure à 70 %)
est le plus souvent traitée chirurgicalement.
Les autres causes de CMT sont plus rares :
—La maladie de Horton est révélée par une
CMT dans 15 à 20 % des cas, ce qui justifie la
mesure systématique de la vitesse de sédimentation
(VS) et de la C-reactive protein (CRP) après 55 ans.
Toute élévation de l’une et/ou de l’autre impose la
mise sous corticoïdes sans attendre l’imagerie ;
—Les emboles d’origine cardiaque nécessitent la
réalisation d’une échographie trans-œsophagienne ;
—Les troubles de l’hémostase (syndrome des
anti-phospho-lipides ou APL…) peuvent se compli-
quer de CMT.
Cas particuliers :
—Une CMT associée à une baisse visuelle lente-
ment progressive évoque une rétinopathie de stase
veineuse (rétinopathie de bas débit). Elle doit faire
rechercher dans des délais rapides une sténose très
serrée de l’artère carotide et en particulier une mala-
die de Takayashu ;
—Une BAV temporaire déclenchée par la fatigue,
un bain chaud ou un effort physique, durant de
quelques minutes à quelques heures (signe d’Uthoff)
est le plus souvent contemporaine ou séquellaire
d’une névrite optique dans le cadre d’une sclérose en
plaques. Elle ne nécessite pas d’imagerie en urgence.
Une BAV isolée, indolore et surtout progressive
évoque avant tout une compression du nerf optique
ou une lésion expansive du nerf ou de ses gaines.
Elle nécessite la réalisation rapide d’une imagerie,
même si les symptômes décrits sont anciens. Elle est
associée à un trouble variable du champ visuel (sco-
tome central, encoche périphérique perçue comme
un voile par le patient) [4, 25, 27, 30]. L’IRM est plus
performante que le scanner pour apprécier la topo-
graphie de la lésion par rapport au nerf et pour étu-
dier le retentissement de cette compression, sur le
nerf lui-même (prise de contraste, atrophie, hyper-
signal T2), mais aussi à distance (atrophie par dégé-
nérescence de type Wallérienne). L’aspect du nerf
optique est un facteur important pour la program-
mation (en urgence ou non) du geste thérapeutique.
Les pathologies responsables de ce tableau sont
nombreuses :
—Atteinte du nerf optique (un gros nerf optique
doit faire évoquer de principe une inflammation et
en particulier une sarcoïdose, plus qu’un gliome,
exceptionnel en dehors d’un contexte de neurofibro-
matose) ou des gaines méningées (méningiome,
infiltration néoplasique) ;
—Compression extrinsèque du nerf optique en
particulier dans son segment intracrânien et intracana-
laire (méningiome, anévrysme géant, volumineuse
tumeur sellaire à prolongement antérieur)
(figure 1a
et
1b)
. Tout son trajet doit être étudié, de la papille au
chiasma. Les processus expansifs orbitaires ne provo-
quent habituellement pas de baisse visuelle, sauf s’ils
sont très volumineux, mais plus volontiers une exoph-
talmie. En revanche, les lésions mêmes petites de
l’apex orbitaire peuvent être responsables de troubles
majeurs et doivent être recherchées avec soin. Souvent,
dans cette éventualité il sera utile de compéter l’IRM
par un scanner en haute résolution centrée sur les apex
orbitaires pour détecter une sténose du canal optique
liée à une anomalie osseuse (dysplasie, lésion lytique
minime) ou préciser l’origine d’une masse (mucocèle).
Une BAV d’installation rapide, évolutive, doulou-
reuse
, (douleur en particulier à la mobilisation du
globe) [21, 28] évoque, chez une femme jeune, une
névrite optique dans le cadre d’une maladie démyélini-
sante. La baisse visuelle s’installe en quelques heures à
quelques jours. Elle est d’intensité variable, allant d’un
voile unilatéral à une cécité complète. La papille est le
plus souvent normale, parfois pâle (séquelle d’un
épisode identique) ou œdémateuse. La récupération
clinique est la règle dans 80 % des cas, et commence
© 2017 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 20/04/2017 Il est interdit et illégal de diffuser ce document.

IMAGERIE DES URGENCES EN NEURO-OPHTALMOLOGIE
293
dès le huitième jour. La douleur est due à la diffusion
de l’inflammation du nerf optique à la zone d’insertion
postérieure des muscles oculomoteurs. L’examen du
champ visuel retrouve généralement un scotome cen-
tral.
L’IRM apporte des arguments pour le diagnostic en
montrant une zone d’hypersignal T2 sur le nerf optique.
Si l’examen est fait précocement (avant le 15
e
jour)
et
avant tout traitement anti-inflammatoire, les coupes
centrées sur les voies visuelles antérieures en TI avec
injection et suppression de graisse (essentielle dans les
lésions orbitaires) montrent une prise de contraste de
la lésion
(figures 2a et 2b)
. Celle-ci peut très rarement
précéder l’hypersignal T2, en particulier lorsque l’IRM
est faite très tôt (2 à 3 jours après l’apparition de la
baisse visuelle). L’injection est donc indispensable dans
toute suspicion de névrite optique aiguë. L’IRM per-
met d’éliminer d’autres causes, en particulier une
lésion expansive située à l’apex orbitaire, entraînant
FIG. 1. – Baisse progressive, fluctuante de l’acuité visuelle de l’œil droit chez une femme de 45 ans. (a) scanner coupe axiale en
haute résolution. (b) IRM T1 axial après injection de gadolinium et suppression de graisse. Lésion expansive détruisant l’os et
comprimant le nerf optique droit à l’apex orbitaire. Méningiome.
FIG. 1. – Progressive visual loss of the right eye in a 45-year-old woman. (a) High resolution CT scan and (b) enhanced axial T1-
weighted MR images with fat suppression. Enhancing lesion (arrow) with destruction of the bone and mass effect on the optic nerve.
Meningioma.
FIG. 2. – Jeune femme de 22 ans. Survenue il y a 5 jours d’une baisse de l’acuité visuelle gauche sur 24 heures, avec impression
de voile blanc devant l’œil. Douleurs à la mobilisation du globe. (a) IRM orbitaire coupe coronale en T2. (b) coupe coronale en
T1 avec injection et suppression de graisse : névrite optique typique : augmentation de volume, prise de contraste et hyper signal
T2 du nerf optique gauche (flèches).
FIG. 2. – 22-year-old woman presenting with a five day history of rapid onset of left visual loss and pain during eye movements.
(a) MRI of the orbit, coronal plane. (b) T2-weighted images and enhanced T1-weighted images with fat suppression. Typical optic
neuritis (arrow): the optic nerve is enlarged, T2W hyperintense, and enhances.
ab
ab
© 2017 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 20/04/2017 Il est interdit et illégal de diffuser ce document.

294
F. HERAN et al.
une baisse visuelle souvent fluctuante. Elle permet de
débuter un traitement par bolus de corticoïdes dans les
névrites optiques.
Une BAV d’apparition brutale le plus souvent
constatée le matin au réveil
évoque une neuropathie
ischémique antérieure aiguë (NOIA) ou une occlusion
artérielle rétinienne. Malgré son caractère très bruyant,
ce tableau clinique n’est pas une urgence d’imagerie
[24]. Le champ visuel montre un déficit altitudinal, à
limites coupées au couteau, le plus souvent inférieur.
—La NOIA est un infarctus de la papille, lié à
l’occlusion des artères ciliaires courtes postérieures
qui vascularisent la tête du nerf optique. L’œdème
papillaire au fond d’œil est constant. Elle peut être
artéritique et doit faire évoquer une maladie de Hor-
ton. Ceci justifie la mesure systématique à partir de
55 ans de la VS et CRP et la mise en route en
urgence d’un traitement corticoïde si l’une et/ou
l’autre est élevée. La biopsie de l’artère temporale
sera faite ultérieurement. Elle peut être non artéri-
tique. Elle est favorisée par une conformation ana-
tomique particulière (petite papille pleine). Il n’y a
pas de traitement curatif d’efficacité prouvée.
L’urgence est de réduire le risque de bilatéralisation.
—
L’occlusion artérielle rétinienne intéresse l’artère
centrale de la rétine (OACR) ou ses branches, et com-
plique une sténose carotidienne dans 11 à 45 % des
cas. Très rarement, il s’agit d’une occlusion de
l’artère ophtalmique. Même si la situation est inquié-
tante, le diagnostic reste purement ophtalmologique,
et ne nécessite aucune exploration radiologique. La
thrombolyse in situ dans les premières heures est
proposée par certaines équipes.
BAV bilatérale
Une BAV progressive asymétrique associée à une
hémianopsie bitemporale
[8, 29] réalise un syndrome
chiasmatique. La lésion causale est le plus souvent une
compression extrinsèque, soit d’origine hypophysaire
(macro adénome), soit d’origine extra hypophysaire :
tumeur supra sellaire (crâniopharyngiome, ménin-
giome), anévrysme carotidien, tumeur du plancher
sellaire
(figure 3)
. Les atteintes chiasmatiques intrin-
sèques sont recherchées systématiquement par l’IRM :
inflammation (sclérose en plaques, sarcoïdose), tumeur
(exceptionnel gliome, essentiellement dans le cadre
d’une NF1, germinome), lésions rares (cavernome…).
L’IRM permet le plus souvent de faire le diagnostic
étiologique, complète le bilan (lésions de la substance
blanche…) et apprécie le retentissement de la lésion
sur le reste des voies optiques.
Une BAV douloureuse, d’installation rapide
doit
faire évoquer une forme rare de névrite optique
bilatérale. Elle se voit parfois dans les neuromyélites
optiques de Devic. Ces névrites optiques bilatérales
sont souvent très inflammatoires, et responsables
d’un œdème papillaire bilatéral. L’imagerie est réa-
lisée très rapidement, comme dans les suspicions de
névrite optique.
Une BAV d’apparition brutale chez un sujet âgé
évoque, en première hypothèse, une double patholo-
gie papillaire ischémique dans le cadre d’une mala-
die de Horton, et nécessite là encore la mesure de la
VS, de la CRP, voire la mise d’emblée sous cortico-
thérapie, avant toute imagerie.
La cécité corticale
est un trouble visuel rare asso-
ciant une cécité bilatérale complète à réflexe photo-
moteur conservé, une désorientation spatiale et des
hallucinations visuelles. Les patients ont souvent une
anosognosie et nient leur trouble. Elle est liée à des
lésions bioccipitales compliquant une intoxication au
monoxyde de carbone (CO), un traumatisme, une
tumeur, un AVC, un coma, une encéphalite. Elle
nécessite donc une imagerie encéphalique rapide
(scanner ou mieux IRM).
Les éclipses visuelles
sont des interruptions très
fugaces de la vision (1 à 2 secondes), en général bila-
térales. Elles ont généralement un caractère position-
nel et apparaissent lors des changements de position
de la tête. Elles sont toujours associées à un œdème
papillaire et sont une complication de l’hypertension
intracrânienne (HIC). Elles nécessitent une imagerie
en urgence (scanner ou mieux IRM).
Troubles du champ visuel (CV)
Le système visuel périphérique gère la perception
de l’espace ou champ visuel. Les voies optiques
peuvent être divisées sur le plan fonctionnel et ana-
tomique en trois régions :
—Nerf optique (préchiasmatique) ;
—Chiasma optique ;
—Voies visuelles rétrochiasmatiques (bandelettes,
corps géniculés, radiations optiques, cortex occipital).
Les lésions préchiasmatiques sont responsables
d’une atteinte monoculaire, et cliniquement d’une
baisse de l’acuité visuelle. Les lésions chiasmatiques
entraînent une perte bilatérale de la perception du
champ visuel latéral ou hémianopsie bitemporale
(HBT) et les lésions rétrochiasmatiques sont respon-
FIG. 3. – Patient de 32 ans. Hémianopsie bitemporale
d’apparition récente. IRM coupe coronale en T2. Volumi-
neuse lésion hypophysaire partiellement kystique comprimant
le chiasma. Hypersignal de la partie latérale gauche du
chiasma (flèche) traduisant sa souffrance.
FIG. 3. – Recent onset of bitemporal hemianopsia in a 32-year-
old man. MRI, coronal plane, T2-weighted images: large sellar
tumor with cystic component exerting mass effect on the optic chi-
asm. High signal intensity on the left side of the compressed optic
chiasm (arrow).
© 2017 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 20/04/2017 Il est interdit et illégal de diffuser ce document.

IMAGERIE DES URGENCES EN NEURO-OPHTALMOLOGIE
295
sables d’une perte de la vision dans le CV controlaté-
ral à la lésion ou hémianopsie latérale homonyme
(HLH) [12]. L’étude du trouble campimétrique se fait
manuellement (Goldman) ou de façon automatisée
(Humphrey). Un trouble du CV nécessite toujours la
réalisation d’une imagerie. S’il apparaît de façon bru-
tale, l’imagerie encéphalique, scanner ou IRM,
s’impose en urgence, à la recherche d’un accident vas-
culaire, d’un hématome, qui nécessitent une prise en
charge thérapeutique immédiate. L’apparition pro-
gressive de ce trouble est souvent en rapport avec un
processus expansif, justifiant une imagerie dans un
délai court (une semaine). La technique d’imagerie
varie selon le trouble, son mode d’installation.
Hémianopsie bitemporale (HBT)
L’imagerie à réaliser est d’abord une IRM car on
recherche une lésion chiasmatique. Que cette sympto-
matologie soit d’installation brutale ou progressive,
l’imagerie doit être réalisée rapidement. Les lésions
causales sont avant tout des macro-adénomes hypo-
physaires, plus fréquents chez les hommes que chez les
femmes. Ils peuvent être hémorragiques, de manière
volontiers aiguë (hyposignal T2 et hypersignal T1 intra-
lésionnels). Dans ce cas, même les petites lésions
peuvent être responsables d’une symptomatologie
aiguë parfois trompeuse orientant vers un tableau
d’hémorragie méningée. L’HBT s’accompagne volon-
tiers d’une baisse de l’acuité visuelle le plus souvent
asymétrique. Les méningiomes du jugum ou de la tente
de l’hypophyse surplombant une hypophyse normale
et les crâniopharyngiomes kystiques à développement
volontiers supérieur et postérieur, peuvent être égale-
ment responsables d’HBT.
Hémianopsie latérale homonyne (HLH)
La lésion est rétrochiasmatique. Si cette lésion est
très focale, elle peut provoquer simplement une qua-
dranopsie
(figure 4)
. L’imagerie est à réaliser en
urgence si l’apparition des symptômes est brutale, à
la recherche d’un infarctus occipital, d’un héma-
tome. Les lésions responsables des HLH sont nom-
breuses. Les principales étiologies des anomalies du
CV sont résumées dans le
schéma 1
.
LES TROUBLES DE L’OCULOMOTRICITÉ
Ils ont plusieurs origines. Ils peuvent être liés à
une paralysie oculomotrice (atteinte d’un ou plu-
sieurs muscles directe ou par le biais d’une dénerva-
tion). Elle provoque une rupture du parallélisme des
axes visuels, responsable d’une absence de fusion
des images qui se traduit par une vision double ou
FIG. 4. – Patiente de 43 ans. Sclérose en plaques. HLH
droite installée en quelques heures. IRM coupe axiale en T2 :
lésion inflammatoire, en hypersignal du corps géniculé droit.
FIG. 4. – 43-year-old woman. Multiple sclerosis. Rapid onset
of left lateral hemianopsia. MRI axial plane T2-weighted images:
hyperintense lesion of the right geniculate body (arrow).
Schéma 1 : Lésions des voies visuelles : résultat sur l’AV et le CV.
Diagram 1: Lesions of the visual pathways: impact on visual acuity and visual field.
N
évrite (SEP, BBS..)
Gliome
Traumatisme
Ischémie
Tumeur
(méningiome…)
Anévrysme
Traumatisme
Lésion osseuse
(dysplasie fibreuse.)
Mucocèle
Tumeur
(macroadénome,
méningiome,
crâniopharyngiome)
Anévrysme
Tumeur (gliome …)
AVC
Hématome
Infection
Inflammation
Traumatisme
HBT
BAV HLH Controlatérale
© 2017 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 20/04/2017 Il est interdit et illégal de diffuser ce document.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%