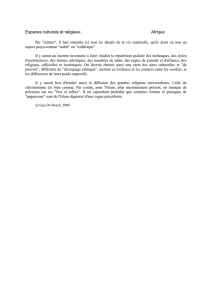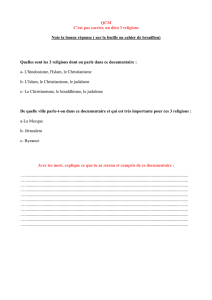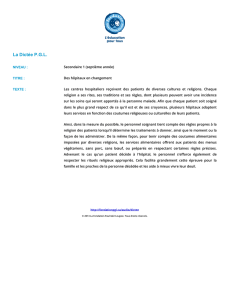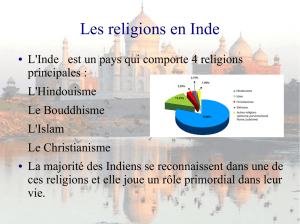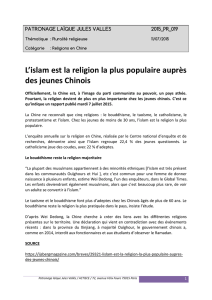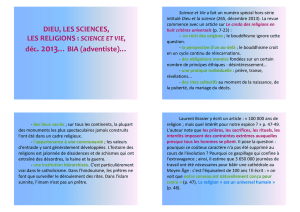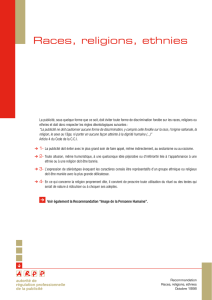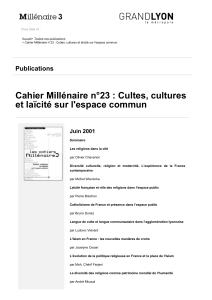Rencontre et dialogue des religions - Reformierte Kirchen Bern

Rencontre et dialogue des religions
Reformierte Kirchen
Bern–Jura–Solothurn
Eglises reformées
Berne–Jura–Soleure
Rencontre et dialogue des religions
Un état des lieux par les Eglises réformées Berne–Jura–Soleure
UG Franz 30.3.2010 8:07 Uhr Seite 1

Rencontre et dialogue des religions
Un état des lieux par les Eglises réformées Berne–Jura–Soleure

Impressum:
Editeur:
Eglises réformées Berne–Jura–Soleure
Le Conseil synodal
Bürenstrasse 12
3000 Berne 23
Téléphone 031 370 28 28
Courriel: [email protected]
www.refbejuso.ch
Concept et rédaction:
Albert Rieger, secteur ŒTN-Migration
Groupe de projet:
Jakob Frey, Pia Grossholz-Fahrni, Hartmut Haas,
Hans Rudolf Helbling†, Christoph Jungen, Matthias Konradt,
Silvia Liniger, Albert Rieger, Magdalena Schlosser
Version française:
Thérèse Marthaler, Maria Vila,
Service de traduction des Eglises réformées Berne–Jura–Soleure,
Bertrand Baumann
Mise en page et production:
Atelier Hanspeter Bisig, Sursee
Photos:
Maison des religions, Berne
Impression:
SWS-Medien AG Print, Sursee
© 2010
4

Préface du Conseil synodal 7
Scènes du quotidien multireligieux 9
1. La Suisse multireligieuse: défis et opportunités 11
2. Notre relation dans la foi 17
2.1 Notre relation au judaïsme 17
2.2 Notre relation à l'islam 23
2.3 Notre relation à l'hindouisme 29
2.4 Notre relation au bouddhisme 35
3. Thèmes du dialogue interreligieux 39
3.1 Mission et dialogue 39
3.2 «Mission parmi les juifs» 40
3.3 Conversion 41
3.4 Célébrer et prier ensemble? 42
3.5 Les religions dans l'espace public 44
3.6 Des Eglises et bâtiments ecclésiaux pour d'autres religions? 46
4. Les rencontres interreligieuses dans leur dimension pratique:
quelques pistes concrètes 49
5. Suggestions pour les paroisses 51
Annexes 53
Auteures et auteurs 53
Sources et sélection bibliographique 54
Adresses et sites Internet 56
SOMMAIRE
5

6
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
1
/
56
100%