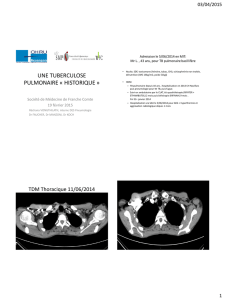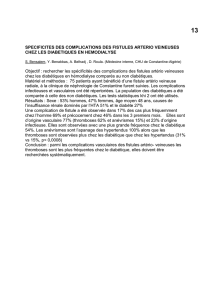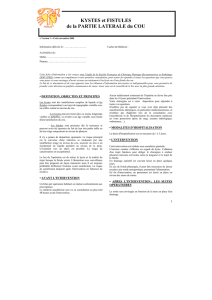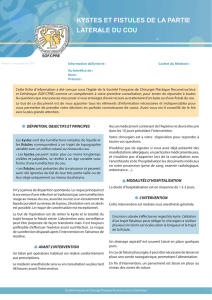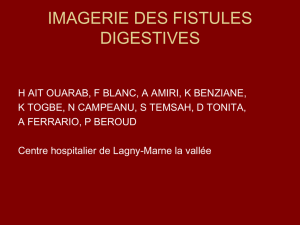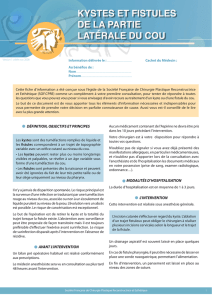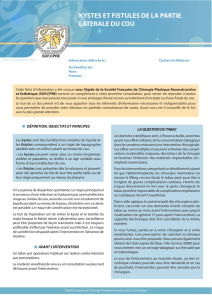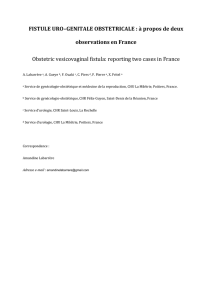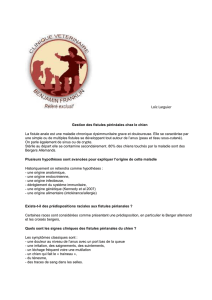La Chirurgie Digestive

20
Al’E
COUTE
DES
A
UTRES
S
PÉCIALITÉS
Il y a quatre types de fistules entre
l’intestin et l’appareil urinaire :
les fistules entéro-vésicales, qui
seules nous intéressent ici, les fistu-
les entéro-urétérales, les fistules
entéro-uréthrales, et enfin les fistu-
les recto-uréthrales.
Les fistules entéro-vésicales sont
pour l’essentiel la conséquence
d’un processus inflammatoire et
infectieux d’origine digestive, qui
s e c o n d a i rement va se fistuliser
dans une vessie initialement saine.
Le plus souvent l’intestin respon-
sable est soit l’iléon terminal, soit
le sigmoïde. Dans ce cadre là, les
deux étiologies principales des fis-
tules entérovésicales sont la diver-
ticulite sigmoïdienne et la maladie
de Crohn.
Plus rarement, ces fistules entéro-
vésicales peuvent être d’origine
radique (après irradiation pelvien-
ne et abdominale, l’atteinte radique
étant alors souvent à la fois intesti-
nale et vésicale), tumorale (cancer
c o l o rectal surtout, plus rare m e n t
vésical, utérin, ou pro s t a t i q u e ) ,
post-traumatique, ou enfin être
secondaires à une intervention chi-
rurgicale abdominale (fistule posto-
pératoire d’une anastomose colo-
rectale dans la vessie par exemple,
exceptionelle, sauf en cas d’antécé-
dent d’irradiation pelvienne).
Enfin, une fistule entéro v é s i c a l e
persistante malgré le traitement
chirurgical et en l’absence de radio-
thérapie dans les antécédents doit
faire rechercher des causes excep-
tionnelles comme une tuberculose,
une actinomycose ou un corps
étranger.
La diverticulose sigmoïdienne n’est
pas en soit une maladie. Il s’agit
d’une hernie de la muqueuse à tra-
vers la paroi musculaire colique.
Ces diverticules peuvent re s t e r
asymptomatiques ou s’infecter par
rétention de matières fécales à son
niveau. Le premier stade de la mal-
adie est la diverticulite aiguë sig-
moïdienne non compliquée dont la
poussée aiguë est habituellement
traitée de manière efficace par les
antibiotiques.
En l’absence de traitement antibio-
tique, ou malgré lui, le processus
infectieux local peut conduire à des
complications allant du simple
abcès périsigmoïdien, à la perfora-
tion d’un diverticule, soit dans la
grande cavité péritonéale, respon-
sable alors d’une péritonite aiguë
généralisée, soit dans un org a n e
creux de voisinage, donnant le plus
souvent une fistule sigmoïdo-vési-
cale (plus rarement sigmoïdo-vagi-
nale, sigmoïdo-iléale voire sigmoï-
do-cutanée).
Les complications infectieuses de la
diverticulite colique sont responsa-
bles, encore aujourd’hui, d’une
mortalité élevée, qui était de 11%
dans une série récente prospective
et multicentrique portant sur 300
patients. Cette mortalité passe de
4% en cas de poussées inflammatoi-
res de diverticulite sigmoïdienne, à
27% en cas de péritonites purulen-
tes et 48% en cas de péritonites ster-
corales. Ces chiff res soulignent
l’importance d’une prise en charge
thérapeutique précoce.
Les fistules d’origine diverticulaire
représentent 5 à 9% des indications
chirurgicales pour diverticulite sig-
moïdienne. Une fistule entre le sig-
moïde et un organe de voisinage
survient quand ce dernier vient
s’accoler au foyer inflammatoire
siège le plus souvent d’un abcés
péricolique. L’ouverture de l’abces
dans l’organe de voisinage par le
trajet fistuleux amène le plus sou-
vent à la “guérison” du syndrome
infectieux clinique et biologique.
La fistule sigmoïdo-vésicale est la
fistule la plus fréquemment ren-
contrée dans la diverticulite sig-
moïdienne. Dans la plupart des
études, elle représente environ 50
à 65% de l’ensemble des fistules.
Par exemple, sur une série récente
de 38 fistules d’origine diverticulai-
re 16 concernaient la vessie, 8 l’in-
testin grêle, 7 le vagin, 6 la peau, et
une le périnée.
II. LA DIVERTICULITE
SIGMOÏDIENNE
I. INTRODUCTION
Le T
raitement des Fistules Entér
ovésicales
Pr Yves Panis Service de Chirurgie Générale et digestive,Hôpital Lariboisière
N°2 Mai 2001
La Chirurgie Digestive

21
Al’Ecoute des
Autres Spécialités
La fistule colovésicale est plus fré-
quente chez l’homme (sex ratio de
2:1 à 6:1 suivant les séries), proba-
blement du fait de l’interposition
chez la femme de l’utérus entre la
vessie et le sigmoïde. Chez la
femme, une hystérectomie est
d’ailleurs retrouvée dans les anté-
cédents dans 50% des cas de fistule
colovésicale.
Cliniquement, une p n e u m a t u r i e
est présente dans 65% des cas, une
fécalurie dans 45% des cas, alors
que les douleurs abdominales et
les signes infectieux ne sont retrou-
vés que chez 20% environ des
patients. Des signes urinaires isolés
à type d’infection urinaire pluri-
microbienne ou d’hématurie sont
observés chez 30% des patients.
La découverte clinique ou radiolo-
gique (extravasation de produit de
contraste du sigmoïde vers la ves-
sie au lavement hydrosoluble ou
surtout air dans la vessie au scan-
n e r) d’une fistule colovésicale
témoigne d’une forme grave de la
poussée inflammatoire et expose
aux complications infectieuses d’o-
rigine urinaire. Par elle-même, elle
justifie donc l’intervention chirurgi-
cale, au mieux à distance de l’épiso-
de aigüe.
En préopératoire, un bilan de la
fistule vésicale elle-même (cystos-
copie, cystographie) est inutile car
la fistule siège le plus souvent sur le
dôme vésical et n’entraine pas de
conséquences sur la fonction réna-
le. De plus, la cystoscopie a une
faible rentabilité diagnostique
puisqu’elle ne visualise l’orifice
fistuleux que dans 30 à 40% des
cas.
L’intervention chiru rgicale com-
prend la résection du sigmoïde sui-
vie d’une anastomose colorectale,
non protégée dans plus de trois
quarts des cas car le plus souvent
les conditions locales le permettent.
La résection colique est associée à
une fermeture simple du dôme
vésical à l’endroit de la fistule. Si
possible, on interposera le grand
épiploon entre l’anastomose colo-
rectale et la suture vésicale. Il est
préferable de laisser en place une
sonde urinaire 8 à 10 jours après
l’intervention pour protéger la
suture vésicale.
Souvent, le trajet fistuleux dans la
vessie est difficile à retrouver.
Dans ces cas, il est inutile de s’a-
charner et la vessie peut-être lais-
sée en l’état. Elle guérira sponta-
nément (sous couvert du sondage
urinaire).
Rarement, une stomie de protection
de l’anastomose colorectale s’avère
nécessaire, en cas d’abcès pelvien
associé, ou de péritonite. Par con-
t re, la réalisation d’une simple
colostomie d’amont, ne touchant
pas à la fistule, s’avérerait inefficace
et dangereuse (avec persistance du
risque septique et rénal). C e t t e
intervention (sigmoïdectomie,
anastomose colorectale, et suture
vésicale) peut être faite en totalité
aujourd’hui sous cœlioscopie.
Il s’agit le plus souvent d’une fistule
e n t re l’iléon terminal (siège le plus
fréquent de la maladie de Crohn) et
le dôme vésical. Du fait de la ma-
ladie de Crohn, cette fistule entéro -
vésicale peut être associée à d’autre s
fistules soit internes entéro - e n t é-
riques (le plus souvent iléo-iléale ou
iléo-sigmoïdiennes) soit externes
e n t é r o - c u t a n é e s .
Comme dans la diverticulite, le
bilan urinaire est inutile. Seul un
bilan digestif complet comprenant
habituellement un transit du grêle
et une coloscopie doit être pratiqué
en préopératoire. La non visualisa-
tion de la fistule sur ces examens ne
doit pas remettre en cause le dia-
gnostic si cette fistule est sympto-
matique cliniquement. Elle sera de
toutes les façons très facilement
confirmée en peropératoire par l’ac-
colement intime entre le segment
intestinal et le dôme vésical.
L’intervention chirurgicale consiste
en une résection du segment intes-
tinal, et comme dans la diverticuli-
te une suture si possible de la fistu-
le vésicale associée à un sondage
urinaire prolongée environ 1 semai-
ne. Ainsi, le plus souvent est réali-
sée une résection iléo-caecale avec
anastomose iléo-colique dro i t e
immédiate (en cas de fistule iléo-
vésicale) ou une colectomie subto-
tale avec anastomose iléorectale (en
cas de Crohn colique avec fistule
colo-vésicale). Là encore, dans
notre expérience, ces interventions
peuvent être le plus souvent réali-
sées sous cœlioscopie.
Le plus souvent, il s’agit d’un can-
cer recto-sigmoïdien qui envahit le
dôme vésical, où siège la fistule. Il
1. CAUSES MALIGNES
IV.AUTRES CAUSES DE
FISTULES
ENTÉRO-VESICALES
III. LA MALADIE DE
CROHN
2. LETRAITEMENT
CHIRURGICAL
1. PRÉSENTATION CLINIQUE ET
BILAN MORPHOLOGIQUE :
N°2 Mai 2001
Le T
raitement des Fistules Entér
ovésicales

Le T
raitement des Fistules Entér
ovésicales
22
Al’Ecoute des
Autres Spécialités
N°2 Mai 2001
Figure 1: Sigmoïdectomie pour diverticulite Figure 2: Anastomose colorectale protégée
Figure 3: Anastomose colorectale latéro-terminale ou termino-terminale

23
Al’Ecoute des
Autres Spécialités
s’agit néanmoins d’une complica-
tion rare (moins de 0,5% des can-
cers recto-coliques). Parfois, celle-ci
du fait de l’envahissement tumoral
peut concerner, à l’inverse des fis-
tules bénignes, la base de la vessie
voire l’urèthre.
En cas de suspicion de cause
maligne, ou d’absence de contexte
clinique, la réalisation d’un bilan
vésical semble justifiée. En effet,
la cystoscopie permettra, non pas
trop de confirmer la fistule, si
celle-ci est évidente cliniquement,
mais surtout d’éliminer un cancer
de la vessie, et de voir l’étendue de
l’envahissement d’un éventuel
cancer recto-sigmoïdien.
Cet envahissement conditionne en
effet le geste chirurgical à proposer.
Un “simple” envahissement loca-
lisé du dôme vésical justifie une
résection “en-bloc” du sigmoïde et
de la portion de vessie atteinte.
Cette intervention donne habituel-
lement un résultat carcinologique
satisfaisant (30-40% de survie à 5
ans) si la résection est jugée R0
(absence de tissu tumoral résiduel
macroscopique ou microscopique).
Par contre, en cas d’envahissement
de la base vésicale il faut proposer
une cystectomie totale associée qui
est une intervention non seulement
mutilante, mais aussi inutile carci-
nologiquement si l’éxérèse n’a pas
la possibilité d’être carcinologique-
ment satisfaisante). Donc dans ces
situations, un bilan complet de l’en-
vahissement vésical, du terrain
(une telle intervention chez le sujet
très agé, fragile n’est pas justifiée),
et du cancer (l’association à une
dissémination métastatique, sur-
tout si elle n’est pas resécable cont-
re-indique la cystectomie) est
indispensable.
Une situation beaucoup plus diffi-
cile est représentée par les récidi-
ves loco-régionales de cancers pel-
viens (gynécologique ou recto-sig-
moïdien) envahissant la vessie. Le
pronostic est souvent très mauvais
et les chances de réintervention à
visée curative quasi-nulles. Dans
ces cas, aucune solution thérapeu-
tique n’est satisfaisante, et on peut
proposer par exemple une simple
colostomie d’amont avec sondage
urinaire à demeure.
En dehors de la cystoscopie, la réali-
sation systématique d’examens
radiologiques urinaires n’est pas
justifiée (le bilan loco-régional par
scanner permettra ainsi d’avoir une
confirmation du bon fonctionne-
ment des reins, sans qu’il soit néces-
s a i re de rajouter une uro g r a p h i e ) .
Le plus souvent, là encore, il s’agit
de fistule iléo ou sigmoïdo-vésicale.
Mais, comme dans la maladie de
C rohn, du fait de l’étendue des
lésions radiques, il existe souvent
des sténoses digestives associées et
2. RADIOTHÉRAPIE
N°2 Mai 2001
Le T
raitement des Fistules Entér
ovésicales
Figure 4: Scanner montrant une sigmoïdite diverticulaire
Figure 5: Fistule iléo-vésicale de Crohn: traitement chirurgical

24
Al’Ecoute des
Autres Spécialités
parfois des autres fistules (notam-
ment entéro-cutanées).
Le bilan préopératoire doit s’assu-
rer tout d’abord de l’absence de
récidive tumorale (scanner abdomi-
no-pelvien et thoracique le plus
souvent); ensuite, de l’étendue des
lésions intestinales radiques (au
minimum par un transit du grêle et
une coloscopie); enfin, un bilan
urinaire est nécessaire pour juger
de l’étendue de l’atteinte radique
non seulement sur la vessie (par
cystoscopie), mais aussi de l’éven-
tuel retentissement sur les uretè-
res et les reins (par urographie).
Le traitement chirurgical consistera
en une résection intestinale guidée
par l’étendue des lésions (le plus
souvent résection iléo-colique droi-
te avec anastomose iléo-transverse
droite) et une suture vésicale proté-
gée par un sondage urinaire de 10
jours
•Keighley MRB et Williams NS.
Intestinal fistulas. In Keighley MRB et
Williams NS (eds). Surgery of the
anus rectum and colon, Saunders,
New York 1997; pp 2335-2416.
•Ambrosetti P, Robert JH, Witzig JA,
Mirescu D, Mathey P, Borst F, et al.
Acute left colonic diverticulitis: a pro-
spective analysis of 226 consecutive
cases. Surgery 1994; 115: 546-50.
•Bouillot JL. Abcès, fistules et occlu-
sions de la diverticulose colique. Rev.
Prat. (Paris) 1995; 45: 973-7.
•B ruce CJ, Coller JA, Murray JJ,
Schoetz DJ, Roberts PL, Rusin LC.
Laparoscopic resection for diverticu-
lar disease. Dis Colon Rectum 1996;
39: 1-6.
•Pontari MA, McMillen MA, Garvey
RH, Ballantyne GH. Diagnosis and
t reatment of enterovesical fistulae.
Am Surg 1992; 58: 258-63.
•Woods RJ, Lavery IC, Fazio VW,
Jagelman DG, Weakley FL. Internal
fistulas in diverticular disease. Dis
Colon Rectum 1988; 31: 591-6.
•Panis Y. Traitement chirurgical des
maladies inflammatoires choniques
de l’intestin. In: Les maladies inflam-
matoires chroniques de l’intestin, JC
Rambaud ed., John Libbey Eurotext,
Paris 1999, pp 123-136.
•S a i n t - M a rc O, Ti ret E, Vaillant JC,
Frileux P, Parc R. Surgical manage-
ment of internal fistulas in Crohn’s
disease. J Am Coll Surg 1996; 183: 97-
100.
•Irving MH. The management of surgi-
cal complications in Crohn’s disease-
abcess and fistula. In Allan RN,
Keighley MRB, Alexander-Williams J
& Hawkins C (eds). Inflamma-tory
Bowel Diseases, 2nd ed, pp 489-500.
E d i n b u rgh: Churchill Livingstone,
1997.489-500.
•Bemelman WA, Van Hogezand RA,
Meijerink WH, Griffioen G, Ringers J.
L a p a roscopic-assisted bowel re s e c-
tions in inflammatory bowel disease:
state of the art. Neth J Med 1998; 53:
S39-S46.
•Perrin H, Panis Y, Messing B,
Matuchansky C, Valleur P.Agressive
initial surgery for chronic radiation
enteritis. Long-term results of resec-
tion versus non resection in 44 conse-
cutives cases. Colorectal disease 1999;
1: 162-167
V. REFERENCES
ACONSULTER
N°2 Mai 2001
Le T
raitement des Fistules Entér
ovésicales
Les principales causes des fistules entéro-vésicales sont: la diverticulite sigmoïdienne, la maladie de
C rohn, les cancers pelviens, la radiothérapie, et plus rarement un traumatisme, ou une tuberc u l o s e .
Elles sont souvent asymptomatiques (environ 50% des cas), découvertes sur un examen radiologique,
ou surtout en pero p é r a t o i re ;
La symptomatologie clinique (pneumaturie ou plus rarement fécalurie, infection urinaire poly micro-
bienne, hématurie, fièvre) est indépendante de l’étiologie; à l’inverse, le passage d’urine par le re c t u m
semble exceptionnel ;
Elles sont associées le plus souvent à un amendement des symptômes cliniques infectieux (fièvre, dou-
leur abdominale) au moment de l’ouverture de la fistule dans la vessie ;
Elles indiquent un traitement chiru rgical, du fait du risque infectieux et rénal ;
La localisation la plus fréquente de la fistule est le dôme vésical ce qui rend le plus souvent très sim-
ple le geste chiru rgical sur la vessie, et qui rend inutile de ce fait un bilan spécifique préopératoire (cys-
toscopie, urographie intraveineuse ou cystographie rétrograde) notamment dans la diverticulite.
En cas de cause maligne, un bilan cystoscopique est par contre indispensable, un envahissement de la
base de la vessie devant faire alors discuter d’une cystectomie totale, intervention inutile et mutilante
si la résection complète de la tumeur est impossible.
Ce qu’il FAUT RETENIR
1
/
5
100%