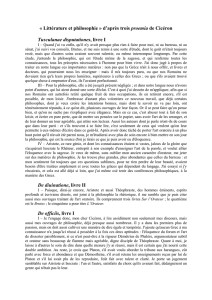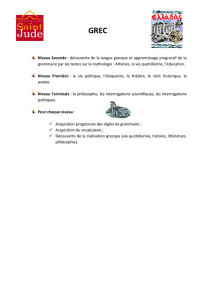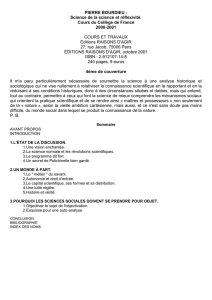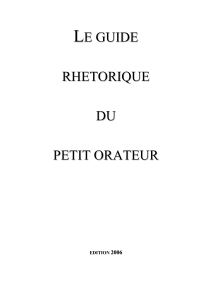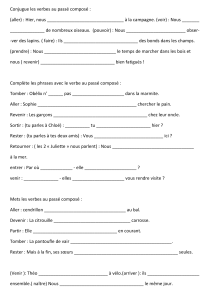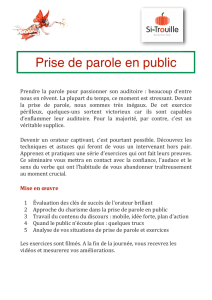INFORMATION TO USERS
publicité

INFORMATION TO USERS
This manuscript has been reproduced trom the microfilm master. UMI films
the text directly from the original or copy submitted. Thus. sorne thesis and
dissertation copies are in typewriter face, while others may be tram any type of
computer printer.
The quality of this reproduction is dependent upon the quallty of the
copy submitted. Broken or indistinct print. colored or poor quality illustrations
and photographs, print bleedthrough, substandard margins, and improper
alignment can adversely affect reproduction.
ln the unlikely event that the author did not send UMI a complete manuscript
and there are missing pages, these will be noted.
Also, if unauthorized
copyright materia' had ta be removed, a note will indicate the deletion.
Oversize materials (a.g., maps, drawings. charts) are reproduced
by
sectioning the original, beginning at the upper left-hand corner and continuing
from left to right in equal sections with small overfaps.
ProQuest Information and Leaming
300 North Zeeb Raad, Ann Arbor, MI 48106-1346 USA
800-521-0600
•
L'opposition savante dans le débat linguistique de la
première moitié du dix-septième siècle: Guillaume Du
Vair et François de La Mothe Le Vayer
par
Martin Chênevert
Mémoire de maîtrise soumis à la Faculté des études
1
supérieures et de la recherche en vue de 1 obtention du
diplôme de Maîtrise ès Lettres
Département de langue et littérature françaises
Université McGill
Montréal, Québec
Août 2000
© Martin Chênevert.. 2000
•
1+1
Nationallibrary
of Canada
Bibliothèque nationale
du Canada
Acquisitions and
Bibliographie Services
Acquisitions et
serviees bibliographiques
395 Wellington Street
395. rue Welington
Ottawa ON K1 A 0N4
canada
Ottawa ON K1 A ON4
canada
The author bas granted a nonexclusive licence allowing the
National Library of Canada to
reproduce, loan, distribute or sen
copies of this thesis in microform,
paper or electronic formats.
L'auteur a accordé une licence non
exclusive permettant à la
Bibliothèque nationale du Canada de
reproduire, prêter, distribuer ou
vendre des copies de cette thèse sous
la forme de microfiche/film, de
reproduction sur papier ou sur format
électronique.
The author retains ownership of the
copyright in this thesis. Neither the
thesis nor substantial extracts from it
may be printed or otherwise
reproduced without the author's
pemusslOD.
L'auteur conserve la propriété du
droit d'auteur qui protège cette thèse.
Ni la thèse ni des extraits substantiels
de celle-ci ne doivent être imprimés
ou autrement reproduits sans son
autorisation.
0-612-70276-6
Canadi
•
ABSTRACT
When Renaissance linguists took charge of the French language and its
evolution, trying to define what French eloquence would be., they relied mostly 00
classical Greek philosophees' theories about language. Divine inspiration4 as evoked
by Plato, was in the ancient times opposed to Aristode's art of oratory and its more
technical approach. In the same way, during the Renaissance. Ciceronians promoted
Aristotelian rhetoric, \vhereas their opponents, such as Erasmus or Montaigne,
revived Plato's thesis.
Withio this context, the present study is centred on two grammariansphilosophers living towards the end of the sixteenth century and the beginning of the
next. In his Eloquence Françoise. Guillaume Du Vair propounded a conception of
the french language inspired by the stoic theory ofrepresentation. François de La
Mothe Le Vayer, on the other hand, refeTs to sceptic philosophers in orders to
develop in his Considérations sur l'Eloquence de ce lems (1637) a theory of
aestheticism based on doubt.
•
•
RÉSUMÉ
À la Renaissance, les linguistes qui prirent en charge l'évolution du français
et qui voulurent détenniner ce que serait l'éloquence, s'inspirèrent considérablement
des conceptions linguistiques de l'Antiquité. En effet, l'inspiration divine de Platon
et la <<technicité» de l'art oratoire d'Aristote sont deux conceptions qui divisaient les
philosophes de la Grèce antique, et qui divise encore_ à la Renaissance, les
théoriciens du langage en France. Les cicéroniens réhabilitent les thèses d'Aristote
et de sa Rhétorique, alors que les anticicéroniens. tels qu'Érasme et Montaigne,
renouent avec les thèses platoniciennes.
Ce travail insiste tout particulièrement sur l' œuvre de deux grammairiensphilosophes de la fin du
XVIii:me
siècle et du début du
XVIyii:me
siècle. Guillaume Du
Vair développe dans son Eloquence françoise (1595) une conception de [a langue
fortelnent marquée par la théorie de la représentation stoïcienne. Pour sa part..
François de La Mothe Le Vayer applique son scepticisme à rétude de la langue. au
point d'exposer dans ses Considérations sur '·Eloquence françoise de ce lems
(1637) une esthétique du doute.
•
•
REMERCIEMENT
Je tiens tout spécialement à remercier mon directeur, M. Nonnand Doiron,
pour la grande confiance qu'il a su me témoigner tout au long de la rédaction de ce
mémoire. Sans sa précieuse participation, son grand dévouement et la finesse de ses
observations, ce travail n'aurait probablement jamais vu le jour.
Je ne saurais passer sous silence la fidèle présence de celle qui m'a applaudi
lors des bons moments et qui m'a consolé lors des périodes plus sombres, Patricia
Forget, ni l'appui de son aimable famille.
•
•
La di fficulté~ c ~ est de nous rendre compte du
manque de fondement de nos croyances.
Wittgenstein~
De la certitude.
Il est curieux de noter que des livres que f ai
écrits ont connu le succès en déterrant de
vieux fantômes morts inconnus qui portaient
en eux plus d"avenir que des vivants.
Pascal Quignard" Le nom sur le bout de la langue .
•
•
TABLE DES MATIÈRES
INTRODUCTION
CHAPITRE 1 : L'éloquence des XVl
ième
et XVII ième siècles
10
Le débat linguistique du XVn ième siècle n'oppose pas directement les
courtisans et les savants, mais plusieurs chapelles savantes, 10-13; Qui sont
les savants? Les pédants de l'Université, 13-14; les humanistes, 14-15; les
religieux, 15-16; et les hommes de lois, 16-19: Platon et la parole inspirée,
19-22; Aristote et l' «art» du discours., 22-23; L'orateur-philosophe de
Cicéron. 23-24; Le traité Du sublime et l'influence de Platon, 24-27: Saint
Augustin et l'inspiration divine, 27-28; L'influence de l'Antiquité sur
Montaigne et Du Vair. 28-33; La Mothe Le Vayer et l'héritage des Anciens
conrre l'esthétique mondaine., 33-39.
CHAPITRE II : Éloquence et philosophie stoïcienne chez Du Vair
40
Le néo-stoïcisme de Du Vair., 40-42; L'importance de la théorie de la
représentation stoïcienne et de l'assentiment., 42-47; De l'eloquence
françoise à la lumière du stoïcisme: l'importance d'un raisonnement clair et
logique. 47-49: Les «passions» comme fondement de l'éloquence., 49-52;
Une théorie de la «sympathie», 52-54; Un savoir «encyclopédique», 54-57;
Nature et éloquence, 57-58; La logique stoïcienne: la rhétorique. 58-61: et la
diaJectique, 61-63.
CHAPITRE III : La Mothe Le Vayer et l'esthétique du doute
64
Les quatre écoles sceptiques de l'Antiquité, 64-68; Le scepticisme à la
Renaissance et au début du XVII,crnc siècle~ 68-71; L'impossibilité d'un
langage sceptique, 71-75; L'élaboration d'un langage sceptique à panir de
l'argument du désaccord d'Agrippa. et du dixième mode d'Énésidème, 7584: Les Considérations sur l'Eloquence françoise de ce lems: une esthétique
sceptique. 84-89; La «mesure» comme réponse à l'indétermination du
monde, 89-93.
•
CONCLUSION
BIBLIOGRAPHIE
94
104
•
INTRODUCTION
Avec la chute de l'empire romain, tous les pays qui étaient sous son contrôle
héritèrent, bien malgré eux, d'une structure politico-sociale bilingue: alors que les
institutions civiles perpétuaient l'usage de la langue latine classique, le peuple la
transformait au contact d'autres cultures pour en arriver aux langues romanes.
En France plus particulièrement, le domaine du sacré, les affaires de l'État et
bientôt les différentes disciplines de l'Université étaient tous sous l'égide de
l'ancienne langue impériale, formant un bloc très homogène. Cette langue du
pouvoir resta très stable au cours des siècles, quoique en disent les humanistes du
XVI ième siècle, qui verront dans ce latin institutionnel le résultat d'une dégradation.
Parallèlement au latin, la langue vulgaire ne cessa d'évoluer, se distinguant de sa
rivale jusqu'à devenir, après de nombreuses transfonnations, le français.
Cet écart est si grand au début du XVI ième siècle, que la France est constituée
d'un système où se confrontent deux langues à part entière. Le latin est considéré
comme une langue noble, le français comme une langue populaire, pauvre et
•
incapable, dit-on, d'aucune subtilité. Mais il ne faut pas se leurrer, les locuteurs
2
•
latins, bien qu'ils tirent toutes les ficelles du pouvoir, n'ont qu'un poids
démographique dérisoire. De sorte que l'élite intellectuelle devra faire de plus en
plus de concessions, jusqu'à en perdre sa position de commande.
Différentes raisons ont entraîné l'effondrement de l'édifice romain,
SI
puissant autrefois. La première, ratifiée par décision royale, est probablement la plus
marquante : l'ordonnance de Villers-Cotterêts qui «stipulait, dans ses articles 110 et
Ill, que tous les actes et opérations de justice se feraient désonnais en français» 1•
Devant l'illogisme d'un système judiciaire fonctionnant dans une langue étrangère
dans la très grande majorité des cas, François 1er et ses représentants en vinrent à
laisser tomber le latin. Non seulement le roi décrète que le français est devenu la
langue du Royaume, mais il confère du même coup un peu de son autorité à une
langue qui n'en possédait pas. Cette autorité fut détenninante pour l'histoire de la
langue française qui, à partir de 1539, n'était plus seulement la langue du peuple,
mais aussi celle de l'État.
Le domaine de la religion, quant à lui, paraissait impénétrable. L'usage du
latin se perpétuait dans le rituel ecclésiastique: la prière, le sermon, la liturgie, etc.,
entretenant ainsi un mystère sacré qui commandait le respect. Puisque la grande
majorité des fidèles ne parlaient que le français, les responsables de l'Église
n'avaient d'autre choix que de s'abaisser en quelques occasions à l'usage du
vulgaire. Cependant Luther et l'esprit de la Réforme soufflèrent un vent de
•
1
Ferdinand 8run04 Histoire de la languejrançaise, t. Il. Annand Colin, 1967, p. 30.
3
•
changement qui eut une influence déterminante sur l'émergence des langues
vulgaires dans toute l'Europe occidentale. L'esprit réfonné favorisait un lien plus
direct entre le croyant et son Dieu. Mais cette approche, où le croyant interprète luimême les Évangiles, implique qu'il peut se les procurer et les lire. Le mouvement de
la Réforme engendra donc une immense vague de traduction des Écritures et des
textes liturgiques en langue vulgaire, poussant des savants comme Érasme, Lefèvre
d'Étaples et même Marot à traduire plusieurs textes sacrés en français. Bien que le
résultat fût moins probant que dans les pays gennaniques, plus attachés aux idées de
la Réforme, la croyance que le vernaculaire puisse révéler les mystères de la religion
ne fit qu'accroître la légitimité de la langue française.
L'utilisation du dialecte francien par la classe dirigeante de la société féodale
avait été la première étape d'une conquête du pouvoir. Avec le développement du
gallicanisme, qui tend à séparer pouvoir temporel et spirituel, la cour des Valois
imposera tranquillement la langue française, qui rayonne de la sphère politique vers
la sphère intellectuelle. Le français pénètre le monde du savoir, que depuis des
siècles le latin lui interdisait. Certes le phénomène fut graduel, et Jean de Meung,
dans sa Continuation du roman de la rose, avait déjà montré, dès le XIIl
ièmc
siècle,
ce que pouvait le français dans le champ des idées et de la philosophie. Mais le
XVI ième siècle marque un tournant décisif. Lorsque Guillaume Budé, par exemple,
entreprit son Institution du prince, il dut rédiger son ouvrage en français pour que
•
François 1er et ses successeurs pussent en profiter. Ce qui n'empêcha pas cet
4
•
humaniste de clamer les grâces et les richesses des langues anciennes. Qu'il ait
utilisé le français à contrecœur est indéniable, mais la concession était faite. Cet
humaniste respecté, ce brillant helléniste et ce fameux bibliothécaire du Roi s'est vu
obligé d'utiliser le français, fût-ce dans le moins important de ses ouvrages.
De façon semblable, plusieurs domaines du savoir comme la géographie't
l'arithmétique et la géométrie utilisent le français. La géographie s'adresse aux
voyageurs et aux marins; l'arithmétique est une science qui aborde principalement le
change des monnaies, l'étude des poids et mesures et la tenue de livre; et la
géométrie sert plutôt aux maçons, aux ouvriers et aux artisans qu'aux érudits.
La médecine., science des sciences au XVI ième siècle, est rédigée en latin, mais
les domaines connexes de la chirurgie et de la pharmacie n'ignorent pas le français.
Il s'immisce d'abord dans les secteurs plus techniques, pour ensuite envahir la
théorie et la spéculation, et même la philosophie, lorsque des auteurs comme
Montaigne, Charron et Descartes adopteront la langue française.
Dans le domaine des lettres, du roman. de la chanson et de la poésie, le
français a toujours prédominé. Depuis les romans de Chrétien de Troyes jusqu' à la
poésie de Marot.. le public de ce type de littérature fut des courtisans ne connaissant
que les dialectes romans. Mais il faut bien préciser que, malgré son importance.. cette
production en français, tous dialectes confondus, n" a qu'une autorité limitée.
•
Ronsard et Du Bellay tenteront d'augmenter et d" «illustrer» le français de
façon qu'il devienne l'égal de ses rivales antiques. Le premier redécouvre les fonnes
5
•
poétiques comme l'ode, qui remplacera les rondeaux et les virelais français. Le
second nourrit le désir d'aborder dans sa poésie des sujets savants et graves, pour
contrer l'esprit de frivolité qui animait la poésie française du début du XVl ième
siècle. Certes les mérites de la nouvelle poésie se définissent souvent au détriment
des poètes de la génération précédente, mais le dessein des poètes de la Pléiade est
clair: élever le français au rang des langues nobles. Dans le dernier quart du
siècle~
c ~ est le français qui fait autorité.
À partir de ce moment, il n'est plus question de justifier l'usage du français, il
s'agit de l'améliorer, de manière qu'il devienne le parfait instrument des arts et des
sciences. Les textes de la fin du XVI ième et du début du
du désir incessant de définir la correction du
des traités et des
grammaires~
français~
xvn ième siècle
témoignent
en compilant ces règles dans
et en uniformisant l'orthographe et la prononciation.
Mais vu 1~ absence d'institution pouvant prendre en charge le développement de la
langue~
cette responsabilité incombe à quiconque croit posséder assez d'autorité en
cette matière. Tous voudront guider le français vers ce qu'ils croient être la
perfection.
Depuis le XlII ième siècle le français parlé à Paris et à la cour de France
s-impose comme le dialecte dominant. C'est la langue du pouvoir économique et
politique qui finit par remporter. C'est alors que s'impose la notion de «bon usage».
•
Danielle Trudeau nomme ce phénomène: «la nonne spontanée» ou «la justification
6
•
sociale et politique de la nonne»2. Comme le montre très bien l'auteur, les
opposants, c'est-à-dire les intellectuels, restent «sourds à la pression sociale, ils ne
se font pas les porte-parole de la nonne spontanée, refusant d'associer la qualité de
3
la langue au prestige social» • Panni ces humanistes érudits, fervents protecteurs des
lettres grecques et latines, quelques-uns ont opté pour la défense du français.
Montaigne, Ramus et Henri Estienne s'efforcèrent de développer le français à partir
de toutes les connaissances acquises au contact des langues antiques. L'étymologie
et l'analogie des structures entre les langues sont des facteurs purement linguistiques
qui, selon eux" détenninent l'évolution d'une langue. Ils ne peuvent concevoir que le
simple prestige doive guider le français. C'est ainsi que s'amorce tout un
mouvement linguistique, où de nombreux savants ont ceci en commun qu'ils
prennent appui sur les langues anciennes pour développer des conceptions
linguistiques qu'ils appliqueront ensuite au français. Non seulement s'efforceront-ils
constamment de rectifier les doctrines linguistiques des courtisans, mais les savants
ne cesseront de se quereller entre eux, afin de savoir qui saura le mieux porter la
langue française vers les sommets de l'art oratoire, tel que l'avaient fait les
Démosthènes et les Cicérons de l'Antiquité.
Guillaume Du Vair et La Mothe Le Vayer représentent bien ce milieu savant.
J'ai choisi ces auteurs, parce qu'ils ont consacré une bonne partie de leurs travaux à
la question linguistique, qu'ils abordent toujours avec un regard humaniste qui
•
2 Danielle Trudeau, Les inventeurs du «bon usage» (/529-/647), Paris, Minuit, 1992, p. 16 et 42.
] Ibid., p. 16.
7
•
trouve chez les Anciens les principes de leur réfonne linguistique. Ces savants ont le
désir de conformer la langue à la philosophie à laquelle ils adhèrent, puisque les
philosophies antiques offraient cette particularité d'intégrer tous les niveaux de la
vie humaine. La philosophie ne se réduit ni à la morale ni à la logique. Elle
s'interroge sur la formation du monde, sur la composition du ciel et de la terre, sur la
nature et sur les dieux. La philosophie antique définit aussi bien la place de l'homme
dans le monde que les principes de la langue et les règles de la grammaire. C'est ce
qui pousse Guillaume Du Vair à soumettre la langue à la logique stoïcienne, et La
Mothe Le Vayer, à la philosophie sceptique.
À la fin du XVI ième siècle, le néo...stoïcisme connaît une large diffusion. Grâce
à l'œuvre de Juste Lipse, c'est tout le stoïcisme ancien et principalement celui de
l'Empire qui est remis en lumière. Les thèses de Sénèque et d'Épictète conquièrent,
plus que le cercle très limité des intellectuels, tout le beau monde de la cour de
France, qui souvent n'y voit qu'une philosophie à la mode. Toutefois, devant les
grands malheurs qu'il souffrit durant les guerres de Religion, Du Vair approfondit
les idées stoïciennes. Il tenta notamment d'accorder cette philosophie à la religion
chrétienne. L'entreprise était d'abord d'ordre éthique. Toutes les Consolations ont
pour fin de guider 1'homme vers une morale salutaire. Le traité De l'eloquence
française (1595) n'est en rien une œuvre morale. Pourtant, l'influence stoïcienne
•
s'exerce de manière évidente sur les théories linguistiques et l'idéal oratoire de
Guillaume Du Vair. Nous verrons dans le second chapitre que la théorie de la
8
•
représentation, l'importance de la notion comme source de connaissance, le contrôle
des passions et un esprit de modération sont des thèmes stoïciens qui infonnent
implicitement les idées que se fait de la langue et de l'éloquence le futur Garde des
Sceaux.
Bien qu'il soit lui aussi redevable aux thèses stoïciennes, c'est principalement
à la philosophie sceptique que La Mothe Le Vayer ira puiser. Ses affinités avec le
Montaigne de «l'Apologie de Raimond Sebond» et ses rapports avec des
philosophes comme Charron et Gassendi lui feront dire que la vérité se cache
derrière une réalité que l'homme ne fait qu'effleurer. Il se gardera d'affinner quoi
que ce soit ou de prétendre à quelque vérité. Dans tous les domaines, la science, la
religion ou l'éthique, La Mothe Le Vayer applique le scepticisme radical de Pyrrhon
et de Sextus Empiricus. Il est donc naturel que ses Considérations sur l'Eloquence
françoise de ce lems (1637), et son écriture en général, soient empreintes des
philosophies du doute. Que fait un linguiste sceptique, lorsque la langue qu'il utilise
repose sur l'affirmation, et que la négation même n'est que l'affirmation d'une
proposition négative? Nous verrons que l'epokhè et l'isosthénie lui fourniront
quelques solutions.
Mais avant d'approfondir les conceptions linguistiques propres à Guillaume
Du Vair et à François de La Mothe Le Vayer, je me dois de tracer un bref aperçu de
l'atmosphère intellectuelle où s'inscrivent leur pensée. La Renaissance remet en
•
lumière une grande quantité de textes qui, depuis Platon jusqu'aux Pères de l'Église,
9
•
discutent soit de la rhétorique, soit de l'éloquence ou de la nature même du langage.
Dans ce foisonnant corpus se dessinent quelques schèmes de pensée majeurs qui se
retrouvent tels quels dans le paysage savant de la Renaissance.
Platon~
défendant la
parole inspirée, et Aristote, proposant le discours réglé, sont les deux auteurs qui
furent à l'origine des deux principaux schèmes qui traverseront les siècles jusqu'à la
Renaissance. Le savoir antique concernant la langue et l'éloquence est sans contredit
la matière première des linguistes de la Renaissance. Ils s'y rétèreront
continuellement et prendront position par rapport à ce savoir avant de décider de ce
qui est bon ou mauvais pour la langue française. Afin de mieux situer la réflexion de
Guillaume Du Vair et de François de La Mothe Le Vayer, nous tenterons donc
d'identifier quelques-unes de ces idées linguistiques héritées de l'Antiquité, qui
dominent la pensée des humanistes de la Renaissance française.
•
•
CHAPITRE 1
L'ÉLOQUENCE DES XVI 1ÈME ET XVII 1ÈME SIÈCLES
Maintenant que l'autorité du français est en grande partie admise, il reste à
nourrir cette langue pour qu'elle vienne à maturité. Depuis l'époque de la Pléiade, le
discours métalinguistique parle d'une langue qui doit s'enrichir et s'augmenter. En
fait seul le savant tient ce discours évolutionniste, qui d'ailleurs s'inscrit
parfaitement dans l'idéologie bourgeoise du progrès, et qui finira par accaparer
l'ensemble du champ discursif. Le courtisan au contraire ne regarde pas la langue
d'un point de vue historique. Le prestige demeure son seul critère linguistique, qu'il
définit comme un privilège atemporel. Cette ignorance des courtisans en ce qui
concerne l'évolution de la langue prend tout son sens lorsque Malherbe vient dire
que la langue française est assez, voire même trop riche, et qu'il faut maintenant
raffiner cette langue 4• Toute la cour se range derrière Malherbe, celui qui ose
s'attaquer à des figures mythiques comme Ronsard, Du Bellay et Amyot. Mais ce
•
4
Ferdinand Brunot, Histoire de la languefrançaise, T. III. p. l, Paris, Annand Colin, 1966, p. 3.
Il
•
besoin d'une langue plus pure et plus légère n'est pas imputable qu~à Malherbe.
Bien auparavan4 Bertaut et Desportes, et même l'œuvre tardive de Ronsard
montrent un effort d'épuration du vocabulaire et de la syntaxe. Le rôle de Malherbe
est de fonnaliser cette tendance et d'en faire prendre conscience à la cour. Malherbe
donne voix aux courtisans qui s'opposent à la tradition humaniste.
En ce début du XVU ième siècle, nous avons l'impression d'assister à un
combat où deux groupes bien définis s'affrontent. Mais à regarder de plus près cette
période où le français cherche à se définir, la frontière qui sépare le courtisan de
l'érudit devient très flottante, à tel point que l'image d'une confrontation serait
abusive. Il n'existe pas entre les deux groupes de division nettement tranchée. La
majorité des théoriciens de la cour ont fréquenté les cercles savants et les collèges,
où ils ont appris le latin et quelquefois le grec. Par exemple, bien que très
intimement associé à resthétique mondaine, Claude Favre de Vaugelas (1585-1650)
fréquenta dès sa jeunesse des humanistes aussi respectables que François de Sales, le
cardinal du Perron et Coëffeteau, et s'adonna tout au long de sa carrière à la
traduction d'œuvres latines, dont l'Histoire de Quinte-Curee. De même, sur
Malherbe, coryphée des
courtisans~
s'exerça puissamment rintluence du néo..
stoïcisme de Guillaume Du Vair et de Juste Lipse.
Nous pouvons encore évoquer la Nouvelle allégorie ou histoire des derniers
•
troubles arrivez au royaume d'Éloquence d'Antoine Furetière. Cet auteur a voulu y
rendre compte des tensions qui divisaient les auteurs sur la question de la langue.
12
•
Contrairement à ce qu'on eût pu penser, Furetière place La Mothe Le Vayer et les
savants dans le camp des mondains. Tous s'ailient contre l'année de Galimatias,
symbole des excès du langage précieux. Selon Furetière, savants et courtisans
partagent plusieurs idées concernant la langue. La reine d'Éloquence apprécie
beaucoup l'influence des langues et du savoir anciens, allant même jusqu'à
reconnaître l'autorité des Anciens sur la langue parlée dans son royaume.
N'oublions pas non plus que la cour de France subit l'influence du néoplatonisme, d'origine italienne. Cet idéal de beauté et d'hannonie qui, de Maurice
Scève à François de Sales, marque tous les milieux de la société française, pénètre
profondément les mœurs de la cour.
Et enfin, certains auteurs parviennent à marier l'héritage savant et les codes
de cour. lean-Louis Guez de Balzac est certainement l'exemple par excellence d'un
auteur qui fusionne humanisme et mondanité, voire préciosité. Nous pourrions
également parler d'homme de lois qui tentèrent d'introduire le discours courtisan
dans l'enceinte très fennée du Palais. Tous ces exemples nous conduisent à
considérer avec beaucoup de réserve l'idée d'un combat linguistique où
s ~ affronteraient savants et courtisans. Entre les membres de chacun des deux
groupes, les rapports sont très complexes et plurivoques.
Ne serait-il pas mieux de percevoir le débat linguistique comme un conflit
opposant plusieurs petites chapelles savantes, puisque à peu près tous les auteurs
•
proposent leur conception de la langue, sans s'identifier très distinctement à un clan
13
•
particulier. Même des initiateurs comme Malherbe et Balzac sont des savants qui
présentent avant tout une conception bien personnelle de la langue. La raison pour
laquelle il est question de langue «courtisane» est que la cour de France fait sienne
les idées de certains théoriciens savants. La préciosité de Balzac, la pureté de
Malherbe et le «bon usage» de Vaugelas sont des conceptions d'origine savante qui
ont été en quelque sorte entérinées par le pouvoir royal.
L'étude du mouvement humaniste de la fm du XVI ième siècle s'avère donc
fort importante pour comprendre l'évolution de la langue au début du XVn ième
siècle, puisque ce sont ces humanistes qui détennineront les critères de perfection du
français. À la fin du XVI ième siècle, un savant ou un érudit est très généralement
celui qui possède de vastes connaissances dans différents domaines du savoir. C'est
en 1637 que, sous la plume de Descartes, le mot «savant» se spécialise pour désigner
les hommes de science, par opposition à «docte» qui «désigne les partisans de la
vieille scolastique»5. L'on peut donc retrouver des savants à plusieurs niveaux de la
société. Le premier bassin important provient bien entendu de l'Université. Celle-ci
fonne nombre d'étudiants qui apprennent, en latin. toutes sortes de sciences, allant
de la philosophie à rarithmétique. Mais l'Université prodigue encore un
enseignement de type scolastique qui reste en général fermé aux avancées de la
nouvelle science. Les clercs n'ont que peu de considération de la part du mouvement
•
humaniste, puisque l'Université représente un aristotélisme révolu. Ces clercs seront
5
Bloch et Wartburg. Dictionnaire étymologique de la languefrançaise. 6
1èmc
éd.• Paris. PUF, 1975.
14
•
très tôt qualifiés de pédants. L'enseignement prodigué dans ces institutions sera
dénoncé tout au long du XVI ième siècle par plusieurs auteurs. entre autres par Ramus,
qui «apparaît ainsi comme l'adversaire par excellence, dans la tradition savante
française. du cicéronianisme (... ]»6, par Montaigne, Du Vair et Balzac. Ils
reprochent aux collèges de fonner la mémoire plutôt que le jugement. Ils croient que
l'accumulation d'exemples, de lieux et de modèles rhétoriques ne développe pas les
habiletés essentielles aux orateurs, à savoir la réflexion et le jugement. Gaston
Guillaumie résume en ces quelques mots les reproches de ces humanistes :
Le jeune écolier (Balzac) en sortira comme ses condisciples, bourré
de latin, la mémoire farcie de citations, familiarisé avec les
élégances artificielles de la fonne, [... ] convaincus que l'éloquence
consiste exclusivement dans la mise en œuvre des procédés de
•
7
l'Ecole.
Ce pédant des collèges deviendra un personnage ridicule. Par exemple, dans son
Histore comique de Francion (1623), Charles Sorel présente I-Iortensius, un maître
de collège, où tous les contemporains ont reconnu Balzac, comme une victime
impuissante des manigances de ses étudiants. Sorel dépeint la pauvreté de
l'enseignement scolastique par la médiocrité d'esprit et de jugement de ce pauvre
clerc.
Le second bassin de savants est celui des étudiants de l'Université qui ont
renié l'enseignement scolastique pour se tourner vers la nouveauté du mouvement
•
fi
7
Marc Fumaroli, L'âge de l'éloquence, Paris. Albin Michel. 1994, p. 579.
Gaston Guillaumie. l.L. Gue= de Balzac el la prose française, Paris. Picard, 1927. p.28.
15
•
humaniste. Plutôt que de perpétuer l'exégèse des ouvrages d'Aristote, ces savants
ont préféré revenir à la source même du savoir antique et réinterpréter les textes
sacrés et païens à partir des originaux, soit en grec, soit en latin. Ramus fréquenta le
Collège, mais il comprit ensuite combien la scolastique était erronée, ce qu'il
explique dans la préface de sa Dialectique:
[ ... ] quand je retourne des escholes Greques & Latines, & desire à
l'exemple & imitation des bons escholiers rendre ma leçon à la
patrie, en laquelle fay esté engendré & eslevé, & luy declairer en sa
langue & intelligence vulgaire le fruict de mon estude, j'apperçoy
plusieurs choses repugnantes à ces principes, lesquelles je n'avoye
8
peu apperçevoir en l'eschole par tant de disputes.
Montaigne se soulève aussi contre la scolastique, lorsqu'il préfère une tête
bien faite à une tête bien pleine, ou lorsqu'il écrit:
De vray, le soing et la despence de nos peres ne vise qu'à nous
meubler la teste de science; du jugement et de la vertu, peu de
nouvelles. 9
À son tour, Balzac dira combien l'étude de Cicéron lui donna horreur du
latin, avant qu'il ne découvre l'érudition humaniste sous la direction de son maître
Heinsius à l'Université de Leyde en Hollande. Marquant à leur façon le
xvn ième
siècle, Gabriel Naudé, Gassendi, La Mothe Le Vayer et les frères Dupuis
s'inscrivent tous dans la pure tradition de l'humanisme renaissant.
Le clergé représente un autre bassin important de la culture savante.
Toutefois, contrairement aux humanistes qui n'ont de cesse de souligner
•
1
9
Pierre de La Ramée dit Ramus, Dialectique, Genève, Slatkine Reprints, 1972, p. IX (pagination manquante).
Montaigne, Essais, livre 1. chap. XXV, Paris, PUF, ((Quadrige», 1992, p. 136.
16
•
l'importance d'étudier les textes sacrés ou païens dans la langue originale, les
religieux mènent leurs études des textes bibliques et patristiques en latin strictement.
D'une part, Luther et Calvin guident la partie réfonnée de l'Église, et d'autre part.,
des jésuites comme Caussin, Garasse et Goulu fonnent au
XVn ième siècle le pendant
tridentin. Mais ces limites ne sont pas absolues. Ceci n'empêche pas Luther et
Calvin d'adapter la religion chrétienne à la pensée humaniste et certains jésuites de
se nourrir de sagesse antique. Mais règle générale, ces différents mouvements
savants se distingueront fortement l'un de l'autre par leur perception de l'éloquence
et par leurs emprunts respectifs aux théories linguistiques antiques.
Enfin, l'on retrouve le dernier foyer de savants au Parlement de Paris.
L'enceinte du Palais pennet de faire montre de son érudition. Un sujet sérieux et
grave comme les affaires de justice demande une érudition nourrie et un langage
élevé. Dans la seconde moitié du XVI ième siècle, s'installe au Parlement une
procédure de remontrance qui, deux fois l'an, pennet à l'avocat général de faire
certaines mises au point. Celui-ci a le pouvoir de critiquer et de réprimander les
avocats récalcitrants, d'exposer ses conceptions de la justice, et de dicter les usages
qu'il faudra dorénavant observer à la cour. Or, le sujet capital de ces harangues sera
celui de l'élaboration d'une langue de la justice. Chacun leur tour, les Pibrac,
Bignon, Mangot et d'Espeisses proposeront, voire imposeront leurs conceptions de
l'éloquence parlementaire. Que ces remontrances suscitent la polémique linguistique
•
pennet au Parlement de devenir le haut lieu du débat linguistique de la fin du
17
•
XVl
ième
siècle. Nombreuses seront les conceptions qui joueront des coudes dans
cette petite enceinte. Faut-il gaver un plaidoyer de citations pour étaler son érudition,
au risque de déplaire à son auditoire? Ou est-il préférable de charmer l'oreille, mais
de porter préjudice au sérieux et à la crédibilité de l'avocat?
Lors des guerres de Religion, l'affaiblissement du pouvoir royal accroît
d'autant la puissance du Parlement de Paris, donnant ainsi à la monarchie française
des allures de république antique. L'orateur devient tout à coup une figure
importante de la société. René Radouant remarque que le Parlement n'est pas le seul
lieu où puisse s'exercer l'orateur. Il prend aussi la parole lors des États-Généraux de
Blois et en pleine rue, pour y persuader le peuple. Même les hommes de guerre
mettent à profit leurs talents oratoires pour gagner la confiance de leurs soldats 10.
Dans le dernier quart du siècle, le Parlement de Paris possède donc l'autorité
nécessaire au contrôle de l'évolution de la langue. Il
devient~
selon Marc Fumaroli,
«le carrefour des débats de la République des lettres» Il. Le Palais reflète toutes les
tendances. Les différentes influences savantes, de J'atticisme à J'asianisme, luttent
pour une reconnaissance. Le Palais est un bassin d'expérimentation où toute sorte de
combinaisons sont testées et soumises à l'approbation du jury, c'est-à-dire aux
avocats de la cour. On retrouve des précieux et des pédants, des humanistes et des
•
\0 René Radouant, «Éloquence politique ou d~libérative», in Guillaume Du Vair, De / 'e/oquence françoise,
Genève, Slatkine Reprints, 1970, p. 54-74.
\1 Marc Fumaroli, op. cil., p. 472.
18
•
cicéroniens, en somme une pluralité de
VOIX.
Dans les débats linguistiques du
XVn ième siècle, le rôle du Palais diminue, mais est loin de disparaître complètement.
Bien que l'universitaire, l'humaniste, le religieux et l'avocat soient tous
qualifiés de «savants», aucun de ces groupes n'embrasse l'immense héritage antique
de la même façon. Nous verrons clairement que chacun des groupes érudits
s'approprie tels orateurs plutôt que tels autres, puisque ceux-là développent des
idées correspondant bien à leurs dogmes. Ces différents groupes d'érudits iront
même jusqu'à occulter certaines conceptions d'un auteur pour ne retenir que celles
dont ils ont besoin. Le meilleur exemple reste celui de Cicéron: ses idées sur
l'éloquence servent autant les cicéroniens que les anticicéroniens, qui sont pourtant
deux camps ennemis. Tout dépend de la façon d'interpréter les écrits ou de l'habileté
à mettre en lumière tel passage plutôt qu'un autre.
Les savants de la Renaissance ne manquent jamais d'appuyer leurs théories
linguistiques sur l'autorité des Anciens, quitte à galvauder le sens des textes qu'ils
invoquent. Globalement, nous pouvons distinguer deux grandes positions. L'une
platonicienne, rejette la technique pour regarder l'éloquence comme un don. L'autre,
aristotélicienne, définit la rhétorique comme un art, dont l'orateur connaît et codifie
toutes les ressources. L'éloquence romaine retrouve, pour l'adapter au génie latin,
ces deux grandes tendances de la rhétorique grecque. Le pseudo-Longin et les
stoïciens de l'Empire reprendront les idées de Platon, alors que Cicéron et Quintilien
•
réviseront celles d'Aristote. Enfin, les Pères de l'Église récupéreront à nouveau les
19
•
enseignements de Platon et d'Aristote, saint Augustin et saint Thomas se faisant
respectivement la voix des thèses platoniciennes et aristotéliciennes. À la
Renaissance, reprenant contact avec tous ces textes, les humanistes renouent avec
cette dichotomie marquante de la pensée linguistique de l'Antiquité.
Dans le Phèdre et le Gorgias, Platon tente de définir ce qu'est le langage
humain. Cette faculté donnée à l'homme raisonnable ne se limite pas simplement,
comme chez l'animal, à la parole proférée (prophorikos), c'est-à-dire aux sonorités
produites par l'appareil vocal. L'homme a également la capacité d'organiser ces
paroles de façon à créer du sens, un discours logique et raisonné. Il doit donc se
produire, pour qu'il Y ait sens, une activité rationnelle, qui est aussitôt communiquée
sous fonne de discours. Pour Platon, ce discours intérieur (dianoia) est la pensée, et
il existe entre la parole proférée et la pensée une relation d'identité. Ce que Curzio
Chiesa explique en ces tennes :
Cette thèse stipule que le langage et la pensée sont la même chose,
dans la mesure où il s'agit de la même structure discursive qui
s'articule dans les sons de la voix et dans le discours silencieux de
l'âme avec elle-même. 12
Cette donnée de la théorie linguistique, selon laquelle la pensée se projette telle
quelle dans le discours, aura une importance capitale pour les linguistes de la
Renaissance, car le discours proféré n'est en fin de compte qu'une simple
•
12 Curzio Chies~ «Écrire dans l'âme»), in Réflexions contemporaines sur / 'Antiquité classique, Grenoble,
Groupe de recherches Philosophie, Langages et Cognition, 1996, p. 109.
20
•
représentation de l'activité psychique. C'est là tout le sens, le double sens en grec,
du mot logos.
Dans son Phèdre, Platon s'attaque à la difficulté de détenniner la nature du
discours parfait. Connaître quelles sont les qualités
d~un
discours qui réussira à
convaincre l'auditoire de façon unanime constitue pour les Grecs un questionnement
fondamental~
puisque la parole est principalement un outil social qui pennet, dans
une structure démocratique, d'acquérir le pouvoir et la connaissance. Le dialogue de
Platon débute donc par le discours de Lysias sur r Amour, que reprend Phèdre pour
l'avoir entendu plus tôt. Socrate répond à son interlocuteur par un autre discours qui
tente de prouver le contraire de ce que Lysias postulait. Mais Socrate s'interrompt au
milieu de son discours pour montrer la futilité de ce procédé rhétorique. À quoi sert
une telle dialectique, qui ne vise qu'à renverser les thèses de son opposant? Mais
tout à coup, lorsqu'il s'apprête à partir, abandonnant tout espoir de produire un beau
discours~
Socrate est pris d'un élan divin qui lui fait dire:
En outre ils sont tous deux [les précédents discours] d'une sottise
vraiment plaisante : bien qu ~ ils ne disent rien de sensé ni de vrai, ils
prennent de grands airs. comme s'ils valaient quelque chose. parce
qu'ils trompent quelques nigauds et se font un renom panni eux. 13
Toujours inspiré par les dieux~ Socrate poursuit avec un nouveau discours devant
expier le premier, qui résultait de la prétention de l'homme à confondre son
semblable. L'inspiration divine est un souffle qui s~empare de Pâme de l'orateur
•
IJ
Platon. Phèdre, Paris, Garnier-Flammarion, 1964, p. 120.
21
•
pour lui communiquer la vérité. Non seulement s'inscrit-elle dans l'âme, mais la
vérité est aussitôt mise en discours par l'orateur en des tennes qui témoigne bien de
son origine divine. Selon Platon, aucune technique oratoire, fùt·elle durement
acquise, ne peut supplanter l'inspiration, ou du moins l'engagement profond de
l'âme tout entière. Il ne reste qu'à espérer la grâce des dieux, à favoriser sa venue
par la pratique de la philosophie.
Platon n'est pas le premier à parler de l'inspiration divine comme critère de
beauté et de perfection. Platon s'inspire certainement de la poésie de Pindare. Mais
l'importance de la figure de Platon aux yeux de la postérité jette dans l'oubli ses
vénérables prédécesseurs. C'est donc aux textes platoniciens que les penseurs des
siècles suivants iront puiser cette notion détenninante de l'enthousiasme, ou de
l'ingenium ainsi que le définit Benoît Timmennans l4 • L'orateur platonicien se fait
donc le porte-parole d'un message de vérité, et le discours qu'il produit traduit ce
discours divin. La vérité s'éclaire d'elle·mëme, le fard de la rhétorique lui est inutile.
Le discours de Lysias dans le Phèdre a beau détenir toutes les qualités esthétiques,
son discours sur l'Amour est ridicule, puisqu'il ne révèle pas la vérité.
Une grande partie du dialogue intitulé Gorgias tente justement de démontrer
la vanité de la rhétorique. L'art d'enseigner s'oppose à l'art de convaincre. Socrate
s'exprime en ces tennes: «Je te propose alors de distinguer deux sortes de
persuasions, l'une qui crée la croyance sans la science, l'autre qui donne la
•
14 Tenne utilisé par BenoÎt Timmennans dans «Renaissance et modernité de la rhétorique», in Michel Meyer
(dir')J Histoire de la rhétorique des Grecs à nos jours, Paris, LOF, «Livre de Poche», 1999, p. 83-243.
22
•
science.» 15 Socrate dira même que la rhétorique n'est pas digne d'être un art, elle
n'est que flatterie, créatrice de laideurs et de mensonges. Il se soulève contre le fait
que l'orateur puisse surpasser le médecin en médecine, sans posséder aucune
connaissance, simplement par le truchement de belles paroles qui persuadent le
patient. La philosophie de Platon condamne cette illusion, et tous ces efforts de la
sophistique qui tente de tromper les sens et la raison. La principale conséquence est
qu'il sépare radicalement la philosophie, qui est une recherche de vérités, de la
rhétorique, qui est un plaidoyer en faveur de l'un des partis possibles, c'est-à-dire de
ce qu'Aristote appellera le <<vraisemblable».
Aristote se fera le théoricien de cet autre courant linguistique qui définit la
rhétorique comme une «technique». Il ne faut toutefois pas croire qu'Aristote
combatte directement la pensée de Platon. Les présupposés épistémologiques
d'Aristote, qui pennettent de considérer la rhétorique comme un art, ne sont pas les
mêmes que ceux de Platon. La théorie des Idées pennettait d'accéder à la
connaissance absolue d'un être. Aristote, instituant la multiplicité de l'être, autorise
l'utilisation de la rhétorique et la place au niveau de la philosophie. Parallèlement au
domaine de la science, où la connaissance s'acquiert grâce à l'élaboration de
prémisses vraies dans le syllogisme, la Rhétorique propose à l'orateur un art
d'interroger et de connaître le domaine des vraisemblables où l'homme évolue, de
raisonner grâce au syllogisme tronqué, aussi appelé enthymème. La rhétorique
•
15
Platon, «Gorgias», in Pro/agoras, Gorgias, Ménon. Paris, Gallimard, «Teb), 1991, p. 76.
23
•
apparaît alors comme cette science de l'accident, que dans la Métaphysique Aristote
dit ne point exister. Il existe trois «arguments» propres à la rhétorique: les
différentes façons de se présenter à la foule (ethos), les moyens de susciter les
diverses passions de son auditoire (pathos), et les différents types de raisonnements
logiques (logos). Les critiques qui frapperont, à la Renaissance, cette vision de
l'éloquence, voudront que la rhétorique ne soit qu'un simple ramassis de procédés
oratoires qui ne font que confondre, tromper et duper la foule. Aristote devient alors
victime de ses affinités avec la sophistique, où l'excellence consiste à plaider aussi
bien le pour que le contre. D'ailleurs, le nom d'Aristote et sa Rhétorique seront
intimement associés, à la Renaissance, à la scolastique médiévale. Les collèges
professent un enseignement basé sur un ensemble de fonnules rhétoriques
stéréotypées, souvent très éloignées de la rhétorique du grand philosophe.
Un phénomène semblable affecta l'œuvre colossale de l'héritier de toute la
réflexion athénienne sur l'éloquence. Après que Platon eut dissocié philosophie et
rhétorique, et que les écoles philosophiques et rhétoriques eurent évolué de façon
divergente, Cicéron, afin d'instituer un parfait orateur, tenta de réunir l'orateurphilosophe platonicien à l'orateur-sophiste aristotélicien. La rhétorique est un art qui
devient nécessaire au philosophe, puisque, pour propager sa connaissance, il doit
savoir parler au peuple. Inversement, l'orateur doit acquérir une science qui
nourrisse ses discours, sinon vides de sens. Cicéron essaie de fondre en un seul
•
orateur la parole humble et simple des stoïciens platonisant avec la véhémence des
24
•
théories pathétiques des sophistes. Se réglant sur le decorum.. sur une bienséance de
la fonne et du contenu du discours, Cicéron valorise autant l'ethos que le pathos, le
fond que la forme, la force que la beauté. À la Renaissance, les savants se
partageront l' œuvre de Cicéron, ruinant du même coup l'idée maîtresse de son
œuvre., celle-là même d'offrir à l'orateur une variété quasi infinie de styles oratoires
et d'attitudes éthiques. Les anticicéroniens accapareront la figure impérieuse et
méditative de l'orateur constamment préoccupé des affaires d" État, et les
cicéroniens, celle véhémente et fougueuse., qui convainc à force d'ornementations
flamboyantes. Puisqu'il sera une référence incontournable aux différentes factions,
Cicéron devient., au XVI ième siècle, une figure quasi divine.
Environ un siècle après la mort de Cicéron et de la République romaine. les
idées platoniciennes sur le langage seront reprises par rauteur anonyme d'un texte
qui marquera les recherches linguistiques de la Renaissance: le traité intitulé Du
sublime. Cet auteur grec du 1et" siècle de l'ère chrétienne expose ce qu'est
«rexcellence et la souveraine perfection du discours» 16. Ce traité ne vise pas les
orateurs civiques, car depuis la naissance de l'Empire, l'homme politique a passé le
flambeau au poète, chantre du pouvoir impérial. Virgile en poésie. Sallustre et TiteLive en histoire.. ces nouveaux orateurs consacrent leurs talents à chanter la gloire de
1"empereur.
•
16
Du sublime. Texte établi et traduit par Henri Lebègue. Paris. Belles Lettres. 1952. p. 3.
25
•
Mais quelle est cette langue qui «est comme la foudre» et qui «disperse tout
sur son passage» 17. Contrairement à l'enthousiasme de Platon, le sublime du pseudoLongin ne repose pas seulement sur un don. L'influence de Cicéron se fait sentir
lorsqu'il affinne que l'art, c'est-à-dire les figures de mots et d'idées, le rythme et la
grammaire, doit se combiner à une nature prédestinée pour atteindre le sublime.
Selon le pseudo-Longin, est sublime seulement celui qui possède une grande âme,
une âme capable des plus hautes passions. L'inspiration
fi' est
plus de l'ordre du
divin, comme chez Platon, où Eros prenait littéralement possession de l'orateur.
Cependant, nous savons que le pseudo-Longin fut influencé par Posidonius (-135....51), philosophe stoïcien platonisant. Or, si nous lisons le pseudo-Longin à la
lumière des conceptions stoïciennes, nous comprenons que le sublime est plus
qu 'humain. Selon les stoïciens, le sage se confond avec la divinité. Pour emprunter
une image à Juste Lipse, Dieu est une étincelle qui illumine l'âme et la raison
humaine. Ainsi que l'orateur de Platon se laissait posséder par un dieu, celui du
pseudo-Longin perçoit, et fait percevoir par son verbe, la nature divine de la flamme
qui le brûle. À l'instar de l'enthousiasme platonicien, le sublime ne saurait se
soumettre à des règles rhétoriques précises:
C'est pourquoi on admire parfois une pensée nue, réduite à ellemême et muette, à cause de cette noblesse même de sentiments.
•
17
Ibid., p. 3.
26
•
Ainsi le silence d'Ajax dans la Nékyia a ce degré de grandeur
auquel nul mot ne peut atteindre. 18
Et afin d'illustrer cette suprématie de l'idée sur la perfection fonnelle du discours, le
pseudo-Longin utilise une image qui préfigure de façon étonnante le débat
linguistique qui occupera les savants et les courtisans du
xvn ièmc siècle. Elle oppose
Platon, chercheur de vérité, et Lysias, producteur de belles phrases. Le pseudoLongin n'aura de cesse de dire combien les indélicatesses stylistiques de Platon ne
rabaissent en rien la grandeur du message qu'il veut transmettre. À l'inverse, la
perfection du rythme et de la mesure ne sauraient élever l'œuvre de Lysias au
sublime. Il ne peut atteindre le génie de Platon qui «dépasse souvent les bornes du
monde qui l'enveloppe [... ]»19. On retrouvera dans les Considérations sur
l'Eloquencefrançoise de ce lems (1637)20 de La Mothe Le Vayer une argumentation
pratiquement identique à ce passage du traité Du sublime :
Pour moi, je le sais, les natures supérieures sont le moins exemptes
de défauts, car le souci d'être correct en tout expose à la minutie, et
il en est des grands talents comme des immenses fortunes : il faut y
laisser quelque place à la négligence. [...] les esprits bas et
médiocres, parce qu'ils ne s'exposent jamais, qu'ils n'aspirent pas
aux sommets, restent le plus souvent mieux préservés des fautes et
Ibid. p. 12.
Ibid., p. 50.
20 Voir La Mothe Le Vayer, «Considérations sur l'Eloquence françoise de ce tems», in Œuvres :précédées de
l'abrégé de /a vie de La Mothe le Vayer, Genève, Slatkine Reprints, 1970, p. 267 (201): «r{ est, dit-il
[Longin], des vertus de l'Oraison à peu près comme des richesses, dont ceux qui ont le plus, & qu'on peut
dire être dans l'opulence, negligent mille petites choses, que les pauvres estiment grandement.» (La
pagination entre parenthèse est celle de l'édition originale, Dresde, Groell, 1756-59.)
18
19
•
27
•
des faux pas et que les grands esprits soient sujets à tomber du fait
de leur grandeur même. 21
Le pseudo-Longin fait donc de la grandeur d'âme le premier critère de
l'éloquence. Le sage stoïcien, Sénèque par exemple, devient donc l'image de
l'orateur parfait, image qui aura énormément d'importance chez les anticicéroniens
de la Renaissance. De là vient l'immense popularité de l'ethos dans les œuvres de
Budé, Érasme et bien entendu, Guillaume Du Vair. Tout le poids de l'argumentation
repose sur la sagesse et l'élévation de l'orateur, plutôt que sur le pouvoir de soulever
les passions ou d'utiliser des développements logiques.
Cette conception de l'éloquence, se fondant non sur l'art, mais sur
l'ingenium, aura d'ailleurs sa version chrétienne. Dans son texte De l'enseignement
chrétien, saint Augustin écrit :
Dans les endroits (discours) où il se trouve que les doctes la
(l'éloquence) reconnaissent, les choses qui sont dites sont telles que
les mots qui les disent ne paraissent pas apportés par celui qui parle
mais semblent se joindre comme spontanément à ces choses mêmes,
comme si on comprenait que la sagesse sort de sa maison, c'est-àdire du cœur du sage et que l'éloquence la suit inséparablement
22
comme une petite servante, même sans avoir été appelée.
On retrouve à nouveau l'orateur platonicien saisi par une force qui le dépasse
entièrement. Les mots qu'il utilise ne sont pas de lui, mais émanent des sujets qu'il
aborde. Alors que Platon associe ce génie à l'emprise des dieux grecs et le pseudo-
•
21
Op. cil., p. 47.
Saint Augustin, De ['enseignement chrétien, IV, 6, 10, in Théologiens et mystiques au Moyen Âge. La
poétique de Dieu, édition et traduction de Alain Michel, Pa';s, Gallimard, «Folio», 1997, p. 103.
22
28
•
Longin à la nature de l'âme stoïcienne, saint Augustin fait intervenir l'Esprit du
Créateur. La parole proférée n'a pas besoin d'un travail esthétique pour être
révélatrice de vérité. C'est une parole brute. Saint Augustin «se livre du même coup
à une critique implicite de l' ornatus païen» 23. Il affinne encore dans son traité De
"ordre
24
que la rhétorique est nécessaire seulement parce qu'aveuglés par la sottise,
les hommes se doivent d'être émus et transportés par de beaux discours afin de saisir
un message pourtant simple pour celui qui voit clairement. L'éloquence de la
«sincérité» est à la Renaissance un argument qui garantit le discours contre la
prétention et la superficialité des courtisans, qui redonnent vie aux sophistes de la
Grèce antique.
L'augustinisme ne sera pas sans influencer Guillaume Du Vair dans sa
conception de la langue. Alors qu'il tente d'unir la philosophie païenne et la religion
chrétienne, les termes qui serviront à identifier ce génie qui accapare l'âme de
l'orateur seront toujours d'une certaine ambiguïté sémantique. Par exemple, afin
d'être éloquent, l'orateur de Du Vair doit posséder de grandes passions et une solide
vertu. Les passions de Du Vair semblent s'apparenter davantage à l'héritage stoïcien
du pseudo-Longin, et la vertu, aux qualités chrétiennes. Mais ce mariage est en luimême contraire, aussi bien au stoïcisme qu'au christianisme.
•
23
24
Marc Fumaroli, op. Cil, p. 71 .
Saint Augustin, De l'ordre, XIII, 38, in op. Cil., p. 92.
29
•
Michel de Montaigne donne un bon exemple d'un style rejetant l'esthétique
au profit de la parole simple et franche. Considérablement influencé par la langue de
Sénèque, Montaigne dénonce le style grandiloquent et ostentatoire de Cicéron, et
croit que ce genera dicendi n'est que mensonge et dissimulation. Montaigne répète
sans cesse, dans son essai intitulé «Considération sur Cicéron», que le temps
employé au travail des verba est une perte de temps, et qu' <<il devoit estre employé à
choses plus necessaires et utiles»25. Il ajoute plus loin: «Fy de l'eloquence qui nous
laisse envie de soy, non des choses»26. Paradoxalement, c'est plutôt le style humile
qui est porteur de sublime, une langue qui naturellement et spontanément représente
la pensée de l'auteur, sans aucun détour rhétorique. Socrate incarne parfaitement ce
discours de l'humilité et de la simplicité:
[...] la façon d'argumenter de laquelle se sert icy Socrates est elle
pas admirable esgalement en simplicité et en vehemence? Vrayment
il est bien plus aisé de parler comme Aristote et vivre comme
Caesar, qu'il n'est aisé de parler et vivre comme Socrates. Là loge
l'extreme degré de perfection et de difficulté: l'art n'y peut
..
d 27
jOln re.
Bien sûr, malgré ses dénonciations, Montaigne n'échappe pas lui-même à la
rhétorique. Mais c'est surtout parce qu'il privilégie la parole privée, celle de la
discussion intime, de l'entretien, qu'il ne peut servir de modèle aux savants qui
cherchent à définir l'éloquence française. Ce niveau de style ne s'applique pas aux
genres traditionnels de la rhétorique. Les orateurs ne peuvent rejeter en bloc
•
Montaigne, op. cil., livre l, chap. XL, p. 251.
Ibid, p. 252.
27 Ibid., livre III, chap. XII, p. 1055.
25
26
30
•
l'enseignement d'Aristote et de Cicéron. Or, même un orateur empreint de la
philosophie stoïcienne, de la brièveté de Sénèque et de l'humilité de saint Augustin
comme l'est Guillaume Du Vair, ne peut nier l'importance des rhéteurs grecs et
latins dans l'élaboration d'une brillante éloquence française. Du Vair admet, dans
une certaine mesure, le rôle de l'art.
Dès le début de la Renaissance, Érasme bataillait pour un logos qui soit basé
sur l'immense vertu de l'orateur. Il dénonce l'attitude morale de l'Église, qui
n'hésite pas à pratiquer l'argumentation sophistique pour confondre ses adversaires.
Il veut montrer que les orateurs de la chaire, moralement corrompus par le luxe et le
pouvoir, sont nécessairement incapables de s'exprimer avec éloquence. L'orateur
doit être d'une vertu irréprochable, ce qui inspire sa parole. C'est pour cette raison
qu'Érasme critique ardemment le latin classique. Celui-ci est une langue morte qui
ne pennet pas d'exprimer les réalités modernes. Or, son désir de l'enrichir à même
le latin médiéval, et donc de diluer, selon certains, l'excellence du latin, est à
l'origine de tout le mouvement d'augmentation de la langue française au XVI ième
siècle. Il défend l'idée qu'une âme forte et puissante doit pouvoir compter sur une
langue flexible et riche pour lui permettre d'exprimer son génie. De là vient cet
argument des linguistes savants du XVII ièmc siècle, qu'il ne faut pas procéder à une
purification extrême du vocabulaire, puisque ainsi on asphyxie en quelque sorte
l'orateur véritable. Devant le purisme de Malherbe et des courtisans du
•
xvn ième
31
•
siècle, La Mothe Le Vayer et Marie de Gournay emploieront souvent cet argument
de la liberté et de la richesse linguistique.
L'éloquence du Palais reflète à sa manière cette conception de l'ingenium. À
côté de l'éloquence visant l'éclat oratoire grâce à un ingénieux accord de sonorités
et de mots à la mode, se développe un courant opposé, initié par Michel de
L' Hospital, approfondi par Guillaume Du Vair et porté à son apogée par Jérôme
Bignon. Il propose comme idéal d'orateur l'homme dont la probité et l'instruction
en matière religieuse lui octroient un logos qui s'apparente au Verbe divin. Du Vair
trouve dans la philosophie stoïcienne une éloquence humaine, mais inspirée par un
logos qui s'élève jusqu'aux dieux. Ce qui lui fera dire dans son Eloquence françoise
que la fréquentation des Anciens imprègne l'âme de leur sagesse. De même le
pseudo·Longin parle des «effluves» qui s'échappent des œuvres des Anciens et qui
rehaussent l'âme de l'orateur.
Mais plus tard, fréquentant davantage les Pères de l'Église, donnant ainsi
naissance «aux grandes remontrances d'inspiration néo-platonicienne»28, Du Vair
donne son envol à la raison humaine qui alors se confond avec la parole divine.
C'est à l'étude de saint Augustin que sera due l'élévation de la parole humaine vers
les voûtes
célestes. Jérôme
Bignon sera l'homme de justice qui marie
harmonieusement sagesse humaine et divine, pour concevoir un orateur hautement
vertueux, faisant montre d'une éloquence toute divine. Du Vair et Bignon suivent
•
21
Marc Furnaroli, op. cil., p. 555.
32
•
ainsi de près l'enseignement de Guillaume Budé qui affirme dans le De Transitu que
la philosophie païenne pennit à l'homme d'atteindre un certain degré de sagesse
humaine, et qu'ensuite, la théologie éleva l'âme humaine vers les choses divines.
La théorie de l'ingenium influencera aussi beaucoup l'Église réfonnée.
Luther et Calvin s'attacheront aux thèses de saint Augustin, puisqu'ils perçoivent le
langage comme un dialogue direct entre Dieu et l'homme, où la rhétorique est
inutile. Chaque homme, s'il est réceptif aux signes que lui envoie Dieu, verra et
percevra la grandeur divine. Son esprit sera pris par la divinité. La contre-réfonne
privilégie au contraire une rhétorique des passions, où un homme parle à un autre
homme, dans le but de le toucher et finalement, de le gagner. La persuasion devient
un élément essentiel de la stratégie tridentine. C'est l'ordre créé en 1540 par saint
Ignace de Loyola et mandaté par le concile de Trente qui aura pour tâche de
développer et ensuite de répandre cette conception d'une rhétorique conune
instrument de propagande religieuse. La compagnie de Jésus soulignera cette partie
très limitée qu'est l'emportement, voire l'enflure du genre élevé décrit par Cicéron.
Ce style, où tout l' ethos et tout le pathos ne sont qu'éblouissement, s'inscrit à
l'opposé de l'ethos pondéré et inspiré de l'anticicéronien. Cet asianisme atteint son
apogée dans La cour sainte (1624) du Père Caussin (1583-1651 ). Tout est mis en
œuvre afin de channer et ainsi persuader l'assemblée des fidèles.
Ce faste de la rhétorique jésuite aura une incidence énonne sur l'éloquence
•
mondaine. En effet, les jésuites étant profondément liés au pouvoir royal, la cour
33
•
n'est par conséquent qu'un miroitement de cette esthétique baroque. Comme
l'explique Benoît Timmennans, le courtisan français n'a plus à persuader ses
condisciples du pouvoir de Dieu et du roi, puisqu'ils sont tous des «créatures» de ce
pouvoir
29
•
L'essentiel du rôle du courtisan consiste à refléter l'ordre et la cohésion
du pouvoir en place. Toujours dans la foulée du cicéronianisme, l'asianisme des
jésuites évolue vers un atticisme de cour. Incarnation du pouvoir central, la cour
croit devoir fixer l'usage de la langue du royaume. Elle cherche à définir un français
classique, sur le modèle de Rome, dont la langue et la littérature témoignaient de la
puissance. Cicéron ne cesse de répéter que la «latinité» (latini/as) est le premier des
critères de l'élocution. Les courtisans français se feront ainsi un point d'honneur de
définir leur «francité».
Mais cette réduction de l'éloquence à l' elocutio, de la persuasion au seul but
du de/ectare, redéfini par les cours italiennes, ne saurait convaincre les savants
humanistes du
xvn ième
siècle. Tente donc de s'organiser une riposte autour de
l'érudit François de La Mothe Le Vayer. Ce philosophe sceptique, issu du milieu
juridique, qui réside maintenant à la cour de Richelieu, couche sur papier sa
conception de l'éloquence française. En 1637, il rédige ses Considérations sur
/ 'Eloquence françoise de ce lems. La particularité de cet ouvrage est de faire fi de
toute la querelle cicéronienne qui partagea si longtemps et si sévèrement les
néoplatoniciens et les cicéroniens à tendances sophistiques. La Mothe Le Vayer
•
29
Benoît Timmermans, op. cit., p. 169.
34
•
restaure l'idée première et entière du plus grand des orateurs. La Mothe Le Vayer,
comme l'avait fait Cicéron, se propose de rétablir l'union entre philosophie et
rhétorique. Selon La Mothe Le Vayer, l'orateur est un philosophe abreuvé de
sagesse sceptique d'abord, mais parfois platonicienne lorsqu'il écrit qu'«il
n'estimoit point de veritable Éloquence, que celle qui nous ravit d'admiration»3o.
L'orateur que décrivait Du Vair dans son Eloquence françoise était sensiblement le
même que celui de La Mothe Le Vayer, bien que l'inspiration platonicienne et
augustinienne mt nettement plus marquée chez Du Vair. La principale tâche de La
Mothe Le Vayer sera donc de réfléchir sur les idées, privilégiant ainsi les res plutôt
que les verba. Il fait de cet axiome son argument majeur contre l'éloquence de cour.
Les théories puristes de Malherbe et les Remarques (1647) sur le «bon usage» de
Vaugelas réduisent tranquillement toute la rhétorique à la seule elocutio, au seul soin
des paroles, sans égard aux idées développées. La Mothe Le Vayer cherche à
dénoncer cette pratique : «Car d' emploier de belles paroles à debiter des choses de
néant, c'est être ridicule en perdant le tems»31. Tandis qu'il tente d'expliquer que
l'éloquence n'est pas digne de ce nom sans l'aide de la philosophie, il compare l'art
oratoire à un ibis:
[... ] ses plumes noires representoient nôtre discours interieur, & le
merite de nos pensées; sans lequel toutes nos paroles pour elegantes
qu'elles soient, & tout nôtre discours exterieur dont les plumes
•
30
31
Fr. de La Mothe Le Vayer, op. cil., t. l, p. 294 (311).
Fr. de La Mothe Le Vayer, «La rhétorique du Prince») in op. cit., t. 1. p. 162 (179).
35
•
blanches de l'Ibis étoient le symbole,
32
considerable.
n'auroient rien de
Toujours selon La Mothe Le Vayer, qui s'inspire de la plus pure tradition
cicéronienne, il faut soumettre l'oratio à la ratio. La langue doit refléter la pensée. Il
faut donc que la langue soit d'une grande souplesse pour être capable d'exprimer,
quelque délicates qu'elles soient, de profondes réflexions. C'est au nom de la liberté
que La Mothe Le Vayer et Marie de Gournay joindront leurs efforts pour combattre
le pwisme de l'éloquence courtisane. Le premier, s'inspirant beaucoup de la
réflexion du pseudo-Longin, tente de démontrer que les fautes stylistiques et
syntaxiques ne sauraient nuire à la véritable éloquence. Le génie autorise la licence,
comme l'explique ce passage des Considérations:
Ils [les grands Precepteurs de l'Éloquence Grecque & Romaine]
nous ont enseigné de mépriser tellement la curiosité des mots,
quand il est question d'expliquer quelque haute et importante
pensée, qu'ils ont mis même je ne sai ~uelle grace, & quasi une
vertu oratoire en cette loüable negligence. 3
De même, dans ses Advis (1641), Marie de Gournay plaidera en faveur d'une
plus grande liberté linguistique. Elle fulmine continuellement contre les droits de
censure que s'arrogent les «frisez et poupées de Cour» 34
:
Bon Dieu donc que ces nouveaux Docteurs sont aises, d'avoir
trouvé la faculté de regenter et de triompher du mestier à si bon
marché, que de mettre seulement la rature dans l'Ouvrage qu'on
•
Ibid.• t. 1. p. 163 (180).
Ibid. t. r. p. 267 (201).
34 Marie de Gournay, Les idées littéraires de Marie de Gournay. édition de Anne Uildriks, Groningen, Druk,
p. 113.
J2
J3
36
•
leur présente~ Disons't trouvé le droit de coupper~ trancher, doller, à
tort et à travers, tant plus ambitieusement, de ce que celuy qui plus
retranche, emporte pour eux la Courronne sur ses compagnons :35
Mais La Mothe Le Vayer et Marie de Gournay défendent-ils la même cause? Bien
qu11s s'unissent pour combattre les courtisans et qu'ils n'hésitent pas à se citer
réciproquement, Marie de Gournay diffère en ce qu'elle considère la poésie comme
le langage de l'éloquence suprême, la «grandiloquentia». Elle s'écarte aussi des
idées de La Mothe Le Vayer par son héritage purement platonicien. Nous ne
pouvons douter qu'elle reprenne les thèses de Ronsard et l'inspiration platonicienne
lorsqu'elle écrit :
Horace d'ailleurs't denie absoluement le tiltre de Poëte à celuy de
qui l'eloqution demeure dans les tenues du langage courant: [ ... l
De tout temps aussi la mesme Poësie s'est raict baptiser le langage
36
des Dieux et non des Humains.
La Mothe Le Vayer utilise exactement la même image que Du Vair pour évoquer
cette influence subtile mais déterminante des Anciens. celle de l"homme qui brunit
simplement à marcher au soleil :
Si est-ce que pour peu que nous meditions sur ce qui nous reste de
leurs incomparables travaux, il est impossible que nous n'en tirions
insensiblement beaucoup de profit, de même que ceux qui prennent
de la couleur & se hâlent sans y penser en se promenant au Soleil. 37
D'autre part, de nombreux indices montrent que La Mothe Le Vayer accueille
aussi dans son traité la tradition renaissante du cicéronianisme. Contrairement à
•
3S
36
37
Ibid, p. 103 .
Ibid., p. 105.
Fr. de La Mothe Le Vayer, op. cil., t. 1, p. 290 (296).
37
•
Platon et à ses adeptes renaissants, La Mothe Le Vayer ne rejette pas l'utilité de la
rhétorique. Suivant l'esprit d'Aristote et de Cicéron, se rappelant constamment la
modération et la «médiocrité» de Denys d' Halicarnasse pour ne pas tomber dans
l'exagération des courtisans et des rhéteurs baroques, il croit que la rhétorique est ce
qui donne de la grandeur au langage naturel. La conception de La Mothe Le Vayer
est bien visible dans ce passage où il dit «que les plus belles femmes relevent l'éclat
de leurs beautez naturelles, par l'application d'une moûche qu'elles se mettent sur le
visage»38. L'art sert donc à rehausser des paroles, quÏ n'ont jamais de valeur qu'en
raison des idées qu'elles expriment.
L'éclectisme est la notion clé de l'éloquence, telle que la conçoit La Mothe
Le Vayer. L'éloquence, loin d'être une simple restauration de Cicéron, est un savant
tissu d'influences très diverses. Reprenant l'image si chère à Cicéron, La Mothe Le
Vayer écrit dans ses Considérations, qu'à l'instar du peintre Zeuxis, qui peignit son
Hélène à partir de toutes les plus belles femmes de Crotone, l'orateur doit fonner
son goût et sa science au contact de plusieurs types d'orateurs. Alléguant ensuite
Quintilien, La Mothe Le Vayer explique que cet orateur recommandait
principalement Cicéron comme modèle à suivre. Mais il insiste beaucoup sur le fait
que Quintilien
[... ] conseille neanmoins qu'en imitant un si excellent prototype, on
tache d'y ajoûter la force du style de Cesar, ('âpreté qui
•
31
Ibid., p. 270 (213).
38
•
recommandoit l'Orateur Cœlius, la diligence de Poilion, & le
jugement de Calvus. 39
La Mothe Le Vayer emprunte à Socrate son intérêt pour la philosophie; à Isocrate,
l'utilisation systématique des règles de la rhétorique; au pseudo-Longin, la liberté du
génie et l'émulation des Anciens; à Démétrius et Denys d'Halicarnasse, cette idée de
la juste mesure; et finalement, à Cicéron, une réflexion qui prône la variété et
l'universalité de la rhétorique. Nous verrons comment cet éclectisme est en fait
profondément lié à son scepticisme.
Dès le début du
xvn ième siècle, les savants et les humanistes perdirent le peu
de pouvoir qu'ils avaient conquis. La cour devient la seule scène du pouvoir et la
seule place où puisse encore se développer un grand orateur. Du Vair, en 1595,
s·adressait encore au gens du
Parlement~
La Mothe Le Vayer, en
1637~
ne
s~adresse
qu'aux courtisans. Il est possible de reprocher aux Considérations leur petit air
vieillot et passéiste, qui veulent perpétuer un humanisme savant qui soit résolument
du siècle passé. Nous pourrions aussi percevoir ce texte comme une simple
condamnation de l'éloquence courtisane au profit d'une éloquence civile chimérique
dont la nature de l'Etat français ne pennet plus la réalisation. Mais les
Considérations, loin de vouloir détrôner l'éloquence courtisane, tentent plutôt de la
guider vers une perfection où doit coïncider l'érudition renaissante et une grâce tout
aulique. La Mothe Le Vayer se fait le théoricien d'une synthèse entre réloquence
•
39
Ibid. p. 291 (299).
39
•
savante et l'éloquence mondaine. Jean-Louis Guez de Balzac est celui qui réussit à
mettre en pratique ce qui reste chez La Mothe Le Vayer des considérations
abstraites. Comme le démontre Gaston Guillaumie dans son étude sur le style de
Balzac, celui-ci est le premier qui réussisse, grâce aux artifices de la rhétorique, à
camoufler son érudition humaniste sous des allures toutes
parfaitement au goût de la cour.
•
naturelles~
correspondant
•
CHAPITRE II
ÉLOQUENCE ET PHILOSOPHIE SToïcIENNE CHEZ
DU VAIR
Dès son plus jeune âge Guillaume Du Vair trouva un profond réconfort à ses
malheurs et à ceux de sa patrie dans la pratique des valeurs stoïciennes. Les morts
successives de sa sœur et de sa mère, ainsi que la désolation qu'engendrèrent les
guerres de Religion l'incitaient, pour l'apaiser, à rationaliser la douleur. Mais cette
popularité de la philosophie stoïcienne ne se limite pas à l'entourage de Guillaume
Du Vair, c'est bientôt toute la population de Paris qui cherchera une consolation
dans la philosophie stoïcienne, puisque, comme le précise Raymond Lebègue,
ces ouvrages, dans lesquels le stoïcisme se mêlait selon des
proportions diverses au christianisme, étaient si bien appropriés aux
préoccupations du temps et apportaient, panni les souffrances
physiques et morales, un si précieux réconfort, qu'ils ont eu le plus
grand succès. 4o
•
.w Raymond Lebègue. «La période platonicienne et la période stoTcienne dans la Renaissance française», in
Bulletin ofthe International Commitee ofthe Historical Sciences, XI (1937), p. 317-18.
41
•
Mais l'apport du stoïcisme au XVI
ième
siècle reste, en bien des cas, limité à sa
partie morale. Dans les écrits de cette sombre période, rares sont les références
directes à la logique ou à la physique stoïciennes. Outre que le stoïcisme n'était pour
beaucoup qu'une simple question de mode, cette relative absence s'explique par le
fait qu'on redécouvre cette philosophie à travers les œuvres d'auteurs de l'Empire
romain, tels que Sénèque, Épictète et Marc·Aurèle, qui privilégiaient la morale
stoïcienne. Cela ne veut pas dire que la logique et la physique aient été balayées. En
principe, elles étaient considérées comme des sciences préliminaires aux vertus
morales. Il fallait étudier Dieu et le monde, la théorie de la représentation et de
l'assentiment, et enfin la dialectique et la rhétorique avant de s'attaquer à l'étude de
la morale, qui mènera finalement le philosophe à la sagesse. De la sainte
philosophie (1584), De la morale des stoïques (1585) et De la constance et
consolation ès ca/amitez publiques (1594) ne sont-ils pas tous des traités dans
lesquels Guillaume Du Vair accorde une importance toute particulière à l'aspect
moral de cette philosophie? Certainement Du Vair suit le mouvement général de son
siècle. Mais si l'on y regarde de plus près, on remarque que la recherche de la vertu
ne se coupe pas du reste de la philosophie. Puisque la vertu stoïcienne repose
principalement sur une utilisation hannonieuse de la raison, il devient essentiel que
la logique dicte les moyens de bien raisonner, et que la physique explique comment
interagissent l'âme, le corps et les sens dans l'élaboration de la raison stoïcienne.
•
Ainsi nous constatons que les trois parties de la philosophie stoïcienne se retrouvent
42
•
dans les oeuvres de Guillaume Du Vair. Tout porte à croire que lorsqu'il travailla à
son traité sur l'éloquence, Du Vair a nourri ses conceptions linguistiques de cette
tripartition stoïcienne de la philosophie, d'autant plus que De l'eloquence françoise,
et des raisons pourquoi elle est denzeurée si basse (1595) est tout juste postérieure
aux trois œuvres majeures nommées plus haut.
La physique stoïcienne tente d'expliquer le monde, qui, selon Diogène
Laërce, «est composé du ciel, de la terre, des choses de leur nature, ou encore des
Dieux, des hommes et de toutes les choses faites à leur sujet»41. Parmi les thèmes
majeurs de la physique, on retrouve la théorie de la représentation. Elle s'avère
importante, puisque réagissant contre la sophistique, les stoïciens affinnent que la
réalité est perceptible pour l'homme. Les Pyrrhoniens et la nouvelle Académie
prétendaient au contraire que les sens et la raison ne pouvaient accéder à la vérité.
La théorie de la représentation doit donc démontrer que l'âme humaine peut
découvrir la réalité cachée sous des apparences souvent trompeuses, à l'aide de la
représentation, du raisonnement et de l'assentiment.
Afin d'illustrer cette théorie de la représentation, Du Vair utilise dans son
texte De la constance la métaphore de l' «Estal royal». Le «Prince souverain» du
royaume incarne ('«entendement», ce que les Grecs appelaient l'hégémonique. Cette
image du prince montre bien que Du Vair remonte directement aux sources, puisque
la racine hêgemôn signifie «guide» et «chef». L'hégémonique, qui réside dans le
•
Diogène La!rce, Vie, doctrines et sentences des philosophes illustres, t. JI, Paris, Garnier-Flammarion,
1965, p. 97.
41
43
•
cœur, et non pas, comme d'autres écoles philosophiques le prétendent,
exclusivement au niveau de la tête, est le lieu où s'exercent les principales activités
de l'âme. Sous les ordres du Souverain, Du Vair parle de «Magistrats» qui voient à
la bonne application des lois du Souverain et qui peuvent l'aviser si une question
douteuse se présente. Ces magistrats représentent la force «Estimative», c'est-à-dire
la fonction déterminante de l'assentiment, déjà potentiellement présente dans la
représentation elle-même, quand elle est «compréhensive» (cataleptique), quand elle
porte la marque de sa propre évidence. Occupant dès l'origine une place cruciale
dans la théorie stoïcienne de la connaissance, l'assentiment ne cessera de prendre de
l'importance, d'abord dans le cadre du stoïcisme romain, pour connaître toute son
extension dans la pensée d'Épictète, qui fait de la prohairesis, du «choix délibéré»,
un concept qui annonce la volonté cartésienne. Du Vair se place tout juste avant cet
ultime et grandiose développement que donne Descartes à la théorie stoïcienne de la
connaissance. Dans les Règles pour la direction de fesprit Descartes réunit d'abord
«toutes les sciences qui ne sont rien d'autre que la sagesse humaine»42. L'unité
profonde des sciences, la connexion des connaissances et de la morale, fait qu'il
applique à l'étude de la nature et de la logique, les mêmes règles qui régissent la
morale. Le sage «accroît la lumière naturelle de sa raison [... ] pour qu'en chaque
circonstance de la vie son entendement montre à sa volonté le parti à prendre» 43 •
•
René Descartes, Règles pour la direction de "esprit, Paris, Vrin, 1970, p. 2.
o Ibid., p. 4.
..2
44
•
Du Vair n'en est pas là. Sa conception du stoïcisme, du choix qui en est le
cœur, n'atteint pas à l'universalité que lui contère Descartes. Sa réflexion se limite à
la classe juridique. L'assentiment stoïcien se confond avec le genre délibératif. La
place qu'il donne, dans le «royaume», aux Magistrats détenant la force «estimative»,
est politique plus que métaphysique. Du Vair utilise l'image de la cire:
Les sens, vrayes sentinelles de l' ame, disposez au dehors pour
observer tout ce qui se presente, sont comme une cire molle, sur
laquelle s'imprime, non la vraye & interieure nature, mais
seulement la face & la forme exterieure des choses. 44
Cette référence à la cire indique que Du Vair connaît la pensée de Cléanthe, qui,
tentant de préciser la théorie de Zénon, utilisait l'image de la cire qui se modifie lors
de l'apposition du sceau. Mais Chrysippe trouve cette image inopérante et préfère
une image aérienne et sonore, celle de l'onde, qui peut enregistrer plusieurs
modifications simultanées. La cire de Cléanthe et l'onde sonore de Zénon sont ce
que les stoïciens appellent le pneuma. C'est ce souffle, traduit en latin par «esprit»,
qui transporte les différentes représentations vers l'hégémonique. Le pneuma peut
être perçu comme un courant qui circule continuellement des sens vers le cœur et du
cœur vers les sens. Ce qui permet de parler d'une certaine tension entre l'âme et les
sens : «[ ... ] la représentation est le résultat de la rencontre de la tension interne du
souffle psychique [pneuma] avec la tension des choses extérieures»45. Les sens
•
.... Guillaume Du Vair, «De la constance & consolation ès calarnitez publiques», in Œuvres, Genève, Slatkine
Reprin~, 1970,p.316.
•, Jean·Baptiste Gourinat, Les stoïciens et ['âme, Paris, PUF, 1996, p. 45.
45
•
transmettent à l'hégémonique des représentations souvent entachées de l'opinion
populaire, la doxa. Ce que Du Vair exprime de cette façon:
Ils en rapportent les images en l'ame, avec un tesmoignage &
recommandation de faveur, & quasi avec un prejugé de leur qualité,
[ ... ] & outre introduisent encore avec les images des choses,
l'indiscret jugement que le vulgaire en fait. 46
Mais afin de contrer ces «illusions», l'hégémonique s'en remet à la faculté de
l'assentiment qui apposera une autorisation finale et durable à la représentation
conçue par les sens et reçue par l'hégémonique.
C'est à ce moment qu'intervient la logique stoïcienne. Jean-Baptiste Gourinat
définit la vertu logique comme un «bon usage de la raison»47. C'est la raison, le
logos ou la dianoia, qui a la lourde tâche d'étudier la validité de la représentation
reçue. Grâce à certaines structures réflexives, le syllogisme par exemple,
l'«entendement» s'interroge afm d'émettre ou de refuser son assentiment. Mais Du
Vair prétend que la «puissance Estimative» doit concéder l'examen des
représentations non seulement à l'entendement, mais aussi au «discours» : «[...] &
outre luy a donné moyen en toutes choses de doute & de consequence de recourir au
discours, raison & conseil de celuy qui commande par dessus»48. Mais il ne faut pas
entendre le mot «discours» en son sens le plus courant. Il faut plutôt le considérer à
la lumière des théories antiques du langage, où la pensée est conçue par Platon et
certains stoïciens comme un échange, une discussion de la raison avec elle-même.
•
Guillaume Du Vair, op. cil., p. 316.
J.-B. Gourina~ op. cil., p. 10.
oiS Guillaume Du Vair, op. Cil.• p. 316.
46
.7
46
•
Platon nomme ce discours intérieur endiathetos, en opposition avec le prophorikos,
discours extériorisé par la parole. En utilisant le tenne «discours», Du Vair traduit
l'expression plus générale de logos, qui ne fait aucune distinction entre le langage de
l'intériorité et de l'extériorité. Mais cette imprécision n'est pas répréhensible si l'on
sait que, selon les stoïciens, la pensée, pour être pensée, doit absolument être
«"ek/a/êtikê", capable de parler, de s'exprimer, un terme que Sénèque ne peut
traduire qu'en forgeant le néologisme latin "enuntiativus" (Ep., 117,13): la pensée
est essentiellement "énonciative,,»49.
La faculté de l'assentiment est conçue par Du Vair comme un dialogue de la
raison avec elle-même, qui se questionne sur la recevabilité d'une représentation.
Ensuite, ce discours intérieur sera représenté tel quel par le discours extérieur. Il est
important de comprendre qu'il Y a une relation de similitude entre le discours
intérieur et le discours extérieur. La réflexion et la parole sont très intimement liées,
et c'est pour cette raison qu'on peut dire qu'une réflexion bien menée se reflètera
dans une parfaite élocution, c'est-à-dire une élocution qui, panni les magistrats
robins, tend à s'effacer, à disparaître derrière la vérité de la parole et la rigueur du
raisonnement : une éloquence nue, claire, qui sélectionne et arrange naturellement
les mots dans le discours.
Lorsque cet assentiment est consenti, la représentation devient une vérité
assurée. Elle devient ce que les stoïciens nomment une notion. Un ensemble de
•
Curzio Chiesa. «Le problème du langage intérieur chez les stofciens», in Revue Internationale de
Philosophie, n° 3, 1991, p. 316.
49
47
•
notions fonne la science vraie, et seul un sage dont la raison s'exerce en continuelle
et parfaite hannonie avec les lois du Créateur peut espérer atteindre et la vérité et la
science.
La perception de la vérité échoit donc à la seule raison humaine. Son activité
judicieuse s'avère détenninante, puisqu'elle garantit le bon fonctionnement de la
faculté d'assentiment, la capacité à s'exprimer de façon logique et éloquente, ainsi
que l'élaboration d'un savoir. Qu'il s'arroge le droit de distinguer le vrai du faux, de
là provient l'idée, sévèrement contestée par ses adversaires, que l'homme stoïcien
est à la grandeur de Dieu. C'est précisément lorsque la puissance <<Estimative» ne
soumet pas la représentation, que celle-ci devient déraisonnable et qu'apparaissent
les emportements passionnels condamnés par la morale stoïcienne.
Maintenant que nous en connaissons les grandes lignes, il sera plus aisé
d'étudier l'influence de cette théorie de la représentation sur les conceptions de
Guillaume Du Vair au sujet de la langue et de l'éloquence françaises. En tant
qu'avocat au Parlement de Paris, Du Vair s'adresse d'abord dans l'Eloquence
françoise, à ses confrères du Palais: «Or ne m'arresteray-je seulement qu'à
l'eloquence meslée és affaires du monde.»5o Il néglige d'aborder l'éloquence
délibérative, mais ceci ne l'empêche pas d'exposer des considérations et une
conception de l'orateur tout de même très universelles. Voyons quelles sont ces
•
sa Guillaume Du Vair, «De l'eloquence française, et des raisons pourquoy elle est demeurée si basse», in op.
cil., p. 390 .
48
•
prescriptions pouvant mener à l'éloquence, et détenninons en quoi elles sont
redevables à la philosophie stoïcienne.
Au début de son traité, Du Vair tente d'expliquer pourquoi la France n'a pas
su donner naissance à de grands orateurs. Pour ce faire, il passe en revue les qualités
et les défauts d'avocats décédés depuis peu, jouissant encore d'une bonne
renommée. Le premier, Monsieur de Pibrac, était «plein de jugement aux affaires»SI.
Il parle ensuite de Monsieur Versoris qui, en plus d'une belle élocution, possédait
«un grand sens & beau jugement»S2. Enfin, Du Vair constate des qualités semblables
chez le grand Président Brisson: «C'estoit [... ] un grand jugement à ce qui estoit
des lettres & du Palais»53. Ces quelques exemples montrent clairement combien,
pour Du Vair, un bon usage du jugement est une condition sine qua non de tout
orateur. Dans sa Philosophie morale des stoiques, Du Vair précise constamment
combien le jugement doit rester clair et que ce sont les passions qui l'empoisonnent:
«Il faut [... ] que nous commencions par oster de nos esprit les passions qui s' y
eslevent, & esbloüissent de leur fumée l'œil de la raison.»S4 L'idéal du magistrat
s'appuie sur un idéal philosophique de la connaissance, la théorie stoïcienne de
l'assentiment. N'est-ce pas pratiquer une forme d'assentiment que de devoir méditer
longuement une question avant de dévoiler son verdict final. Par la suite, si l'orateur
a conçu une réflexion de qualité, le discours en reflètera la logique et la rigueur.
•
Ibid., p. 390.
Ibid, p. 391 .
.53 Ibid, p. 391.
.54 Guillaume Du Vair, «La philosophie morale des stoiques», in op. cil., p. 259.
.51
.52
49
•
L'étude de la philosophie stoïcienne pousse Du Vair à privilégier l'argumentation
logique, et à réduire d'autant l'apport du pathos, qui tient à l'Église de Rome, à la
contre-réforme et au mouvement jésuite. Du Vair, malgré sa foi, ne peut s'empêcher
de critiquer ouvertement l'institution religieuse et les conceptions de
qu~elle
r éloquence
met de l'avant et qui reflètent la corruption romaine. Du Vair s'approprie
1~ esprit logique et rationnel des stoïciens dans le but de s'opposer à cette rhétorique
des passions qui ne donne que dans l'éclat et la sophistique.
Même si tous ces avocats excellent par l'usage de leur jugement, Du Vair
n ~ en conclut pas moins que tous ces esprits doivent être qualifiés «de diserts plustost
que d~eloquens»55, et qu~ils ne surpassent jamais la valeur des orateurs grecs et
latins. Monsieur de
Pibrac~
par exemple.. malgré ses très grandes qualités, «sa douce
& gracieuse humeur ne pouvoit concevoir des passions fortes & courageuses, &
telles qu'ils les faut pour animer une parfaite oraison.»56 Une remarque analogue
n ~ épargne pas non plus le Président Brisson:
[ ... ] il étoit né d'une fort douce nature.. quasi non susceptible de
passions. De sorte que s'il eust entrepris une grande & vehemente
action, où il eust fallu desployer les maistresses voiles de
reloquence, j'ay opinion qu~il ne luy eust pas reüssi. 57
Bien que le jugement doive rester maître de 1~ oraison chez ces avocats, ce sont les
passions qui pennettent d'atteindre la grande éloquence, et qui servent même à
définir l'élévation du style.
•
SS
S6
S7
Ibid.• p. 390.
Ibid.. p. 391.
Ibid.. p. 392.
50
•
Cependant le tenue «passions» étonne sous la plume d'un stoïcien, qUI
considère les emportements passionnels comme une source de troubles et de
malheurs. Il est toutefois possible de comprendre la signification que veut lui donner
Du Vair en se rapportant de nouveau à la théorie de la représentation.
L'hégémonique n'a pas seulement la tâche d'analyser et de donner son assentiment
aux représentations que lui envoient les sens. Il peut aussi donner le branle à certains
mouvements des sens et des membres. Après avoir reçu la représentation d'une
pomme paraissant alléchante, l' hégémonique, par l'intennédiaire du souffle
psychique, peut ordonner à la main qu'elle saisisse le fruit. Les stoïciens appellent
ce mouvement de l'âme une impulsion. Sans entrer dans le détail de la typologie
complexe des impulsions stoïciennes, disons que les impulsions peuvent être soit
raisonnables, soit déraisonnables. Une impulsion est déraisonnable lorsqu'elle n'a
pas obtenu l'assentiment de l'hégémonique. Cette impulsion déraisonnable échappe
au contrôle de la raison et cherche des états d'âme préjudiciables au bonheur. Ces
passions destructrices et dangereuses sont par exemple le désir, le plaisir et la peur.
Mais si l'impulsion est «raisonnable» elle se soumettra à l'assentiment et prenant le
nom de volonté, poussera l'homme à rechercher «des états durables»58 comme le
bonheur, la sagesse, etc. Si l'homme par exemple désire être sage, il ne le désirera
pas qu'occasionnellement, il persévérera dans la recherche de son but ultime: la
•
58
Jean-Baptiste Gourinat, op. Cil., p. 90.
51
•
sagesse. Dans sa Philosophie mora/es des stoiques, Du Vair explique le rôle de la
volonté en ces tennes :
Que le bien de l'homme & la perfection de sa nature consiste en une
droite disposition de sa volonté à user des choses qui se presentent
selon la raison; [...] Car [... ] il fera son profit, recevra du
contentement de tout ce qui luy pourra arriver, & s'establira un
repos d'entendement fenne & immobile comme un rocher panny
les flots. 59
Si ce n'est du vocabulaire, nous sommes très proche ici de la fonnulation
cartésienne. Ce sont «les passions», autrement dit, la volonté stoïcienne qui incite
continuellement l'orateur à viser une perfection morale, qui se reflètera ensuite dans
son éloquence. De sorte que l'essentiel de l'argumentation de Du Vair réside dans la
probité de l'orateur, c'est-à-dire dans la prépondérance de l'argument éthique. Cette
importance de la volonté et de l' ethos est ce qui rapproche l'éloquence de Du Vair
du mouvement de l' ingenium dont nous avons parlé dans la première partie. Ce n'est
pas une inspiration divine qui ravit l'orateur de Du Vair. Toutefois, la volonté
stoïcienne, parce qu'elle cherche invariablement à se soumettre aux lois que lui
insuffie la raison divine, s'apparente à l'enthousiasme que définit Platon dans le
Phèdre ou dans l'Ion. Cette volonté chez Du Vair pourrait aussi être rapprochée de
ce que remarque le pseudo-Longin dans son traité Du sublime à propos du besoin,
pour Platon, de toujours aller au-delà de l'humanité. Comme Cicéron dans le De
legibus, la volonté de Du Vair aspire également à transcender la raison humaine, à
•
59
Guillaume Du Vair, op. cil., p. 261.
52
•
toucher des lois plus authentiques que les lois humaines, celles du logos, qui assure
l'ordre de la cité universelle. Il recherche cette justice naturelle qui a précellence sur
les conventions légales de 1'homme. Ce n'est donc plus vraiment la raison de
l'orateur qui s'exprime, mais une raison instruite par les lumières divines. C'est cet
ethos s'élevant vers la divinité qui doit ravir l'auditoire. Cette éloquence «ne meine
pas l'auditeur, mais l'entraine; regne panny les peuples, & s'establit un violent
empire sur l'esprit des hommes»60.
La volonté de l'orateur doit s'adresser directement à la volonté de son
auditoire. L'orateur doit susciter chez son interlocuteur les mêmes «passions
raisonnables» qui l'ont poussé à désirer la perfection. L'éloquence, selon Du Vair,
est moins une transmission de connaissances et de raisonnements logiques qu'une
transmission de passions. L'auditoire ne doit pas comprendre l'orateur, il doit
ressentir, à son tour, ce que l'orateur a éprouvé. L'orateur poursuit ce noble dessein
de planter dans le cœur de l'auditeur une disposition d'esprit qui le pressera de
s'élever moralement. Concevoir l'éloquence comme un transfert de passions est
d'autant plus plausible qu'émotions et raison ont toutes deux leur siège dans le cœur.
Comme l'affinne Du Vair, les passions sont «comme pointes aigües [qui]
transpercent non seulement les oreilles, ains les cœurs des escoutans»61.
On peut donc affinner que ce traité linguistique de Du Vair pose comme
condition à l'éloquence sublime une théorie de la sympathie (sum-patheia) .
•
60
61
Ibid, p. 393.
Ibid, p. 408.
53
Toute la force & l'excellence de l'eloquence consiste de vray au
mouvement des passions : par cet instrument, comme par une forte
milice, elle exerce son souverain Empire, tourne & fleschit les
volontez des hommes, & les fait servir à ses desseins. 62
Une théorie de la sympathie qui repose sur la physique stoïcienne, puisque, comme
nous l'avons précisé plus tôt, la pensée n'est une pensée qu'autant qu'elle est
traduisible en paroles. Mais l'inverse est aussi vrai. Suivant cette relation d'analogie
entre le logos intériorisé et le logos extériorisé, une parole doit nécessairement
conduire une passion ou une volonté. Par conséquent, la parole de l'orateur, qui
touche l'esprit de l'auditeur, évoque automatiquement l'élan premier de l'orateur. Le
langage ne sert qu'à transmettre une passion :
Car la passion s'estant conceuë en nostre cœur, se fonne incontinent
en Dostre parole, & par nostre parole sortant de nous entre en autruy,
& Y donne semblable impression que nous avons en nous mesmes,
par une subtile & vive contagion. 63
C'est aussi grâce à la sympathie que le jeune orateur apprendra les finesses de
réloquence. Le précepte est une première méthode d'apprentissage de l'art oratoire,
mais Du Vair considère qu'elle est plus ou moins efficace. C'est par la fréquentation
des avocats, par sa présence aux plaidoyers que l'apprenti orateur percevra les
nuances et les subtilités de l'éloquence. C'est en communiquant avec l'âme des
avocats, en faisant sienne leur nature que le jeune orateur s'appropriera les clefs de
l'art oratoire : «[ ... ] ainsi les esprits & les mœurs des hommes se confonnent à ceux
•
62
63
Ibid, p. 403.
Ibid, p. 403.
54
•
avec lesquels ils frequentent ordinairement. Il passe par contagion ès choses des
unes aux autres une grande part de leur nature»64.
Lorsqu'il s'agit d'atteindre une éloquence sublime, Du Vair insiste
constamment sur cet autre point qu'il faut posséder une énonne connaissance des
lettres : «[ ...] il faut un grand estude qui ait quasi effleuré tous les autres arts, acquis
une connoissance universelle de toutes choses, & une science particuliere des loix,
des coustumes, des mœurs, (... ]»65. La connaissance des lettres signifie, dans son
acception ancienne, la somme de tout ce qui relève de la culture générale, ce que les
savants de la Renaissance ont appelé le savoir «encyclopédique» (encyclopœdia), un
savoir qui fasse le tour des connaissances et des disciplines. Ces écrits proviennent
autant des domaines scientifiques que littéraires, autant des Anciens que des
Modernes. Afin d'évoquer cette nécessité d'une grande culture, Du Vair utilise
l'image du maître maçon :
Qui est (... ] le bon mesnager, lequel a jamais entrepris d'eslever un
grand edifice, qui auparavant que de commencer à bastir, n'ait fait
provisions de bois, de pierre, de chaux, & autres matieres
convenables, de peur qu'ayant desja fort avancé son ouvrage, il ne
fut contraint de tout laisser là, si quelque chose necessaire luy venoit
à manquer?66
Par exemple, selon Du Vair, l'avocat Versoris «ayant donné tout son esprit aux
procés, il n' estoit pas à beaucoup pres parvenu jusques où sa nature cultivée par l'art
•
64
Ibid, p. 404.
6~ Ibid, p. 401.
66
Ibid. p. 401.
55
•
& sollicitude l'eust peu aysément porteo)67.
L'importance d'une vaste culture
littéraire est certainement en rapport direct avec les concepts stoïciens de notion et
de science. Lorsqu'une représentation est soumise à l'assentiment et qu'elle est
jugée vraie, elle est ensuite conservée dans l'hégémonique. Par la suite, grâce à la
mémoire, celui-ci peut confronter différents souvenirs, afin d'élaborer une
connaissance sûre et véritable, que le stoïcien appellera une notion. Bien qu'il y ait
des pré-Ilotions. comme la connaissance du bien ou du bonheur, que l'on acquiert
très tôt dans l'enfance, la notion du blanc ou la notion de monstre. par exemple, ne
s'élabore que par la comparaison de nombreuses représentations. Et l'ensemble de
ces pré-notions et de ces notions forme la science. Toutefois, seul le sage stoïcien est
savant, puisqu'il est le seul qui réussisse à confonner son jugement aux règles de la
raison divine. C'est pourquoi r orateur chez Du Vair fait souvent figure de sage. Par
exemple M. Mangot ne démontrait pas cette prestance et cette élocution pesée,
assurée et noble du sage. Il affectait plutôt «une parole pressée & aiguë» qui lui
interdisait le titre d'orateur. Un autre argument peut encore nous persuader que
l'orateur de Du Vair s'apparente au sage stoïcien. Autant il est difficile pour le
stoïcien de devenir sage. autant il est très ardu pour l'orateur de toucher au sublime.
e' est en transposant cette idée stoïcienne de «l'impossibilité du sage» dans le
contexte linguistique de la Renaissance que Du Vair dira à propos de la pauvreté de
•
réloquence «que la difficulté de la science en soy. dont la perfection ne se peut
67
Ibid., p. 391.
56
•
acquerir qu'avec un incroyable travail, & heureuse rencontre de plusieurs choses fort
necessaires, en est la principale cause»68.
En ce qui a trait à l'acquisition des notions, trop nombreux sont les avocats
qui embrassent une quantité phénoménale de connaissances, mais qui négligent de
porter un jugement droit sur cette infonnation. Tout comme le stoïcien juge et
approuve les notions pour en faire une science, l'orateur doit faire siennes par
l'étude toutes les infonnations acquises au cours de ses différentes lectures.
L'incapacité à digérer les notions acquises se traduit, pour l'avocat, par un usage
abusif de citations et de références aux textes anciens :
Vous appercevez aysément quand ceux qui parlent en public vous
apportent des estudes mal digerées, & des inventions qui ne sont pas
recuites en une longue & profonde Meditation; tout y entrebaille, &
beaucoup de choses y bouclent & se jettent hors leur vray & droict
allignement. 69
De même Du Vair remarque que la volonté de tout dire sur un même sujet témoigne
de l'incapacité de synthétiser les notions et d'en retenir seulement les éléments
importants: <<Davantage il affectait de dire tout ce qui se pouvait sur un sujet, de
sorte que l'abondance l'empeschoit, & la multitude ostoit à ce qu'il avoit de beau, sa
grace & elegance.» 70
Cette conception s'apparente beaucoup à celle de Montaigne qui déplore
l'accumulation irraisonnée d'autorités, et encourage plutôt l'effort de l'entendement.
•
68
69
70
Ibid, p. 400.
Ibid, p. 402.
Ibid, p. 391.
57
•
Montaigne et Du Vair se font les dénonciateurs d'un problème fréquemment soulevé
à leur époque, que les collèges ne font que bourrer la mémoire des étudiants de
formules rhétoriques, et qu'ils ne fonnent pas la réflexion et la compréhension. Ce
que Montaigne exprime ainsi: «Nous ne travaillons qu'à remplir la memoire, et
laissons l'entendement et la conscience vuide.» 71
Ce que désire Du Vair de son orateur est une étude qui rendra toutes les
parties de son discours fluides et naturelles. L'éloquence se retrouve chez un orateur
lorsqu'il «est doüé d'une grande grace naturelle»72. Bien qu'on ne puisse pas limiter
l'émergence, à la Renaissance, d'un questionnement sur le discours naturel à la seule
influence des doctrines de la philosophie stoïcienne, il reste qu'elles jouent un rôle
primordial dans le traité de Du Vair. Probablement inspirés par des philosophes
comme Pannénide, qui voit le monde comme une unité, les physiciens stoïciens
conçoivent le cosmos comme un tout, où tous les éléments sont consubstantiels.
André Bridoux décrit la conception stoïcienne de l'Univers: «Le monde est un,
d'une fonne sphérique parfaitement adapté à son mouvement. Il est admirable par la
proportion de ses éléments, par l'ajustement de ses parties, par sa beauté.» 73 C'est-àdire que chaque partie du monde est régie selon les lois de la raison divine. Étant un
corps, le monde est aussi doté d'une raison. Le but ultime du stoïcien est de
s'accorder à ces résonances divines, de se laisser pénétrer par le pneuma du monde.
•
Michel de Montaigne, op. cil., livre l, chap. XXV, p. 136.
Guillaume Du Vair, op. cil.• p. 390.
73 André Bridoux, Le slofcisme el son influence, Paris, Vrin, 1966, p. 50.
71
72
58
•
Antoinette Virieux-Reymond résume ainsi la relation du stoïcien avec son univers:
«[...] le stoïcien cherchera à entrer en contact avec lui [Zeus], non seulement pour
contempler la vérité, mais surtout pour être dirigé dans sa vie.»74 Or, lorsque
l'orateur raisonne et qu'il prend la parole devant un auditoire, il tente de conformer
sa parole à l'ordre de la nature, à la parole même de la divinité. Tout, selon les
stoïciens, doit converger vers ce «naturel». Voilà pourquoi Du Vair affirme que la
naïveté et la spontanéité des auteurs français sont des marques de ce naturel, de la
«nature» que porte en lui chaque homme. La nature impose cette mesure que
Cicéron appelait decorum, et qui adapte judicieusement le discours à chacune des
situations. Mais encore là, celui qui néglige d'observer les lois divines, ne pourra
faire preuve de prudence ni de mesure. Du Vair privilégie une rhétorique de la
sincérité et de la mesure et non du pathétisme et de l'amplification; une rhétorique
du cœur plutôt que de l'artifice. La théorie de la représentation stoïcienne pennet à
Du Vair de garantir un jugement et une qualité d'expression orale quasi infaillibles.
Le langage stoïcien étant en quelque sorte créateur de vérité, l'orateur détient un
pouvoir immense. Cette puissance est perceptible en grande partie au niveau
éthique.
Bien que la théorie de la représentation soit omniprésente dans l'éloquence de
Du Vair, elle ne serait rien sans la logique stoïcienne. Comme nous l'avons déjà dit,
c'est la logique qui dicte à la raison ses règles de fonctionnement. Ce n'est que
•
74
Antoinette Virieux-Reymon~ La logique et l'épistémologie des stoïciens, Chambéry, Éd. Lire, s.d., p. 43.
59
•
lorsque la raison applique les lois de la logique qu'elle peut prétendre à toute la
puissance que lui contèrent Guillaume Du Vair et, avant lui, les anciens stoïciens. La
logique stoïcienne se compose de la rhétorique et de la dialectique. La logique fut
toujours une partie très importante de la philosophie stoïcienne. Chrysippe fut celui
qui la développa amplement dans une œuvre colossale.
Elle [la rhétorique] a déjà une grande importance, qui peut se
mesurer à l'importance de la parole dans le monde grec. Mais la
dialectique a une importance plus grande encore. [... ] Objet de tous
les soins de Chrysippe, la dialectique n'a cessé d'être cultivée par
les stoïciens, au point qu'on les appelait assez couramment: les
75
dialecticiens.
Le texte de Guillaume Du Vair reflète bien cette hiérarchie qui place la
dialectique au-dessus de la rhétorique. Du Vair fait partie de ceux qui, de Platon à
Montaigne, en passant par saint Augustin, croient que la rhétorique est moins un art
qu'un artifice, qu'une fonne du mensonge. Lorsque Du Vair commente l'éloquence
de l'avocat Mangot, il explique que son atticisme, comparable au style de Lysias,
n'est pas de l'ordre du grand discours: «Si l'Eloquence consistoit seulement en une
clarté, & pureté d'oraison, & qu'elle ne contint autre chose que ce que Iseus &
Lysias en ont recherché; je le comparerois librement aux anciens [... ])} 76. Si les
auteurs portent un grand soin au choix des paroles et à l'agencements des syllabes,
de façon à charmer les esprits, ils deviennent pour Du Vair des sophistes, qui
présentent subrepticement le vrai comme faux, des «esprits oyseux» qui ne font pas
•
75
76
André Bridoux, op.ci/., p. 85.
Guillaume Du Vair, op. cil., p. 393.
60
•
porter leurs efforts sur l'essentiel : les idées. Suivant les doctrines stoïciennes, celui
qui ne réfléchit pas, c'est-à-dire celui qui ne met pas à profit le discours intérieur
(endiathetos), pour ne s'arrêter qu'aux détails ronnels, ne peut proférer un discours
sensé. Selon Du Vair, bien qu'esthétiquement réussis, leurs discours sont vides de
sens.
La rhétorique n'est, pour Du Vair comme pour les stoïciens, qu'un aspect
secondaire du logos. Marc Fumaroli remarque que ce souci stylistique est tout de
même visible dans l'Eloquence française: «Il [Du Vair] préfère ne pas mettre en
évidence cette "cuisine" de l'élocution.»77 À peine s'arrête-t-il à donner quelques
directives, toutes fondées sur un principe de modération et de juste proportion:
l'orateur doit utiliser des «sentences [qui] sont belles & pleines)/8, «une grande
brièveté [et] une grande clarté» 79 dans style et une juste utilisation des métaphores;
«Bref tout y coule avec juste proportion» 80. On peut expliquer ce refus de la
rhétorique par la conception que se fait Du Vair de l'éloquence, reflet de la raison
divine. C'est ici qu'il se trouve le plus proche de la conception longinienne du
sublime. Jamais le style ne sera grand s'il ne provient d'une âme belle et juste.
Quant à l'elegance du stile, elle est [...] d'autant plus admirable
qu'elle contient une douceur & grace, dont on ne connoist point la
cause ny l'artifice, qui reluit par toute l'Oraison, comme le teint en
•
Marc Fumaroli, op. cit., p. 508.
Guillaume Du Vair, op. cit., p. 407.
79 Ibid., p. 408.
10 Ibid., p. 407.
77
7B
61
•
un corps naturel, lequel suit la temperature & bonne constitution des
humeurs dont il est composé. sl
On voit ici comment la théorie de l'ingenium se joint chez Du Vair, comme chez
Huarte, à une théorie des humeurs. C'est la grandeur et l'intégrité de l'orateur qui
pennettent de toucher l'auditoire, tout autant que de respecter les limites de la
convenance. La rhétorique en elle-même reste toujours secondaire. Du Vair
considère que la beauté du discours ne tient pas à l'ornementation, mais à
l'invention et à la disposition.
Dans son Eloquence française, Du Vair affinne que la dialectique est, d'une
part, le véritable sujet de la logique, et d'autre part, l'art le plus important de toute
l'éloquence. Il ne faut pas se surprendre de cette affinnation, puisque la philosophie
stoïcienne s'appuie entièrement sur la dialectique. C'est elle qui définit la faculté de
l'assentiment. Elle propose les raisonnements syllogistiques qui pennettront au
jugement d'accepter ou de refuser la validité de la représentation. Diogène remarque
combien «sans connaissance de la dialectique, le sage [stoïcien] ne peut être
infaillible dans son raisonnement, car c'est par elle que l'on distingue le vrai du faux
(... ]»82. Les stoïciens de l'Antiquité voient dans la dialectique la clé de leur
puissance, l'art par excellence qui garantit la vérité. «Le trait propre de la logique
stoïcienne est d'avoir fait de la dialectique une science.»83 C'est par le langage que
se manifeste la vérité, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Le langage stoïcien est
•
III
Ibid, p. 408.
82
Diogène Laerce, op. cit., p. 67.
Émile Bréhier, Chrysippe et "ancien stoi"cisme, Paris, PUF, 195 J, p. 62.
13
62
•
donc investi d'un pouvoir énonne, puisqu'il crée l'être des choses. Ceci s'oppose
aux théories sceptiques qui contestent que le langage puisse assurer quelque vérité
dans un monde, par principe, impossible à détenniner.
Les stoïciens expliquent cette puissance de l'énonciation par le fait que le
langage est directement inspiré par les lois de la nature et de la divinité. Le langage
évoque donc un lien naturel, non conventionnel, entre les mots et les objets.
Contrairement aux sceptiques qui considèrent le langage comme une entente entre
les hommes, le langage stoïcien touche, en les nommant, à la substance même des
choses. C'est pourquoi la science étymologique était très populaire auprès des
stoïciens de l'Antiquité, car elle pennettait de retrouver le sens premier et véritable
et, du même coup, l'essence.
Fidèle à cette conception de la dialectique qu'élaborèrent les différents
maîtres du Portique, Du Vair affinnera que «si l'ordre est le pere de l'ornement & de
la beauté, et l'ordre est enseigné par ceste science [la dialectique], ceste science se
peut dire la principale maitresse de l'eloquence.»84
Toutefois, pour mieux comprendre cette citation, il faut bien définir ce qu'est
pour Du Vair la dialectique. La scolastique médiévale réduit la dialectique à l'art des
arguments logiques, qui trouvent leur champ d'application lors des chicanes
oratoires. Du Vair renverse les choses et, à l'instar de ses prédécesseurs stoïciens,
pose la dialectique comme l'art qui englobe tous les éléments d'une rhétorique:
•
... Guillawne Du Vair, op. cil., p. 403.
63
•
l'invention, la disposition, l'élocution, la mémoire et l'action. De plus, Du Vair lui
octroie ce même pouvoir que lui donnaient les anciens stoïciens, de pouvoir juger de
la vérité des choses. Comme nous l'avons vu, toute la puissance de l'orateur réside
dans sa capacité à modeler sa pratique de l'éloquence et sa vie en général sur la
«raison divine». Expression que nous pourrions aisément remplacer par le mot
«ordre». Selon les stoïciens, le cosmos est parfaitement organisé, et l'homme
s'insère harmonieusement dans cette perfection que les Grecs associaient aux lois de
la nature. Le bonheur et la sagesse stoïcienne consistent à se confonner à cet ordre
naturel, bien plus qu'aux lois imposées par 1'homme. Or, c'est cette dialectique qui
orchestre toutes les disciplines de l'éloquence, de façon à les faire vibrer en parfaite
harmonie avec le pouls de Dieu. La dialectique selon Du Vair «nous suggere les
arguments, & ayde l'invention par certains lieux & reservoirs, [...] nous enseigne
puis apres la façon dont nous les devons disposer, [...] & [ ... l nous monstre l'ordre
universel que nous devons garder en tout le corps de l'oraison»85.
•
as Ibid., p. 403.
•
CHAPITRE III
LA MOTHE LE VAYER ET L'ESTHÉTIQUE DU DOUTE
Avant de s'attarder plus longuement à l'influence du scepticisme sur la
conception linguistique de La Mothe Le Vayer, il faut retracer brièvement l'histoire
de cette philosophie antique, en insistant sur ce qui concerne le langage.
On s'accorde en général pour dire qu'il y aurait eu quatre écoles sceptiques au
cours de l'Antiquité. Pyrrhon d'Élis (v. 365- v. -275) est le fondateur du scepticisme
ancien. Nous avons conservé peu de sources, mais ce philosophe serait le premier à
poser comme principe directeur de sa pensée le refus de toute assertion. Pyrrhon doit
cette attitude de ne rien déclarer à son «impression» que tous les phénomènes qu'il
perçoit, bien que paraissant évidents et «immédiats» 86, ne soient que des pièges
dressés par les sens. Pyrrhon croit donc que les choses et les phénomènes sont
indifférents (a-diaphora), incertains (a-stathmèta) et indétenninés (an-épicrita), et
que sur de telles illusions, toute réflexion philosophique devient vaine, voire
•
dangereuse, car de croire au pouvoir de l'assertion mène droit à l'erreur. Une telle
16
Léon Robin, Pyrrhon elle scepticisme grec, Paris, PUF, 1944, p. 18.
65
•
incertitude face au monde pourrait sembler insupportable à qui désire quelque vérité
directrice, mais Pyrrhon croit que cette attitude, qui n'autorise aucune «fausse»
vérité, apporte au contraire un sentiment de quiétude morale que ne saurait apporter
aucune croyance dogmatique: tranquillité qu'il nomme l'ataraxie.
À la suite de Pyrrhon et de son élève, Timon de Phlionte (v. -320- v. -230),
les Nouveaux Académiciens concilieront avec l'idéalisme platonicien le scepticisme
de Pyrrhon. L'engouement d'Arcésilas et de Carnéade pour les thèses sceptiques
n'entre nullement en conflit avec la pensée de Platon, car le Socrate qu'il mettait en
scène usait d'une méthode philosophique dite aporétique, c'est-à-dire qui visait à
démontrer l'absurdité des thèses de l'opposant, sans jamais vraiment proposer de
solution au problème:
Si donc il y avait chez Socrate et Platon des gennes de scepticisme,
c'est grâce à l'influence pyrrhonienne que l'esprit d'Arcésilas, avec
ses tendances préexistantes, a pu les découvrir et les faire fructifier
[...].87
Ces Nouveaux Académiciens furent toutefois si occupés à combattre cette
seule école philosophique qu'était le stoïcisme, que Sextus Empiricus dira d'eux
qu'ils n'étaient nullement pyrrhoniens, puisqu'ils afflnnaient de façon dogmatique
que le monde était insaisissable, à seule fin de contredire les stoïciens qui le
croyaient
compréhensible.
Avec
ce
dogmatisme
négatif,
les
Nouveaux
Académiciens s'écartaient de la pensée de Pyrrhon, que J'humain n'aurait pas les
•
17 Ibid,
p. 46.
66
•
capacités sensibles ni raisonnables lui pennettant de saisir la nature et l'essence du
monde.
Malgré cette divergence, les Nouveaux Académiciens sont tout de même à
l'origine d'une notion que tous les sceptiques, pyrrhoniens ou non, considéreront
comme essentielle et centrale: la suspension de l'assentiment. Ce qu'ils appellent en
grec l'epokhê et que La Mothe Le Vayer se plaît à nommer «cette divine Epoque».
Bien que ce soient les Nouveaux Académiciens qui lui aient donné ce nom, il reste
que Pyrrhon, sans l'avoir nommée, fut le premier à la concevoir, en proposant le
refus de l'assentiment comme l'élément clé d'une éthique philosophique. Sur toutes
choses, il jugea salutaire de suivre les lois et coutumes de son pays.
Avec la venue d'Énésidème (_1er siècle) et d'Agrippa (1 er siècle ap. J.C.), nous
assistons à la naissance du troisième âge du scepticisme et à une certaine renaissance
de cette philosophie, puisque ceux que nous nommons les dialecticiens renouèrent
avec les thèses proprement pyrrhoniennes, qui avaient été oubliées des Nouveaux
Académiciens et des philosophes ultérieurs.
Cette école s'avère importante pour une étude de l'influence du scepticisme au
XVn ieme siècle, étant donné que, dans leur profond désir de combattre la pensée
dogmatique, les dialecticiens établissent des répertoires d'arguments qui visent à
démontrer que la seule voie véritable est celle de l'epokhê. Ces modes ou moyens
sceptiques prouvent, chacun à leur manière, qu'il est impossible de dire rien qui soit
•
vérité. Il y aura toujours une perception ou une opinion vraisemblable qui viendra
67
•
s'opposer à ce qu'on croyait vérité. Énésidème propose dix modes. Ceux-là même
que Sextus détaille dans ses oeuvres et dont La Mothe Le Vayer vantera tant les
vertus. Ils fonctionnent tous selon le principe de la relativité des phénomènes. Par
exemple, le sujet, puisqu'il change continuellement de condition, ne percevra jamais
un objet de la même façon. La distance qui le sépare de l'objet, ou bien son état
psychologique et physique sont des conditions qui affectent la perception du sujet.
Nos perceptions s'avèrent donc relatives et indétenninables. Pour sa part, Agrippa
expose cinq modes. Ces cinq modes sont le désaccord, le diallèle, la régression à
l'infini, le relatif, et l'hypothétique. Alors qu'Énésidème considérait plutôt nos
perceptions, Agrippa s'attaque aux raisonnements pour montrer que tout est
indémontrable. Dès qu'il pose une définition, il doit recourir à une seconde
définition pour prouver la première, et à une troisième pour la seconde, et ce, à
l'infini. Même chose avec l'argument de l'hypothétique : si un philosophe émet une
hypothèse, il ne donne aucune preuve. Ce qui peut bien être renversé par l'hypothèse
inverse. Le lecteur d'Agrippa arrive toujours au même résultat: la logique n'a pas de
fondement. Ces cinq modes constitueront le principal appareil argumentatif de
Sextus Empiricus dans ses Esquisses pyrrhonienlles88 , tandis que La Mothe Le
Vayer n'en fait presque jamais mention, se limitant à la classification d'Énésidème.
Les dialecticiens auront aussi comme adversaires les stoïciens. Ils
s'attaqueront alors aux représentations sensibles et intelligibles, qui ne sauraient
•
Habituellement intitulées par ses traducteurs français Hypothyposes pyrrhoniennes. Pierre Pellegrin préfère
traduire le titre original par Esquisses pyrrhoniennes.
18
68
•
constituer une base de vérité, quand bien même il y aurait assentiment de la part du
sage. Pour le sceptique dialecticien, mais aussi pour les sceptique en général, le vrai
existe, mais il reste tout à fait insondable. Les perceptions humaines ne sont en fait
qu·un simulacre de vérité. Il faut dépasser l'illusion créée par les perceptions
sensibles, et sagement accepter le fait que la vérité restera toujours dissimulée. Au
xvn ième
siècle, le philosophe Pierre Gassendi évoque cette question dans ses
ouvrages et croit que l'homme ne possède pas un nombre suffisant de sens pour
connaître la vérité. Il doit se contenter d'une perception partielle.
Succèdent aux sceptiques dialecticiens, non pas des philosophes, mais bien
des médecins. Désireux de s'éloigner de la tradition hippocratique, ces médecins
empiriques adaptent la philosophie sceptique à la méthode médicale. La notion de
signe, comme la représentation sensible, perd toute valeur de vérité. Tel symptôme
ne sera plus automatiquement associé à la présence de telle maladie. Le médecin
empirique suspendra plutôt son jugement devant cette incapacité du signe à traduire
la réalité. Cette méthode des médecins empiriques aura plus tard une très grande
influence sur des philosophes comme Bacon, Locke et Hume. Mais de ces médecins
empiriques, nous ne retiendrons qu'un nom: celui de Sextus Empiricus. Il sera la
principale référence de ceux qui redécouvriront la philosophie sceptique aux XVI
ième
et XVII ième siècles.
Durant tout le Moyen Âge, le scepticisme sombre plus ou moins dans l'oubli,
•
étant donné la très grande autorité de la métaphysique aristotélicienne. D'ailleurs on
69
•
peut expliquer cette longue disparition par l'insuffisance de témoignages écrits qui
eussent pennis de bien reconstituer tous les grands principes de la philosophie
sceptique. Seuls restaient les Académiques de Cicéron, les bribes retenues par
Diogène Laërce dans ses Vies, doctrines et sentences des philosophes illustres, et
l'œuvre vite oubliée d'un Sextus Empiricus qui, somme toute, fut un auteur mineur
et peu reconnu en son temps. Selon Richard Popkin :
Exception faite de Gian Francesco Pico della Mirandola, nous
n'avons connaissance d'aucune reprise notable des idées
pyrrhoniennes durant la période précédant l'impression des
Hypotyposes de Sextus.89
N'eût été la traduction latine de Henri Estienne, publiée en 1562, Sextus
Empiricus et le scepticisme pyrrhonien n'eussent probablement jamais connu l'essor
et l'importance que nous leur connaissons aujourd'hui. Puis Michel de Montaigne
réactualisa les thèses sceptiques de Sextus pour les appliquer au grand débat de la fin
du XVI ième siècle: les guerres de Religion. Contre l'esprit très rationaliste des
réfonnistes, qui croyaient détenir par le jugement et «les lumières de l'esprit» une
interprétation juste des textes sacrés, Montaigne, utilisant les réflexions de Sextus,
montra dans son <<Apologie de Raimond Sebond» l'impuissance de la raison
humaine et l'impossibilité de détenniner aucune vérité. L'être humain ne peut
absolument rien connaître par sa raison, il doit s'en remettre à l'irrationalité divine,
c'est-à-dire opter pour le fidéisme. Comme Pyrrhon qui, refusant de choisir, suivait
•
19
Richard H. Popkin, Histoire du scepticisme d'Érasme à Spinoza, Paris, PUF, Coll. Léviathan, 1995, p. 54.
70
•
les règles et les mœurs de sa société, Montaigne suit la tradition religieuse qu'est le
catholicisme, sans avancer ni avoir aucune preuve rationnelle d'une réelle supériorité
du dogme catholique.
La cible première du scepticisme de Montaigne est la raison. Montaigne et
son successeur, le philosophe Pierre Charron, en soumettant la raison à l'examen,
questionnent implicitement tous les domaines de la connaissance humaine.
Maintenant que le doute a été semé, bientôt tous les savants devront douter de ce
qu'ils avaient érigé en certitude, et notamment de l'aristotélisme:
Revêtu de son voile fidéiste, le nouveau pyrrhonisme de Montaigne
et de ses disciples allait avoir des répercussions extraordinaires sur
le monde intellectuel, la théologie, les sciences et les pseudosciences.9o
Entraînés par Montaigne dans ce mouvement de remise en question des
connaissances, les philosophes verront deux voies s'ouvrir à eux. La première est
celle du rationalisme de Descartes, où le doute est
momentané~
le temps de faire
table rase, pour reconstruire sur des assises nouvelles et solides. La seconde voie est
celle du doute systématique, la raison n'étant d'aucun secours contre les mystères de
la religion et de la Nature. Adopteront ce scepticisme radical des philosophes
comme Pierre Gassendi, qui s'efforcera de combattre la philosophie aristotélicienne,
Guy Patin, Samuel Sorbière, Gabriel Naudé et, bien entendu, François de La Mothe
Le Vayer.
•
90
Ibid, p.I07.
71
•
La Mothe Le Vayer dans son œuvre entière se donnera pour mission de
réfuter tous les domaines du savoir où se manifeste une certaine fonne de
dogmatisme. Que ce soit à propos de théologie, question qu'il aborde dans son Petit
discours chrétien de l'immortalité de l'âme; ou à propos de morale, dont il traite
dans De l'instruction de M le Dauphin; ou à propos de science, comme dans son
Discours pour montrer que les doutes de la philosophie sceptique sont de grand
usage dans les sciences; ou enfin, dans ses Considérations sur l'Eloquence françoise
de ce tems ou dans ses Nouvelles remarques sur la langue françoise, où il traite du
langage; toujours ce sceptique cherchera à renverser les idées reçues et à soulever
les paradoxes susceptibles de ruiner les doctrines. Pour s'en convaincre, il ne s'agit
que de citer cette phrase tirée du Petit traité sceptique sur cette commune façon de
parler, «n'avoir pas le sens commun»: «Les dix moiens de l'Epoque sont ces
rénards subtils, qui portent l'incendie & la désolation dans les bleds des philistins,
c'est à dire, dans toutes les disciplines des savants [...]»91.
Étudions maintenant l'argumentation sceptique que propose La Mothe Le
Vayer, et voyons quelle est la conception linguistique qui résulte de sa réflexion
philosophique, car le style de notre auteur est fortement tributaire du type
d'argumentation qu'il développe. Les sceptiques anciens ont tout de suite aperçu la
contradiction qui pouvait découler de leur conception du langage. Une philosophie
qui ne veut rien affinner, qui se limite à la non-assertion, se retrouve en quelque
•
91
Fr. de La Mothe Le Vayer, op.
Cil.,
t. Il, p. 270 (197).
72
•
sorte prisonnière du langage et de sa valeur assertorique. Le centre de
l'argumentation sceptique sera, de l'Antiquité jusqu'au XVIl ième siècle, une tentative
de lever de différentes manières cette contradiction entre les principes du
scepticisme et son mode d'énonciation.
Sur ce plan, Pyrrhon ira jusqu'au bout de la logique sceptique et prônera
l'aphasie, c'est-à-dire la suspension totale de toute affinnation portant sur la nature
même des choses. En pratique, le sage suit les règles que lui impose la société où il
vit. Pyrrhon et les sceptiques atteignent ainsi l'état de grâce qu'est l'ataraxie.
D'autres sceptiques ont proposé une tenninologie marquée par l'usage
constant de préfixes privatifs, notamment le a dans la langue grecque. Par exemple,
Pyrrhon disait que les choses sont a-diaphora ou an-épicrita, c'est-à...dire
«indifférentes» ou «indétenninées». Ces fonnes reflètent l'impossibilité ontologique
de détenniner la nature des choses. Stratégie linguistique que l'on peut rapprocher
des théologies négatives développées, dès le judaïsme hellénistique, par Philon et
Clément d'Alexandrie 92 , puis, au Moyen Âge, par Denys l'Aéropagite dont
l'influence est énonne. La Mothe Le Vayer n'est pas sans connaître cette philosophie
du Dieu caché qu'on peut regarder comme une fonne de scepticisme chrétien, qui va
de Nicolas de Cues, à Montaigne, à Pierre Charron. Cependant, ces stratégies
linguistiques restent d'une aide secondaire, car il est toujours possible de transfonner
•
92 Jean Daniélon, «La transcendance de Diew), in Message évangélique el culture hellénistique aux [If! etllf!
siècles, Tournai, Desclée & Cie, 1961, p. 297·316.
73
•
les expressions négatives en propositions dogmatiques. On Pavait déjà reproché aux
Nouveaux Académiciens qui faisaient usage de ce type de procédés. Enfin, La
Mothe Le Vayer utilise rarement les expressions privatives ou négatives.
Passons ensuite à un autre procédé cherchant à définir la portée linguistique
du scepticisme: celui de l'auto-relativisation du discours. Des expressions comme
«je ne définis rien», «pas plus ceci que cela», «pas plus», <<tout est indétenniné» ou
encore «peut-être» expriment que les phrases qui semblent au premier abord
affinnatives ne le sont pas. Ainsi le langage reste fondamentalement indétenniné,
puisqu'il est lui-même arbitraire. C'est dire que le scepticisme se distingue d'abord
du stoïcisme par sa conception du signe.
Sextus Empiricus explique sur plusieurs pages ces expressions dubitatives,
qui risquent d'être comprises comme des expressions négatives et, du même coup,
associées aux dogmatiques. Il prend grand soin de rejeter cette interprétation. Il
précise d'abord le sens du mot «détenniner» (orisein) . Selon Sextus, «détenniner»
doit être entendu au sens fort et stoïcien d'«énoncer quelque chose sur une chose
obscure en y ajoutant l'assentiment»93. Ce que ne font pas les sceptiques, puisqu'ils
ne donnent leur assentiment ni aux représentations ni aux notions. Les sceptiques ne
font que dire leur «impression» (pathos). C'est précisément ce qu'expriment les
différentes expressions de relativité: le sceptique ne détennine rien, parce qu'il ne
•
dit jamais que ce qu'il perçoit et non ce qui est vraiment:
93
Sextus Empiricus, Esquisses pyrrhoniennes, Paris, Seuil, «Points», 1997, p. 163.
74
•
Quand, donc, le sceptique dit: (de ne détennine rien», il veut dire
ceci: «Je suis actuellement affecté de manière telle que je ne pose
ni ne rejette dogmatiquement aucune des choses qui ont été mises
dans le champ de cette recherche.» En disant cela, il veut parler de
ce qui lui apparaît concernant les sujets proposés, affinnant cela de
manière descriptive et non avec une assurance dogmatique, mais
rapportant ce qu'il ressent (paskhei).94
Toutes ces tentatives d'hannoniser le scepticisme et le langage ont ceci en commun
qu'elles cherchent à transfonner non seulement l'usage, mais la nature même du
langage. Les procédés sceptiques n'ébranlent que de manière superficielle le pouvoir
«affinnatif» et logique de la proposition.
Lors de la redécouverte de la philosophie sceptique au XVI ième siècle,
Montaigne soulève à nouveau ce problème de l'incompatibilité du langage et de la
philosophie dans l'«Apologie de Raimond Sebond» :
Je voy les philosophes Pyrrhoniens qui ne peuvent exprimer leur
generale conception en aucune maniere de parler: car il leur faudroit
un nouveau langage. Le nostre est tout formé de propositions
affirmatives, qui leur sont du tout ennemies: 9s
Montaigne va droit à la question sceptique de l'inadéquation du langage. Cette
nécessité d'un «nouveau» langage fait que les procédés énumérés plus haut,
habituels aux sceptiques, sont jugés inutiles par Montaigne, encore qu'il ne dédaigne
pas de s'en servir à l'occasion. Comme il l'explique ensuite, les sceptiques ont beau
expliquer et justifier l'usage de tennes comme «détenniner» et «douter», leurs
efforts ne résistent pas aux critiques des philosophes dogmatiques :
•
94
Ibid, p. 163'()4.
95
Michel de Montaigne, «Apologie de Raimond Sebond», in op. cil., livre Il, chap. XII, p. 527.
75
•
[...] quand ils disent: Je doubte, on les tient incontinent à la gorge
pour leur faire avouër qu'aumoins assurent et sçavent ils cela~ qu'ils
doubtent. Ainsin on les a contraints de se sauver dans cette
comparaison de la medecine, sans laquelle leur humeur seroit
inexplicable: quand ils prononcent : J'ignore, ou : Je doubte, il
disent que cette proposition s'emporte elle mesme, quant et quant le
reste, [...].96
Montaigne pousse le scepticisme, pourrait-on dire au point de faire table rase
de toutes les tentatives des sceptiques antiques. Il nous dit que ces jeux de langage
auxquels s'amusait Sextus, lorsqu'il indiquait comment il faut lire tel tenne ou telle
expression, toutes ces «fantaisies» ne mènent absolument à rien. Il faudrait pouvoir
penser le problème linguistique autrement. En fait, doutant même de la logique et de
la méthode sceptique, Montaigne pousse le scepticisme au-delà de ses propres
limites. Montaigne retient ridée que la forme interrogative pourrait être la seule dont
disposerait la philosophie pour exprimer le doute : «Cette fantaisie est plus
seurement conceuë par interrogation: Que sçay-je? comme je la porte à la devise
d'une balance.»97
Suivant les traces de son prédécesseur, La Mothe Le Vayer n'aura toutefois
pas la prétention de créer un nouveau langage qui soit mieux adapté aux besoins du
scepticisme. Probablement s'agissait-il d'une tâche utopique dans l'esprit même de
Montaigne. La Mothe Le Vayer conçoit quand même une œuvre littéraire et
philosophique dont le langage tient réellement compte de la spécificité de la
•
96
97
Ibid, p. 527.
Ibid, p. 527.
76
•
philosophie sceptique. Comme Sextus Empiricus, La Mothe Le Vayer s'en prendra
aux dogmatiques de son temps et voudra réfuter les conceptions linguistiques liées
au purisme. La stratégie principale de La Mothe Le Vayer consiste à faire valoir que
toute position offre une position contraire, et qu'ainsi personne ne peut réellement
prétendre à la vérité. Pour convaincre ses adversaires de pratiquer l'epokhê, il met en
évidence la constante
isosthénie (isostheneia)
des
arguments, c'est-à-dire,
littéralement, «l'égalité des forces» en présence., ce que Montaigne figurait par
l'image de la balance. La démonstration de l'isosthénie est le cœur de toute
l'argumentation de notre philosophe. Elle structure et ponctue son style. Sextus
Empiricus représente un point de référence constant. La Mothe Le Vayer y puise
abondamment, sans toutefois s'y limiter.
Dans ses Esquisses pyrrhoniennes, afin de réfuter chacune des notions
dogmatiques, Sextus utilise les cinq modes d'Agrippa. Le désaccord flagrant qui
existe entre les écoles sur une même notion, le diallèle., la régression à l'infini., etc.
Sextus fait rarement usage des modes d'Énésidème. Et lorsqu'il le fait, il le fait
brièvement. Au contraire, La Mothe Le Vayer s'y réfère souvent, au dixième
notamment, celui qui expose la diversité des mœurs et des coutumes comme preuve
de l'impossibilité d'établir quelque vérité morale que ce soit. La Mothe Le Vayer
encense à plusieurs reprises le «divin» Sextus, mais il ne conserve en fait qu'une
mince partie des ressources dialectiques exploitées par son maître, essentiellement le
•
premier mode d'Agrippa, celui du désaccord entre les écoles sur une même question,
77
•
et le dixième d'Énésidème. Peut-être La Mothe Le Vayer subit-il ici rinfluence de
Montaigne, qui aimait étourdir ses lecteurs par l'étalage d'une profusion de
coutumes différentes. Ainsi les lois qui paraissaient fondées en raison ne sont en fait
que traditions, qui ne résistent pas à l'examen. La fortune du dixième mode
s'explique certainement en partie par le bouleversement épistémologique que produit
la découverte du Nouveau-Monde. Montaigne était un fervent lecteur de récits de
voyages, La Mothe Le Vayer le sera aussi. Le dixième mode sceptique est tout à
coup amplement illustré par de frappants exemples qui remettent en question les
croyances que l'on pensait les plus assurées. La Mothe Le Vayer a toujours fait
preuve d'un grand intérêt pour ce type d'ouvrages. Comme le montre bien Pintard
dans Le Libertinage érudit, La Mothe Le Vayer se nourrit à deux sources
importantes. Il s'intéresse, d'une part, aux ouvrages des géographes et des historiens
antiques~
tels que Strabon et Hérodote; d'autre part, aux récits des voyageurs et des
découvreurs modernes, tels que Jean de Léon, Herrera, Oviedo, sans oublier les
relations de Marco Polo et de Samuel de Champlain, etc. L'érudition de La Mothe
Le Vayer est colossale, à tel point qu'il se place «[...] pour la connaissance des
différences de mœurs et d'idées, au premier rang de ses contemporains. Ainsi
dépasse-t-illargement ses prédécesseurs, Montaigne et Charron.»98
Au début de sa carrière, La Mothe Le Vayer utilise la fonne du dialogue pour
•
exprimer son scepticisme. Dans ses Dialogues à l'imitation des Anciens écrits~ selon
René Pintard. Le Libertinage érudit dans la première moitié du XVl/e siècle. Genève-Paris. Slatkine. 1983.
p.139.
'18
78
•
Pintard, vers 1632 ou 1633, un interlocuteur n'exprime jamais une idée sans qu'un
autre lui réponde pour défendre une position opposée. Dans un premier temps, le
sceptique soulève donc le désaccord. Dans un deuxième temps, il accumule quantité
d'exemples, dans le but de convaincre des bienfaits de la suspension du jugement,
qui accorde la tranquillité. Ainsi Ephestion entretient son interlocuteur, Eudoxe, sur
le sujet des rites funéraires, lui montrant combien les coutumes étrangères peuvent
être différentes des nôtres:
Les anciens Irlandois, Massagetes, Derbices, et autres, faisoient
gloire de manger ainsi leurs pareos decedez, et les histoires
modernes des Indes, tant Orientales qu'Occidentales, nous marquent
infinies Provinces où cette mesme coustume est encore en usage. 99
Dès ses premiers écrits, La Mothe Le Vayer opte pour une structure argumentative
fortement marquée par la logique sceptique. Elle se divise clairement en deux
mouvements, comparables à ceux qu'on retrouve chez Sextus. Il soulève d'abord le
désaccord, puis l'illustre d'une grande quantité d'exemples dont le but est de
démontrer l'isosthénie des thèses opposées, et l'importance de l'epokhê.
Les Dialogues de La Mothe Le Vayer subissent une double influence
sceptique. Certains montrent bien cette sagesse que procure la suspension du
jugement, tandis que d'autres révèlent un polémiste très virulent, qui n'hésite pas à
prendre position. Dans ces derniers cas, La Mothe Le Vayer ne professe plus
l'epokhê pyrrhonienne, mais use plutôt d'une dialectique néo-académicienne. Il se
•
99
Fr. de La Mothe Le Vayer Dialogues faits à l'imitation des Anciens, Paris, Fayard, 1988, p. 31.
t
79
•
pennet alors d'affinner sans scrupule. Comme le constate Pintard, l'œuvre de
jeunesse de La Mothe Le Vayer est plutôt impétueuse et ne correspond en rien à la
retenue et à la mesure qu'il développera dans ses écrits tardifs, tels que ses
Opuscules. Autrement dit, le scepticisme éristique deviendra tranquillement
pyrrhonien.
Le Petit traité sceptique sur cette commune façon de parler, «n'avoir pas le
sens commun» (1646) est assez représentatif des conceptions du philosophe de la
maturité. La Mothe Le Vayer cherche à y expliquer que cette expression «ne pas
avoir le sens commun» est plus ridicule qu'injurieuse, puisqu'il est tout simplement
impossible de détenniner un sens un tant soit peu «commun». Il montre dans un
premier mouvement que, contrairement à ce que le vulgaire peut penser, certaines
personnes sont honorées de ne pas avoir le «sens commun». II ne s'agit pas
seulement d'une pointe, ni d'un jeu sur les mots comme les aimaient les philosophes
sceptiques depuis l'Antiquité, mais bel et bien d'un argument éthique, où se révèle
tout l'élitisme des conceptions de La Mothe Le Vayer. Si le vulgaire s'acharne à
trouver, puis à professer des vérités générales, c'est qu'il craint la solitude qu'entraîne
forcément la reconnaissance du caractère insondable de la réalité. Il n'y aurait donc
de «communauté» que des gens qui mentent, ou qui s'illusionnent. Ce qui donne un
tout autre sens à la question de l'hypocrisie. Le sage sceptique ne peut être
entièrement sincère que dans l'ataraxie. Dès qu'il tente de donner à l'une de ses
•
assertions une portée générale, a fortiori une portée sociale, soit qu'il se confonne
80
•
aux préjugés, soit qu'il invente, soit qu'il travestit. Dans tous les cas, il donne à ce
qui n'en possède pas, une extension provisoirement plausible.
Après avoir bien montré qu'il est impossible de s'accorder sur la nonne,
puisqu'il est «[...] insupportable de s'attribuer la connoissance du Sens commun,
quand à peine l'on sait quels sont les sentiments de ses plus proches voisins»lOo, La
Mothe Le Vayer, toujours à la manière de Sextus Empiricus, explique qu'en
supposant même un accord sur ce que serait le «sens commun» :
[...] encore est il aisé de montrer par induction & par quelques
exemples appropriés à ce SUje4 combien cette supposition est
erronée, et combien de choses passent universellement pour bonnes
& vertueuses dans un lieu, qui sont reputées aussi généralement
méchantes et vicieuses dans un autre. Commençons par la
comparaison du vieil au nouveau Monde, [... ]101
Débute alors une longue description de mœurs et de coutumes qui renforcent l'idée
qu'il existe toujours quelques éléments paradoxaux propres à renverser nos
croyances. Plusieurs exemples sont tirés des récits de voyage. La Mothe Le Vayer
entend ainsi réfuter les fondements même de l'éthique. Si cette partie de la
philosophie apparaît sans fondement, c'est alors toute la philosophie qui tombera
sous le coup du scepticisme: «Ces trois points [de l'éthique] examinés
•
o'·
te.» 102
sceptiquement,
nous peuvent C
lalre
Juger d
e touti
e res
•
100 Fr. de La Mothe Le Vayer, «Petit traité sceptique sur cette commune façon de parler, "n'avoir pas le sens
commun"»), in op. Cil., t. Il, p. 256 (143).
101 Ibid. t. Il, p. 256 (143).
102 Ibid, t. Il. p. 259 (156).
81
•
Lorsqu'il a bien montré que l'isosthénie faisait figure de maîtresse en éthique,
il recourt ensuite à deux modes d'Énésidème : celui de la relativité lO3 , qui établit que
la gauche n'existe pas sans la droite et qu'une conception philosophique ne va pas
sans son exact opposé; et celui qui montre par différents exemples que les sens et
même la raison, qu'on dit souveraine, sont une source intarissable de mensonges et
d'erreurs 104. À la fin de ce parcours très sinueux et ponctué de longues étapes, La
Mothe Le Vayer revient brièvement dans les dernières pages de son opuscule sur
l'expression «sens commun» pour conclure :
Je me doute bien que je ne me suis que trop étendu dans cet
Opuscule au gré de plusieurs, qui diront peut-être qu'en traitant du
Sens commun, j'ai fait voir que je n'en avois pas grande
..
105
provIsion.»
Au fond, La Mothe Le Vayer ne s'intéresse guère à l'expression qui donne son nom
au traité. L'intéresse davantage une question beaucoup plus importante à ses yeux :
«Et ils considéreront, s'il leur
plait~
que c'est le propre de l'Epoque de traiter des
paradoxes, & de rendre douteuses les propositions qu'on reçoit ordinairement pour
constantes.»106 Son projet est en fait l'établissement d'une structure argumentative
autonome, faite de quelques paradoxes essentiels qui permettent de réfuter n'importe
quels dogmes ou opinions.
•
103 Correspond au huitième mode de Sextus, à la page 129 de ses Esquisses pyrrhoniennes, et au dixième
mode décrit par Diogène La!rce.
e e
104 Sous ce dernier mode, on peut regrouper les 3 , 4 et Se modes qui concernent les différentes perceptions
~ssibles selon les caractéristiques du sujet, de l'objet ou bien des deux à la fois.
os Fr. de La Mothe Le Vayer, op. cil., 1. Il, p. 271 (202).
106 Ibid, 1. Il, p. 271 (202).
82
•
De ce point de vue, l'écriture de La Mothe Le Vayer possède des
caractéristiques frappantes. Elles ne sont ni d'ordre morphologique, comme l'ajout
d'un a privatif pour marquer les limites de la définition, ni d'ordre lexical, tel l'ajout
d'expressions toutes faites pour souligner la relativité du discours. La Mothe Le
Vayer ne répond en rien au vœu de Montaigne qui souhaitait la création d'un
nouveau langage. Il utilise une langue très confonne aux normes de son temps. Son
originalité est à chercher ailleurs.
Un texte de La Mothe Le Vayer se présente toujours comme le résultat d'un
savant échafaudage d'assertions, d'arguments qui s'affrontent en apparence, mais qui
en réalité finissent par construire un parfait équilibre, une entière impartialité de
l'énonciation. La Mothe Le Vayer ne se contente pas d'écrire en toutes lettres que
tout possède son exact contraire, il le représente dans l'élaboration de ses textes, qui
sont de vastes illustrations de ce principe de l'égalité des forces. Bernard Beugnot,
dans un court article traitant de la fonction du dialogue chez La Mothe Le Vayer,
remarque que «[...] le dialogue accroît l'effet sceptique par la multiplication des
plans et des points de vue»107. Il note encore que le dialogue sceptique de La Mothe
Le Vayer est bien différent de ceux de Platon ou de Cicéron, car il «est régi au
contraire par un principe de juxtaposition et trouve là sa nature propre [... ]»108.
•
107
Bernard Beugnot, «La fonction du dialogue chez La Mothe Le Vayer», in Cahiers de l'association
internationales des études!rançaises, nO 24 (1972), p. 38.
108
Ibid, p. 38.
83
•
Les différentes positions évoquées par les personnages des premiers
dialogues sont plus tard habilement assumés, dans les Opuscules et les Petits traités.,
par un auteur unique. Malgré cette évolution fonnelle, la réflexion de La Mothe Le
Vayer demeure essentiellement la même. Grâce à cette constante isoslhénie des
arguments, La Mothe Le Vayer ne réalise-t-il pas l'acte de langage par excellence du
pyrrhonisme, l'aphasie? Bien sûr, l'aphasie de La Mothe Le Vayer n'est pas celle de
Pyrrhon, puisque celui-ci, en refusant l'écriture, retire au langage le masque de la
stabilité. Mais La Mothe Le Vayer propose tout de même une suspension complète
du jugement. Il vise dans plusieurs textes à toucher un scepticisme absolu, qui
balance invariablement d'un point de vue à l'autre, sans ne jamais rien déterminer.
Là se trouve la quiétude que recherchent toutes les philosophies morales de
l'Antiquité, qui est d'amener le lecteur à reconnaître l'epokhê pour le seul salut
s'offrant à l'âme humaine.
Enfin, La Mothe Le Vayer réussit de façon convaincante à résoudre le
problème qu'avait toujours posé le scepticisme, celui d'une incompatibilité entre
langage et philosophie, qu'il hannonise dans une écriture subtile. Parmi ses
contemporains, sans doute est-il celui qui est allé le plus loin dans l'élaboration d'une
réflexion sceptique, malgré la réprobation, voire la menace des pouvoirs religieux et
civil. Qu'un libertin comme Cyrano de Bergerac, dans L'autre monde, ou les états et
empires de la Lune et du Soleil., doive pour se protéger exprimer ses idées sous le
•
84
•
voile d'un roman utopique, indique toute l'audace et toute la ténacité dont La Mothe
Le Vayer fait preuve dans son œuvre.
Mais La Mothe Le Vayer ne fut pas qu'un philosophe tentant d'hannoniser
son mode d'expression à la logique de sa philosophie. Sa vision éclectique du savoir
humaniste le poussa par ailleurs à prendre la plume pour l'examen de questions
grammaticales et linguistiques. Sa façon bien à lui d'aborder ces matières en fait un
grammairien pyrrhonien. En effet, dans les Considérations sur l'Eloquence françoise
de ce lems (1637), La Mothe Le Vayer présente des conceptions linguistiques qui
s'inspirent profondément de la «divine sceptique». L'on peut discerner dans ce texte
deux principes essentiels qui détenninent toute sa conception de la langue et de
l'éloquence.
L'expression «pas plus ceci que cela»lo9, empruntée à Sextus Empiricus,
exprime bien l'idée générale du premier de ces principes. L'esprit antidogmatique
des sceptiques, appliqué au domaine linguistique, se traduit par un constant refus de
privilégier une pratique au détriment d'une autre. Puisqu'il est impossible de
connaître les fondements ontologiques du langage, le grammairien ne peut se
déclarer en faveur de tel ou tel usage. Tous les usages se valent. Le sceptique du
xvn ièrnc siècle s'opposera donc au «bon usage» et au «bel usage» de son temps, qui
reflètent, sur un plan linguistique, l'esprit du dogmatisme. Afin de dénoncer cette
attitude à vouloir tout régler, La Mothe Le Vayer ne donne-t-il pas l'exemple de ces
•
109
Sextus Empiricus, op. cil., p. 157.
85
•
deux stoïciens, Cléanthe et Chrysippe, qui faillirent à leur désir de codifier la
rhétorique ancienne110?
Ce principe sceptique, faisant de ce qui s'oppose des égaux., est
particulièrement évident dans la première partie des Considérations., où il est
question du soin que l'on doit apporter au choix des mots pour atteindre une grande
éloquence. Question épineuse s'il en est une au XVII ième siècle, car là réside le cœur
du débat linguistique. Faut-il respecter ou dénoncer la conception réductrice de la
cour qui règle l'usage? Faut-il défendre ou condamner une théorie des registres
stylistiques qui décide de la noblesse ou de la délicatesse d'une expression, qui
décrète d'un mot qu'il est «haut» ou qu'il est «bas»? La Mothe Le Vayer répond
d'une part que l'éloquence n'est pas une question de mots et de rhétorique, mais bien
davantage de sagesse et de philosophie: «Il s'en faut tant qu'il y ait de la repugnance
entre la Philosophie & la Rhetorique, que les plus celebres Orateurs ont reconnu la
sagesse pour le principal fondement du bien dire, & que la Philosophie étoit la mere
commune de toutes les plus belles paroles [...]» III. D'autre part, éclairé des lumières
de la philosophie sceptique, il déclare que le choix des mots est secondaire. Qu'un
tenne soit ou non du «bon usage», ce n'est pas ce qui fait l'éloquence, car il y a
toujours absence de critères véritables. Ce qui donne à l'auteur une grande liberté
vis-à-vis du vocabulaire.
•
110
Fr. de La Mothe Le Vayer, op. cit.• t. 1, p. 265 (195).
III
Ibid, p. 267 (203).
86
•
Afin de démontrer que l'une et l'autre des options se valent, La Mothe Le
Vayer utilisera à nouveau son argument du désaccord. Dans la première partie de
son traité, il énumère donc plusieurs exemples montrant que le soin porté aux
vocables s'avère essentiel. Les plus grands orateurs, tels Cicéron et Quintilien, ont
demandé de rejeter les mots barbares, dialectaux, bas ou archaïques et surtout ceux
qui entraînaient de l'obscurité Il 2. Mais dans les pages suivantes, il en arrive à
démontrer tout le contraire. Car le soin dans le choix des mots peut se retourner
contre son auteur :
Aussi faut-il avouer, que comme c'est une chose fort à estimer, [...]
de n'user point de tennes reprehensibles, c'est d'une [sic] autre côté
une grande misere de s'y asservir de telle sorte, que ce soin
prejudicie à l'expression de nos pensées. ll3
n montre maintenant que la perfection de l'éloquence provient parfois de l'usage de
ces mêmes mots barbares, vieux, obscurs, qui frappent l'esprit et qui expriment
mieux la pensée de l'orateur.
Mais son argument du désaccord ne se limite pas seulement au chapitre
traitant du vocabulaire. II est mis à profit tout au long de l'ouvrage, toujours pour
prouver qu'aucune règle ne peut faire autorité. Contrairement à Du Vair, qui
présente les Anciens entourés d'une auréole d'unanimité, La Mothe Le Vayer
informe son lecteur que même les plus grands philosophes ont été critiqués en leur
temps. Même un Cicéron, dont le nom se confond aux XVI
•
112
113
Ibid, p. 266-67 (196-200).
Ibid, p. 267 (200).
ièrne
et
xvn ième siècles
87
•
avec celui d'éloquence, s'est vu reprocher par ses contemporains ses «périodes» trop
longues et «ce je ne sai quoi de lache & d'enervé» 114. Quintilien, Cicéron et
Alexandre donnaient chacun une définition différente de ce qu'était la longueur
parfaite d'une phrase.
Le désaccord apparaît encore concernant l'argument qui oriente toutes les
Nouvelles
remarques
sur
la
langue françoise
(1647-48).
En
repassant
scrupuleusement les Remarques de Vaugelas, La Mothe Le Vayer s'amuse à
montrer que l'usage des gens de cour, qui est le principe de la grammaire, dément
très souvent les règles même que le grammairien tente d'établir: «Il veut, qu'on dise
prévit, & non prévût, celui-ci néanmoins est plus en usage.» 115 Il est audacieux de
trancher, car un autre usage, ainsi qu'on pouvait le dire à propos des coutumes, sera
toujours également reconnu. L'intérêt de cet argument du désaccord pour La Mothe
Le Vayer réside dans l'idée que, si les plus grands esprits n'ont jamais pu rien
définir, il convient de ne donner que des directives très générales, laissant place aux
convictions de chacun. Ne croyant en théorie en aucune vérité, mais tâchant en
pratique de respecter une certaine tradition socioculturelle, le sceptique est libre de
choisir. Devant l'instabilité fondamentale du langage, le grammairien sceptique
revendique la liberté. Et serait-elle seulement intérieure, philosophique, qu'elle
placerait La Mothe Le Vayer à contre-courant de la conception linguistique du
•
114
liS
Ibid. p. 290 (297).
Fr. de La Mothe Le Vayer, «Des nouvelles remarques sur la langue françoise», in op. cit., t.
n, p. 486 (32).
88
•
xvn ième siècle qui travaille à dégager toujours
plus de règles, qui sont aussi celles
de la pensée.
Même Vaugelas professe en partie cette liberté sceptique. Il fait lui aussi
appel à la liberté de jugement. Lorsqu'il est impossible de distinguer deux
expressions qui expriment une idée semblable, Vaugelas les juge toutes deux aptes à
figurer au «bon usage» :
Que si elles sont partagées, ou en balance, il sera libre d'user tantost
de l'une des façons & tantost de l'autre, ou bien s'attacher à celuy
des deux partis, auquel on aura le plus d'inclination, & que l'on
croira le meilleur. 116
Ce type de remarque est très proche de la pensée de La Mothe Le Vayer. C'est
l'importance attribuée au désaccord qui oppose les deux grammairiens. La Mothe Le
Vayer prétend que tout y est sujet, alors qu'il ne touche, selon Vaugelas, qu'une
infime partie du langage. Il n'y a que très peu de désaccord possible, explique le
grammairien dans la préface aux Remarques, puisque l'<<usage déclaré», c'est-à-dire
l'usage de «la plus saine partie de la Cour»"', a déjà tranché le désaccord. Et lorsque
l'usage est dit «douteux», le principe de l'analogie lèvera bientôt le doute. C'est dire
que Vaugelas voudrait effacer toute fonne d'hésitation.
La position de Marie de Gournay s'apparente à celle de La Mothe Le Vayer.
On peut la dire sceptique, car, lorsqu'elle défend avec acharnement les poètes de la
Pléiade, elle lutte pour cette liberté d'énonciation et cette richesse de la langue qui
•
116
117
Claude Favre de Vaugelas, Remarques sur la languefrançoise. Paris, Droz, 1934. p. XII.
Ibid., p. VIII.
89
•
furent si chères aux poètes renaissants, et que la notion de «bon usage» en pratique
viendra remplacer. Mais La Mothe Le Vayer considère infructueux l'effort des
poètes du XVl ième siècle, lorsqu'il écrit dans ses Considérations: «J'avoue [...] que
nos Poëtes mêmes qui se sont voulu donner quelque liberté en cela, n'y ont pas
travaillé avec succès» 118. Marie de Gournay bagarre pour l'égalité des différents
registres linguistiques et peste contre ceux qui rejettent un pan entier de notre langue
au nom de la pureté. Son antidogmatisme veut conserver tout le spectre des
possibilités, elle ne saurait souffrir la servitude que lui impose l'usage. Bien qu'elle
ne soit pas associée au mouvement sceptique, elle témoigne tout de même en
matière de grammaire d'un doute systématique, d'une liberté de jugement qui la font
une adepte de cette philosophie. Elle joint d'ailleurs les rangs des érudits dans la
défense du langage.
De ce premier principe de l'égalité des contraires, où toute tentative de
régl~mentation s'avère
téméraire, voire chimérique, découle un second principe, tout
aussi déterminant pour la réflexion sceptique de La Mothe Le Vayer. Il s'agit en fait
d'un corollaire, car s'il y a égalité et qu'on ne peut favoriser l'un plus que l'autre, il
faut se ranger dans une neutralité que La Mothe Le Vayer nomme la mesure. Si l'on
retourne à Sextus, il exprime ainsi cette maxime sceptique : «du fait de la force égale
des choses opposées, nous sommes conduits à l'équilibre»1I9. La Mothe Le Vayer
illustre ce principe qui guidera ses conceptions linguistiques par l'exemple de
•
118
Fr. de La Mothe Le Vayer, op. Cil., t.1, p. 270 (215).
119
S
' .
extusE
mplncus.
. p. 157.
op. CIl.,
90
•
Démétrius. Dans cette citation tirée des Considérations, Démétrius examine le débat
concernant l'hiatus et donne ensuite son avis sur la meilleure des attitudes:
Il ne faut pas douter qu'il n'y ait de certains concours de voielles, qui
sont grandement à fuir à cause du mauvais son qui en procede [... j.
Mais aussi ne faut-il pas penser que ce soit une maxime generale,
qu'on ne doit jamais souffrir deux voielles qui se touchent. A la
verité Demetrius nous apprend qu'Isocrate & ses Disciples la
voulurent établir; en quoi ils furent contredits par d'autres qui
prenoient ce conflit, ou collision de voieIles, comme les Latins en
parlent, pour une chose du tout indifferente. L'avis de Demetrius,
qui doit, ce me semble, être suivi, tient le milieu entre ces deux
extremitez. 120
Mais il faut immédiatement préciser que cette «médiocrité» ne s'applique pas
à toute sorte de travaux :«[... ] la médiocrité, qui est une si grande vertu dans toute la
Morale, est presque un vice insupportable dans la Poësie», car, «sans mentir,
l'entousiasme d'un grand Poëte le fait voler bien haut»121. La mesure s'applique
alors aux ouvrages didactiques ou philosophiques qui traitent «des pensées sérieuses
et raisonnables» 122, où la matière demande du jugement et de la réflexion.
C'est principalement dans les deuxième et troisième parties de son traité qu'il
mettra à profit cette maxime, qui est en grande partie une réponse à l'esthétique
baroque de la fin du siècle précédent, où régnaient l'hubris et l'exagération. La
mesure témoigne d'une bonne utilisation du jugement et de la raison. Sans ces
facultés, nous sombrons dans l'arbitraire: « [ ... ] mais Demosthene & Ciceron se
•
Fr. de La Mothe Le Vayer, op. cit., 1. l, p. 277 (243).
Fr. de La Mothe Le Vayer, «Discours pour montrer que les doutes de la Philosophie Sceptique sont de
~d usage dans les sciences)), in op. cil., t.1I, p. 226 (21 et 22).
22 Ibid, p. 227 (23).
120
121
91
•
sont par tout donné de merveilleuses licences pour ce regard. On ne doit pourtant
pas penser qu'ils en aient ainsi usé sans raison.»'23 Nous voyons se dessiner ici
l'influence de la philosophie stoïcienne sur La Mothe Le Vayer. Il a beau s'élever
plus souvent qu'à son tour contre les thèses du Portique, il admire tout de même
cette image du sage qui maîtrise ses passions pour mettre de l'avant les facultés de
l'esprit. Il devient alors difficile de départager le scepticisme et le stoïcisme. On peut
dire que l'attitude stoïcienne vient en quelque sorte combler un vide laissé par le
scepticisme. Le sceptique se retrouve en pratique dans une position délicate où il
doit tout de même souscrire à une fonne de philosophie «provisoire». Et grâce à la
raison, il parvient à montrer la faiblesse de la raison même.
C'est dans cet esprit que La Mothe Le Vayer aborde la question des phrases et
des «oraisons» dans ses Considérations. Tout peut être soumis à la règle de la
mesure chez La Mothe Le Vayer : la longueur et la qualité de la phrase, l'utilisation
des citations étrangères, le style, l'hyperbole, la métaphore, etc. Par exemple,
lorsqu'il étudie la phrase et sa parfaite composition, il ne fonnule aucune règle, sinon
celle très générale: «Une période peut pêcher [sic] dans la quantité en deux façons,
soit qu'elle soit trop longue, ou trop courte.»124 Une phrase longue et complexe
devient obscure, voire inintelligible, tout comme à l'autre extrémité une phrase trop
courte. De même lorsqu'il parle des tropes et des figures, il propose aux auteurs d'en
•
user avec modération et jugement :
123
124
Fr. de La Mothe Le Vayer, op. cil., t. l, p. 273 (227).
Ibid, p. 274 (229).
92
•
Car les metaphores dont nous avons déja parlé, les epithetes, les
paronomasies ou allusions, les hyperboles, & le reste des Figures
[...] sont autant de lumieres d'Oraison, qui lui donnent un lustre
merveilleux. C'est pourtant aussi une maxime generale, qu'il n'en
faut pas user avec excès, pource que les plus belles choses du
monde perdent leur grace, & deviennent même odieuses, si on s'en
sert immoderément. 125
Il aborde la question des citations grecques ou latines avec le même regard.
C'est le jugement et la bienséance qui doivent guider le choix des citations. Lorsque
l'orateur s'adresse à un auditoire peu familier des questions savantes, les langues
anciennes seront certainement mal reçues. Tandis que devant une assemblée
d'érudits, il aurait tort de ne pas faire étalage de ses connaissances. Encore qu'il
doive même alors avoir «de la retenuë, & quelque bien-seance à observer en
cela»'26. La règle d'or de La Mothe Le Vayer est celle de la mesure, du decorum
cicéronien. Une mesure qui a pour critère le jugement et la raison. Dans les
nombreux exemples que reofennent les Considérations, quelle que soit la matière
étudiée, oous retrouvons cette maxime que La Mothe Le Vayer résume de belle
façon dans ce passage :
Celui qui se souviendra que toutes les vertus consistent en une
certaine mediocrité Geometrique, également distante de l'excès &
du defaut, ne s'étonnera pas que nous mettions toûjours l'Eloquence
entre deux extremitez à fuir, puisque ses Professeurs l'ont qualifiée
l'une des plus grandes, & des plus éclatantes de toutes les vertus. 12?
•
Ibid, p. 277 (245).
Ibid., p. 287 (282).
127 Ibid, p. 289 (293).
125
126
93
•
Cette théorie sceptique de la langue peut être rapprochée des conceptions
pascaliennes de l'homme et de l'éloquence. Selon Pascal l'homme, par sa nature, se
retrouve pris entre deux pôles : un infiniment grand et un infiniment petit, «un
milieu entre rien et tout» 128. En ce qui concerne l'éloquence, Pascal se préoccupe
d'abord de la justesse du ton. Il faut construire son discours selon «l'esprit et le cœur
de ceux à qui l'on parle [... ]», il ne faut pas «faire grand ce qui est petit, ni petit ce
qui est grand»129. Mais Pascal et La Mothe Le Vayer sont aux antipodes, si l'on
considère le sens que chacun donne à cet écartèlement qui définit la condition
humaine. La grâce de l'un apparaît là où s'arrête le vide creusé par l'autre.
•
121
129
Blaise Pascal. Pensées. Paris, Librairie Générale Française, «Livre de poche», 1972~ p. 29.
Ibid, p. 8.
•
CONCLUSION
Les guerres qui déchirèrent la Grèce, dans la première partie du IV ième siècle
av. J.C., eurent pour effet d'ébranler profondément la notion de «divinité». Les
citoyens comprirent que ces dieux de la cité, qui devaient protéger les populations,
maintenir ou du moins rétablir rapidement la paix, restaient sourds à leurs
supplications. Le doute s'installe parmi les philosophes, donnant lieu à un
affrontement entre ceux qui restent fidèles au traditions religieuses et ceux qui
troquent l'autorité spirituelle pour une autorité humaine.
Platon reste fidèle aux usages du passé. Il continue à honorer les dieux et
construit sa métaphysique en postulant une essence absolue des êtres et des choses.
Platon désire que l'âme humaine s'élève au-dessus des lois établies par l'homme,
pour qu'elle accéde à des vérités immuables, voire divines. Transcendance évidente
lorsque Platon entreprend de définir le langage, plus encore lorsqu'il définit la
poésie et qu'il décrit le phénomène de l'enthousiasme. Le dieu prend littéralement
possession du poète. Par le truchement de cette voix et de ce corps qu'il «possède»,
•
le dieu s'adresse aux hommes. Dans le Phèdre et dans l'Ion, Platon explique qu'un
95
•
discours n'est beau que lorsqu'il est inspiré par l'esprit d'un dieu, par une force
supérieure.
À l'inverse, les sophistes, Protagoras en tête, professent un agnosticisme qui
rend vain tout questionnement religieux. Selon le célèbre mot du maître d'Abdère:
«l'homme est mesure de toutes choses» 130. Une fois l'absolu évacué, l'homme se
retrouve sans aucune vérité stable, seule la diversité des jugements fait loi. Les
sophistes s'attacheront à développer des outils oratoires leur pennettant de tirer
profit de cette diversité. Le langage et le raisonnement humains deviendront les
facultés fondatrices de cette nouvelle réalité. Le langage sophistique, ignorant la
vérité, n'a jamais que plus ou moins de vraisemblance, c'est-à-dire qu'il entraîne
plus ou moins le consensus. Sans être lui-même sophiste, c'est dans ce contexte
intellectuel qu'Aristote développera sa Rhétorique.
Au cours du IV ième siècle avant notre ère, se côtoient donc deux courants
philosophiques, proposant des conceptions du langage diamétralement opposées.
Cependant, ces deux courants s'apparentent en ceci que la langue et l'éloquence
sont déterminées par la philosophie. La fureur poétique tient étroitement à la
métaphysique platonicienne, de même que la sur-valorisation de la rhétorique tient
au naturalisme sophistique.
n existe une corrélation profonde entre la philosophie et
le langage, qui fait que seuls les philosophes peuvent se consacrer à l'étude de la
•
langue, du moins lorsqu'il s'agit des fondements de la langue, ce que les
IJO Jacqueline de Romilly, Les grands sophistes dans ['Athènes de Périclès, Paris, Librairie Générale
Française, «Livre de poche», s.d., p. 136.
96
•
grammalnens du XVII
ièmc
siècle nommeront la «grammaire générale». La
«grammaire particulière», qui s'intéresse au style et à l'esthétique d'une langue,
n'est ainsi qu'une activité qui s'ajoute aux lois grammaticales fondamentales, et à
laquelle peuvent s'adonner ceux qui ne sont pas philosophes.
On peut remarquer le même phénomène dans le cas de Cicéron. C'est sa
conception de l'orateur qui détermine la nature du langage et de l'éloquence.
Cicéron englobe le rôle de l'avocat et son art de la rhétorique dans une sphère plus
grande qu'est la connaissance philosophique. Étant donnée l'importance de la figure
de l'avocat au sein de la république romaine, celui-ci était investi d'une
responsabilité civile et humaine que seules les lumières de la philosophie pouvaient
garantir.
Au début du XVII ièmc siècle, les savants humanistes Guillaume Du Vair et
François de La Mothe Le Vayer poursuivent [a tâche du «grammairien-philosophe»
de l'Antiquité, puisqu'ils tentent de définir une langue qui tienne aux principes de
leur philosophie respective.
La physique stoïcienne fait de l'homme un être non pas divin, mais tout de
même éclairé d'une lumière divine, puisque la divinité n'est pas externe au monde,
elle se confond avec lui. Mais le stoïcien doit remplir une condition capitale: pour
donner droitement son assentiment, la raison doit continuellement s'exercer selon
•
les règles de [a logique stoïcienne. Toute la science et toute la sagesse tiennent ici
principalement à la faculté de jugement. Or, le jugement stoïcien s'avère d'autant
97
•
plus important que les philosophies antiques concevaient le langage comme un reflet
exact de la pensée, une matérialisation en sons et en lettres de la réflexion. La
perfection du langage «proféré» est donc la simple répétition d'un langage intérieur
parfaitement conçu. Le langage et la philosophie apparaissent toujours intimement
liés.
On retrouve aussi chez François de La Mothe Le Vayer cette correspondance
entre philosophie et langage, et cette reproduction de la réflexion dans les structures
de la langue. D'ailleurs il le mentionne clairement : «la parole est l'image de nôtre
discours intérieur»
131.
Alors que le stoïcien, grâce aux sens et à la raison, croit
posséder une perception juste de la réalité, le pyrrhonien, ou sceptique, juge qu'il ne
peut pas déterminer la nature du monde, puisqu'il est impossible pour l'homme non
pas même de le juger, mais de l'observer. Seul le créateur peut percevoir l'entièreté
de la réalité d'ici-bas. Face à cette indétennination, le sceptique est contraint de
considérer toutes les opinions possibles sans jamais pouvoir se prononcer, puisqu'il
ne peut en réfuter aucune. S'il doit les considérer toutes dans son esprit, il doit
également toutes les exprimer dans son langage parlé et écrit. C'est pourquoi la
langue sceptique de La Mothe Le Vayer se caractérise par la juxtaposition d'une
foule d'idées différentes et opposées. La seule position que La Mothe le Vayer laisse
voir dans ses textes est que toutes les positions se valent. C'est aussi pour cette
•
raison que dans les débats linguistiques qui l'opposent à Vaugelas, La Mothe Le
131
La Mothe Le Vayer. op. cil., t. 1, p. 265 (194).
98
•
Vayer fait constamment valoir la liberté linguistique contre la tyrannie de l'usage.
Lorsque l'usage intervient pour autoriser ou stigmatiser tel mot, il contrevient au
fondement même du scepticisme, qui demande qu'on suspende son jugement.
Les théories de Du Vair et de La Mothe Le Vayer, avec leur air vieillot et
conservateur, clôturent une époque, celle de l'humanisme érudit. Que le langage soit
une parfaite et simple représentation de la raison, est une conception qui sera
dépassée par Descartes, pour qui le langage sera un système de signes pennettant
d'exprimer sa pensée, mais dont la nature diffère de celle de l'esprit.
Les linguistiques du XVIl ième siècle se divisent en deux catégories: les
tenants de l'Usage contre le parti des grammairiens de la Raison. Il est clair que Du
Vair et La Mothe Le Vayer furent les grands perdants face aux gardiens de l'usage
que furent Malherbe, Vaugelas, avec sa «bible» du beau langage, et Ménage.
Jusqu'au XIX ième siècle Vaugelas fera autorité auprès des grammairiens. La postérité
aura donc donné raison plus souvent qu'autrement aux Remarques de Vaugelas
plutôt qu'à celles de La Mothe le Vayer, qui proposait un usage qualifié d'archaïque
et de pédant par ses contemporains.
Il faut toutefois souligner que la définition d'un «bon usage» fut loin d'être
un débat de la première importance pour nos deux savants. Ce serait méconnaître
leurs véritables aspirations philosophiques. Dans ses Nouvelles remarques sur la
•
langue françoise, le désir de La Mothe Le Vayer est moins de définir le beau parler
de la cour que de critiquer la méthode de Vaugelas. D'ailleurs, Danielle Trudeau
99
•
remarque qu' «ils [les opposants à Vaugelas] réagissent simplement à l' affinnation
trop brutale du détenninisme social de la nonne.»132 La Mothe Le Vayer n'accepte
pas que l'élaboration d'une langue repose sur un principe aussi arbitraire que celui
du prestige. Il estime, et c'est précisément ce qui constitue l'apport capital des
grammairiens-philosophes du début du XVU ième siècle, que la langue doit être
développée et décrite selon des critères logiques et rationnels.
La Grammaire générale et raisonnée de Port-Royal paraît en 1660. Cette
première grammaire dite «philosophique», qui aura une influence extraordinaire sur
les recherches grammaticales des siècles suivants, fonnule des concepts que l'on
retrouvait déjà dans les travaux linguistiques de Du Vair et La Mothe Le Vayer, bien
que ces concepts n'apparussent pas nommément dans leurs écrits. Lorsque Arnauld
qualifie sa grammaire de «générale», il signifie qu'il ne se préoccupe pas de décrire
l'usage particulier d'une langue, comme le firent Malherbe et Vaugelas, mais qu'il
s ~ intéresse strictement aux fondements immuables et communs à toutes les langues.
Arnauld explique qu'il est impossible de comprendre la langue avant «qu'on ait bien
compris auparavant ce qui se passe dans nos pensées» 133. Au fond, Arnauld reprend
l'approche que les linguistes humanistes ont toujours valorisée.
Dans De l 'eloquence françoise, et des raisons pourquoy elle est demeurée si
basse, non seulement Du Vair s'attarde-t-il à montrer l'importance cruciale de la
•
Danielle Trudea~ op. cit., p. 42.
Antoine Arnauld et Claude Lancelo~ Grammaire générale et raisonnée de Port-Royal, éditée par A.
Bailly, Genève, Slatkine Reprints, 1968, p. 46.
132
133
100
•
logique dans l'élaboration du langage, mais il tente aussi de découvrir les lois
universelles de l'éloquence lorsqu'il entreprend la traduction de discours prononcés
par <<Demosthene et iEchines» : «Je pense que l'on y trouvera les membres, les nerfs
& la charnure entière; mais quant au teint & la couleur, je ne me le promets pas» 134.
Il existe déjà pour Du Vair des lois qui viennent bien avant les questions de style, et
qui sont primordiales lorsqu'il est question d'étudier le langage.
Dans son traité Considérations sur l'Eloquence française de ce lems, La
Mothe le Vayer s'attaque directement aux grammairiens qui concentrent leur
attention sur des questions stylistiques, telles que le rejet des mots inusités, la
recherche de sonorités harmonieuses et la construction d'une cadence bien rythmée.
Il regrette que ces grammairiens ne s'attachent qu'à décrire et réglementer la
«grammaire particulière». L'idéal linguistique que propose La Mothe Le Vayer est
une langue qui respecterait un ordre universel. Il faut retourner à l'expression la plus
simple, à celle que la nature aurait pu lui attribuer. La Mothe Le Vayer affirme que
«la maxime d'Aristote [paraît] bien plus raisonnable, quand il soûtient que tout ce
qui se fait cùntre ordre, se fait contre la nature qui est admirablement ordonnée en
toutes ses parties.» 135
Comme le montre Noam Chomsky dans La linguistique cartésienne, la
grammaire de Port-Royal tente de démontrer que toute phrase, derrière son aspect
•
stylistique propre, peut se réduire à une structure profonde commune à tous les
134
135
Guillaume Du Vair, op. Cil., p. 406.
La Mothe Le Vayer, op. cil., p. 293 (306).
101
•
locuteurs, même de langues différentes. C'est cette structure profonde que l'on peut
relier au langage de l'ordre et de la nature que mentionnait, ou plutôt, pressentait Du
Vair et La Mothe Le Vayer comme la matière première d'une «grammaire
générale».
Mais l'influence des grammairiens-philosophes humanistes ne s'arrête pas à
la grammaire de Port-Royal. Au siècle suivant, le grammairien Du Marsais, dans ses
Véritables principes de la grammaire (1729), reprend en grande partie la division
devenue maintenant systématique d'une grammaire générale et particulière: «II y a
dans la grammaire des observations qui conviènent à toutes les langues; ces
observations fonnent ce qu'on apelle la grammaire générale. [... ] Outre ces
observations générales, il y en a qui ne sont propres qu'à une langue particulière.» [36
Cette même division, que l'on retrouve ensuite dans la Grammaire (1775) du
philosophe sensualiste Condillac, aura même des répercussions jusque dans le
XXième siècle, puisqu'elle se retrouve au cœur des théories linguistiques de
la
grammaire générative développée autour de Noam Chomsky.
Cette dichotomie s'avère importante puisqu'elle pennet au grammairIen
d'étudier la langue française dans son individualité aussi bien que dans ses
propriétés communes aux autres langues. Il est donc possible de rendre compte de la
valeur arbitraire de l'usage et du caractère universel de la langue, c'est-à-dire de
•
considérer la langue comme un système de signes, dont le mécanisme se fonde sur le
136
Du Marsais, Les véritables principes de la grammaire. Paris, Fayard, 1987, p. 61.
102
•
fonctionnement de l'esprit humain. La Grammaire de Condillac, qui s'appuie sur la
philosophie
sensualiste,
où
«la
pensée
et
la
langue
se
conditionnent
mutuellement» 137, s'oppose farouchement à l'hypothèse des idées innées, défendues
par Descartes et par les grammairiens de Port-Royal. Quoi qu'il en soit, ces deux
grammaires partagent tout de même ce principe directeur selon lequel «c'est dans
l'analyse de la pensée qu'il faut chercher les principes du langage.»)138 C'est le
postulat qui traverse les ouvrages de Guillaume Du Vair et de La Mothe Le Vayer.
À défaut d'avoir pu fixer l'usage, les linguistiques savants de la Renaissance
n'auront certainement pas été sans influencer les générations subséquentes de
grammairiens. Étudier les grammaires des XVIU ième et XIX ième siècles comme des
descendantes directes de la pensée des grammairiens-philosophes de la Renaissance
permettrait sûrement de mieux comprendre leurs fondements et leur évolution.
Les structures sociales monarchiques, qui pennettaient les implacables
commandements de Vaugelas et de Ménage, disparaissent avec la Révolution. Les
Remarques, témoignage éclatant de la puissance sociopolitique de la royauté dans le
domaine du langage, tombent alors en désuétude. Avec les progrès de l'esprit
positiviste et de l'empirisme scientifique, c'est maintenant la pensée de Du Vair et
de La Mothe le Vayer qui paraît beaucoup plus moderne, puisque ce sont des règles
générales et des remarques fondées sur des raisonnements logiques que recherchent
•
137 Étienne Bonnot de Condillac, Grammaire, édition de Ulrich Ricken, Stuttgart-Bad Canstatt, FrommannHolzboog, 1986, p. XXVII.
131 Ibid, p. 1.
103
•
les linguistes et les grammairiens modernes. Ces grammairiens-philosophes
paraissent d'autant plus modernes qu'à partir de Wittgenstein, il est factice, sinon
impossible de départir philosophie et théorie du langage.
•
•
BIBLIOGRAPHIE
1- Sources
Traités linguistiques et rhétoriques
Arnauld. Antoine et Lancelot, Claude. Grammaire générale et raisonnée de
Port-Royal, éditée par A. Bailly, Genève, Slatkine Reprints, 1968.
Augustin (Saint). «De l'enseignement chrétien», IV, 6, 10. in Théologiens et
mystiques au Moyen ige. La poétique de Dieu, édition et traduction de
Alain Michel. Paris, Gallimard, «Folio classique», 1997. 766 p.
--------------------. «De l'ordre». XIII, 38, in Théologiens et mystiques au
Moyen Âge. La poétique de Dieu, édition et traduction de Alain Michel.
Paris, Gallimard., «Folio classique». 1997, 766 p.
Balzac, Jean-Louis Guez (de). «Paraphrase ou de la grande éloquence», in
Roger Zuber (éd.), Œuvres diverses. Paris, Honoré Champion. 1995, p.
151-172.
Condillac, Étienne Bonnot (de). Grammaire., édition de Ulrich Ricken,
Stuttgart-Bad Canstatt, Frommann-Holzboog, 1986, 356 p.
Du Marsais, César Chesneau. Les véritables principes de la grammaire et
autres textes, 1729-/756, Paris, Fayard, 1987,637 p.
Gournay, Marie le Jars (de). Les idées littéraires de Marie de Gournay, édition
de Anne Uildriks. Groningen, Druk, 1962, 300 p.
Platon. «Ion», in Œuvres complètes, 1. V, 1ère partie. Édition et traduction de
Louis Méridier. Paris, Belles lettres, 1949, p. 29-82.
•
-------... «Protagoras», in Œuvres complètes, 1. III, l\:rc partie, édition et
traduction d'Alfred Croiset. Paris, Belles lettres, 1955, p. 20-86.
e
--------. «Gorgias», in (éd.), Œuvres complètes, t. III, 2 partie. édition et
traduction d'Alfred Croiset. Paris. Belles lettres, 1955, p. 107-224.
105
•
--------. «Phèdre», in Le banquet/Phèdre, traduction, notices et notes par Émile
Chambry. Paris, Garnier-Flammarion, 1964~ p.l 0 1-1 72.
Sextus Empiricus. Esquisses pyrrhoniennes. Paris, Seuil, «Points», 1997, 570 p.
Sorel, Charles. De la connaissance des bons livres, édition de Lucia Moretti
Cenerini. Rome, Bulzoni, 1974, 400 p.
Du sublime, Texte établi et traduit par Henri Lebègue. Paris, Belles Lettres,
1952_ 73 p.
Vaugelas, Claude favre (de). Remarques sur la languefrançoise, introduction
de Jeanne Streicher. Paris, Droz, 1934. 624 p. Réimpr. de r édition
originale, Paris, Veuve Camusat, 1647.
--------------------.. . .-----.. -----. Nouvelles remarques de M de Vaugelas sur la
languefrançoise. Genève, Slatkine, 1972,540 p. Réimpr. de l'édition
Paris, G. Deprez, 1690.
Guillaume Du Vair
Actions el lraiclez oratoires, édition de R. Radouant. Paris, Comély, 1911, 280 p.
Traité de la constance et consolation ès calamitez publiques, édition de J.
Flach et F. Funck-Brentano. PariS., Tenin_ 1915,255 p.
De la sainte philosophie. Philosophie morale des stoiques, édition et notes de
G. Michaut. PariS., Vrin, 1945, 122 p.
Œuvres. Genève, Slatkine Reprints, 1970., 1176 p. Réimpression de I"édition
de Paris_ 1641.
De l'eloquencefrançoise, édition critique précédée d'une étude de René
Radouant. Genève, Slatkine Reprints, 1970, 192 p. Réimpr. de l'édition
de Paris, 1907.
François de La Mothe Le Vayer
«Considérations sur l'Eloquence françoise de ce tems», in Œuvres: précédées
de l'abrégé de la vie de La Mothe le Voyer. Genève, Slatkine Reprints_
1970, 2 vol. Réimpression de Œuvres de François deLa Mothe Le Vayer.
Dresde, M. Groell, 1756-59, 7 vol.
•
«Des nouvelles remarques sur la langue françoise», in Œuvres, 1. Il, p. 478496.
106
•
«De la Rhétorique du Prince», in Œuvres, t. 1, p. 175-236.
«De la lecture de Platon et de son éloquence», in Opuscules et petits traitez,
parus dans Œuvres, t. l, p. 318..322.
Dialogues faits à l'imitation des Anciens. Paris, Fayard, 1988, 507 p.
II· Études
Ouvrages généraux
Adam, Antoine. Histoire de la littérature française au xvlfème siècle, 1. l,
L'époque d 'Henri IV et de Louis XIII. Paris, Éd. Mondiales, 1962, 615 p.
Arnim, Hans Friedrich August von. Stoicorum veterumfragmenta. Stutgardie,
TeubnerL 1968, 4 vol.
Baggioni, Daniel. «Imaginer une langue universelle chez les grammairiens
philosophes de l'âge classique et les "idéologues" (1600-1850)>>, in JeanMichel Racault (dir.), Ailleurs imaginés: Littérature, histoire,
civilisations. Paris, Diff. Didier-Érudition, 1990, p. 87-105.
Bréhier, Émile. Chrysippe et l'ancien stoïcisme. Paris, PUF, 1951. 295 p.
Bridoux" André. Le stolcisme et son influence. Paris. Vrin, 1966, 239 p.
Brunot, Ferdinand. Histoire de la langue française, T. III, Laformation de la
langue classique. Paris, Annand Colin. 1966, 2 vol.
Brunsch\vig, Jacques. Études sur les philosophies hellénistiques. Épicurisme,
stoi'cisme, scepticisme. Paris, PUF, 1995, 364 p.
Chiesa.. Curzio. «Écrire dans l'âme», in Réflexions contemporaines sur
l'Antiquité classique. Grenoble, Groupe de recherches Philosophie..
Langages et Cognition, 1996, p. 109-130.
Chomsky.. Noam. La linguistique cartésienne. Paris" Seuil. 1969.. 182 p.
Compagnon, Antoine. «Montaigne ou la parole donnée»" in Frank Lestringant
(dir.), Rhétorique de Montaigne. Actes du colloque de la Société des amis
de Montaigne (Paris. 14 et 15 déc. 1984). Paris, Honoré Champion, 1985.
p.9-19.
•
Cossutta, Frédéric. Le scepticisme. Paris" PUF, «Que sais-je?», 1994" 128 p.
107
•
Croll, Morris W. «Juste Lipse et le mouvement anticicéronien à la fin du XVIe
siècle et au début du XVIIe siècle), in Revue du XVie, 1914, p. 7-45.
Daniélon, Jean. «La transcendance de Dieu», in Message évangélique et
culture hellénistique aux Ile et Ille siècles, Tournai, Desclée & Cie. 1961,
485 p.
De Boer, Josephine. «Men's Literary Circles in Paris, 1610-1660», in
Publcations of the Modem Language Association of America, 53 (sept.
1938), p. 730-80.
Demonet-Launey, Marie-Luce. «Question doubteuse: le langage», in Bulletin
de la société des amis de Montaigne, 6c série, nO 15-16, 1983. p. 9-21; n°
17-18, 1984, p. 17-37.
Dumont, Jean-Paul. Le scepticisme et le phénomène. Paris, Vrin, 1985, 264 p.
Fumaroli, Marc. L'âge de l'éloquence. Rhétorique et «res literaria») de la
Renaissance au seuil de l'époque classique. Paris, Albin Michel, 1994.
882 p.
Gourinat, Jean-Baptiste. Les stoïciens et l'âme, PariS., PUF. 1996, 125 p.
Guillaumie, Gaston. J.L. Guez de Balzac et la prose française. Paris. Picard.
1927.561 p.
Holmes. Catherine E. L'Éloquence judiciaire de 1620 à 1660, reflet des
problèmes sociaux, religieux et politiques de l'époque. Paris, Nizet, 1967,
318 p.
Jehasse, Jean. La Renaissance de la critique. L'essor de l'humanisme érudit de
1560-1614. St-Étienne, Publications de l'Univ. St-Étienne. 1976. 712 p.
----------------. Guez de Balzac et le génie romain. St-Étienne, Publications de
l'Univ. de St-Étienne~ 547 p.
Julien-Eymard D'Angers. Recherches sur le stoïcisme aux XVl ièrnc et XVU
siècles. Hildesheim; New-York.. Georg Olms, 1976~ 532 p.
ièmc
Lebègue.. Raymond. «La période platonicienne et la période stoïcienne dans la
Renaissance française», in Bulletin ofthe International CommUee ofthe
Historical Sciences~ XI (1937), p. 314-18.
•
Le Guern, Michel. «Sur la place de la question des styles dans les traités de
rhétorique de l'âge classique», in George Molinié et Pierre Cahné (dir.)~
Actes du colloque international «Qu'est-ce que le style? ». Paris, PUF..
1994, p. 175-185.
108
•
Magnien, Michel. «Un écho de la querelle cicéronienne», in Frank Lestringant
(dir.), Rhétorique de Montaigne. Actes du colloque de la Société des amis
de Montaigne (Paris, 14 et 15 déc. 1984). Paris, Honoré Champion, 1985,
p.85-99.
Maurens, Jacques. La tragédie sans tragique. Le néo-stofcisme dans l 'œuvre de
Pierre Corneille. Paris, Annand Colin, 1966,348 p.
Michel, Alain. «Rhétorique et philosophie dans la littérature latine: Les
problèmes du cicéronisme», in Marc Fumaroli et Jean Mesnard (dir.),
Critique et création littéraire en France au XV/lème siècle. Paris, CNRS,
1977, p. 7-15.
-----------------. «L'influence de l'académisme cicéronien sur la rhétorique et la
philosophie au xvn iême siècle: La Mothe le Vayer, Huet, Pascal,
Leibniv>, in P. Tuyman, G. C. Kuiper et E. Kessler (dir.), Acta conventus
neo-Iatini amstelodamensis. Munich, Fink, 1979, p. 758-774.
Molinié, George. «La question du style naturel», in Littératures classiques,
n° 17 (automne 1992), p. 199-204.
Nash, Jerry C. «Stoicism in Early French Renaissance Literature», in Studies in
Philology, vol. LXXVI, 3 (July, 1979), p. 203-217.
Ott Karl August. «La notion du «bon usage» dans les Remarques de
Vaugelas», in Cahiers de l'association internationale des études
françaises, nO 14 (1962), p. 79-94.
Pintard, René. Le Libertinage érudit dans la première moitié du XVIIe siècle,
Genève-Paris. Slatkine. 1983, 765 p.
Popkin, Richard H. Histoire du scepticisme d'Érasme à Spinoza. Paris, PUF,
«Léviathan».. 1995, 341 p. Traduction de The History ofScepticism
[rom Erasmus to Spinoza. Berkeley, Univ. of Califomia Press.. 1979,
333 p.
Radouant, René. «L'union de l'éloquence et de la philosophie au temps de
Ramus».. in Revue d'histoire littéraire de /a France, XXXI (1924), p.
161-192.
Reboul, Olivier. Introduction à la rhétorique. Paris, PUF, 1991. 238 p.
Robin, Léon. Pyrrhon et le scepticisme grec. Paris, PUF, 1944, 255 p.
•
Romilly, Jacqueline (de). Les grands sophistes dans l'Athènes de Péric/ès,
Paris.. Librairie Générale Française, «Livre de poche», s.d., 288 p.
Soter, Istvan. La Doctrine stylistique des rhétoriques du XVI/ème siècle.
Budapest, Eggenberg, 1937. 65 p.
109
•
Stegmann. André. L 'héroïsme cornélien. genèse et signification.
Colin, 1968, 2 vol.
Paris~
Annand
Timmennans, Benoît. «Renaissance et modernité de la rhétorique», in Michel
Meyer (dir.) Histoire de la rhétorique des grecs à nos jours. Paris, LGF,
«Livre de Poche», 1999, pp. 83-240.
Trudeau, Danielle. Les inventeurs du «bon usage» (/529-/647), Paris, Minuit..
1992,226 p.
Vickers, Brian. «Pour une véritable histoire de l'éloquence», in Études
littéraires, XXIV, 3 (hiver 1991-92), p. 121-152. Trad. de Solange Vouvé
revue par l'auteur et Benoît Beaulieu.
Virieux-Reymond, Antoinette. La logique et l'épistémologie des stoïciens.
Chambéry, Lire, s.d., 331 p.
Youssef: Zobeidah. Polémique et littérature chez Guez de Balzac.
1972.455 p.
Paris~
Nizet,
Zobennan, Pierre. «L'éloquence d'apparat et le style», in Littératures
classiques, nO 28 (1996), p. 255-271.
Zuber.. Roger. Les belles infidèles et la/ormation du goût classique. Perrot
d'Ab/oncourt et Guez de Balzac. Paris~ Colin~ 1968. 503 p.
----------------. «Libertinage et humanisme: une rencontre difficile»~ in Dixseptième siècle, 32: 127 (Avril-Juin 19S0)~ p. 163-179.
Guillaume Du Vair
Hag~
Kenji. «De la Sainte Philosophie de Guillaume Du Vair», in Studies in
Languages & Cultures, 5 (1994), p. 57-67.
----------...--....«Guillaume Du Vair et son Éloquence francoise», in Studies in
Languages & Cultures, 6 (1995), p. 129-139.
Marin, Maxim. «Le stoïcisme de Juste Lipse et de Guillaume Du Vair», in
Christian Mouchel (éd.)~ Juste Lipse (1547-1606) en son temps. Paris..
Honoré Champion, 1996, p. 397-412.
Mesnard, Pierre. «Du Vair et le néo-stoïcisme».. in Revue d 'histoire de la
philosophie, 1928, p. 142-166.
•
Radouant, René. Guillaume Du Vair, l'homme et l'orateur. jusqu 'à lafin des
troubles de la ligue (/556-1596). Paris, Société française d'imprimerie et
de librairie, 190S.. 463 p.
110
•
Tarrete, Alexandre. «Le stoïcisme de Guillaume Du Vair, ou de l'utilité de la
philosophie par gros temps», in Littératures classiques, n° 37 (1999), p.
57...67.
Zanta, Léontine. «Deux néo...stoïciens. Juste Lipse et Du Vair», in La
Renaissance du stoïcisme au
siècle. Paris, Honoré Champion, 1914,
p.151-331.
xvr
François de La Mothe Le Vayer
IO e trope ou la différence culturelle comme
argument sceptique», in Recherche sur le XVI! s., n° 5, Paris, CNRS,
1982. p. 21-29.
Beaude~ Joseph. «Amplifier le
Beugnot, Bernard. «La fonction du dialogue chez La Mothe le Vayen>, in
Cahiers de l'association internationale des études françaises, n° 24
( 1972)~ p. 3 1-4 1.
Doiron. Nonnand. «Orasius, Phyllarque et Narcisse: La sophistique à l'époque
classique», in Littératures classiques. n° 33 (1998). p. 67-77.
Étienne, L. Essai sur La Mothe le Voyer. Rennes, Vatar~ 1849.
Guisan. G. «Les Considérations sur l'éloquence française de ce temps [sic] de
François de La Mothe le Vayer», in Études de Lettres. XVIII (1944), p.
70-108.
Julien-Eymard D~ Angers. «Stoïcisme et libertinage dans l'œuvre de François
de La Mothe le Vayer», in Revue des sciences humaines. n° 75 (1954), p.
259-84.
Kerviler. René de. François de La Mothe le Voyer, précepteur du duc d'Anjou
et de Louis XlV: Étude sur sa vie et sur ses écrits. Paris. RouveYre, 1879.
216 p.
McKenna.. Anthony et Moreau~ Pierre-François (dir.). Libertinage et
philosophie au XVlt me siècle. St-Étienne~ Publications de l'Univ. de StÉtienne. [996, 2 vol.
Salazar~
Philippe-Joseph. «La Mothe le Vayer ou l'impossible métier
d'historien». in Seventeenth-Century French Studies (Nonvich), XIII
(1991). pp. 55-70.
' " Pl'·
-..--..-------------------.. -..---.« "Pa Il as annee:
0 emlque et 1·'
Itterature se1on La
•
Mothe le Vayef», in Roger Duchêne et Pierre Ronzeaud (dir.), Ordre et
III
•
contestation au temps des classiques, vol. II. Tübingen, Romanisches
seminar, 1992, p. 63-73.
Wickelgren, Florence. «La pensée de La Mothe le Vayer», in French Quater/y,
(1923), p. 236-252.
--------------------------. La Mothe le Vayer, sa vie, son oeuvre.
1934.307 p.
•
Paris~
Droz,