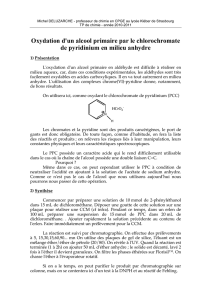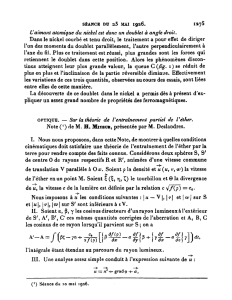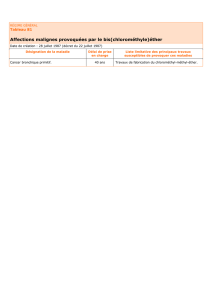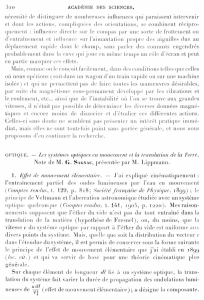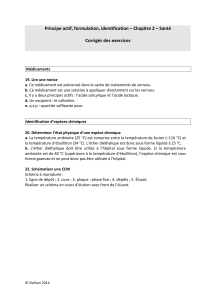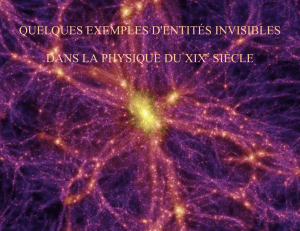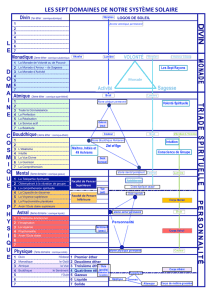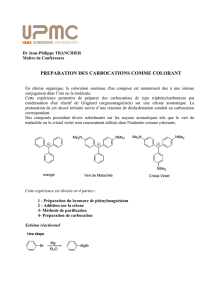Thibault_Ghislain_2010_these - Papyrus : Université de Montréal

Université de Montréal
ÉTHÉRÉALISATION
AMORCES D’UNE CONTRE-HISTOIRE
par
Ghislain Thibault
Département de communication
Faculté des arts et des sciences
Thèse présentée à la Faculté des études supérieures
en vue de l’obtention du grade de Ph. D.
en communication
Février 2010
© Ghislain Thibault, 2010

ii
Université de Montréal
Faculté des études supérieures
Cette thèse intitulée :
Éthéréalisation : amorces d’une contre-histoire
présentée par :
Ghislain Thibault
a été évaluée par un jury composé des personnes suivantes :
Line Grenier (UdeM), présidente-rapporteuse
Thierry Bardini (UdeM), directeur de recherche
Kim Sawchuk (Concordia), membre du jury
Peter Galison (Harvard), examinateur externe
Marcel Lajeunesse (UdeM), représentant du doyen de la FES

iii
Résumé
Cette thèse est une enquête épistémologique qui s’interroge sur la persistance
de « l’éther » dans le champ de la technologie. De façon générale, le mot
« éther » évoque un modèle conceptuel de la physique pré-einsteinienne, celui
d’un milieu invisible permettant la propagation de la lumière et des ondes
électromagnétiques. Or, ce n’est là qu’une des figures de l’éther. Dans plusieurs
mythologies et cosmogonies anciennes, le nom « éther » désignait le feu
originel contenu dans les plus hautes régions célestes. Aristote nommait
« éther », par exemple, le « cinquième être », ou « cinquième élément ». La
chimie a aussi sa propre figure de l’éther où il donne son nom à un composé
chimique, le C4H10O, qui a été utilisé comme premier anesthésiant général à la
fin du XIXe siècle. L’apparition soutenue dans l’histoire de ces figures
disparates de l’éther, qui a priori ne semblent pas entretenir de relation entre
elles, est pour nous la marque de la persistance de l’éther. Nous défendons ici
l’argument selon lequel cette persistance ne se résume pas à la constance de
l’attribution d’un mot ou d’un nom à différents phénomènes dans l’histoire,
mais à l’actualisation d’une même signature, éthérogène. À l’invitation
d’Agamben et en nous inspirant des travaux de Nietzsche et Foucault sur
l’histoire-généalogie et ceux de Derrida sur la déconstruction, notre thèse
amorce une enquête historique motivée par un approfondissement d’une telle
théorisation de la signature. Pour y parvenir, nous proposons de placer l’éther,
ou plutôt la signature-éther, au cœur de différentes enquêtes historiques
préoccupées par le problème de la technologie. En abordant sous cet angle des
enjeux disparates – la légitimation des savoirs narratifs, la suspension des sens,
la pseudoscience et la magie, les révolutions de l’information, l’obsession pour
le sans-fil, l’économie du corps, la virtualisation de la communication, etc. –,
nous proposons dans cette thèse autant d’amorces pour une histoire autre, une
contre-histoire.
Mots-clés : Éther ; Technologie ; Histoire ; Éternel retour ; Révolution de
l’information ; Communication médiatique ; Sans-Fil ; Discours ; Cyberculture.

iv
Abstract
This dissertation stands as an epistemological inquiry into the persistence of the
notion of ether within technology’s discursive field. Most often, the word
“ether” is understood as a conceptual model in pre-einsteinian physics which
designates the medium responsible for the propagation of electromagnetic
waves and light. However, this proves to be only one of the many figures of
ether. In multiple mythologies and cosmogonies, ether was also the name
employed to refer to a sublime and pure fire filling the highest spaces of the
universe. Aristotle, for example, named “ether” what he considered to be the
“fifth being,” or the “fifth element.” Chemistry also makes use of ether, where
the name denominates the compound C4H10O, used as the first general
anaesthetic agent at the end of the nineteenth century. From our point of view,
the sustained occurrences of ether in these different figures, so disparate indeed
that they appear unrelated, marks the manifestation of its persistence. We argue
that this persistence should not be narrowed down to a constant attribution of a
“word” or a “name” to several historical phenomenons, but rather should be
viewed as the actualization of a same etherogeneous “signature.” Responding to
an invitation by Italian philosopher Agamben, and building on Nietzsche’s and
Foucault’s history-genealogy as well as on Derrida’s deconstruction, our
dissertation proposes an historical program oriented towards a theorization of
the signature. To do so, we suggest locating the ether, or rather the ether-
signature, at the heart of several historical inquiries concerned with the
contemporary problem with technology. Approaching some of theses issues –
the legitimating of narrative knowledge, the suspension of the senses,
pseudoscience and mysticism, information and industrial revolutions, wireless
obsessions, body and corporeality, virtualization of communication, etc. –, our
dissertation aims at locating and articulating as many baits towards an-other
history, a counter-history.
Keywords : Ether; Technology; History; Eternal Return; Information
Revolution; Media and Communication; Wireless; Discourse; Electronic
Culture.

v
ÉTHÉROPATHE (ETHER-PATH)
ÉTHÉROSCOPIE .............................................................................................................. vii
Remerciements .......................................................................................................... ix
Tous les nietzsches sous éthers .................................................................................. 1
É-T-H-E-R ......................................................................................................................... 7
Le mot ......................................................................................................................... 8
Le nom....................................................................................................................... 13
ÉTHÉROGRAPHIE ........................................................................................................... 17
Comment s’écrit la contre-histoire ........................................................................... 18
Expériences ............................................................................................................... 41
Mythes ...................................................................................................................... 55
Métaphores ............................................................................................................... 65
Une contre-histoire, éthérologiquement dirigée ..................................................... 75
ÉTHÉROLOGIE................................................................................................................ 77
éther + logos ............................................................................................................. 78
heteros + logos .......................................................................................................... 83
La signature ............................................................................................................... 95
Les sens de H ........................................................................................................... 103
La surface d’inscription ........................................................................................... 108
ÉTHÉROMANIE ............................................................................................................ 123
Corporéalité ............................................................................................................ 124
ÉtHérésies ............................................................................................................... 134
L’éther et la révélation anesthésique ..................................................................... 153
L’éther et la révélation de l’information ................................................................. 159
Attrition des sens, attrition des fils ......................................................................... 173
ÉTHER 2.0 .................................................................................................................... 175
Les paradoxes d’une révolution par attrition ......................................................... 176
Mythes et promesses .............................................................................................. 178
Les ritournelles du sans-fil ...................................................................................... 184
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
 149
149
 150
150
 151
151
 152
152
 153
153
 154
154
 155
155
 156
156
 157
157
 158
158
 159
159
 160
160
 161
161
 162
162
 163
163
 164
164
 165
165
 166
166
 167
167
 168
168
 169
169
 170
170
 171
171
 172
172
 173
173
 174
174
 175
175
 176
176
 177
177
 178
178
 179
179
 180
180
 181
181
 182
182
 183
183
 184
184
 185
185
 186
186
 187
187
 188
188
 189
189
 190
190
 191
191
 192
192
 193
193
 194
194
 195
195
 196
196
 197
197
 198
198
 199
199
 200
200
 201
201
 202
202
 203
203
 204
204
 205
205
 206
206
 207
207
 208
208
 209
209
 210
210
 211
211
 212
212
 213
213
 214
214
 215
215
 216
216
 217
217
 218
218
 219
219
 220
220
 221
221
 222
222
 223
223
 224
224
 225
225
 226
226
 227
227
 228
228
 229
229
 230
230
 231
231
 232
232
 233
233
 234
234
 235
235
 236
236
 237
237
 238
238
 239
239
 240
240
 241
241
 242
242
 243
243
 244
244
 245
245
 246
246
 247
247
 248
248
 249
249
 250
250
 251
251
 252
252
 253
253
 254
254
 255
255
 256
256
 257
257
 258
258
 259
259
 260
260
 261
261
 262
262
 263
263
 264
264
 265
265
 266
266
 267
267
 268
268
 269
269
 270
270
 271
271
 272
272
 273
273
 274
274
 275
275
 276
276
 277
277
 278
278
 279
279
 280
280
 281
281
 282
282
 283
283
 284
284
 285
285
 286
286
 287
287
 288
288
 289
289
 290
290
 291
291
 292
292
 293
293
 294
294
 295
295
 296
296
 297
297
 298
298
 299
299
 300
300
 301
301
 302
302
 303
303
 304
304
 305
305
 306
306
 307
307
 308
308
 309
309
 310
310
 311
311
 312
312
 313
313
 314
314
 315
315
 316
316
 317
317
 318
318
 319
319
 320
320
 321
321
 322
322
 323
323
 324
324
 325
325
 326
326
 327
327
 328
328
 329
329
 330
330
 331
331
 332
332
 333
333
 334
334
 335
335
 336
336
 337
337
 338
338
 339
339
 340
340
 341
341
 342
342
 343
343
 344
344
 345
345
 346
346
 347
347
1
/
347
100%