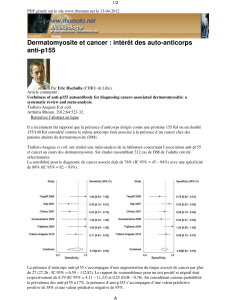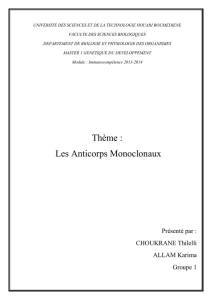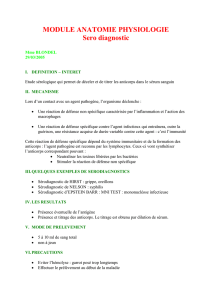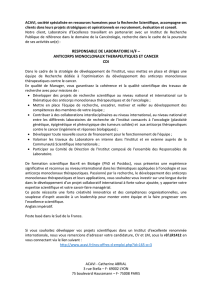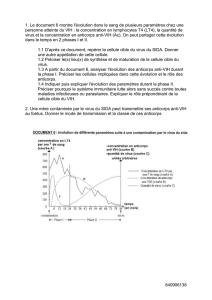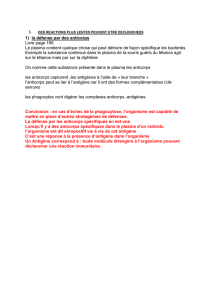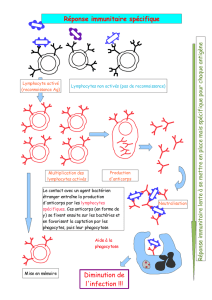Anticorps monoclonaux comme substances thérapeutiques

Introduction
Le potentielthérapeutique des anticorps comme
«magicbullets» avait déjà été décritpar PaulEhr-
lichen1908. En 1975, Köhler et Milstein ont réussi
àfabriquer des anticorpsmonoclonauxàl’aide
de la techniquedel’hybridome. Au cours des
25 dernières années, les techniques de biologie
cellulaireetmoléculairesesont affinées, si bien
qu’ilest devenu possible aujourd’huidefabri-
quer des quantités pratiquement illimitées d’an-
ticorpsmonoclonauxmurins, chimères et huma-
nisés pourdenombreuses applications cliniques,
notamment dans la recherche, le diagnosticetle
traitement des maladies. Les premières applica-
tions thérapeutiques ont faitappel àdes anti-
corps monoclonauxproduits chez la souris (anti-
corps murins).Les injections d’anticorpsmurins
provoquaient cependant des réactions immunes
et entraînaient la formation d’anticorpshumains
anti-souris(Human Anti-Mouse Antibodies –
HAMA). La découverte du fondement génétique
de la diversité des anticorpsetlabiotechnologie
du DNA recombinant ont, par la suite, ouvert
la porte aux formes partiellement humanisées
d’anticorpsmurins. Les anticorpsmonoclonaux
chimères, humanisés et entièrement humains
sont moins immunogènes, et induisent beaucoup
moins fréquemment la formation d’anticorps
anti-immunoglobuline dans le cadre de la pra-
tique thérapeutique. Ces anticorpspeuvent par
conséquent être utilisés de manièrerépétée du-
rant une périodeprolongée. Les anticorpsmono-
clonauxsesont ainsi largement imposés au cours
des dernières années dans le traitement de dif-
férentes formes de cancer,decertaines maladies
rhumatismales ou auto-immunes, de même que
dans le contrôle des réactions de rejet après
greffe.
De la souris àl’homme:
anticorpsmonoclonaux chimères,
humanisésetentièrement humains
Les premiersanticorpsmonoclonauxont été fa-
briqués par la fusion d’une cellule Bproduisant
des anticorpsetd’une lignée de cellules myélo-
mateuses. Les cellules myélomateuses sont des
curriculum Forum Med Suisse 2008;8(8):140–143 140
Anticorps monoclonaux comme
substances thérapeutiques
Adrian F. Ochsenbein
Klinik und Poliklinik für Medizinische Onkologie, Inselspital Bern
Quintessence
(Les anticorps monoclonaux peuvententraînerindirectement des réactions
cytotoxiquespar l’activation du systèmeducomplément et/oupar le recrute-
ment de cellules effectricessecondaires(par ex. cellules T, cellules NK [natural
killer], granulocytes). Les anticorps monoclonaux peuventégalement intervenir
danscertainsprocessus physiologiques cellulaires. Ils peuventbloquer lesré-
cepteurs de certainsfacteurs de croissance àlasurface des cellules ou neutra-
liser des ligands en circulation.
(L’utilisationd’anticorps murinsétait limitéepar l’inductiond’anticorps
humainsanti-murins(HAMA). Il estcependant devenupossible, grâce àla
technologie génique, de produire des anticorps ayantune grande homologie
avec la molécule IgG humaine. Il s’agit des anticorps chimères(partie humaine
invariable,partie murinevariable), des anticorps humanisés(seulessubsistent
des séquences isolées d’acidesaminésduCDR [Complementary Determining
Region] murin)etdes anticorps monoclonaux entièrementhumains.
(Grâce àlafabricationd’anticorps recombinants,ilest devenupossibled’uti-
liser lesanticorps monoclonaux de manière répétitive dansletraitement de
plusieurs maladies.Les anticorps monoclonaux sont utilisésaujourd’hui dans
le traitement de l’ostéoporose,des réactions de rejet des greffesd’organes, de
maladies auto-immunes, ainsi qu’en rhumatologie et en oncologie.
Summary
Monoclonal antibodies as therapeutic substances
(Antibodiesare not toxic for atargetcell per se but act either by blocking
vital signalling moleculesonthe cell surface or via asecondary effector mech-
anism including antibody-dependent cellular cytotoxicity (ADCC) or comple-
ment-dependent cytotoxicity (CDC). In addition, monoclonal antibodies block
central signalling pathways by binding to extracellular receptors or by neu-
tralising their ligands.
(The therapeutic application of monoclonal antibodies of murine origin in
human disease was limitedbythe induction of human anti-mouse antibodies
(HAMA). The generation of chimaeric antibodies (the constant part of the anti-
body is human, the variable part is murine) lessened but did not eliminatethe
murine content. Furtherelimination of rodent sequences enabled the produc-
tion of humanised monoclonal antibodies (only amino acid sequences of the
CDRsare murine), followed by generation of fully human antibodies.
(The reducedimmunogenicityofchimeric, humanised and fully human anti-
bodiesallowedrepetitive application to patients withvarious diseases. Mono-
clonal antibodies are now establishedinthe therapy of osteoporosis, transplant
rejection, autoimmune diseases, rheumatology and malignancy.
Vous trouverez les questions àchoix multiple concernant cet article àlapage 135 ou sur internet sous www.smf-cme.ch.
140-143 Ochsenbein 023_f.qxp:Layout 18.2.2008 10:19 Uhr Seite 140

lymphocytes Bimmortalisés ayant la faculté de
produiredes anticorps. Cette fusion permet de
fabriquer des lignées cellulaires àtrès longue
durée de vie, capables de produiredes anticorps
dont la spécificité peutêtre choisie [1].
L’anticorpsanti-CD3 (Orthoclone OKT3®,muro-
monab-CD3) est un représentant de la première
génération. Il est utilisé dans le traitement du
rejet aiguaprès greffed’organe et aété le pre-
mier anticorpsmonoclonal admispourl’usage
thérapeutiquechez l’homme. L’ expérience clini-
queamontré quelemuromonab-CD3 doitêtre
utilisé en association avec d’autres médicaments
immunosuppresseurspourprévenir la réponse
immunitaire contrel’anticorps murin. Les anti-
corps HAMApeuvent néanmoins apparaître
malgrél’application simultanée d’une immu-
nosuppression intensive. Une réaction immune
contrelemuromonab-CD3 affaiblit la liaison
avec le CD3eet peutaffaiblir l’effet thérapeutique.
La demi-vie normale du muromonab-CD3 dans
la circulation est de 18 heures. Après le dévelop-
pement d’anticorpsHAMA, le muromonab-CD3
peutêtre éliminé de la circulation en quelques
heures seulement. On aégalement décritlafor-
mation d’anticorps IgE circulantscontre le muro-
monab-CD3 pouvant déclencher des réactions
anaphylactiques potentiellement fatales lors d’ap-
plications répétées.
Contrairementautraitement limité dansletemps,
propre aux rejetsaigus de greffes, celui des mala-
dies cancéreusesouauto-immunesnécessitedes
applicationssur des périodes relativement pro-
longées pour obtenir l’effet thérapeutique désiré
de façondurable. La constatation selonlaquelle
la réactionimmunitaire du patientcontre lesan-
ticorpsdesouris compromet l’efficacité thérapeu-
tique dans ces affections chroniques aconduitau
développement de stratégies visant àdiminuer
l’immunogénicité des anticorpsmonoclonaux
[2]. Dansunpremier temps,ons’est mis àprodui-
re des anticorps monoclonaux chimères(fig. 1 x).
Ceux-ci sont constituésd’une partie murineva-
riableetd’une partie humaineconstante.Lafré-
quence d’induction d’une réponseanti-anticorps
aainsi considérablementdiminué, ce qui aper-
mis d’administrerces médicaments de manière
répétée. Certainsanticorps chimères, par ex. le
rituximab (Mabthera®)etlecétuximab(Erbitux®)
n’induisent que rarement la formation d’anti-
anticorps. L’incidence des HAMA atteint en re-
vanche61% avec l’infliximab (Remicade®). Le
développement d’anti-anticorps contre l’inflixi-
mabest corrélé avec la diminutiondeson effica-
cité thérapeutique et une augmentationdurisque
de réactions aiguëslorsdelaperfusion.Laforma-
tion de HAMAreste par conséquent un problème
potentielsignificatif, même si lesanticorps mono-
clonaux chimèressesontaujourd’hui solidement
implantésdanslapratique clinique. Ils exigent
toutefois un suiviattentifet, le cas échéant,l’ad-
ministration concomitantedecorticostéroïdes,
voire parfois l’interruptiondumédicament.
La poursuite systématique des efforts de recher-
che apar la suiteconduit au développement d’an-
ticorpshumanisés. Dans les anticorpshumanisés,
toutes les séquences d’acides aminés provenant
de la souris sont remplacées par des séquences
humaines, àl’exception des Complementary De-
terming Regions (CDR)responsables de la forma-
tion de l’antigène (fig.1). On espérait obtenirainsi
une réduction significative de l’immunogénicité
encore associée aux anticorps chimères. En pra-
tique,ons’est cependant trouvé confronté àl’in-
ductionderéactions àanticorps humainsantihu-
mains (HAHA),dont l’incidenceétait néanmoins
relativement faible par rapportàcelle constatée
avec les anticorpschimères. L’alemtuzumab (Mab-
Campath®)induit des HAHA avec une incidence
de l’ordre de 1,9%etletranstuzumab (Hercep-
tin®)avec une incidence encoreinférieurede0,1%.
D’autres anticorps humanisés, tels que le dacli-
zumab(Zenapax®), induisentenrevanche des
HAHA avec une incidence atteignant 34%. L’hu-
manisation des anticorpsmurins ne se faitdonc
pas sans problèmes, car les séquences d’acides
aminés situées entre les régions CDRcontribuent
de manièrenon négligeable àl’affinité des anti-
corps. Il n’est donc pas possible, dans l’humani-
sation de certains anticorps, de conserver exclu-
sivement les régions CDR, et il fautsouvent se
résoudreàmainteniraussi certaines séquences
d’anticorps murinsdansles segmentssitués entre
les zones CDR(Framework).
Des anticorps entièrement humains ont été dé-
veloppés au cours des dernières années, afinde
diminuer encoreplusl’immunogénicité des an-
ticorpsmonoclonauxthérapeutiques [3,4]. Diffé-
rentes méthodes ont été utilisées: des souris por-
teuses d’un défaut immunitaire (severecombined
immune deficiency,SCID) peuventêtrerecons-
truites àl’aide de tissu fœtal humain. L’ immunisa-
tion de ces souris génèredes anticorpshumains.
La plusgrande partie des anticorpshumains est
cependant produiteinvitro par la méthode Phage-
Display ou par l’intermédiaire de souris trans-
géniques produisant des anticorpsentièrement
humains. Plusieurs de ces anticorpsexclusive-
ment humains sont actuellement testés dans le
cadre d’essais cliniques de phase IàIII.
curriculum Forum Med Suisse 2008;8(8):140–143 141
Figure 1
Anticorps monoclonaux recombinants. Les séquences de souris sont représentées en rouge,
les portions humaines en blanc.
murin chimère humanisé humain
régions framework
régions hypervariables
(CDRs)
140-143 Ochsenbein 023_f.qxp:Layout 18.2.2008 10:19 Uhr Seite 141

Les anticorps entièrementhumainssont-ilsdès
lors supérieurs dansleurs applicationsthérapeu-
tiquesaux anticorps humanisés, et ces derniers
sont-ilsvraiment meilleurs que lesanticorps chi-
mères?L’immunogénicité des anticorps théra-
peutiques constitue un sérieux problèmequi li-
miteenpratique leur utilisationrépétéedansle
traitement de différentes maladies.L’immunogé-
nicité des anticorpsmonoclonauxest dued’abord
àlareconnaissancepar le système immunitaire
des séquences d’acides aminés étrangères (sé-
quences murines).C’est la reconnaissancedece
phénomène quiaconduitaudéveloppement suc-
cessif d’anticorps initialementchimères, puis hu-
manisés et maintenant entièrement humains. Il
fauttoutefois bien comprendre quemême les an-
ticorpsentièrement humains conservent, de par
leur spécificité, une séquence d’acides aminés uni-
que (étrangère)pour l’organisme. Cette séquen-
ce contient le sitedeformation des anticorps et
estappelée idiotype.L’organismepeutdonc ré-
pondre àlaprésence de cette région idiotypedes
anticorpsentièrement humains par la formation
d’anticorpshumains antihumains (HAHA).Les
anticorpsont faitleur apparition au cours de
l’évolution pourrenforcer l’immunogénicité des
protéines étrangères. Ils le font en se liant àdes
récepteurs Fc ou par l’activation de la cascade du
complément. Ces fonctions contribuent àconser-
ver le caractèreimmunogène des anticorps, qu’ils
soient chimères, humanisés ou entièrement hu-
mains (depar leur idiotype). Et, ce sont précisé-
ment ces propriétés des anticorpsqui sont indis-
pensables pourproduirel’effet thérapeutiquequi
consiste en la destruction des cellules cibles (par
ex. tumorales). La fabrication d’un anticorpsavec
une fonction effectricemaximale contrecertaines
cellules cibles, mais sans potentielimmunogène
propre,constitue doncune véritable gageure.
On dit souvent des anticorps monoclonaux qu’ils
présentent une homologie de séquence par rap-
port àl’IgG humainede75% pour lesanticorps
chimères, de 95%pour lesanticorps humaniséset
de 100% pour lesanticorps entièrementhumains.
Ces chiffresnesonttoutefois corrects que si l’on
part de l’idéeque lesanticorps humainsetmurins
sont totalement différents. D’un côté, il existe des
homologies de séquences fortement conservées
entre les anticorpshumains et les anticorpsmu-
rins. D’un autrecôté, les anticorpsentièrement
humains ne correspondent pas totalement àla
séquence programmée du génome, puisqu’une
mutation somatique efficace alieu au cours de la
maturation de l’affinité de l’anticorps [5].
On peutretenir, en résumé, queledéveloppe-
ment successifd’anticorpschimères, humanisés,
puis entièrement humains apermis de diminuer
significativement l’immunogénicité des anticorps
initialementmurins. Si cette évolutionaautorisé
une utilisationthérapeutique de ces anticorps
dansdenombreusesmaladies de l’homme né-
cessitantdes applicationsrépétées,onnesaurait
considérer simplement le passage des anticorps
chimèresaux anticorps humanisés, puis aux an-
ticorps entièrementhumains, comme un progrès
constantdelatechnique de traitement.Chacune
de ces classes d’anticorps provenantdeprocédés
de fabricationbiotechnologique différentsases
avantages et sesinconvénients,qu’il s’agit d’exa-
miner au cas par cas,dans une perspective d’ex-
périmentation clinique.
Mécanismes d’action desanticorps
monoclonauxnon conjugués
Mécanismes effecteurs immunotransmis
Les anticorpsmonoclonauxnesont pas en soi
cytotoxiques pourune cellule cible. Ils induisent
en revanche des effets cytotoxiques (par ex.
contreles cellules tumorales) par une interaction
avec le système du complément ou avec des cel-
lules effectrices (lymphocytes T, monocytes, gra-
nulocytes, éosinophiles, etc. (fig.2x
,tab. 1 p).
Les effets cytotoxiques générés par l’activation
de la cascade du système du complément et par
la cytotoxicité induite par le complément sont
globalement désignés par le terme de Comple-
ment-DependentCytotoxicity (CDC)[6].Les mé-
canismes effecteurs quifont appel àdes cellules
effectrices secondaires sont appelés Antibody-
DependentCell-Mediated Cytotoxicity (ADCC)[7].
curriculum Forum Med Suisse 2008;8(8):140–143 142
Effets
immunotransmis
Effets
biorégulateurs
ligands solubles
récepteurs membranaires
composante complémentaire C1q
récepteur Fc-g
C1q
FcR
Cellules effectrices
Cellules cibles
Figure 2
Mécanismes effecteurs des anticorps monoclonaux. Effets immunotransmis par l’activation de
la cascade du complément par liaison de C1q àl’IgM membranaire ou àdes molécules d’IgG
(CDC) ou par le recrutement de cellules effectrices via des récepteurs Fc (ADCC). Fonctions
biorégulatrices par liaisons croisées de récepteurs cellulaires avec transduction directe de
signaux intracellulaires (par ex. signaux d’apoptose) ou blocage de récepteurs ou de ligands
(par ex. récepteurs du facteur de croissance).
140-143 Ochsenbein 023_f.qxp:Layout 18.2.2008 10:19 Uhr Seite 142

curriculum Forum Med Suisse 2008;8(8):140–143 143
L’activation de la cascade du complément et celle
des cellules effectrices se faitpar l’intermédiaire
d’hydrates de carbone de la partie Fc de l’anti-
corps. La partie Fc de l’IgG1humaine est parti-
culièrement efficace dans l’activation de la cas-
cadeducomplément et des cellules effectrices
chez l’homme. La région constante de l’IgG1hu-
maine est par conséquent privilégiée dans la
fabrication des anticorpsmonoclonauxchimères
et humanisés ayant pourobjectif une cytotoxicité
in vivo aussi puissante quepossible.
Actionsbiorégulatrices
Les anticorpsmonoclonauxpeuvent cependant
aussi induire des effets thérapeutiques sans de-
voir activer des mécanismes effecteurs immunolo-
giques (fig. 2, tab. 1). Les anticorps monoclonaux
peuventbloquer des récepteurs cellulairesde
surface ou neutraliser des ligands solubles (par
ex. vascular endothelialgrowthfactor [VEGF],
TNF-a, etc.). Les anticorps peuventaussi entraî-
ner la transduction directe de signaux intracellu-
laires par cross-linking de récepteurs. Cecipeut
induire,suivantlerécepteur,l’apoptoseimmédia-
te de la cellule. Un exemple d’anticorpsmono-
clonal àeffet biorégulateurest le trastuzumab
(Herceptin®), quiselie au récepteurepidermal-
growth-factor family (HER-2/neu).Leblocage de
ce récepteurréduitlepotentiel prolifératifdes
cellules quiexpriment le HER-2/neu de manière
excessive. On notera néanmoins queles effets bio-
régulateurs sont souvent difficilesàdistinguer
des effets immunotransmis.Ilexiste précisément
pour le trastuzumabdes données expérimenta-
lesqui montrent, en plus de la fonctionbiorégu-
latrice,des effets supplémentaires importantsde
cytotoxicitécellulaire sous la dépendance d’anti-
corps.
Immunoconjugués: anticorps porteurs
Le terme d’immunoconjugué estutilisé pour dé-
crire des anticorps monoclonaux (ou d’autres
sous-unités)utiliséscomme porteurs de subs-
tancesactives, par ex. des radio-isotopes, des
toxines, des cytostatiques, des cytokinesoudes
cellules (tab. 1). L’activité immunologiquedeces
anticorpsest alors sans importance. Les effets
qu’ils développent sont ceuxdelasubstance
qu’ils transportent [8].
Les anticorpsmonoclonauxconjugués avec l’in-
dium111 ou le technetium99 sont déjà utilisés dans
le diagnosticducancer.Les radio-isotopes comme
l’iode131,l’itrium90 et le venium186 paraissent très
prometteursdans l’optique des applications thé-
rapeutiques. La fixation de l’isotope àl’anticorps
permet d’appliquer un rayonnement relativement
concentré sur le tissu tumoral. L’un des principaux
avantages thérapeutiques de la radio-immuno-
thérapie par rayons bêta est quelerayonnement
pénètredeplusieurs millimètres dans la tumeur.
Il n’est doncpas nécessaire que l’antigènecible
soit exprimédanschaque celluletumorale.
Autres formes d’anticorps
Les anticorps dits bispécifiques sont capablesde
reconnaîtredeux antigènesdifférents. Leurs ef-
fetssontindépendants de la régionFc, si bien
que ces moléculesn’activentque trèspeu le sys-
tème du complément et qu’ainsi une partie des
effets indésirablesassociés àcemécanismepeut
être supprimée.Les anticorps bispécifiques ne
nécessitentdès lors pas la totalitédes structures
de la molécule d’Ig et peuventêtreréduitsàdes
fragments de Fv.Les combinaisons de deux ou
trois chaînesindividuellesdeFvs résultentendes
anticorps bispécifiques de massemoléculaire mi-
nimequi pénètrentdansles tissus de manière
optimale. Malheureusement, leur demi-vie in vivo
est courte si on la compare àcelle des molécules
àstructure IgGcomplète.
Tableau1.Mécanismesd’actiondes anticorps
monoclonauxthérapeutiques.
Anticorpsisolés
Cytotoxicité parl’intermédiaire du complément (CDC)
Cytotoxicité cellulaire dépendantdes anticorps(ADCC)
Interactions biorégulatrices(récepteur/ligand)
Vaccinationanti-idiotypique
Immunoconjugués
Anticorpsmarqués parunisotope radioactif
Immunotoxines
Anticorpsmarqués parchimiothérapie
Immunoconjuguésdecytokines
Immunoconjuguéscellulaires
Références
1Yoo EM,Chintalacharuvu KR, Penichet ML,Morrison SL.
Myeloma expression systems. JImmunol Methods. 2002;
261:1–20.
2Berger M, Shankar V, Vafai A. Therapeutic applicationsof
monoclonalantibodies.AmJMed Sci. 2002;324:14–30.
3Weiner LM.Fully human therapeuticmonoclonal antibodies.
JImmunother.1997;29:1–9.
4Little M, Kipriyanov SM, Le Gall F, Moldenhauer G. Of mice
andmen:hybridomaand recombinantantibodies.Immunol
Today.2000;21:364–70.
5Diaz M, CasaliP.Somatic immunoglobulin hypermutation.
Curr Opin Immunol. 2002;14:235–40.
6Gelderman KA, Tomlinson S, Ross GD, Gorter A. Complement
function in mAb-mediated cancer immunotherapy. Trends
Immunol. 2004;25:158–64.
7Casadevall A, Pirofski LA. Antibody-mediated regulation of
cellular immunity and the inflammatory response. Trends
Immunol. 2003;24:474–8.
8Pastan I, Hassan R, Fitzgerald DJ,Kreitman RJ.Immuno-
toxintherapyofcancer.Nat Rev Cancer.2006;6:559–65.
Correspondance:
Prof.AdrianF.Ochsenbein
Klinik undPoliklinik
fürMedizinischeOnkologie
Inselspital
CH-3010Bern
140-143Ochsenbein 023_f.qxp:Layout 18.2.2008 10:19 Uhr Seite 143
1
/
4
100%