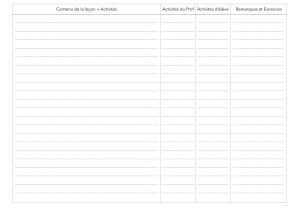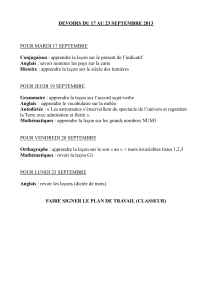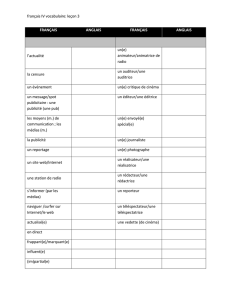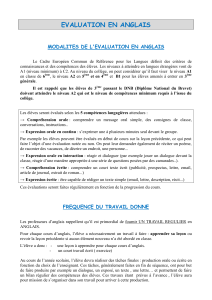FRANÇAIS Qu`est-ce que comprendre une leçon

Écouter pour comprendre l’oral
FRANÇAIS
Langage oral
Informer et accompagner
les professionnels de l’éducation CYCLES 2 3 4
eduscol.education.fr/ressources-2016 - Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche - Mars 2016 1
Retrouvez Éduscol sur
Qu’est-ce que comprendre une leçon ?
Approche descriptive des situations sociales d’interlocution
Aucune notion n’est plus vague que la notion de situation. Elle apparaît, de prime abord,
comme un ensemble hétéroclite de caractéristiques auxquelles renvoie, au terme de
son analyse, le psychologue ou le linguiste pour lever une ambiguïté ou expliquer le
fonctionnement particulier d’un énoncé.
Pourtant les observations que nous avons pu faire des situations scolaires nous ont conduits
aux deux conclusions suivantes :
a) Une situation n’est pas un amalgame de stimuli mais il s’agit toujours d’un ensemble
organisé.
b) Si nous voulons comprendre les fonctionnements différentiels de la langue, il nous faut
prendre en compte ce caractère organisé, c’est-à-dire la nature sociale des situations.
Nous définirons provisoirement une situation de production de discours comme un ensemble
de paramètres physiques et surtout sociaux que l’on peut mettre en relation plus ou moins
systématique avec certaines formes discursives caractérisables par la concurrence de
certaines marques de surface.
Les situations ne se réduisent pas en effet à leurs seules caractéristiques physiques ; elles
sont constituées de réseaux de significations plus ou moins partagées par les différents
interlocuteurs. Ainsi, l’école sera perçue comme un lieu où les enfants doivent effectuer
certains apprentissages. À cette signification centrale viendront s’adjoindre des significations
périphériques que les agents sociaux privilégieront plus ou moins : lieu de contraintes ou lieu
où l’enfant doit développer ses capacités, etc. Non seulement les situations sont constituées
de significations, mais elles sont aussi organisées de façon telle qu’un sujet particulier ne peut
intervenir n’importe comment : les individus sont dotés de statuts auxquels sont adjoints des
rôles plus ou moins explicitement définis.
Les rôles ne se définissent que dans leurs relations de complémentarité (maitre-élèves ;
parents-enfants, etc.). De plus, ainsi que le notent J. BEAUDICHON et F. WINNYKAMEN1, pour
un même individu, il y a superposition des rôles : le même enfant est écolier, fils, frère, etc.
1. BEAUDICHON (J.), VINNYKAMEN (F.) : Adaptation aux interactions et aux situations sociales, dans Savoirs et
savoir-faire psychologiques chez l’enfant, ouvrage collectif, sous la direction de P. OLERON. Mardaga, Bruxelles, 1982.
Michel Brossard - Université de Bordeaux II
Bulletin de psychologie - Tome XXXVIII, n°371

eduscol.education.fr/ressources-2016 - Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche - Mars 2016 2
CYCLE I FRANÇAIS I Langage oral
3
Écouter pour comprendre l’oral
Retrouvez Éduscol sur
Un bon repérage de la situation permet au sujet de sélectionner le rôle qu’il est sensé y tenir.
Dès qu’il y a identification des rôles réciproques, la situation est, pour ainsi dire, « balisée »
pour les différents interlocuteurs. Ceci ne veut pas dire que ce qui va être dit est tout entier
prévisible, mais l’identification des rôles réciproques, permet de circonscrire le champ des
significations possibles et surtout oriente l’attention des interlocuteurs de telle sorte qu’ils
soient en mesure d’effectuer les interprétations correctes. D’un côté, les rôles sont le résultat
des pratiques sociales (pratiques qui se sont institutionnalisées) mais d’un autre côté, ils
organisent ces pratiques, les codifient, les planifient, de ce fait ces pratiques deviennent en
partie prévisibles pour les différents acteurs.
On peut donc dire et ceci est d’autant plus vrai lorsque nous avons affaire à des situations
scolaires par exemple, qu’une situation non seulement est organisée mais encore qu’elle
est prête à fonctionner d’une certaine façon avant même que l’un des acteurs ne la mette
effectivement « en marche ». Bref, il y a un fonctionnement social silencieux des situations qui,
à la fois, oriente et spécifie les interventions des différents acteurs.
Cette organisation complexe des situations, les rôles qu’y remplissent les différents
participants, les initiatives qu’ils prennent, nécessitent différentes opérations de filtrages
de la part d’un sujet particulier, afin que celui-ci soit en mesure d’intervenir avec efficacité à
l’intérieur ces situations initialement cadrées. C’est pourquoi les difficultés de compréhension
peuvent ne provenir non pas tant du travail de décodage proprement linguistique de l’énoncé
que d’une mauvaise identification du niveau de pertinence de cet énoncé. C’est pourquoi l’une
des hypothèses que nous formulerons concernant les difficultés de compréhension par l’enfant
du discours scolaire.
Ce que nous venons de dire nous conduit à rejeter à la fois une conception purement
déterministe (les discours seraient produits par les situations) et une conception idéaliste du
locuteur (celui-ci serait un pur producteur de sens).
En fait les acteurs sont pris dans les situations : ils interagissent, « travaillent » à l’intérieur
d’un univers socialement signifiant. Ils vont actualiser telle ou telle signification potentielle,
modifier des significations déjà données, introduire des significations relativement nouvelles.
Et pour rendre possible une signification nouvelle, il faudra que le locuteur transforme la
situation telle qu’elle était initialement donnée de façon à ce que de nouvelles relations
puissent être établies.
Concevoir l’activité linguistique comme une activité sociale, c’est mettre l’accent sur le fait que
le sens produit est directement « branché », et ceci de façon plus ou moins complexe sur les
significations déjà constituées.
Il nous faut insister sur ce double aspect des situations d’interlocution. D’une part elles sont
déjà construites et en ce sens le locuteur doit apprendre à les déchiffrer. De nombreux auteurs
ont, au cours de ces dernières années, insisté sur le fait que, pour un enfant, apprendre à
parler ce n’était pas seulement acquérir un savoir-faire linguistique mais que c’était aussi et
simultanément acquérir un savoir des usages sociaux de la langue.
D’autre part, les échanges linguistiques contribuent en retour soit à reproduire comme c’est le
cas dans les échanges ritualisés, soit à transformer les situations et les significations qui les
constituent. Pour ne prendre qu’un exemple très simple. J. BERKO-GLEASON a bien montré
comment un jeune garçon en refusant que sa mère s’adresse à lui d’une certaine façon,
signifiait par là qu’il fallait désormais le considérer et le traiter comme une grande personne2.
2. BERKO-GLEASON (J.) : Code Switching in Children’s Language, In Cognitive Development and The Acquisition of
Language, Ac. Press. N.Y., 1973, 159-167.

eduscol.education.fr/ressources-2016 - Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche - Mars 2016 3
CYCLE I FRANÇAIS I Langage oral
3
Écouter pour comprendre l’oral
Retrouvez Éduscol sur
Si les rôles gouvernent les usages linguistiques, inversement ils se construisent en grande
partie au cours des interactions verbales. On peut donc considérer les significations sociales
comme du sens « objectivé » et le sens d’un énoncé comme le « moment » linguistique des
significations sociales en cours de transformation.
C’est pourquoi on peut dire que les échanges linguistiques produisent toujours quelque chose
même quand, apparemment, on ne fait que « parler »3.
Cet ancrage de l’énoncé dans la situation sociale, nous l’appellerons à la suite de J.P.
BRONCKART4 l’ancrage communicatif que nous distinguerons avec lui de l’ancrage énonciatif
tel qu’il est pris en compte par la théorie de l’énonciation.
Cette notion d’ancrage communicatif conduit à mettre au premier plan une autre notion
proposée par Goffman dans son analyse de l’interaction sociale qui est celle de cadrage.
L’activité de cadrage consiste précisément à mettre en relation ce que l’on va dire avec
le champ des significations possibles en identifiant la zone de pertinence à l’intérieur de
laquelle on a l’intention de communiquer quelque chose à son interlocuteur. Un très grand
nombre d’ajustements repérables dans le dialogue concerne la recherche par les différents
interlocuteurs du cadre à l’intérieur duquel un énoncé doit être interprété5.
Si, dans les échanges quotidiens, les différents interlocuteurs ont le droit de s’interroger sur
le cadre, voire de le remettre en question, dans le dialogue scolaire, seul le maitre a le droit de
définir le cadre à l’intérieur duquel les différentes interventions seront acceptées ou rejetées.
La compréhension de la leçon par les enfants implique qu’ils ont correctement identifié le
cadre à partir duquel les énoncés successifs du maitre prennent sens.
Approche descriptive des situations et des dialogues
scolaires
II ne s’agit en aucun cas de porter un jugement de valeur sur les situations scolaires telles
que nous pouvons les observer (même si l’on pense qu’elles ne peuvent pas être considérées
comme des situations optimales d’acquisition). Il s’agit au contraire de saisir la réalité de ces
« structures participatives » (IGUMPREZ, 1980) et d’en entreprendre l’investigation. Les rôles
respectifs, les moyens, l’objectif sont ici strictement définis de telle sorte que les contraintes
situationnelles doivent pouvoir permettre de comprendre les caractéristiques et le mode de
fonctionnement du « texte » scolaire. Nous pensons, en effet, que si nous plaçons un adulte
(ayant une certaine représentation des enfants face à une vingtaine d’enfants avec pour objectif
de leur transmettre à l’aide de langage un corps de connaissances, nous ne pouvons pas avoir
n’importe quel fonctionnement langagier possible. Ceci ne veut pas dire que le texte serait en
quelque sorte préinscrit dans la situation.
3. Pour mieux cerner la nature des dialogues scolaires, nous distinguerons entre dialogue à finalité explicite
(échanges d’informations, explicitations scolaires, etc.) et dialogues à finalités implicites. Par dialogues à finalité
implicite nous entendons l’ensemble des échanges au cours desquels apparemment il ne se produit rien (on parle
pour le plaisir), mais où en fait, au cours d’un travail incessant et en grande partie inconscient de la communauté
parlante, se forment, se réaffirment, se remanient les groupes sociaux et leurs systèmes de représentations.
4. BRONCKART (J.P.), SCHNEUWLY (B.) — Une approche totalitaire de la langue. Texte préparatoire au Colloque :
« Le langage de l’enfant en milieu scolaire : problématiques et méthodes », décembre 1981.
5. Bien souvent une discussion consiste moins pour deux interlocuteurs à décider de la vérité ou de la fausseté
d’une proposition, qu’à se mettre d’accord sur le cadre à l’intérieur duquel la proposition en question peut être ou non
acceptée.

eduscol.education.fr/ressources-2016 - Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche - Mars 2016 4
CYCLE I FRANÇAIS I Langage oral
3
Écouter pour comprendre l’oral
Retrouvez Éduscol sur
Nous considérons au contraire le texte comme le produit d’une série de prises de décisions,
mais ces décisions s’effectuent à l’intérieur d’un éventail de possibles relativement limités, si
l’on veut voir la leçon parvenir à son terme. Dans la mesure où il dirige le dialogue, le maitre
détient à lui seul le pouvoir d’effectuer différentes prises de décisions6.
Comme dans tout dialogue un ensemble de significations va être construit en commun.
Mais le propre du dialogue pédagogique c’est que cet ensemble de significations n’est pas
encore connu des élèves alors qu’il constitue l’objectif de la leçon pour le maitre. Le maitre
va donc par un jeu de questions guider les enfants vers la découverte de cet ensemble de
significations.
Nous distinguerons dans les situations scolaires deux versants : un versant pédagogique
et un versant linguistique. Du côté du versant pédagogique nous essayons de répondre à la
question : quelle activité pédagogique le maître est-il en train d’accomplir ? Du côté du versant
linguistique, nous essayons de répondre à la question : par quelles procédures linguistiques le
maitre s’efforce-t-il de réaliser tel acte pédagogique ?
Nos hypothèses générales sont au nombre de deux :
1. C’est l’enchaînement des actes pédagogiques qui permet de comprendre la nature et la
forme des actes de langage effectués – ainsi que l’organisation discursive de la leçon prise
dans sa globalité.
2. La compréhension de la leçon suppose que l’enfant, au travers des énoncés successifs,
perçoive la nature de l’acte pédagogique effectué et puisse ainsi identifier l’information qui
constitue l’objectif de la leçon.
Nous avons retenu cinq traits (mais nous ne prétendons bien évidemment pas à l’exhaustivité)
permettant de caractériser les situations scolaires d’apprentissage. Ces traits se retrouvent à
la fois sur le versant pédagogique et sur le versant linguistique.
1. Le maitre doit transmettre un savoir nouveau à l’aide du langage. Le maitre doit atteindre un
objectif : montrer la nécessité d’une opération, définir une notion. Ceci explique le caractère
très fortement finalisé du dialogue scolaire.
Les séquences (terme que nous définissons plus haut) s’organisent, les questions sont posées
et les réponses sélectionnées en fonction de cet objectif. Cette connaissance nouvelle (focus
de la leçon) doit être reliée à des connaissances déjà acquises et sur lesquelles doivent venir
se greffer les connaissances nouvelles. Ces connaissances réactualisées vont donc servir
de cadre à l’intérieur duquel les propositions portant sur les notions nouvelles deviennent
pertinentes.
2. La leçon telle qu’elle est conduite est le résultat d’un compromis entre deux exigences
contradictoires le maitre doit à la fois atteindre l’objectif dans un délai qui ne dépend pas de
lui seul mais il doit aussi aussi permettre au maximum d’enfants d’effectuer les démarches
cognitives attendues. Il doit donc aller de l’avant mais veiller en même temps à ce que tout
le monde suive la progression. Cette nécessité de progresser en vérifiant éclaire la forme
dialoguée des échanges en même temps que les caractéristiques de ce dialogue. Ceci explique
que les questions du maitre peuvent se repartir sur deux grands axes : l’axe de la progression
(le maitre pose une question et va sélectionner parmi les réponses celle qui lui permet
de progresser vers l’objectif) et l’axe de la vérification qui permet d’effectuer les cadrages
nécessaires.
6. Ainsi que l’a montré Rhian Jones, au terme du dépouillement d’un important corpus, il est très rare qu’un enfant
prenne l’initiative d’un échange. Les interventions des enfants sont dans l’immense majorité des cas placés sous la
dépendance des sollicitations du maitre. Le langage en milieu scolaire, Thèse de doctorat de 3ème cycle, Université de
Paris V, 1980.

eduscol.education.fr/ressources-2016 - Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche - Mars 2016 5
CYCLE I FRANÇAIS I Langage oral
3
Écouter pour comprendre l’oral
Retrouvez Éduscol sur
3. Le maitre est expert en ce qui concerne la qualité des représentations des élèves. Ceci
explique l’originalité du questionnement pédagogique et d’une façon plus générale du
questionnement didactique (chaque fors qu’un locuteur s’efforce d’enseigner quelque chose
à son interlocuteur). En questionnant, le maître n’est pas en quête d’une information qu’il
ne détiendrait pas, mais il questionne pour s’assurer de l’état des connaissances de son
interlocuteur et pour actualiser une connaissance qui servira de cadre pour de nouveaux
énoncés.
L’enfant, en fournissant une réponse, sait qu’à partir d’elle son propre savoir est expertisé
et que la question circonscrit un domaine à l’intérieur duquel il faudra acquérir de nouvelles
connaissances. Pour l’enfant, comprendre la question du maître, c’est non seulement
comprendre le type de questionnement auquel on a affaire dans le cadre scolaire mais c’est
encore être en mesure d’identifier la visée pédagogique à l’intérieur de laquelle se situe la
question (ou tout au moins s’en inquiéter).
Les questions du maitre et les réponses des enfants sont la forme linguistique que prennent
les rôles sociaux maitre-élève et les pratiques conjointes qui en découlent. On peut imaginer
des situations pédagogiques familiales où peut s’instaurer ce type d’échanges question-
réponse, mais ce n’est que clans le cadre scolaire que l’on peut observer ce fonctionnement de
façon aussi systématique7.
4. Le fait que les apprentissages scolaires se fassent exclusivement sous une forme verbale
entraine un certain nombre de conséquences. Le maitre ne se contentera pas de poser des
questions ou de transmettre des informations mais il s’efforcera d’expliciter des règles ou
des opérations de nature plus ou moins complexe. En d’autres termes nous assisterons à des
séquences au cours desquelles le maître met en mots un ensemble d’opérations que tout sujet
connaissant engagé dans la même activité de connaissance est censé devoir accomplir. Nous
assistons alors à une véritable mise en scène d’un « je »-sujet connaissant qui commente
l’ensemble des opérations que l’on doit effectuer pour aboutir au résultat désiré, sujet qui en
même temps qu’il s’extériorise, se pose comme exemplaire.
Au cours des différentes activités, le maitre est amené à diversifier son rôle selon le type
d’attitudes et de conduites qu’il cherche à susciter. Schématiquement on peut distinguer les
formes d’interaction suivantes :
•le maitre est face aux élèves ; il joue son rôle de maitre en donnant des consignes, posant
des questions, rectifiant, etc. Les formes pronominales les plus fréquemment rencontrées
seront alors l’opposition je/vous ;
•le maitre récapitule un cheminement effectué mais surtout exhorte à une recherche col-
lective. Bien que guidant l’ensemble des opérations, il fait comme s’il n’était qu’un parmi
d’autres. Au travers du « nous », c’est toute la classe qui est censée s’interroger, rechercher,
proposer telle ou telle solution ;
•le maitre s’identifie à un sujet connaissant engagé dans une suite d’opérations. Ainsi que l’a
bien montré A. BOUACHA8, le maitre « s’expose » en commentant ses propres actions. Ceux
qui assistent à ce commentaire de soi-même sont censés effectuer les mêmes opérations
pour leur propre compte et en éprouver du même coup la nécessité. Les formes pronominales
préférentiellement utilisées seront alors un « je » qui ne renvoie bien évidemment pas au sujet
énonciateur et le « on » qui marque les contraintes (logiques, méthodologiques...) qui s’exer-
cent sur l’ensemble des sujets engagés dans la même tâche.
7. EDVARDS (A.D.), FURLONG (F.J.) : The Language of teaching, Heineman, London, 1978.
8. BOUACHA (A.) : « Alors » dans le discours pédagogique: épiphénomène ou trace d’opérations discursives ?
Langue Française, 50, mai 1981.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
1
/
14
100%