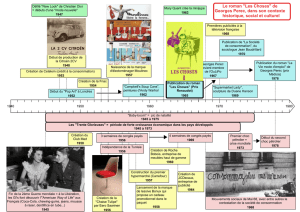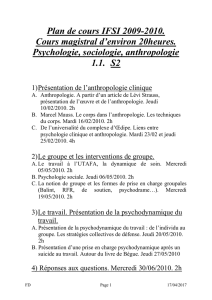L`essentiel dans le presque rien, Avant-propos

Avant propos du presque rien
Laurent Denizeau
Cet ouvrage est le fruit d’une journée d’étude organisée par le Centre Interdisciplinaire
d’Ethique de l’Université Catholique de Lyon en février 2012, qui réunissait quelques
penseurs autour d’une approche du « presque rien ». L’idée de cette journée a germé à partir
d’un intérêt et d’un étonnement suscités par l’œuvre d’un anthropologue, Albert Piette, qui a
consacré la majeure partie de ses travaux à une anthropologie du détail. Détail qui n’a rien
d’accessoire dans son approche puisqu’il l’appréhende comme constitutif de notre humanité,
de notre manière spécifiquement humaine d’être présent au monde. D’abord outil
méthodologique d’une discipline fondée sur l’observation des hommes, cette attention au
détail conduit aujourd’hui Albert Piette à réinterroger les fondements épistémologiques d’une
anthropologie dite sociale et culturelle, attentive aux univers de représentations à l’œuvre dans
la vie des hommes, pour déployer une anthropologie existentiale qui se tournerait vers les
modalités humaines de la présence au monde. Mais il n’est pas question dans cet ouvrage de
débats inhérents à la discipline anthropologique, bien plutôt des perspectives existentielles
que déploie une pensée du détail.
Nous nous sommes donc rencontrés autour de cette étrange idée d’une humanité
inscrite dans le détail, de quelque chose d’essentiel qui se jouerait dans le presque rien.
Etrange idée parce que, habituellement, ce qui nous parle, ce à quoi l’on prête attention, c’est
ce qui s’impose par le sens, et se trouve par là-même du côté de l’événementiel, de ce qui est
dense de sens à nos yeux. Face à cette densité, il y a un aspect plus ou moins négligeable du
détail qui, en lui-même, n’est presque rien. Lorsque l’on dit par exemple que « c’est de l’ordre
du détail » ou que « c’est un point de détail », l’on dit surtout que c’est un point secondaire,
qui ne mérite pas notre attention et finalement disparaît derrière l’horizon de sens qui nous
préoccupe. Ce n’est pas le détail qui retient l’attention, encore moins la pensée. Ce qui nous
parle, c’est ce qui peut se raccrocher à une vue d’ensemble, ce qui paradoxalement s’impose à
nous par la force de sens que nous lui accordons. Ce qui nous parle, c’est ce qui sort de la
banalité devenue insignifiante du quotidien : l’événement, l’extraordinaire, le sensationnel. Ce
qui est chargé de sens et condense nos imaginaires et qui constitue, au final, une toute petite
part de notre existence. Le reste, où est-il ? Ce qui se passe dans la vie de tous les jours, ce qui
revient tous les jours, ce qui est banal, ordinaire, sans surprise, ces presque riens de
l’existence sont souvent délaissés, et par là-même impensés. Pourquoi ? Parce qu’ils vont de
soi. Qu’est-il besoin d’interroger ce qui va de soi ? La pensée court là le risque de tourner en
rond : nous n’interrogeons pas l’habituel précisément parce qu’il ne pose pas question, il n’est
pas inscrit dans des enjeux de sens. Là se situait la raison d’être de notre rencontre : penser
l’ordinaire, les détails de l’existence, penser ces presque riens, et peut-être y voir notre
manière humaine d’habiter le monde.
Penser le presque rien nous décale. Le détail nous dit que l’on n’est plus tout à fait
devant, comme spectateur commentant la toile de notre existence, mais dedans. Le détail nous
soustrait à une vue d’ensemble et fait affleurer ce qui autrement ne saurait voir le jour, pour
peut-être envisager un sens derrière le sens. La plus grande partie de notre vie n’est faite que
de détails minuscules que l’on ne retient pas, d’expériences non communiquées et même non
mémorisées parce qu’impossibles à relier au récit cohérent que l’on se fait d’une vie. Mais
une vie peut basculer sur un détail, comme le détail d’un tableau peut apporter un éclairage
essentiel à la compréhension de l’œuvre. Il peut ainsi devenir une clé de lecture comme un

élément subversif de l’œuvre, un renversement du sens. Ne perd-il pas alors son statut de
détail lorsqu’il en vient à cristalliser des enjeux de sens qui amènent soit à mieux comprendre
soit à porter un autre regard sur l’ensemble ? Mais précisément, s’attacher au détail c’est
rester à l’échelle du petit et de l’insaisissable parce que le détail ne se suffit pas à lui-même, il
renvoie à autre chose. Sinon, il n’est plus ce presque rien pour devenir ce presque tout, ce qui
nous manquait pour faire le tour de la totalité. Beaucoup de choses se jouent dans ce presque,
qui peut être soit ce qui manque, soit ce qui échappe, comme le fait remarquer Jankélévitch à
propos de ce que l’on peut entendre par presque rien: « Le Presque des énigmes pique notre
seule curiosité, tandis que le Presque du mystère appelle notre respect. »
1
Le presque rien dont
nous parlons renvoie essentiellement à du hors-champ. C’est pourquoi il nous échappe, tout
en nous invitant au fondamental. C’est pourquoi nous y entrevoyons l’ordre du détail qui
convoque à une latéralité du sens et semble désigner, davantage qu’un bout ou un fragment,
une certaine intimité de ce qui travaille le récit de nos vies. Le détail qui nous intéresse dans
cet ouvrage c’est celui qui manifeste la poétique propre de la banalité.
Comment penser ces presque riens ? Comment penser ce que nous vivons sans y
penser ? Derrière cette interrogation du presque rien, c’est un regard qu’il s’agit de retrouver,
la fraîcheur d’un regard, qui peut être celui d’un jeune enfant pour qui il n’y a pas encore
d’ordinaire parce que le monde est une réalité trop nouvelle où tout le quotidien peut devenir
source d’étonnement. Ce qu’il s’agit de retrouver c’est justement cette ouverture à
l’étonnement. Le détail convoque à une certaine fraîcheur de la pensée. Georges Perec a écrit
quelques très belles lignes dans un texte appelé « Approches de quoi ? » qui ouvre l’Infra-
ordinaire :
Interroger l’habituel. Mais justement, nous y sommes habitués. Nous ne l’interrogeons
pas, il ne nous interroge pas, il semble ne pas faire problème, nous le vivons sans y
penser, comme s’il ne véhiculait ni question ni réponse, comme s’il n’était porteur
d’aucune information. Ce n’est même plus du conditionnement, c’est de l’anesthésie.
Nous dormons notre vie d’un sommeil sans rêves. Mais où est-elle, notre vie ? Où est
notre corps ? Où est notre espace ? Comment parler de ces « choses communes »,
comment les traquer plutôt, comment les débusquer, les arracher à la gangue dans
laquelle elles restent engluées, comment leur donner un sens, une langue : qu’elles
parlent enfin de ce qui est, de ce que nous sommes. Peut-être s’agit-il de fonder notre
propre anthropologie : celle qui parlera de nous, qui ira chercher en nous ce que nous
avons si longtemps pillé chez les autres. Non plus l’exotique mais l’endotique.
Interroger ce qui semble tellement aller de soi que nous en avons oublié l’origine.
2
Il s’agit de s’étonner du familier, de ramener au premier plan ce que l’on ne voit plus à force
d’évidence, et d’y voir autre chose que de la futilité ou de la trivialité. Il s’agit de nous y voir
car c’est d’une véritable anthropologie dont il est question dans ce regard, une anthropologie
qui ne se fonde plus sur du lointain mais sur du proche, sur du familier, sur nous-mêmes. Se
pencher sur les détails de nos vies, ce que fait Perec dans l’infra-ordinaire et qui peut très vite
devenir ennuyeux, si nous perdons la poétique du détail jusque dans sa répétitivité, qui
devient alors rythme au fil de quelques moments d’existence partagés. Il est question pour
Perec d’écrire sur le banal, d’écrire sur ce qui n’est jamais écrit : dresser des listes détaillées
de ces adresses de la rue Vilin, reporter le texte de deux cent quarante-trois cartes postales
1
Vladimir JANKELEVITCH, Le Je-ne-sais-quoi et le Presque-rien. La manière et l’occasion, Paris, Seuil,
[1957] 1980, p. 54.
2
Georges PEREC, L’infra-ordinaire, Paris, Seuil, [1989] 2010, p. 11-12.

sans rien connaître de qui les envoie ni de leur destinataire, se balader autour de Beaubourg,
dans Londres et décrire ce que l’on y voit ici et maintenant, décrire les bureaux imaginés des
grands de ce monde, comme sur ce qui se donne à voir sur son propre bureau, non pas
seulement dans une approche romantique de ce que peut évoquer la belle table sur laquelle le
poète créé mais tout le détail de ce qu’il a sous les yeux lorsqu’il créé, y compris cette
« gomme blanchâtre sur laquelle est écrit en noir STAEDTLER MARS PLASTIC »
3
passée
par là-même sans aucun mérite qui puisse lui incomber à une étrange postérité. Décrire,
jusque dans ce qui peut paraître trivial à force de banalité, comme dans ce chapitre qui semble
friser l’obsessionnel : « Tentative d’inventaire des aliments liquides et solides que j’ai
ingurgités au cours de l’année mil neuf cent soixante-quatorze »
4
. Il n’y a pas de sens, ou
plutôt Perec part dans tous les sens, et l’on ne s’y retrouve plus dans cet inventaire du
quotidien trop singulier, où s’enchevêtrent des détails sans importance. Ses descriptions ne
mènent nulle part, elles laissent dériver le lecteur d’une banalité à l’autre. Perec fait des listes
de détails sans vue d’ensemble, sans direction. Il écrit sans aucune autre fin que de porter
l’ordinaire de nos vies à l’existence.
Dans cette multitude de détails infra-perçus qui font notre quotidien, se dessine notre
présence, notre manière d’être là. Parler de présence c’est s’intéresser au simple fait d’être, en
dehors de toute intentionnalité, finalement tout ce qui peut nous échapper dans le fait d’être, et
qui fait que nous sommes autre chose qu’un sujet rationnel, qu’un acteur du jeu social qui
n’agit qu’en réponse aux enjeux de sens non plus des situations mais des interactions qu’il
traverse. L’homme rêvasse, se prend à regarder de plus près sa « gomme blanchâtre sur
laquelle est écrit en noir STAEDTLER MARS PLASTIC » sans raison, et en y regardant de
plus près, il prend de la distance, il suspend le cours des choses et leurs enjeux de sens, pour
être simplement là.
Cet essentiel que nous cherchons dans les presque riens de nos existences se prêtait
difficilement à une somme conséquente, tel que l’on pourrait être en droit de l’attendre de la
publication d’actes, interrogeant les différentes traditions intellectuelles, croisant une
multitude de regards pour mieux cerner les enjeux d’une telle pensée et faire le tour de la
question. Comment faire le tour du presque rien ? Nous avons joué le jeu du presque rien
jusque dans l’écriture de ces actes qui n’en sont pas vraiment, tout au plus une rencontre de
quelques regards (anthropologique, théologique, philosophique, psychologique et médical)
autour de notre perception du détail pour voir en quoi il s’inscrit, en toute discrétion, au cœur
de notre rapport au monde et aux autres.
Dans cette optique, nous ne pouvions faire l’économie dans un premier chapitre d’une
lecture d’Albert Piette, qui a inspiré cette journée, et de sa notion de « mode mineur de la
réalité ». En s’attachant à construire une ethnographie minutieuse des modes de présence de
l’homme, Albert Piette situe leur spécificité dans une approche minimale du monde. Ainsi,
l’homme ne serait jamais pleinement absorbé dans les enjeux de sens des situations qu’il
traverse. Le détail préserve alors l’homme de tout effet saturant du sens pour l’introduire dans
une présence minimale au monde. Dans un deuxième chapitre « action et présence ou la
reposité comme mode de vie ensemble », Albert Piette revient sur ces restes de la présence.
Ces détails nous montrent que l’homme n’est jamais pleinement là, entièrement à la situation,
totalement identifié à la trame de ce qui se déroule. L’homme est toujours un peu là et en
même temps un peu ailleurs. Notre humanité se donne dans ces petits restes de la présence,
3
Georges PEREC, L’infra-ordinaire, op.cit., p.107-108.
4
Georges PEREC, L’infra-ordinaire, op.cit., p.97-106.

dans cette capacité de distraction et donc de prise de distance vis-à-vis des enjeux de sens.
Partagé entre l’action et la simple présence, l’homme se caractériserait par son aptitude à la
« reposité ». Dans son chapitre « le beau geste dans l’amitié », Jean-Marie Gueullette,
médecin et théologien, s’attache à la valeur du détail dans notre relation à l’autre, en
particulier dans la relation d’amitié où, si le beau geste n’est pas un geste saturé de sens, il
n’en reste pas moins un geste habité. Le détail dit quelque chose de la présence de l’ami au-
delà, ou peut-être en-deçà, de sa volonté d’être présent. La relation n’est plus interaction, mais
devient coprésence à l’autre. Le détail évoque alors une certaine gratuité du sens et de la
présence. Dès lors, on peut se demander ce qu’il en est de ce presque rien dans des situations
denses de sens, comme à l’approche de la mort. Infirmière en soin palliatif et philosophe,
Laure Marmilloud se pose la question de la possibilité d’une gratuité du sens dans un lieu
aussi dense de significations que les unités de soins palliatifs, dans sa contribution « Le
presque rien dans l’ultime de la vie ». Les soins palliatifs sont souvent appréhendés comme
des soins d’attente, lorsque tout ce qui est d’ordre curatif est épuisé. Ces soins répondent aux
besoins élémentaires de chacun des patients, à l’évitement de la souffrance mais se glissent
aussi, dans l’interstice de la relation, un sourire, un geste d’affection, une parole
d’encouragement. Ces manières d’être en présence de l’autre et avec lui n’ont l’air de rien, et
pourtant, elles refont le lien avec la vie en réaffirmant sa place de sujet, au-delà de son statut
de malade. Anne Lacombe, ergothérapeute, poursuit cette réflexion dans une contribution
intitulée « Quand l’extra-ordinaire joue avec l’ordinaire ». Lorsqu’un état de crise amène des
situations de handicap, nos habitudes de vie et tout notre rapport au monde s’en trouvent
bouleversés. Autrefois ordinaires, ces détails qui faisaient le quotidien deviennent extra-
ordinaires et nécessitent une créativité pour reconstruire son lien au monde qui est avant tout
un lien aux autres. Loin de pouvoir conclure une telle réflexion, un dernier chapitre intitulé
« Ethique de la présence. Ouvertures sur l’essentiel » tente de reprendre les grands lieux
investis par notre rencontre autour du presque rien (détail, sens et présence). Ce dernier
chapitre est aussi l’occasion d’évoquer la réflexion de Jean-Dominique Abrell, directeur
artistique de l’ensemble de musique ancienne Energeïa
5
, pour prolonger notre réflexion
jusque dans le domaine de l’art et laisser cette pensée non aboutie des presque riens de la
présence humaine au monde s’ouvrir sur une approche contemplative.
Au fil de ces différentes contributions, nous percevons combien le détail parle moins
du sens que de la présence et nous invite à considérer l’aspect existentiel de ce presque rien,
que cela soit dans les modalités humaines d’être au monde, dans la relation d’amitié, dans la
relation à l’autre atteint dans sa fragilité. Sans doute aurait-il fallu multiplier les interlocuteurs
et les lieux possibles de cette réflexion : y-a-t-il du détail dans la relation amoureuse ? Quels
sont les presque riens d’une expérience spirituelle ? etc. Mais prétendre à l’exhaustivité en
matière de presque rien c’est un peu manquer son propos. Ne pas jouer le jeu du détail. Voici
donc quelques presque riens d’une pensée non aboutie du détail, quelques esquisses de ces
« je ne sais quoi » de nos existences.
Pour citer cet article : Laurent Denizeau, « Avant-propos du presque-rien », in L’essentiel
dans le presque rien, Lyon, éditions Profac, 2013, p.3-10.
5
Jean-Dominique Abrell est intervenu en musique lors de notre journée d’étude. C’est pourquoi sa contribution
s’est avérée difficilement transposable à l’écrit. Néanmoins nous relatons dans ce dernier chapitre les principaux
points de sa réflexion.
1
/
4
100%