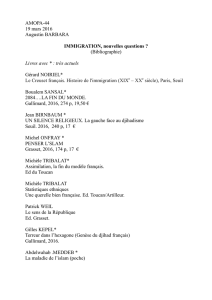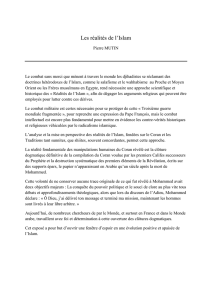Revue du 'Muṣḥaf Uthmanique' de Comerro

Sélection d’ouvrages présentés en hommage
lors des séances 2013 de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.
J’ai l’honneur de déposer sur le bureau de l’Académie, en
hommage de son auteur, Mme Viviane Comerro, son livre
intitulé Les traditions sur la constitution du muṣḥaf de
‘Uthmān, Beyrouth, Orient-Institut, 2012, 219 p.
Le livre de Viviane Comerro, publié dans la collection des
Beiruter Texte und Studien de l’Institut allemand, constitue
une contribution remarquable à l’histoire d’un épisode
fondamental de l’histoire de l’islam, celui de la mise par
écrit du Coran sous le califat de ‘Uthmān (règne de 644 à
656). Dans le débat ouvert par les tenants de l’école
hyper-critique qui rejetaient toute possibilité d’exploiter
les récits transmis par la tradition musulmane sur les
débuts de l’islam pour en écrire l’histoire, des voix se sont
élevées pour défendre l’utilisation par les historiens de
ces sources qui, comme le rappelle justement Viviane Comerro, ont une « visée peut-être
d’abord doctrinale avant d’être historique » (p. 6). Deux questions se posent : celle de
l’authenticité et de la véracité de l’information d’une part, celle des intentions des
auteurs. Sur le premier point, l’auteur prend la suite de l’enquête de Harald Motzki,
centrée sur le récit classique dérivant d’al-Zuhrī (mort en 124/742), mais elle élargit son
champ d’investigation à d’autres narrations dues à d’autres contemporains d’al-Zuhrī.
Sur le second, Viviane Comerro entame une démarche originale qui la conduit à analyser
la façon dont des savants musulmans du IXe au XVe siècle ont repris les données de ces
sources anciennes et les ont adaptées à d’autres enjeux.
Le point de départ est constitué par la version quasiment canonique du récit de la mise
par écrit du Coran transmise par al-Bukhārī (mort en 256/870) que l’auteur analyse de
manière détaillée. Elle examine d’une part les informations qui dérivent d’al-Zuhrī et de
l’autre le projet qui sous-tend la présentation finale : il s’agit en effet pour les savants
musulmans de cette époque d’expliquer, face à la polyphonie, voire à la discordance des
témoignages qui signalent par exemple plusieurs codices concurrents, que le texte du
Coran, autrement dit la vulgate ‘uthmānienne, correspond bien, et lui seul, à la
Révélation.
Viviane Comerro étudie avec précision et finesse les textes et la façon dont les auteurs
qu’elle a retenus composent ou recomposent l’événement. Un premier exemple est tiré
du Tafsīr d’al-Ṭabarī (mort en 310/923) : il lui permet de définir une série de « motifs
narratifs », des informations ponctuelles qui sont susceptibles d’être agencées d’une
manière ou d’une autre dans des récits ayant trait à un événement donné. Cette analyse,
qui constitue la matière du ch. 3, permet de revenir dans le chapitre suivant au point de
départ, le récit proposé par al-Bukhārī. Il en ressort que les informations, loin d’être
livrées de manière neutre comme il pourrait sembler de prime abord, ont été
sélectionnées de manière à offrir une image plus consensuelle de la mise par écrit, plus
légitime également puisqu’elle est le fait des trois meilleurs Compagnons du Prophète,
les trois premiers califes. Viviane Comerro en vient même à proposer une hypothèse
www.aibl.fr 1

Sélection d’ouvrages présentés en hommage
lors des séances 2013 de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.
particulièrement intéressante du point de vue doctrinal : le texte d’al-Bukhārī viendrait
appuyer la thèse du caractère créé de la lettre du Coran et prendrait donc place dans le
débat théologique qui a marqué le IIIe/IXe siècle (p. 101).
A l’extrémité de la période définie par l’auteur pour son étude, l’Itqān d’al-Suyūṭī (mort
en 911/1505) parvient à gommer le vide séparant l’oralité initiale de la version écrite en
démontrant, à l’aide de traditions soigneusement sélectionnées, que le muṣḥaf de
‘Uthmān est rigoureusement le même que celui que l’ange Gabriel a enseigné à
Muhammad. Les dissensions de la communauté primitive ou l’existence de codices
rivaux s’estompent grâce à l’art consommé de la manipulation des informations dont fait
preuve al-Suyūṭī. C’est ainsi que s’impose une version dont Viviane Comerro montre fort
justement qu’elle est l’aboutissement d’une « théologisation progressive de l’histoire du
texte canonisé » (p. 204).
L’auteur n’oublie pas ceux qu’elle appelle « les exclus », ceux dont la voix n’a pas été
intégrée à ce qui a fini par devenir, au prix de maints glissements, LE récit de cet épisode
crucial. Certes, ‘A’isha, fille d’Abū Bakr et femme du Prophète, ainsi que le neveu et
gendre de ce dernier, ‘Alī, figurent dans d’autres traditions qui les montrent eux aussi
en possession d’une version écrite du Coran. Mais ce qu’ils rapportent n’est pas repris
dans les œuvres analysées dans ce livre. Il était toutefois difficile pour les savants
sunnites de passer complètement sous silence le témoignage de ‘A’isha, reconnue
comme une autorité pour un nombre important de ḥadīths touchant d’autres points.
Aussi apparaît-elle comme garante d’une donnée relativement mineure portant sur
l’ordre des sourates. Il n’en va pas de même pour ‘Alī dont les ḥadīths ont, il est vrai, été
recueillis par des auteurs chiites et ne sont pas repris dans les textes dont il vient d’être
question.
Viviane Comerro n’est pas seulement experte en matière de tradition musulmane, elle
est au fait des différents aspects du problème de la mise par écrit du Coran et peut donc
lorsque cela est nécessaire confronter les ḥadīths aux vestiges manuscrits qui ont été
conservés. Sa recherche, fortement marquée à l’origine par la contribution de Harald
Motzki, la dépasse à l’arrivée par son ampleur et ouvre à l’historien des débuts de l’islam
des perspectives nouvelles. Sa contribution, qui éclaire à la fois un épisode fondateur de
l’islam et sa présentation par l’orthodoxie sunnite, n’intéresse pas seulement la période
des débuts mais permet de mieux comprendre la façon dont, de nos jours encore, les
musulmans se représentent la canonisation de la vulgate coranique.
François DÉROCHE
15 février 2013
www.aibl.fr 2
1
/
2
100%