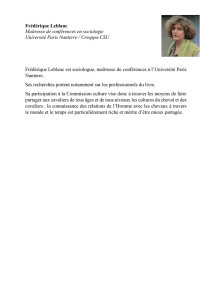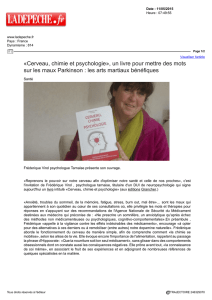Frédérique Leichter-Flack, Le laboratoire des cas de

EXTRAITS DE PRESSE
Frédérique Leichter-Flack, Le laboratoire des cas de
conscience
Presse écrite
Le JDD, 12 mai 2013
Frédérique Leichter-Flack : « Un écrivain a le droit de tout explorer »
La chercheuse de 39 ans vient de recevoir le prix Émile Perreau-Saussine. La littérature aide
à répondre à la question : qu'est-il juste de faire ?
Itv de Marie-Laure Delorme
Le Point, 4 avril 2013
Le prix de l'intelligence
Chaque année, en mémoire d'un jeune professeur de philosophie politique prématurément
disparu, le prix Emile-Perreau-Saussine honore le travail d'un chercheur en sciences
humaines de moins de 40 ans. Cette année, Frédérique Leichter-Flack remporte ce « prix de
l'intelligence » face à Jean-Baptiste Jeangène Vilmer (« La guerre au nom de l'humanité. Tuer
ou laisser mourir », PUF).
La lauréate 2013 sera couronnée le 17 avril à 18 heures à la mairie du Ier arrondissement de
Paris. Il faut lire son «Laboratoire des cas de conscience » (Alma), qui puise dans la littérature,
de Melville à Camus, de Gogol à Kafka, tous les outils pour penser la complexité de notre
monde, de la justice sociale à la bioéthique, du droit humanitaire à l'éthique militaire •
Christophe Ono-dit-Biot

Esprit, décembre 2012
Tout se passe comme si le monde littéraire apportait, comme il l'a déjà fait dans son
histoire, un crédit particulier au savoir charrié par la fiction. Et la philosophie n'est pas en
reste : Frédérique Leichter-Flack a publié un Laboratoire des cas de conscience dans lequel elle
propose la médiation de fictions littéraires comme outil opératoire sur les questions
d'éthique. Grâce à Bartleby, à la Colonie pénitentiaire, à des exemples tirés des œuvres de
Dostoïevski, Hugo ou Camus, elle travaille des questions de morale touchant aussi bien à
des domaines de droit international qu'à celui de la justice. Ce faisant, Frédérique Leichter-
Flack s'inscrit dans la droite ligne des travaux de Martha Nussbaum : dès son prologue, elle
se réfère à l'imagination narrative qui, selon l'expression de la philosophe américaine
qu'elle reprend à son compte, fait « de l'enseignement des humanités un irremplaçable
moyen de former des citoyens actifs et engagés dans les affaires publiques ».
Cette approche conjointe par l'évolution de l'art lui-même, par les concepts mis en œuvre
par la philosophie récente et les sciences cognitives incline à penser que les émotions
esthétiques proposent une ouverture sur le monde nécessaire à l'éducation d'un citoyen.
Carole Desbarats
Madame Figaro, 27 juillet 2012
UNE PLAGE PHILO. Cette jeune philosophe part du principe que tout ce qui touche à
l'éthique a été traité en littérature. Elle revisite alors les grands textes littéraires, de Hugo à
Dostoïevski, pour répondre à d'importantes questions sociétales. C'est un hommage à la
littérature doublée d'une édifiante réflexion.
Bernard Babkine, Olivia Mauriac, Isabelle Potel, et Minh Iran Muy
Bibliobs-Nouvel Obs, 17 juillet 2012
Bons tuyaux #5 - Onfray s'éprend de Mme Socrate
La philosophie occidentale se goinfre de concepts, d'idées, de néologismes au point que les
penseurs institutionnels subversifs se retrouvent avec les penseurs institutionnels tout court
pour définir la philosophie comme l'art de créer des concepts. Or, il existe une autre
tradition, celle de la philosophie existentielle descendant en droite ligne de la philosophie

antique : elle invite moins à penser, conceptualiser, théoriser, discuter, qu'à mener une vie
philosophique. Et puis, en marge, il existe une façon de faire, plutôt dominante chez les
Anglo-Saxons, qui part d'un cas très concret pour mener une réflexion étourdissante à
l'issue de laquelle il ne subsiste plus aucune certitude, sinon celle qu'on a vraiment pensée.
Je songe aux travaux intéressants de Stéphane Ferret ou de Ruwen Ogien. C'est dans cette
lignée que Frédérique Leichter-Flack inscrit sa réflexion.
Dans « le Laboratoire des cas de conscience », elle utilise le roman pour, excusez du peu,
penser la justice, le jugement, la condamnation, l'innocence, la responsabilité, la culpabilité,
la valeur d'une vie, le fait de mourir pour des idées, la prise d'otages, la question du sacrifice
ou du martyre, la non-ingérence, etc. Pour mobiliser une casuistique, elle convoque Hugo
et Dostoïevski, Kafka et Camus, Melville et Gogol, mais aussi, autres grands romans, le
Talmud et la Bible... Elle recourt également au fait divers : un chanteur célèbre qui frappe
sa compagne et la tue, des jeunes filles qui mettent le feu à une boîte aux lettres pour se
venger d'une ancienne copine et qui embrasent l'immeuble, un adolescent boxeur qui
frappe une jeune fille qui harcelait sa jeune sœur et la tue, etc.
L'analyse est simple, claire, mais profonde. La construction de la démonstration s'inspire
plus de la nouvelle ou du roman policier que de la dialectique classique ou de la
phénoménologie allemande. Le livre refermé, on a l'impression d'avoir assisté à un discours
de Socrate sur l'agora. L'auteur inquiète, fait sourire, conduit son lecteur, sans en avoir
l'air, là où elle veut – et l'on se dit que la philosophie française gagnerait à creuser ce sillon
prometteur.
Michel Onfray
Le Nouvel Observateur, 28 juin 2012
Michel Onfray s’éprend de Mme Socrate
La philosophie occidentale se goinfre de concepts, d’idées, de néologismes au point que les
penseurs institutionnels subversifs se retrouvent avec les penseurs institutionnels tout court
pour définir la philosophie comme l’art de créer des concepts. Or, il existe une autre
tradition, celle de la philosophie existentielle descendant en droite ligne de la philosophie
antique : elle invite moins à penser, conceptualiser, théoriser, discuter, qu’à mener une vie
philosophique. Et puis, en marge, il existe une façon de faire, plutôt dominante chez les

Anglo-Saxons, qui part d’un cas très concret pour mener une réflexion étourdissante à
l’issue de laquelle il ne subsiste plus aucune certitude, sinon celle qu’on a vraiment pensée.
Je songe aux travaux intéressants de Stéphane Ferret ou de Ruwen Ogien. C’est dans cette
lignée que Frédérique Leichter-Flack inscrit sa réflexion. Dans « le Laboratoire des cas de
conscience », elle utilise le roman pour, excusez du peu, penser la justice, le jugement, la
condamnation, l'innocence, la responsabilité, la culpabilité, la valeur d’une vie, le fait de
mourir pour des idées, la prise d’otages, la question du sacrifice ou du martyre, la non-
ingérence, etc. Pour mobiliser une casuistique, elle convoque Hugo et Dostoïevski, Kafka et
Camus, Melville et Gogol, mais aussi, autres grands romans, le Talmud et la Bible…Elle
recourt également au fait divers : un chanteur célèbre qui frappe sa compagne et la tue, des
jeunes filles qui mettent le feu à une boîte aux lettres pour se venger d’une ancienne copine
et qui embrasent l’immeuble, un adolescent boxeur qui frappe une jeune fille qui harcelait
sa jeune sœur et la tue, etc. L’analyse est simple, claire, mais profonde. La construction de
la démonstration s’inspire plus de la nouvelle ou du roman policier que de la dialectique
classique ou de la phénoménologie allemande. Le livre refermé, on a l’impression d’avoir
assisté à un discours de Socrate sur l’agora. L’auteur inquiète, fait sourire, conduit son
lecteur, sans en avoir l’air, là où elle veut – et l’on se dit que la philosophie française
gagnerait à creuser ce sillon prometteur.
Michel Onfray
Le Huffington post, 13 juin 2012
Qu’est-il juste de faire ?
S'il vous arrive de vous interroger sur des sujets aussi actuels que la responsabilité d'un
employeur dans le suicide d'un salarié, la peine qui devrait être infligée à l'auteur d'un coup
ayant eu des conséquences désastreuses, le fait de savoir à qui appartient l'enfant qu'une
mère porteuse refuse de remettre au couple géniteur ou encore sur la légitimité de la torture
dans le contexte du terrorisme, le dilemme de la prise d'otages pour un état démocratique,
s'il est juste de mourir pour ses idées, ou plus personnellement, sur votre propension, votre
passivité ou vos limites à aider un prochain en détresse ou en fin de vie, vous devez lire de
toute urgence Le Laboratoire des cas de conscience de Frédérique Leichter- Flack.
Non, il ne s'agit pas d'un pavé universitaire difficile à consommer. C'est même exactement
le contraire. Pour répondre à la question parfois lancinante "qu'est-il juste de faire ?" quand

il faut juger, choisir, décider d'intervenir ou pas, Frédérique Leichter-Flack part d'une
situation réelle illustrée par un fait divers ou un événement récent ou pose un problème de
société comme celui de la solidarité ou de la désobéissance civile ou militaire. Puis, et c'est
ce qui fait le sel de l'affaire, elle puise dans une grande œuvre de fiction littéraire des outils
pour y réfléchir. "La fiction littéraire" écrit-elle "porte en elle une formidable réserve de
sens que le raisonnement théorique ne peut combler. Elle apprend à faire avec l'émotion, à
ne pas croire qu'en matière de justice les idées peuvent suffire. Elle empêche d'en rester à
des réponses trop tranchées, oblige sans cesse à déplacer le regard, invite l'inquiétude et le
doute à la table du décideur." Bref, tout ce qu'on aime…
Mais si la littérature a tous les pouvoirs, l'auteur ne met pas toutes les fictions sur le même
plan.
Si elle a choisi Kafka, Gogol, Camus, Melville, Dostoïevski ou Hugo, sans oublier la Bible,
c'est pour desserrer l'emprise du mal en "scrutant l'interface en perpétuel mouvement du
juste et de l'injuste" alors que d'autres œuvres, comme Le choix de Sophie de William
Styron ne sont, à ses yeux, que fascination sidérante pour le mal. Mais c'est aussi la lecture
qu'elle en fait, en perpétuel mouvement cette fois entre la fiction et la réalité d'aujourd'hui
qui fait surgir des arguments auxquels on n'avait pas pensé, outre qu'elle donne envie de
lire les textes qu'on ne connaît pas ou de relire d'un autre œil ceux qu'on a déjà lus.
Billy Budd d'Herman Melville, La Métamorphose, La Colonie pénitentiaire et Le Château de
Kafka, Le Manteau de Nicolas Gogol ou Les Misérables de Victor Hugo, Le Prisonnier de
l'israélien Yizhar, L'Hôte de Camus en passant par l'Antigone de Sophocle, le Talmud et
dans la Bible, le jugement de Salomon ou la parabole du bon Samaritain, mettent en récit
une série d'inquiétudes et d'incertitudes au cœur de nos débats de société. Sans dire où est le
bien et le mal, la littérature est un laboratoire des cas de conscience quand elle propose des
dilemmes de fiction. Encore faut-il, et c'est là que l'auteur intervient "en comprendre la
signification, en démêler les différents fils, en apprivoiser le tragique afin d'être capable de
repérer dans les rencontres de l'existence, ce qui demande intervention, exige un choix ou
engage une responsabilité". Frédérique Leichter-Flack y excelle et nous rend plus
intelligent, ce dont il serait dommage de vous priver.
Caroline Eliacheff
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
1
/
25
100%