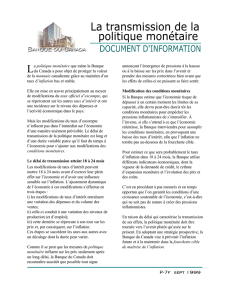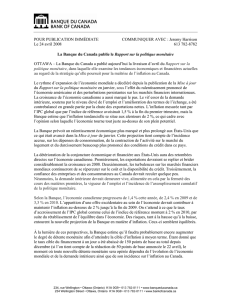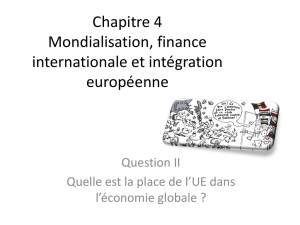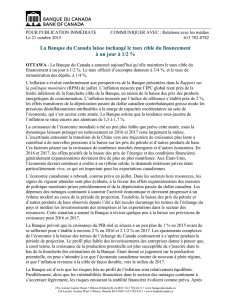politique monétaire, croissance économique et limite de vitesse

Le 10 septembre 2004
uit fois l’an, la Banque du Canada publie un communiqué que les économistes et les
médias analysent de près, en raison de son influence sur une large gamme de taux
d’intérêt, notamment ceux pratiqués sur les prêts hypothécaires, les lignes de crédit et même les
certificats de placement garanti.
Dans son communiqué, la Banque du Canada annonce
si elle a décidé d’ajuster ou non la cible qu’elle vise
pour le taux du financement à un jour, qui rémunère
les prêts à un jour entre institutions financières. Au
cœur de cette décision – qu’elle concrétise en ajustant
le taux des intérêts qu’elle verse sur les dépôts des
banques à charte chez elle et le taux des intérêts
qu’elle perçoit sur les prêts à un jour (le taux
d’escompte) – se trouve une question simple : à quel
rythme l’économie peut-elle croître sans pousser
l’inflation au-delà de la fourchette visée par la Banque
du Canada, soit au-delà de 1 à 3 p. 100? Autrement
dit, quelle est la « limite de vitesse » de l’économie
canadienne? La réponse à cette question influe de
façon importante sur la politique monétaire.
Si la Banque du Canada estime que l’économie
affiche une croissance trop rapide, dépassant son
potentiel ou sa limite, elle aura tendance à relever
la cible de taux du financement à un jour. Ce
relèvement exerce des pressions à la hausse sur les
autres taux d’intérêt, comme les taux
hypothécaires, ce qui a tendance à décourager les
emprunts et donc à ralentir la croissance de
l’économie et de l’emploi.
Si la Banque du Canada estime que l’économie
affiche un taux de croissance trop lent, inférieur à
son potentiel ou à sa limite, elle aura tendance à
réduire la cible de taux du financement à un jour.
Cette diminution exerce des pressions à la baisse
sur les taux d’intérêt et a tendance à encourager
l’emprunt et la croissance de l’économie et de
l’emploi.
Si l’on en juge par ses publications récentes, la
Banque du Canada semble estimer que l’économie ne
peut croître à un taux supérieur à 3 p. 100 par an sans
générer de graves pressions inflationnistes.
La théorie de l’inflation
Pour comprendre pourquoi la Banque du Canada croit
qu’il faut limiter le taux de croissance de l’économie
et comment elle en arrive à son estimation de 3 p. 100,
il faut connaître quelques faits fondamentaux sur
l’inflation par les prix.
De nombreux économistes estiment qu’il y a inflation
généralisée lorsque la demande globale dépasse l’offre
globale – par exemple, lorsque les consommateurs
demandent plus de biens et services que les usines ou
les fournisseurs de services peuvent en produire
pendant une période donnée. Lorsque leur capacité de
fournir davantage de marchandises et de services est
limitée à court terme (p. ex. parce qu’il faut de deux à
cinq ans pour construire une nouvelle usine et du
temps pour trouver les employés qui possèdent les
compétences voulues), les entreprises rationnent leur
production en relevant leurs prix. Selon cette théorie,
les économies – y compris celle du Canada – sont
limitées par l’offre, du moins à court terme.
Limiter la vitesse de l’économie
À la fin des années 1990 et au début de la présente
décennie, les décideurs se préoccupaient du débat sur
la limite de vitesse, car l’économie canadienne
affichait un taux de croissance très rapide, qui se
situait à 5,5 p. 100 en 1999 et à 5,3 p. 100 en 2000.
H
POLITIQUE MONÉTAIRE, CROISSANCE
ÉCONOMIQUE ET LIMITE DE VITESSE
Capsule d’information pour les parlementaires
TIPS-27F
Bibliothèque du Parlement
Ce document est la version papier d’une capsule d’information Web consultable en ligne à
http://lpintrabp.parl.gc.ca/apps/tips/index-f.asp

LIBRARY OF PARLIAMENT
BIBLIOTHÈQUE DU PARLEMENT
2
À cette époque, la Banque du Canada estimait que
l’économie ne pouvait croître à un rythme supérieur à
un taux variant entre 2,75 et 3,25 p. 100 par an sans
provoquer de graves pressions inflationnistes.
Pourtant, certains économistes du secteur privé
estimaient pour leur part que l’économie pouvait sans
danger afficher un taux de croissance d’au moins
3,5 p. 100 par an sans que l’inflation dépasse la
fourchette visée. Il faut noter que, si les deux limites
sont supérieures au taux de croissance annuel moyen
de 2,9 p. 100 pour la période de 1971 à 2003, elle sont
inférieures au taux de croissance annuel moyen de
3,7 p. 100 observé depuis le début de l’actuelle phase
d’expansion en 1992 et au taux de croissance annuel
moyen de 3,8 p. 100 enregistré depuis 1995, année où
le taux de chômage est tombé sous les 10 p. 100 pour
la première fois depuis la récession de 1990-1991.
Entre 2001 et 2003, la croissance est tombée sous la
normale, son taux annuel moyen passant à 2,5 p. 100,
et le débat sur la limitation de la croissance a perdu de
son actualité. Un redressement récent de l’économie
aux États-Unis et au Canada pourrait toutefois mener
à un regain d’intérêt. Comme de nombreux
économistes s’y attendaient, la Banque du Canada a
annoncé, le 8 septembre 2004, qu’elle relevait sa cible
pour le taux du financement à un jour de 2 à
2,25 p. 100, parce que la robustesse de la croissance
aux États-Unis et en Asie devrait pousser l’économie
canadienne à la limite ou au-dessus de son potentiel
estimé. La Banque du Canada croit qu’il faut de 18 à
24 mois pour qu’une modification de la cible de taux
du financement à un jour se répercute sur l’économie
et l’inflation.
On s’attend à voir la politique monétaire des États-
Unis suivre un cours semblable, et son orientation
influe souvent sur la politique économique et
monétaire du Canada. Dans un discours prononcé à
Londres en juin 2004 devant la International Monetary
Conference, Alan Greenspan, président de la Federal
Reserve, a déclaré qu’il était prêt à relever les taux
d’intérêt selon le besoin si l’inflation dépassait les
attentes. Pour beaucoup, cela signifie que la Réserve
fédérale américaine ne craint plus, comme elle l’a fait
au cours des deux ou trois dernières années, un recul
généralisé des prix (déflation), mais s’inquiète à
nouveau d’une éventuelle hausse des prix (inflation).
L’importance de changements
modestes de la limite de vitesse
Les petites variations de la limite de vitesse estimée de
l’économie importent, parce que les estimations
peuvent engendrer leur propre réalisation. Par
exemple, si la Banque du Canada estime que la
croissance de l’économie canadienne ne doit pas
dépasser 3 p. 100 par an pour éviter l’inflation, son
influence par la voie des taux d’intérêt pourrait bien
confirmer cette estimation. L’écart entre 3 et
3,5 p. 100, par exemple, peut sembler faible (50 points
de base), mais il se traduit par environ 6,1 milliards de
dollars d’activité économique supplémentaire, si l’on
utilise les chiffres du PIB nominal pour 2003 en
supposant un taux d’inflation de 2 p. 100. Pour se
faire une idée de l’ampleur de ce chiffre, il suffit de
penser que 6,1 milliards de dollars représentent une
fois et demie la production nominale annuelle de l’Île-
du-Prince-Édouard.
Mesurer la croissance potentielle
La mesure habituelle de la limite de vitesse de
l’économie – la croissance potentielle – équivaut
normalement à la somme du taux de croissance de la
productivité et du taux d’accroissement de la
population. Deux grandes conséquences s’ensuivent.
En premier lieu, si la population augmente,
l’économie peut croître plus rapidement. En second
lieu, si les secteurs d’activité peuvent produire
davantage avec moins d’intrants (main-d’œuvre,
matériaux, énergie, etc.), donc améliorer leur
productivité, la croissance peut aussi s’accélérer.
Étant donné que la hausse de la productivité annuelle
a été en moyenne de 2 p. 100 entre 1996 et 2002 et
que la population a augmenté d’environ 1 p. 100 par
an ces dernières années, on estime que la limite de
vitesse ou croissance potentielle au Canada devrait
être d’environ 3 p. 100.
La Banque du Canada s’attend toutefois, sauf si la
productivité devait nettement s’améliorer au Canada, à
ce que le taux de croissance potentiel du pays chute en
raison du vieillissement de la population et
d’amenuisements prévus de la croissance
démographique, deux phénomènes qui entraînent une
diminution du nombre de travailleurs. Dans une de

LIBRARY OF PARLIAMENT
BIBLIOTHÈQUE DU PARLEMENT
3
ses publications, la Banque du Canada a estimé, par
exemple, que la croissance potentielle pourrait
décliner pour varier entre 0,7 et 2,8 p. 100 entre 2031
et 2041.
Comme tous les modèles économiques, ce calcul
s’appuie sur des hypothèses dont certaines prêtent à
débat. Par exemple, on suppose que la croissance
démographique et la productivité sont des limites à la
croissance économique découlant de l’offre; mais
pourquoi ne serait-ce pas la vigueur de la croissance
économique qui se traduirait en fait par des gains de
productivité et l’arrivée d’immigrants plutôt que
l’inverse? Si une demande robuste exerçait cette
influence positive sur la productivité, toute hausse
prématurée des taux d’intérêt amenée par la banque
centrale pourrait décourager en fait la croissance de la
productivité (et ainsi une croissance potentielle plus
élevée), dans la mesure où les décisions
d’investissement des entreprises sont influencées par
les variations des taux d’intérêt. Par conséquent, la
Banque du Canada est tenue d’interpréter avec
beaucoup de soin les pressions inflationnistes.
Repousser les limites
Le débat sur la limite de vitesse de l’économie se
ramène à un différend sur la mesure dans laquelle
l’économie peut s’adapter de façon non inflationniste
à des poussées de la demande. Pour assurer une
certaine souplesse à son processus de prise de
décision, la Banque du Canada ajoute à l’équation
« croissance de la population plus hausse de la
productivité » un éventail assez large de
considérations moins théoriques et plus intuitives,
s’appuyant sur diverses enquêtes, afin de jauger les
pressions inflationnistes et la capacité de production.
Il s’agit notamment d’analyses des taux d’utilisation
des capacités dans les usines canadiennes, de
sondages sur les attentes en matière d’inflation et de
tenue de l’économie, d’analyses du marché du travail,
notamment du taux de chômage, et, enfin, d’une
observation attentive de la croissance économique et
des pressions inflationnistes à l’étranger, surtout aux
États-Unis, puisque le comportement de ces facteurs
dans ce pays tend à influer de manière déterminante
sur la politique monétaire canadienne.
Quels que soient les efforts que la Banque du Canada
déploie pour éviter une analyse trop rigide du
potentiel de croissance non inflationniste de
l’économie, certains économistes estiment que la
fourchette de variation de l’inflation ciblée par la
Banque – de 1 à 3 p. 100 – prédispose cette dernière à
avoir une opinion trop limitée de la souplesse et de la
capacité de l’économie pour ce qui est d’évoluer sans
porter le taux d’inflation à la hausse. Ils soutiennent
que la préoccupation première de la Banque du
Canada, soit le maintien de l’inflation dans cette
fourchette, encourage de façon générale un
comportement prudent qui sous-estime la capacité
d’adaptation de l’économie. Selon la Banque, par
exemple, les données disponibles laissent entendre
que les entreprises canadiennes sont moins capables
d’adopter de nouvelles technologies que leurs
homologues américaines en raison de leur taille
comparativement plus modeste. La Banque croit
également que les données laissent entendre que le
marché de la main-d’oeuvre canadien est relativement
peu souple par rapport à celui des États-Unis, où la
limite de vitesse de l’économie est généralement
supposée supérieure à celle du Canada. Lors d’un
témoignage devant le Comité permanent de la
Chambre des communes, le 21 avril 2004, le
gouverneur de la Banque du Canada, David Dodge, a
déclaré que « la structure même de l’économie
canadienne signifie que nous connaîtrons des taux de
chômage relativement plus élevés que les États-
Unis ». Lors d’un autre témoignage devant le même
comité, le 23 octobre 2002, il a déclaré que la Banque
estime que le marché du travail canadien doit être plus
souple. Pour ce qui est du marché du travail, on
entend par flexibilité accrue une formation officielle et
en milieu de travail plus importante ainsi que
l’élimination ou la modification d’aspects
institutionnels tels que les lois sur le salaire minimum,
l’assurance-emploi et la syndicalisation.
Certains observateurs estiment néanmoins que
l’économie canadienne est beaucoup plus adaptable
que la Banque du Canada le croit. Ils notent, par
exemple, que les contraintes sur le plan de l’offre au
sein du pays – surtout telles que les mesurent les taux
d’utilisation des capacités – ne sont pas aussi
significatives qu’elles peuvent le sembler, le Canada
étant une économie relativement ouverte dotée de peu

LIBRARY OF PARLIAMENT
BIBLIOTHÈQUE DU PARLEMENT
4
de tarifs douaniers et droits de douane. Par
conséquent, les entreprises et les consommateurs
canadiens peuvent toujours acheter des marchandises
à l’étranger si les prix des articles produits au pays
commencent à monter en raison de contraintes
internes pesant sur l’offre. Même si une tendance
accrue à acheter des marchandises étrangères peut
causer des pressions inflationnistes au Canada à
moyen ou long terme, les preuves que tel est le cas
sont limitées; de plus, rares sont les signes d’un tel
lien entre la chute du dollar canadien et une hausse
des prix intérieurs, comme les années 1990 l’ont
démontré.
Ceux qui estiment que l’économie canadienne est
relativement souple et que la Banque du Canada
devrait croire davantage en sa capacité de croître de
façon non inflationniste sont également d’avis que le
marché du travail et les entreprises du pays sont
beaucoup plus adaptables que la Banque le suppose.
Enfin, d’après eux, l’expérience des années 1990
justifie une approche plus libérale; ils soulignent que
cette période a été marquée par la vigueur de la
croissance économique et la faiblesse ou la diminution
de l’inflation. Compte tenu des énormes avantages
que laissent entrevoir une croissance économique
robuste et un chômage moindre, ils estiment que les
décideurs devraient être plus attentistes en matière de
politique monétaire et laisser l’économie canadienne
croître rapidement sans imposer à la croissance des
limites qu’ils jugent artificielles.
préparé par
Marc-André Pigeon
Service d’information et de recherche parlementaires
Pour en savoir plus…
Voir la bibliographie ainsi que les hyperliens internes et externes
de la version Web du présent document à :
http://lpintrabp.parl.gc.ca/apps/tips/index-f.asp
ou composer le (613) 996-3942
1
/
4
100%