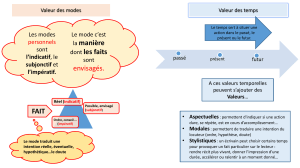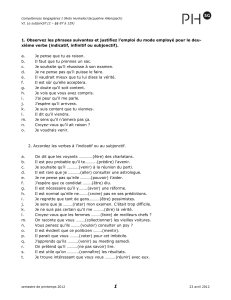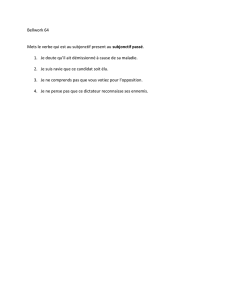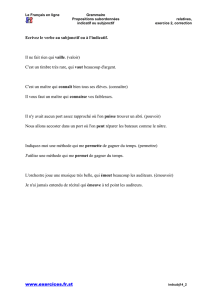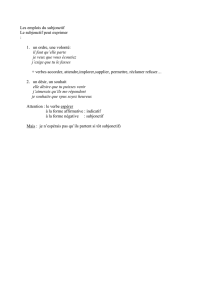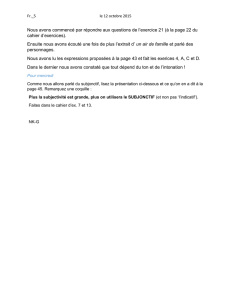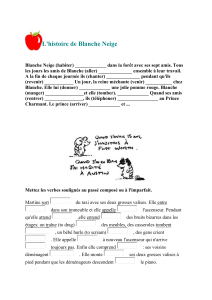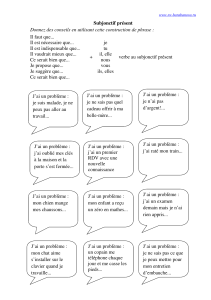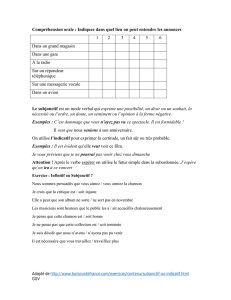article subjonctif corrigé

Actes du colloque AcquisiLyon 09, Lyon, 3 et 4 décembre 2009. 1
L’emploi du subjonctif en français par des apprenants terminalistes tunisiens
Sabeh BOULARES
(DILTEC) Université de Paris 3 Sorbonne Nouvelle /
(EDIPS) ISEFC Université de Tunis
ABSTRACT
This paper is devoted to a survey of errors committed by
very advanced Tunisian learners of French who substitute
the indicative mood to the expected subjunctive mood in
their written assignments. The sources of this type of
errors are discussed. Errors are caused by ignorance of the
internal constraints that determine the use of the
subjunctive in these contexts in written French: the
semantics of the verbs involved as well the type of
conjunctive marker used…
1. INTRODUCTION
Le maniement du mode subjonctif suscite de nombreuses
difficultés chez les apprenants tunisiens terminalistes en
contexte de français langue seconde lors des tâches de
production de textes argumentatifs. En effet, il s’agit d’un
mode des plus délicats d’emploi en français car c’est un
mode des plus riches en nuances.
Afin de déterminer les difficultés quant à l’emploi du
mode subjonctif ainsi que les raisons sous-jacentes à ces
difficultés, nous avons procédé à l’analyse de 527
rédactions argumentatives d’apprenants de la 4è année
secondaire. Les élèves sont âgés en moyenne de 18 ans.
2. CADRE THEORIQUE
Le subjonctif forme avec l’indicatif l’ensemble des modes
personnels. Alors que l’indicatif se caractérise par son
aptitude à actualiser un procès grâce au nombre de ses
formes, le subjonctif est propre à exprimer un procès
«présenté comme l’objet d’un jugement, d’un sentiment,
d’une volonté et non comme un fait que l’on pose en
actualisant» [Wag91 : 344].
Le mode subjonctif est le mode de l’in fieri selon G.
Guillaume [Gui70 : 11], le mode qui ne saurait exprimer
une image-temps réalisée et qui ne saurait distinguer les
époques nettement. La détermination du mode en discours
se fait selon que «les milieux traversés par l’image
verbale sont ou ne sont pas interceptifs de la visée ; et ces
milieux sont constitués essentiellement par le sémantisme
du verbe principal et par la valeur de l’élément
introducteur. » [Bay73 :155]. Alors que les verbes de
sentiment et les verbes de volonté (vouloir, désirer,
ordonner…) sont interceptifs et demandent l’emploi du
subjonctif dans la subordonnée, les verbes d’opinion et de
perception sont interceptifs (douter, désespérer) ou non
interceptifs (croire, affirmer) selon leur sens. Certaines
conjonctions sont virtualisantes et régissent le mode
subjonctif : à condition que, afin que, pour que, avant que,
sans que.
G. Guillaume [Gui70] explique la visée interceptée et la
visée non interceptée en recourant aux notions d’idée
regardée et d’idée regardante. L’idée regardée est une
idée dépendante ; l’idée regardante est celle à travers
laquelle on présente l’idée regardée. Ce qui commande le
choix entre le subjonctif et l’indicatif c’est la nature de
l’idée regardante. Au cas où l’idée regardante est
actualisante, elle ne freine pas la visée ; si elle est opaque,
elle est inactualisante, elle freine la visée. Toute
explication du mode de l’idée regardée est à chercher
dans l’analyse des idées regardantes.
Le travail d’analyse entrepris nous a permis d’identifier
certains types d’erreurs d’emploi du mode subjonctif.
Nous procèderons dans ce qui suit à la description et à
l’analyse de l’emploi de l’indicatif au lieu du subjonctif.
3. L’EMPLOI DE L’INDICATIF AU LIEU DU
SUBJONCTIF
L’écart consistant à substituer l’indicatif au subjonctif est
très fréquent chez les élèves tunisiens terminalistes.
D’autant plus, c’est un écart qui embrasse quasiment tous
les types de subordonnées. Nous procèderons à l’analyse
des erreurs relevées selon la nature de la proposition
subordonnée.
3.1. Le cas des complétives
« (1) … Mais il faut que nous se contentons de ce qu’on
est parce que c’est une bonne idée. (…) Pour ça, il faut
que nous se contentons de ce qu’on est ». / « (2) : Pour
cela, il faut que nous lisons tout les types de romans ».
Dans les complétives contenues dans ces phrases, le mode
indicatif est employé par erreur. En fait, pour la
complétive, l’idée regardante se trouve dans son support
qui peut être « nominal, adjectival ou verbal » : « l’emploi
du mode subjonctif dans les complétives introduites par
que, à ce que, de ce que est imposé par […] la classe
sémantique du verbe, du nom ou de l’adjectif dont dépend
la complétive (contrainte lexicale exercée par le terme
principal), [Rie94 :324]. Dans ces phrases, le support de
la complétive est verbal : il faut ; il fait partie du champ
de la nécessité. Ce genre de verbe exprime une idée
regardante inactualisante dans la mesure où l’action
envisagée dans chaque complétive à savoir se contenter,
lire est simplement envisagée dans son éventualité donc
virtualisée. Si bien que le mode à employer dans ces
complétives est le mode inactuel : le subjonctif et non

2 Actes du colloque AcquisiLyon 09, Lyon, 3 et 4 décembre 2009.
l’indicatif. Or les deux modes s’opposent comme nous
l’avons avancé plus haut.
Outre l’emploi dans la complétive du mode erroné
après il faut que, le même type d’erreurs a été constaté
après un support traduisant la subjectivité du lecteur,
exemple : « (3) En dernier lieu, c’est bien que
l’identification à un personnage peut être un
épanouissement personnel : le fait de fuir le monde réel,
s’évader et chercher ».
La subordonnée comprend un verbe à l’indicatif au lieu
du subjonctif. C’est une complétive ayant pour support un
adjectif, le mot bien utilisé pour apporter un jugement sur
l’identification au personnage romanesque, une sorte
d’appréciation subjective de cette identification. Lorsque
le support de la complétive appartient au champ du
jugement, il donne lieu à une idée regardante
inactualisante nécessitant l’emploi du mode inactuel
qu’est le subjonctif. Le procès exprimé par la périphrase
verbale peut être contenu dans le verbe à l’infinitif
être est bien admis et donc réel, soit «l’effet de
l’identification au personnage », mais a été soumis à un
jugement subjectif, donc il a été virtualisé.
3.2 Le cas des relatives
Relatives dont l’antécédent est un superlatif relatif (le
seul; le meilleur; le plus…). On décèle fréquemment la
présence du mode indicatif à la place du subjonctif dans
les relatives, exemples :« (1) : L’écrivain […] est le seul
parmi les artistes qui peut écrire les sentiments des
hommes » ; «(4): Dans nos jours, la guerre est la plus
forte épreuve que nous vivons dans un monde caractérisé
par l’intolérance et l’indifférence» ; « (5) : le racisme,
c’est le meilleur élément qui peut décrire correctement
cette mauvaise situation. »
D’après Guillaume [Gui70 : 44] «Le mode dans la
relative dépend de l’actualité et de l’inactualité de
l’antécédent ». Ainsi, c’est l’indicatif qui est à employer
dans le cas d’un antécédent actuel et le subjonctif dans le
cas d’un antécédent inactuel. Par ailleurs, il est à noter
que l’antécédent ne peut être inactuel qu’en présence d’un
environnement linguistique particulier. Dans ces
exemples, les relatives ayant pour antécédents des
pronoms introducteurs qui/ que des substantifs et un
environnement linguistique inactualisant : le seul, le
meilleur, la plus forte. Ces superlatifs relatifs sont de
nature à rendre l’antécédent inactuel. A chaque fois,
l’antécédent (les artistes, épreuve, élément) est isolé des
autres moyens pour être présenté de façon exclusive
c’est-à-dire pour être soumis à une appréciation subjective
qui relève du champ de la préférence, et ce, en même
temps que les autres moyens sont exclus. Ceci dit, mis
dans un cadre subjectif, l’antécédent est rendu inactuel et
exprime donc une idée regardante inactualisante qui
nécessite l’emploi du subjonctif dans la relative puisque
dans ce genre d’emploi «la pensée opère dans un champ
de comparaison plus ou moins vaste dont elle détache un
objet qu’elle isole de tous ceux qui y restent en mettant
sur lui la marque du superlatif » Guillaume [Gui70 : 40].
Relatives dont l’antécédent est un nom avec un article
indéfini. Exemples : (6) « par conclusion il faut avoir des
gens qui sont indifférence (pour indifférents) avec les
autres. » ; (7) D’abord, dans notre monde on ne trouve
jamais un homme qui est compréhensif et qui veut
accepter l’autre. », Dans les deux cas, les deux
propositions relatives s’appuient chacune sur un
antécédent indéterminé à cause de l’article indéfini qui
l’accompagne. La première relative qui sont indifférents
s’appuie sur le support nominal des gens ; or ces gens
existent seulement dans la pensée du locuteur et non pas
réellement : l’existence de ce genre de personnes est
souhaitée par le locuteur, voire nécessaire puisque nous
avons le verbe impersonnel traduisant la nécessité il
faut. Ces gens ne figurent donc pas sur la ligne
d’actualité de la pensée ; l’antécédent est donc inactuel,
d’où le besoin de recourir au mode subjonctif qui
virtualise l’action. G. Guillaume [Gui70 : 42] ajoute
concernant le mode dans la relative «que l’article de
l’antécédent est sujet à exercer une action sur le mode de
la relative » et d’expliquer que « l’article le, différemment
de l’article un pose comme acquise l’existence » de la
chose en question, ce qui amène l’emploi de l’indicatif.
Au contraire, l’article indéfini un revêt cette chose d’une
sorte d’indétermination, de virtualité qui appelle l’emploi
du subjonctif. Donc, pour les deux relatives, l’antécédent
est indéterminé (des, un) et alors virtualisé, c’est pourquoi
il requiert le recours au mode subjonctif.
3.3 Le cas des circonstancielles
Les difficultés d’emploi du subjonctif apparaissent aussi
dans les subordonnées circonstancielles qu’elles soient
finales, de manière, de temps ou de concession.
Les circonstancielles de but On parle de circonstancielle
de but chaque fois que la subordonnée vise à décrire « le
mobile rendant compte de la principale ; une relation de
finalité s’établit entre la proposition principale régissante
et la proposition subordonnée » Soutet [Sou00 :92]. Vu
que les circonstancielles de but manifestent une intention,
elles sont logiquement au subjonctif. Mais certains élèves
substituent le mode indicatif au mode subjonctif dans la
circonstancielle de but introduite par pour que, exemples :
(8) « Pour moi, accepter ce qu’on est un grand défaut car
il faut que nous changes pour qu’on peut se developper
et avoir les nouveaux technologies.» ; (9) « j’espère qu’il
arrive ce jour-là pour qu’on peut admirer les autres
types d’écrire pour les grandes écrivains ». En fait, cette
locution renferme l’idée regardante qui détermine le mode
à employer dans la subordonnée : l’indicatif si elle est
actualisante et le subjonctif dans le cas contraire
c’est-à-dire au cas où elle est inactualisante. Or pour que
exprime l’intention (le but) et non un résultat précis, donc
les actions rendues par les verbes à l’indicatif peut se
développer (exemple 8) et peut admirer (exemple 9) sont
tout simplement envisagées, voire souhaitées et donc
virtualisées d’où la nécessité d’employer le mode du
virtuel qu’est le subjonctif. Selon Camoun [Cam92 : p74],
ce type d’erreur substituant l’indicatif au subjonctif
constitue un véritable écart par rapport à la norme étant

Actes du colloque AcquisiLyon 09, Lyon, 3 et 4 décembre 2009. 3
donné que la conjonction finale pour que est l’une de ces
conjonctions qui résistent normalement à la concurrence
temporelle.
Les circonstancielles de manière « (10) […] l’écriture
ne peut jamais être un moyen pour que quelqu’un
exprimer ses sentiments et enseigné tout ce qu’il senti à
l’autre…. Lorsque l’un des amoureux peut mentir à
l’autre sans que l’autre connaît la vérité ».
La circonstancielle de manière est introduite par sans que.
Le mode de la circonstancielle dépend de la conjonction
ou de la locution conjonctive qui l’introduit et qui
renferme l’idée regardante susceptible de déterminer le
mode à utiliser dans la subordonnée. Dans le cas de cette
subordonnée et s’agissant d’une locution conjonctive qui
l’introduit, c’est la locution sans que qui renferme l’idée
regardante. Sans fait partie des prépositions qui
expriment l’anticipation dans la mesure où elle évoque
l’idée d’exclusion et donc d’inactualisation. Elle annonce
un procès secondaire qui va être exprimé dans la
subordonnée, un procès censé accompagner un autre,
rendu par le verbe principal mais il ne se réalise pas.
L’expression de la manière vient du fait du
non-accompagnement du procès principal par le procès
secondaire, qui devrait logiquement se réaliser. Cette idée
d’exclusion est à l’origine de l’inactualisation du procès ;
elle nécessite l’emploi du subjonctif dans la
circonstancielle de manière. L’action que le subjonctif est
censé exprimer est tout simplement envisagée.
Les circonstancielles de temps La commande
automatique du subjonctif s’observe selon Soutet [Sou00 :
89] « dans des contextes où interviennent soit une visée
d’anticipation, soit une visée négative, soit une
combinaison des deux ». On parle d’anticipation
chronologique chaque fois que l’événement décrit dans la
subordonnée est censé survenir après l’événement décrit
dans la principale et qu’il est perçu par rapport à ce
dernier comme simplement prospectif. C’est ce qui fait
que le subjonctif s’impose dans les circonstancielles de
temps commençant par avant que et jusqu’à ce que.
Dans cet extrait (11) «Ceci est l’exemple de « Don
quichotte qui est émerveillé par les héros des romans qu’il
a lu et qui veut imiter ces héros jusqu’à ce qu’il est
considéré comme un fou…», la proposition subordonnée
circonstancielle temporelle est introduite par la locution
conjonctive jusqu’à ce que qui fait partie des conjonctions
de temps entraînant l’emploi du subjonctif dans les
subordonnées qu’elles introduisent. Cet élément est classé
par G. Guillaume [Gui70 : 43] parmi les conjonctions
exprimant « la simple expectative », c’est pourquoi elles
sont inactualisantes. La subordonnée introduite par ladite
conjonction est présentée comme étant située dans la suite
chronologique immédiate de la principale. Cette locution
conjonctive exclut donc toute concomitance de la
principale et de la subordonnée. L’action qui consiste à
considérer Don Quichotte comme fou est, telle que le
contexte la présente, effective ; mais au départ, le procès
est envisagé par le locuteur comme simplement virtuel, le
procès est vu dans une sorte de prospectif imaginaire. Le
caractère expectatif de l’idée regardante impose le recours
au subjonctif qui exprime donc un procès réel mais conçu
au début comme projeté par l’esprit.
Les circonstancielles de concession Parmi les
propositions circonstancielles qui se construisent avec le
subjonctif, Imbs [Imb53 :46] cite les conjonctions
concessives qui indiquent qu’un fait ne produit pas la
conséquence attendue (quoique, bien que, encore que et
dans la langue familière, malgré que) ou ne répond pas à
ce qu’on attend (bien loin que). L’emploi du mode
subjonctif dans les circonstancielles concessives pose des
difficultés aux élèves tunisiens et ce, quelle que soit la
locution introductrice. Qu’il s’agisse de bien que ou de
malgré que, c’est généralement le mode indicatif qui est
utilisé au lieu du subjonctif comme l’illustrent ces
exemples : (12) « On ne peut nier que ces personnages
romanesques permettent aux lecteurs d’aimer la vie et
avoir un regard optimiste sur la vie bien qu’il y a
beaucoup de choses mauvaises. » ; (13) « Malgré que
l’esclavage a été éradiqué depuis un siècle il est revenu
dans un autre costume : c’est le racisme ».
Dans les subordonnées concessives, et comme nous
l’avons annoncé ci-dessus, l’emploi du subjonctif est de
règle. A ce propos, les linguistes remarquent que l’emploi
de l’indicatif n’est pas rare dans la langue parlée et se
rencontre chez des écrivains modernes, mais cet emploi
est considéré comme « incorrect et familier, populaire ou
archaïque » remarque Hanse [Han00]. Bien que exprime
l’idée d’opposition, voire d’une forte idée d’adversation
(incompatibilité entre deux procès : celui de la principale
et celui de la subordonnée). L’idée regardante contenue
dans cette locution est donc virtualisante, elle réclame
l’emploi du subjonctif dans la subordonnée. Par
conséquent, le procès présenté dans la subordonnée (il y a
beaucoup de mauvaises choses) fonctionne comme une
cause inopérante qui annonce un paradoxe (il faut aimer
la vie même s’il y a, dans cette vie, de mauvaises choses).
Cette cause inopérante que contient bien que est une
appréciation subjective à laquelle le procès subordonné
est soumis. Le subjonctif exprime une action virtualisée
afin d’être soumise à une appréciation subjective. Une
remarque s’impose, concernant le noyau verbal peut
jouer ; il s’agit ici d’une périphrase verbale donc d’un
entier sémantique comprenant deux éléments
verbaux dont le premier est le semi-auxiliaire et le second
est l’infinitif qui fournit à la périphrase son côté
sémantique c’est-à-dire le vrai procès, le semi-auxiliaire
donne à la périphrase verbale ses traits grammaticaux
dont le mode à utiliser. C’est le verbe pouvoir qui doit
être donc au subjonctif.
4. INTERPRETATIONS ET IMPLICATIONS
L’analyse menée nous a permis de constater, à travers les
erreurs d’emploi du mode subjonctif, une assimilation
insuffisante du système modal français traduite par une
confusion des emplois et des valeurs des modes différents
à savoir le subjonctif et l’indicatif. Ce travail a révélé
aussi une intériorisation insuffisante des contraintes à la
fois syntaxiques (se rapportant à la construction des

4 Actes du colloque AcquisiLyon 09, Lyon, 3 et 4 décembre 2009.
phrases) et sémantiques (en rapport avec le sémantisme
du verbe support de la complétive, le sens de l’antécédent
de la relative ou aussi le sens de la conjonction
introduisant la circonstancielle) pesant sur l’emploi du
subjonctif. Ce qui montre un décalage entre le niveau
institutionnel des apprenants objet de notre étude et le
stade d’acquisition atteint : bien qu’ils aient fait au moins
10 ans d’étude de langue française et qu’ils soient
considérés, par conséquent, comme avancés, le degré de
maîtrise des emplois des formes verbales est en deçà des
attentes. Ce constat nous permet de rejoindre celui de
Housen & al [Hou06], à la suite de leur enquête sur le
développement de la morphologie verbale chez des
apprenants avancés de FLE en Belgique. Ces chercheurs
ont procédé à l’analyse selon les critères de Bartning et
Schlyter [Bar04]. Ces chercheurs ont délimité, à partir de
leurs travaux sur les apprenants suédophones de français
L2, six stades de développement allant du début de
l’acquisition jusqu’à une production quasi-native. Le
subjonctif est l’un des éléments qui marquent les stades
avancés qui sont au nombre de trois : 1/ un stade avancé
inférieur dans lequel apparaissent des structures
spécifiques, complexes et variées du français (entre autres
le subjonctif) ; 2/ un stade avancé moyen qui se
caractérise par la poursuite du développement de la
morphologie flexionnelle. A ce niveau, le subjonctif
devient plus productif ; 3/ un stade avancé supérieur qui
se caractérise par une morphologie flexionnelle stabilisée,
même dans les énoncés multipropositionnels.
Housen & al (ibid) ont constaté une discordance entre
l’évaluation du niveau de compétence déterminé d’un
point de vue instructionnel et le stade d’acquisition atteint
selon les critères de Bartning et Schlyter : bien que les
trois groupes d’apprenants ayant servi à l’étude soient
considérés comme des apprenants avancés dans la mesure
où ils ont fait +/- 870h d’enseignement de FLE, seul un
groupe a atteint le stade avancé concernant la production
formelle des formes verbales et l’exploitation
fonctionnelle de ces formes, dont celles du subjonctif.
Il semble par ailleurs d’après leurs travaux que le contexte
extra-curriculaire (langue familiale, contexte social) soit
déterminant dans la connaissance des formes et dans leur
exploitation fonctionnelle : les performances des
apprenants évoluant dans un contexte social bilingue
(néerlandophone/francophone) sont de loin meilleures que
celles du groupe appartenant à un milieu unilingue
(uniquement néerlandophone). De même, les
performances du groupe bilingue dont le milieu familial
est francophone sont nettement meilleures que celles des
autres groupes. Pour ce qui est des apprenants tunisiens,
nous pensons que le contact avec la langue française en
dehors de la classe de français les aiderait à mieux la
maîtriser. Au contraire, les difficultés seraient plus nettes
au cas où ils ne la rencontrent qu’en classe et qu’elle
représente vraiment une langue étrangère pour eux. Ce
travail va constituer le prochain volet de notre recherche.
Housen & al (ibidem) ont de même constaté que
l’enseignement est plus efficace en ce qui concerne la
connaissance des formes et leur correction que sur
l’exploitation fonctionnelle. Le degré d’exploitation
fonctionnelle est limité chez les apprenants dont la langue
de famille n’est pas le français mais le néerlandophone,
alors que la production formelle ne pose pas de difficultés
importantes. Ceci nous fait penser au manuel de l’élève
tunisien qui montre une prise en compte très modeste des
modes verbaux, omettant l’étude des valeurs de ceux-ci
dans les textes et négligeant l’exploitation des erreurs des
apprenants. Par conséquent, il ne favorise pas assez
l’exploitation fonctionnelle des formes verbales.
Des remarques avancées découlent certaines implications.
L’apprenant devrait s’entraîner à déterminer le mode du
verbe de la subordonnée tout en sachant qu’il dépend du
type de celle-ci ou du subordonnant qui l’introduit. De
son côté, l’enseignant devrait favoriser l’observation
abondante de textes argumentatifs authentiques, afin que
les apprenants s’imprègnent des emplois concrets des
modes. D’autre part, il devrait entraîner les élèves à : -
identifier les modes et les temps et à comprendre les
enjeux d’un texte : s’il rapporte des faits réels ou s’il
exprime des ordres à réaliser, s’il fait état d’actions
envisagées mais non réalisées… - repérer les
dysfonctionnements dans un texte et essayer de
l’améliorer ; - réécrire un texte argumentatif en
maintenant la cohérence des temps et des modes.
RÉFÉRENCES
[Bar04]
Bartning, I & Schlyter, S (2004) : Itinéraires
acquisitionnels et stades de développement en
français L2, French Language Studies, 14, p
281-299.
[Bay73]
Baylon et Fabre (1973), Grammaire
systématique de la langue française, Nathan
[Cam92]
Camoun (1992), Etudes de
psycho-systématique française et arabe,
Faculté des lettres de la Manouba, Tunis.
[Gui70]
Guillaume G. (1970), Temps et aspect, suivi de
l’architectonique des temps, Champion, Paris.
[Han00]
Hanse J. (2000), Nouveau dictionnaire des
difficultés du français moderne, 3ème édition,
de Boeck.
[Hou06]
Housen, A et al (2006) : Le développement de
la morphologie verbale chez des apprenants
avancés de FLE : apports et limites du contexte
instructionnel:[www.groupelca.org/h/colloque2
006/actespdf/housen_kemps_pierrard.pdf]
[Imb53]
P. Imbs (1953), Le Subjonctif en français
moderne, faculté des lettres de l’université de
Strasbourg, France.
[Rie94]
Riegel M., Pellat J. C., Rioul R. (1994),
Grammaire méthodique du français, PUF
[Sou00]
Soutet O. (2000), Le subjonctif en français,
Ophrys.
[Wag91]
Wagner Wagner et Pinchon (1991), Grammaire du
Français classique et moderne, Hachette.
1
/
4
100%