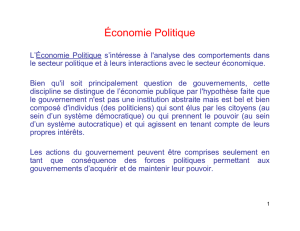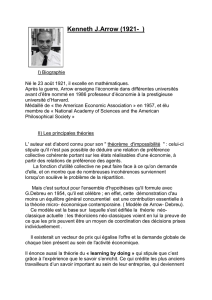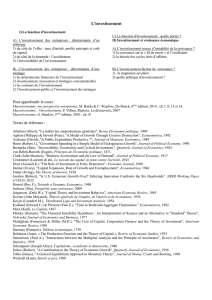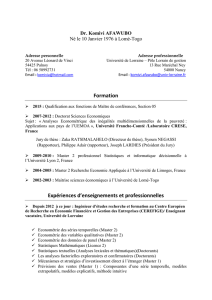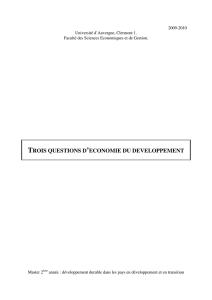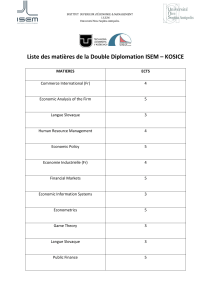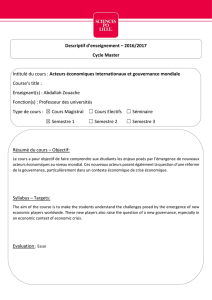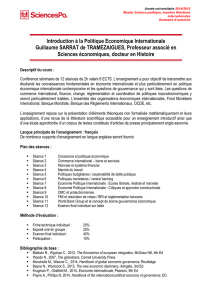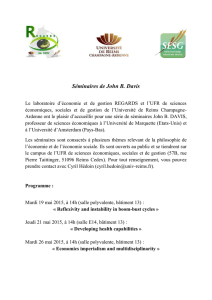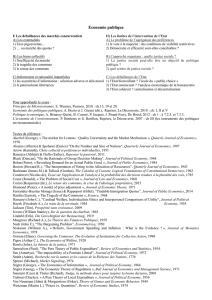capital social et performances economiques

LAMETA Working Paper
2004-08
Capital social et performances économiques : une analyse basée sur le
fonctionnement d’une économie informelle
Joëlle Fopoussi∗
Résumé : L’économie informelle actuelle nous éloigne de plus en plus de la vision initiale d’Arthur
Lewis (1954), qui représentait la dualité comme une phase transitoire du processus de
developpement. Pour expliquer ce dualisme qui se perpétue trois courants d’analyse ont émergé :
les héritiers de la théorie neo-classique, les néo-marxistes et les théoriciens de l’économie du
développement. Du débat qui existe entre ces trois courants, nous retenons deux analyses extrêmes
sur l’expansion de l’économie informelle en Afrique subsaharienne. La première lie la vitalité de
l’économie informelle aux contraintes financières et réglementaires qui pèseraient sur l’activité
économique formelle. La seconde constate que la croissance extensive de l’économie informelle en
Afrique est le signe d’une dérive vers une simple économie de subsistance, dont la contribution à
l’activité économique se limite à assurer la survie des masses populaires. Tout en reconnaissant
cette dérive, nous proposons une autre vision du rôle de l’économie informelle dans le processus de
développement. La théorie de la croissance endogène donne de nouvelles perspectives à l’analyse
du dualisme économique. Elle nous permet de montrer que, l’économie informelle est le lieu où le
lien entre le capital social et la production des richesses est le plus concret et le plus évident.
Mots clé : capital social, économie informelle, croissance économique
Abstract : Arthur Lewis (1954) describes economic dualism as an intermediate phase of the
development process. Nowadays, the reality of informal economy in less developed countries is too
far from this conception. The dynamism of informal economy in subsaharian Africa can be explain
by many reasons. Two majors visions are opposed on this debate. On one hand, there are those who
think that the expansion of informal economy is a consequence of the weight of financial and
administratives constraints on the official economy. On the other hand, those who notice that
informal economy is growing while poverty is increasing. Although we agree with this observation,
we can not conclude that informal economy is another form of subsistence economy. The
endogeonous growth theory offer new perspectives to the analysis of economic dualism. The
informal economy is the framework where the link between social capital and economic
performances is much more tangible.
Keywords : social capital, informal economy, economic growth
∗ LAMETA-CNRS UMR 5474, Université Montpellier I, Faculté des sciences économiques, Espace Richter,
Avenue de la mer, CS 79 606, 34960 Montpellier cedex 2, joë[email protected]

INTRODUCTION
Le concept même du capital social a acquis de nos jours une place incontestée dans la
pensée économique. Cependant, l’idée d’admettre le capital social comme un bien
économique fait débat. Effet, le capital social est difficilement quantifiable, d’où l’absence
de statistiques détaillées à l’échelle nationale. Il est même difficile de dire ce qu’il convient
de mesurer comme facteurs déterminants du capital social, car les relations sociales et
engagements communautaires susceptibles d’être intégrées dans le capital social sont
multiples, variées et pour beaucoup intangibles. L’utilisation du terme même de capital
peut paraître contestable, car ce terme est plus courant lorsqu’il s’agit de biens tangibles,
durables ou périssables dont l’accumulation peut être estimée.
la notion de capital social intègre des formes d’organisation sociale. Elle se réfère
également à l’ensemble des connaissances et pratiques partagées eu sein de l’organisation.
A ce propos, les économistes ont depuis longtemps admis les différentes formes de savoir
comme des formes de capital. L’interprétation qui considère que les règles
communautaires comme des composantes du capital social, rend difficile l’élaboration
d’une approche empirique pertinente. Une telle approche est plus aisée si le capital social
est défini comme un aspect du capital humain.
Dans le domaine de l’économie du développement, les avis sont partagées sur les vertus ou
les défauts de ce que, dans une définition large, nous nommons par « institutions
informelles ». Si ces formes d’organisation sociale contribuent à la formation du capital
social, il faudrait alors s’interroger sur la nature même de cette productivité. L’existence
même de l’économie informelle pourrait empêcher l’émergence de structures socio-
économiques plus productives.
2

Dans une première définition, le capital social est une notion qui englobe « des
caractéristiques de l’organisation sociale tels le rapport de confiance, les normes, les
réseaux qui améliorent l’efficacité de la société en facilitant les actions coordonnées »1.
Cette définition mène à un amalgame entre le tangible et l’intangible. Le tangible regroupe
des éléments aussi variés que les coutumes traditionnelles et codes de conduite.
L’intangible représente des notions comme les relations interpersonnelles qu’on peut
formaliser. Certains auteurs se sont focalisés sur le rapport de confiance. D’autres ont porté
leur intérêt sur des aspects de l’organisation sociale comme les tontines, les coopératives
financières ou agricoles, qui font du capital social un actif. Cette approche implique qu’il
existe des formes productives et non productives de capital social2. Dans toutes ces
contributions littéraires, le champ d’analyse du capital social est une espace dont les limites
restent à définir, entre l’individu et l’Etat (la société). Il s’identifie globalement aux
activités de la société civile. Les mécanismes qui permettent la formation du capital social
s’observent le mieux dans certaines formes d’institutions informelles. Le terme
« institutions informelles » représente aussi bien des aspects de l’économie informelle ou
souterraine, certaines formes de sociétés criminelles que des structures de l’économie
solidaire ou populaire.
Pour ce qui est de l’économie informelle dans les pays en voie de développement, le poids
de l’organisation sociale se mesure au fait que, c’est elle qui fixe implicitement les
conditions d’accès à cette économie. La notion de confiance est le fondement du contrat
social entre les acteurs économiques de cette économie. Elle régit les relations marchandes
1 PUTNAM R.D., with R. LEONARDI and R.Y. NANETTI, 1993, Making democracy work : civic
traditions in modern Italy, Princeton University Press, Princeton, P. 167.
2 Partha DASGUPTA, Social capital and economic performance : analytics, Working Paper, Facuty of
Economics, University of Cambridge, Revised version, January 2002.
3

et non marchandes entre les agents économiques. Les réseaux structurent l’économie
informelle. Ils constituent la principale barrière à l’entrée de cette économie.
Les barrières les plus difficiles à franchir à l’entrée de l’économie informelle sont les
barrières non financières. Leur importance échappe souvent aux économistes, et est mis en
lumière par un travail anthropologique de longue haleine. La plus immédiate est
l’existence de castes, aussi bien en Afrique qu’en Inde. La caste est un des éléments d’un
enchevêtrement complexe de hiérarchies, elle joue un rôle de « barrière à l’entrée » non
écrite assez efficace. Des barrières fondées sur l’appartenance ethnique, en l’absence de
castes, peuvent être aussi efficaces que ces dernières pour assurer à une catégorie de la
population le monopole de l’exercice d’une activité économique. La religion joue
également un rôle important en matière de barrière l’entrée. Elle est généralement un
facteur associé à d’autres comme la communauté éthnico-geographique et/ou la
transmission d’un savoir-faire.
La difficulté à pénétrer dans un réseau représente un obstacle majeur à l’accès à certaines
activités informelles. Le réseau peut prendre des multiples formes ou les combiner :
• Réseau de transmission de l’information sur la clientèle, les fournisseurs, les
concurrents, la police, etc.
• Réseau d’autoprotection collective (milices armées).
• Réseau commercial (groupements d’achat ou de vente).
• Réseau d’organisation du marché (partage du marché, règlement des conflits).
Ces multiples réseaux imbriquées peuvent être constitués sur des bases elles-mêmes
diverses : communauté de caste ou de religion, communauté d’origine géographique,
communauté ethnique ou de parentèle. L’importance du réseau est lié au fait que l’emploi
informel est surtout un emploi non qualifié. Par conséquent, des critères d’embauche plus
objectifs comme le niveau d’étude ou de formation n’ont ici que peu d’utilité. Les réseaux
4

ou les relations personnelles sont une variable d’ajustement entre l’offre et la demande sur
le marché du travail en Afrique subsaharienne. A Bamako, « 55,7 % des salariés irréguliers
et 54,4 % des salariés sans protection sociale ont accédé à leur emploi actuel par le biais de
relations personnelles, alors que l’incidence de cette procédure n’est que de 16% pour les
salariés protégés »3.
La structure des réseaux est souvent peu apparente. Pourtant, l’appartenance à des réseaux
familiaux, amicaux, associatifs ou syndicaux, est une condition nécessaire pour exercer
certaines activités. L’apprentissage d’un ensemble de codes urbains, lié à l’appartenance
aux réseaux, constitue l’élément principal de la qualification de ces travailleurs. Il devient
alors difficile de distinguer les barrières de réseau des autres formes de barrières non
financières, en particulier de celles qui relève de l’appartenance ethnique ou de la
qualification. Dans certaines ethnies, l’appartenance à l’ethnie et au sein de celle-ci, à un
« tissu très dense d’alliances matrimoniales entrecroisées » (Morice, P.61) est la condition
pour accéder aux connaissances techniques qui elles-mêmes permettront de s’établir à son
propre compte4. Dans d’autres cas, les réseaux de relations apparaissent comme plus
importants que les connaissances techniques, dont les futurs micro-entrepreneurs peuvent
se dispenser. Le réseau peut être également le signe d’un autre type de qualification :
connaissance de l’administration, des sources de financement, etc.
L’analyse des réseaux souligne toute la complexité que pose la notion de capital social. En
effet, s’il est reconnu que les relations personnelles sont une variable d’ajustement sur le
marché du travail, encore faut-il que les bases de l’ajustement soit clairement définies ou
formalisées. L’appartenance au réseau suffit-elle pour que l’offre satisfasse à la demande,
3 EL HADJI SIDIBE B. et LACHAUD J.-P.,1993, Pauvreté et marché du travail au Mali : le cas de Bamako,
Institut international d’études sociales, OIT, Genève, Discussion papers n°52, P.92.
4 MORICE A., 1987, « Ceux qui travaillent gratuitement : un salaire confisqué », in AGIER M., COPANS J.
et MORICE A. (coord.), Classes ouvrières d’Afrique noire, Karthala, Paris, pp 45-76.
5
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
1
/
29
100%