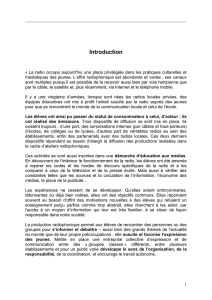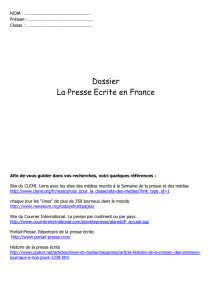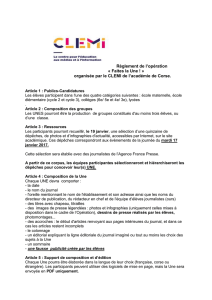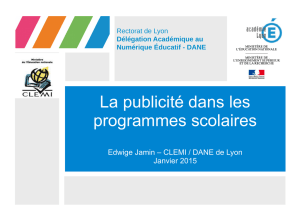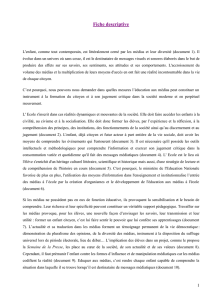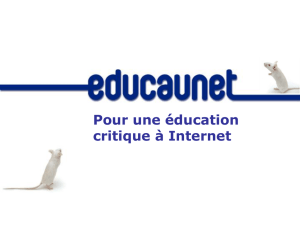Du commencement de l`EAM à l`éducation citoyenne Entretien avec

Du commencement de l'EAM à l'éducation citoyenne
Entretien avec Jacques Gonnet. Fondateur et directeur (1983-2004) du CLEMI, professeur des
Universités Paris 3 Sorbonne nouvelle.
"L'Éducation Aux Médias introduit le bruit de monde à l'école et en ce sens elle permet une
éducation à l'actualité et au politique". Cette phrase est extraite du discours de Jacques Gonnet lors
de l'ouverture de la conférence "les 30 ans du CLEMI*" le 15 novembre 2013.
Monsieur Jacques Gonnet nous expose les prémices et l'installation de cette éducation aux médias.
Le premier point de cet entretien aborde la façon dont s'est opéré le rapprochement du monde
des médias et de l'école.
Un premier rapprochement est opéré par des expériences individuelles d'enseignants qui, passionnés
par la presse, font entrer l'actualité du monde dans leur classe.
A l'exemple de ce maître d'école dans l'Oklahoma aux Etats-Unis, dans les années 1860, qui tous les
jours apportait des quotidiens pour que les élèves puissent constater les différences, travailler
dessus, réfléchir.
Mais ce rapprochement des médias et de l'éducation ne s'est pas opéré sans tension.
Les technologies nouvelles, comme par exemple les rotatives ou la télévision, induisent une
diffusion massive de l'information. Souvent perçues comme objets de fantasmes et de peurs, elles
posent à l'école des interrogations. Doit-on faire entrer la presse à l'école, pourquoi faire rentrer la
presse à l'école ?
Mais inversement la question qui se pose est pourquoi la presse ne rentrerait-elle pas à l'école dans
la mesure où le monde est aussi ce qui fait partie de l'école ?
La question qui se pose alors est : comment traiter le monde avec les disciplines, la philosophie, la
littérature, les mathématiques, la géographie ?
Dans les années soixante-dix la demande des enseignants de travailler avec la presse se fait de plus
en plus forte. Ils s'interrogent sur la façon de questionner le monde avec leurs élèves et la réponse
est de partir de l'intérêt des enfants et des adolescents, de leur motivation.
Le second point de cet entretien aborde les nouvelles formes de pédagogie mise en place par
cette éducation aux médias.
Le précurseur en France est Célestin Freinet qui dans les années 1920 a su répondre à la motivation
des enfants en laissant une part importante à l'expression libre pour qu'ils racontent leur quotidien.
Tout comme Janusz Korczak en Pologne, Ovide Decroly en Belgique, John Dewey en Angleterre,
ces enseignants, qui sont parfois des médecins, s'interrogent sur les capacités qu'ont les enfants à
recevoir une masse d'information et sur les questions qu'ils vont se poser.
Le projet pédagogique de Freinet est de donner des outils aux enfants pour que ces derniers
construisent à travers le journal une connaissance du monde. Ils deviennent citoyens dans la mesure
où ils sont partie prenante d'une société.
La construction de cette connaissance se retrouve dans l'élaboration des journaux lycéens. Comment
s'exprimer dans un journal ? Peut-on tout dire ? L'objectif pédagogique est de mettre les personnes
en situation de responsabilité.
Le CLEMI accompagne et promeut cette expression lycéenne dans le respect des droits et des
obligations (Les droits et la déontologie des journaux lycéens : circulaire du 6 mars 1991 actualisée
par la circulaire du 1er février 2002).

Crée en 1982 par Jacques Gonnet à la demande du Ministre de l'éducation nationale Alain Savary, le
CLEMI Centre de Liaison de l’Enseignement et des Médias d’Information est «chargé de
concevoir et de développer une éducation aux médias».
Le troisième point de cet entretien aborde la notion d'éducation aux médias.
Si la Commission européenne définit l'EAM comme la « capacité à accéder aux médias, à
comprendre et apprécier, avec un sens critique, les différents aspects des médias et de leur contenu
et à communiquer dans divers contextes », Jacques Gonnet insiste sur deux notions, simples, brèves
et claires :
-L'éducation aux médias est une éducation politique.
-L'éducation aux médias est une éducation à la démocratie.
Le fait de vivre dans un régime démocratique n'est pas inné et ne va pas de soi, l'histoire nous
le montre à plusieurs reprises. C'est pourquoi, l'école se doit d'introduire en son sein le
questionnement sur les valeurs de la démocratie.
Une des missions de service public de l'école est de mettre en place des pratiques démocratiques,
des ateliers de démocratie.
En ce sens l'école doit promouvoir les capacités à s'exprimer, à argumenter et à écouter.
Le cœur de cet apprentissage de la différence et de l'ouverture à l'autre se fait avec et par les médias
qui sont le baromètre des démocraties.
* Centre de Liaison de l’Enseignement et des Médias d’Information
7 avril 2015
1
/
2
100%