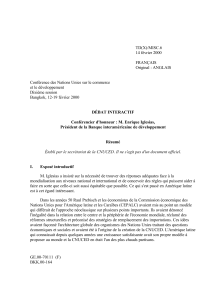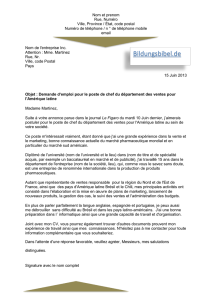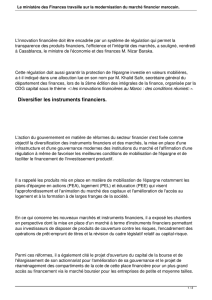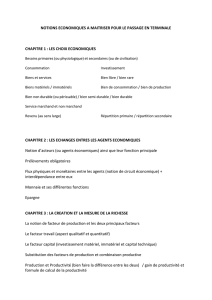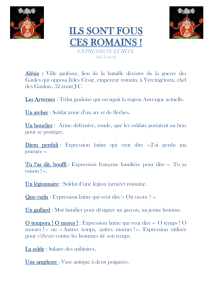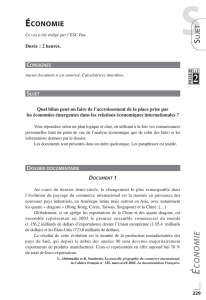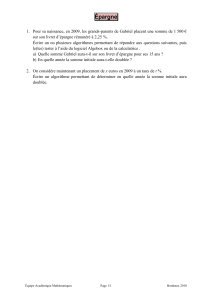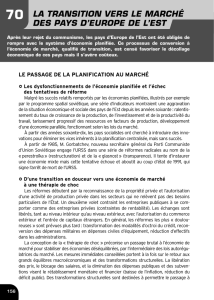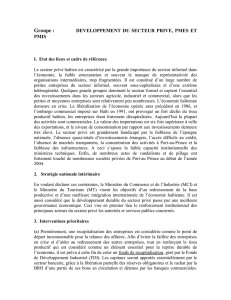Document complet au format .


2
PRÉSENTATION
Ce document est un résumé partiellement actualisé de la publication de la Commission économique pour
l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC) intitulée « Desarrollo productivo en economías abiertas »
(Développement du secteur productif dans le contexte d’économies ouvertes),1 paru en 2004. Ce titre fait
intervenir deux éléments que certains considèrent parfois comme diamétralement opposés. D’une part, le
processus de mondialisation et sa conséquence inéluctable, à savoir la plus grande ouverture sur le monde des
économies de l’Amérique latine et des Caraïbes, sont perçus comme un processus irréversible. D’autre part, les
politiques productives sont considérées indispensables dans tout programme public visant à promouvoir le
développement économique.
La région se trouve actuellement au terme d’un processus de réformes qui a atteint son apogée
dans la décennie 1990 et au seuil d’une nouvelle étape aux contours encore indistincts. En raison de
l’incertitude qui règne quant à la direction que l’Amérique latine et les Caraïbes vont prendre dans
l’immédiat, et sachant que celle-ci sera finalement déterminée par les actions conscientes des opérateurs
sociaux, la CEPALC a donc souhaité dresser le bilan du chemin parcouru et présenter sa vision des
mesures qui devraient nécessairement faire partie d’un agenda positif.
L’Amérique latine et les Caraïbes constituent la région du monde en développement qui s’est le plus
fermement engagée dans le processus d’internationalisation et de libéralisation économique axé sur le rôle
prépondérant du secteur privé et condensé dans ce qui a été appelé le Consensus de Washington. Ce train de
réformes misait sur le fait que l’équilibre budgétaire, la stabilité des prix et l’ouverture sur le monde allaient
apporter aux sociétés un élan de croissance, un recul du chômage ainsi que des gains de productivité et une
augmentation des salaires réels.
Au terme de la période de réformes, le bilan s’avère mitigé puisqu’il comporte des aspects aussi bien
positifs que négatifs; pour résumer l’évolution globale, l’image la plus synthétique possible de l’ensemble du
processus est celle d’une trajectoire en forme de parabole composée d’une période d’essor immédiatement
suivie d’une étape de crise, puis d’une phase finale de déclin.
La résorption des déséquilibres budgétaires, ainsi que la maîtrise des processus chroniques
d’hyperinflation qui sévissaient dans la région, ont été accompagnées de progrès manifestes en matière
d’investissements en infrastructure, de modernisation de certains segments de l’appareil de production et de
croissance des exportations. Au passif de ce bilan, il faut inscrire un taux de croissance faible et volatile, le
démembrement de l’appareil de production, la progression du chômage et du travail informel, l’aggravation de
la vulnérabilité extérieure et la détérioration des principaux rapports macro-économiques.
La reprise d’un processus de croissance dynamique et stable passe d’abord par le fonctionnement
d’une macroéconomie assainie qui préserve et consolide les progrès accomplis dans les années 90, soit un taux
d’inflation réduit et un déficit budgétaire contrôlable. La politique macro-économique doit non seulement être
en mesure de garantir la stabilité nominale; il faut également qu’elle parvienne à atténuer la volatilité réelle et
ce, moyennant l’accroissement de l’épargne intérieure et l’approfondissement des marchés financiers afin de
réduire la dépendance vis-à-vis de l’épargne extérieure. Il faut en outre appliquer des politiques budgétaires
anticycliques qui impliquent la volonté d’épargner durant les phases d’expansion.
1 Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC), Desarrollo productivo en
economías abiertas (LC/G.2234(SES.30/3)), Santiago du Chili, juin 2004.

3
Ce document se penche également sur la qualité de l’insertion sur les marchés extérieurs. En raison de
la vocation exportatrice des pays de la région et des pratiques protectionnistes des pays développés, les débats
se centrent aujourd’hui sur l’accès aux marchés. Néanmoins, l’accès aux marchés ne suffit pas à résoudre les
problèmes institutionnels ni à engendrer le développement productif requis pour relancer la croissance. Il est
indispensable de parvenir à un taux de croissance dynamique et soutenu des exportations et, dans le même
temps, d’accroître leur effet d’entraînement sur la croissance économique; pour ce faire, il est particulièrement
important de mettre en œuvre une stratégie de politiques publiques qui visent à améliorer le mode d’insertion
extérieure de la région et à stimuler des gains de compétitivité et de productivité de l’appareil de production.
L’État doit nécessairement prendre part à ce processus et appliquer des politiques actives de
promotion des exportations qui permettent de tirer parti des externalités positives dans l’ensemble de l’appareil
de production, de compenser les défaillances des marchés des capitaux au niveau du financement des
exportations, de mettre à profit des économies d’échelle, de saisir les opportunités d’apprentissage, ainsi que de
veiller à l’utilisation rationnelle des ressources naturelles et à l’exploitation des nouvelles technologies en
matière d’environnement.
Les mécanismes d’incitation devront tenir compte de la nécessité d’accorder la priorité à la promotion
des exportations de nouveaux produits ou de nouveaux marchés, activités qui doivent être considérées comme
de véritables innovations. Par ailleurs, il est indispensable que les politiques de promotion des exportations
soient conçues comme des stratégies à moyen et à long terme, de façon à assurer la continuité des politiques,
quels que soient les changements intervenus dans les équipes gouvernementales chargées de les mettre en
œuvre.
Comme signalé plus haut, l’un des héritages fâcheux des années 1990 a été l’hétérogénéité croissante
de l’appareil de production, qui a entraîné une exclusion elle aussi croissante de certains agents économiques
alors que d’autres s’acheminaient vers la modernisation productive. La structure productive des économies
latino-américaines se caractérise actuellement par trois grandes catégories d’unités, en fonction de leur degré
de formalisation et de leur taille. Le premier groupe est composé des grandes entreprises, dont beaucoup sont
des transnationales, qui présentent généralement des niveaux de productivité proches de la frontière
internationale mais qui ont très peu de liens avec l’économie locale et une faible capacité innovatrice. La
deuxième catégorie correspond aux petites et moyennes entreprises du secteur formel qui ont généralement de
grandes difficultés pour accéder à certains facteurs de production, en particulier au financement et aux services
technologiques et qui, surtout, présentent une faible capacité d’articulation productive aussi bien entre elles
qu’avec les entreprises appartenant à d’autres catégories. Le dernier groupe est constitué par les micro
entreprises et les petites entreprises du secteur informel qui, en raison de leur structure et de leurs capacités,
sont celles qui présentent la plus faible productivité relative et évoluent dans un contexte qui les prive de toute
possibilité de développement et d’apprentissage; qui plus est, les travailleurs et les employeurs ne font l’objet
d’aucune protection sociale contre les risques qu’ils encourent, y compris la perte d’emploi ou de revenu.
Le développement du secteur productif de cette économie « à trois vitesses » exige l’adoption de
politiques publiques actives qui contribuent à niveler le terrain de jeu et facilitent la mise en place d’une
structure de soutiens et d’incitations articulée autour de trois grandes stratégies: d’inclusion, de modernisation
et de densification.
La stratégie d’inclusion aura pour but de faciliter le passage au secteur formel de l’économie du plus
grand nombre possible de micros et petites entreprises du secteur informel. Les mesures à prendre dans le
cadre de cette stratégie sont de grande envergure, tout en restant sélectives quant aux destinataires; elles
doivent notamment prévoir la simplification des normes et des démarches, la réduction des charges fiscales, un
accès plus large au crédit et à la formation. La stratégie de modernisation concerne les petites et moyennes

4
entreprises du secteur formel et est fondée sur un dosage de politiques horizontales et sélectives. Les premières
sont destinées à améliorer l’accès à l’information, au crédit et à la technologie, tandis que les politiques
sélectives s’appliquent à la formation d’associations de petites entreprises, en passant par le développement de
fournisseurs ou de clients de grandes entreprises jusqu’à la consolidation de structures productives regroupées
sur un seul territoire (clusters) ou articulées comme étapes d’une chaîne de valeur.
La stratégie de densification vise les grandes entreprises et a essentiellement pour but d’intégrer de
nouveaux savoirs au tissu productif d’un pays et de favoriser les innovations au sens large. Elle comporte des
mesures destinées notamment à renforcer les liens locaux de la base exportatrice, à favoriser la coopération
entre les secteurs public et privé dans le cadre du système d’innovation et à attirer un investissement étranger
de meilleure qualité sur les plans productif et technologique.
Un autre sujet abordé dans ce document est la déchirure du tissu social qui a été l’une des retombées
les plus graves des expériences de politique qui ont caractérisé les années 1990. La conjugaison de deux
tendances, à savoir la recrudescence du taux d’activité et le fléchissement du taux d’occupation, s’est traduite
par une progression du chômage et du nombre de travailleurs du secteur informel.
L’aggravation de l’hétérogénéité productive et des inégalités ainsi que la progression du travail
informel et du chômage n’entraînent pas seulement des pertes statiques et dynamiques au niveau du produit et
de la croissance; elles constituent aussi une menace latente pour la cohabitation démocratique et la
communauté de vues et de propos qui doivent aller de pair avec les processus de changement historique
nécessairement liés au développement économique.
A la lumière de tous ces éléments, la CEPALC a proposé que soit conclu un pacte de cohésion sociale
fondé sur l’adoption d’engagements réciproques de la part des secteurs sociaux et de l’État et sur lequel
reposerait la construction d’une société inclusive dans la région. Un tel pacte devra respecter les fondements de
la politique macro-économique et favoriser la création de nouveaux emplois, la protection sociale, ainsi que
l’éducation et la formation.
Il faut, finalement, garder à l’esprit que la région évolue dans un contexte international caractérisé par
un processus de mondialisation d’un espace économique hiérarchisé au sein duquel seuls les pays les plus
développés affichent une croissance convergente. Par ailleurs, de profondes asymétries subsistent en matière
de création de technologies et de capacités propres à surmonter les obstacles qui freinent l’entrée à des secteurs
plus porteurs; le développement des systèmes financiers nationaux varie selon les pays, de même que leur
degré d’autonomie dans la formulation de politiques.
Dans ce contexte, la principale contradiction de ce processus de mondialisation réside dans le fait que
les problèmes d’ordre mondial se multiplient alors que leur traitement continue de relever essentiellement des
initiatives de politique à l’échelon national. Le document met en lumière les effets de ce déséquilibre en
matière de gouvernance internationale dans quatre domaines déterminés: les régimes macro-économiques et
financiers, les négociations commerciales multilatérales, la mise en valeur durable de l’environnement et la
migration internationale.

5
La CEPALC se propose, par cette analyse, de contribuer à la formation de connaissances dans la
région ainsi qu’à la définition des options de politique économique disponibles, de façon à contribuer au débat
sur le type d’architecture institutionnelle qui devrait encadrer le processus actuel de mondialisation. L’objectif
ultime de cet effort intellectuel est l’édification de sociétés dans lesquelles l’intégration au reste du monde soit
un moyen de consolider les identités nationales, la croissance du produit serve d’assise matérielle à l’accès à
une structure plus équitable de la consommation et la démocratie soit la voie effective par laquelle les peuples
puissent agir sur la destinée de leurs pays.
José Luis Machinea
Secrétaire exécutif
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
1
/
41
100%