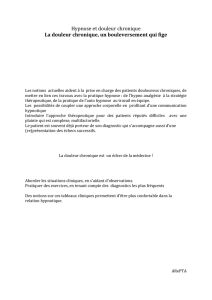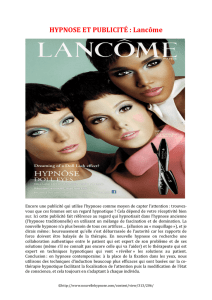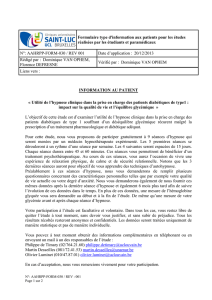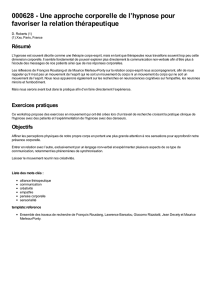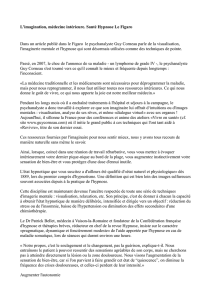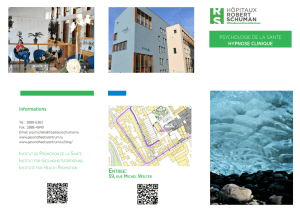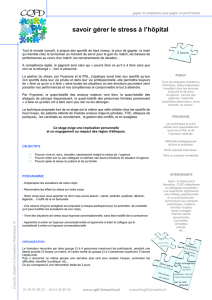Les applications de l`hypnose dans la SEP

D O S S I E R
11
LE COURRIER DE LA SEP NOVEMBRE 2015 N°145
par le Docteur Olivier ANNE
Médecin neurologue et praticien en hypnose médicale
La Rochelle
Les applications de l'hypnose
médicale dans la sclérose en plaques
D
OSS
IE
R
Il existe un important engouement
pour l’hypnose dans le domaine médical
à l’heure actuelle.
Principalement utilisée au bloc
opératoire pour compléter ou
remplacer l’anesthésie et analgésie
médicamenteuse, ou comme méthode
de psychothérapie, l’hypnose médicale
étend désormais son champ d’action
vers les maladies chroniques.
L’hypnose s’avère très utile dans
la sclérose en plaques.
En effet par son approche et ses effets
à la fois psychiques et corporels, elle
favorise une meilleure qualité de
vie en permettant de mieux gérer
les symptômes ainsi qu’en facilitant
l’acceptation de la maladie.
Les mots sont les
médicaments les plus
effi caces utilisés par
l’homme.
Rudyard Kipling
(1865-1936), auteur
du Livre de la jungle
et Prix Nobel de
Littérature

12 N°145 NOVEMBRE 2015 LE COURRIER DE LA SEP
Qu•est-ce que l'hypnose ?
Selon Milton ERICKSON,
le processus d’hypnose
est naturel et accessible
à tous notamment sous
forme d’auto-hypnose.
L’hypnose se défi nit comme un état de conscience modifi é,
différent du sommeil. Elle se défi nit également comme un outil
thérapeutique qui utilise cet état de conscience modifi é pour
aider le patient à résoudre ou améliorer une problématique.5
Milton ERICKSON (1901-1980) (fi g. 1), psychiatre américain,
a beaucoup œuvré au rayonnement, au renouveau et au
développement de l’hypnose, à tel point que les outils
hypnotiques les plus utilisés à l’heure actuelle portent son
nom (nous parlons alors d’hypnose « Ericksonienne »). Il
défi nit l’hypnose comme un processus qui isole la personne
de son environnement conscient immédiat et dirige son
attention vers l’intérieur d’elle-même et vers ses propres
potentialités réelles.1
Fig. 1 : Milton ERICKSON
(1901-1980), un thérapeute
hors du commun, selon le titre
de sa biographie signée par
l’un de ses disciples, Jay Halley.
Atteint de poliomyélite à l’âge
de dix-sept ans, il est très vite
confronté à un important handi-
cap moteur et à la présence de
douleurs neurogènes intenses.
Il expérimente alors sur lui-
même différentes techniques
d’imagerie mentale qui lui per-
mettent d’accélérer le processus de rééducation et améliorer
sa qualité de vie. Il mettra par la suite en application l’ensemble
de ces phénomènes dans l’hypnose thérapeutique et décou-
vrira les principes de l’auto-hypnose. Ses travaux ont inspiré
plusieurs approches thérapeutiques dont l’hypnose erickso-
nienne, qui porte son nom, les thérapies brèves et l’approche
systémique de l’école de Palo Alto, ainsi que la programmation
neuro-linguistique. A l’instar de l’approche psychanalytique
freudienne, Milton ERICKSON conçoit l’inconscient comme
une partie saine, bénigne et utile qui porte l’ensemble des ap-
prentissages et ressources à activer.
Petit historique de l'hypnose médicale
Les états de conscience modifi és à usage thérapeutique ont
été utilisés de façon très ancienne et dans de nombreuses
cultures et traditions. Classiquement, nous situons les débuts
de l’hypnose dans la médecine occidentale au milieu du
XVIIIe siècle avec les travaux et la pratique de Franz Anton
MESMER (1734-1815). Le professeur Jean Martin CHARCOT
(1825-1893) (Fig. 2), le père de la neurologie moderne et de
la méthode anatomo-clinique, utilisa l’hypnose et l’enseigna
à de nombreux disciples, notamment Sigmund FREUD (1856-
1939), lors de ces fameuses leçons de l’Hôpital de la Pitié
Salpêtrière à Paris.2
Apres une longue période de désuétude, l’hypnose médicale
suscite un nouvel intérêt avec Milton Erickson (Fig. 1). Les
apports de Milton ERICKSON sont majeurs. En particulier il
démontre que le processus d’hypnose est totalement naturel
et accessible à tous. En cela, il s’oppose aux conceptions plus
anciennes qui associaient hypnose à un état ou une person-
nalité pathologique qui rendait la personne hyper sugges-
tible. Il considère l’hypnose comme une science de l’inter-
communication. Il développe alors toute une série d’outils
hypnotiques basés sur le langage. L’effi cacité de ces outils
repose sur la notion de permissivité, approche non directive,
qui laisse le contrôle au patient. Son approche permet égale-
ment la découverte de l’auto-hypnose, où le patient apprend
à se guider lui-même dans le processus hypnotique.1,2
Fig. 2 : Le professeur Jean Martin CHARCOT (1825-1893)
lors de ses leçons à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière.
Les bases neurophysiologiques de l•hypnose
Les études neurophysiologiques du
processus hypnotique sont de plus
en plus nombreuses. L’exploration du
métabolisme cérébral par la neuro-ima-
gerie fonctionnelle permet notamment
de mieux appréhender le processus
hypnotique. En effet ces études ont
démontré une plus large activité corti-
cale notamment des régions préfron-
tales durant l’hypnose en comparaison
à celle de l’état de conscience ordi-
naire. Cette activité s’avère spécifi que
au processus hypnotique, se distin-
guant de la simple imagerie mentale
mais aussi de l’effet placébo.3,4,5,7
Il est désormais bien démontré qu’il
existe un pattern d’activité cérébrale
spécifique à l’hypnose lors d’une
stimulation douloureuse. Cette activi-
té est bien corrélée à une modulation
des composantes affective et sensori
discriminatives du message doulou-
reux. D’autres études suggèrent la
mise en place d’une barrière mnésique
qui réduit la prise de conscience de
la douleur. La région cérébrale la
plus impliquée dans ces processus
de modulation du message doulou-
reux est le cortex cingulaire antérieure
(fi g. 3) 3,4,5,6,7,8, 9, 10
Hypnose médicale

D O S S I E R
13
LE COURRIER DE LA SEP NOVEMBRE 2015 N°145
L’hypnose est un processus mental naturel. Chacun de nous
expérimente très régulièrement des phases d’hypnose
spontanée. En effet toute activité qui mobilise une grande
concentration et focalisation modifi e notre état de conscience
en l’orientant vers notre monde intérieur et imaginaire. Cela
génère alors une modifi cation de notre perception du monde
extérieur et une distorsion du temps. La vision d’un film
passionnant, un trajet en voiture bien connu où l’on s’ennuie
un peu et où l’on oublie une partie du parcours sont des
exemples fréquents d’hypnose spontanée.
Lors d’une séance d’hypnose thérapeutique ou hypnose
provoquée, le soignant propose au patient de vivre le
processus hypnotique par le biais d’une focalisation induite
par des outils de langage. Une fois la focalisation installée,
le soignant propose au patient de se concentrer sur les
différentes sensations présentes au travers de l’exploration
des cinq sens. Le patient ressent alors cette expérience
comme un rêve éveillé. Il reste donc tout à fait conscient
et vigilant. Il conserve le contrôle, dirige le processus en se
laissant guider par les suggestions du soignant que le patient
a toute liberté d’intégrer ou non. Le patient peut décider
à tout moment d’arrêter le processus s’il le souhaite. Le
soignant peut par exemple convier le patient à s’immerger
dans une activité agréable, à revivre un souvenir agréable.
Les séances se déroulent sur une trentaine de minutes en
moyenne en position assise ou allongée à la convenance du
patient.
Parfois il s’avère utile au patient d’apprendre l’autohypnose
pour mieux gérer une situation ou un symptôme au
quotidien. Après une première séance réalisée avec
l’accompagnement du soignant, la procédure d’induction
puis d’accompagnement au travers de l’exploration des cinq
sens est répétée jusqu’à ce que le patient sache de façon
autonome « s’autoguider » dans le processus d’hypnose.
Déroulement d•une séance d•hypnose
Le cortex cingulaire
antérieur est
spécifi quement activé
lorsqu’une stimulation
douloureuse est effectuée
sous hypnose. Cette
activation permet de
réguler la transmission
du message douloureux.
Fig. 3 : Etude en IRM fonctionnelle
de l’activité cérébrale lors d’une
stimulation douloureuse ressen-
tie, soit en conscience ordinaire,
soit pendant l’hypnose. Le pattern
d’activité révèle une hyperactivité
du cortex cingulaire antérieure lors
de la séance d’hypnose, impliquée
principalement dans la modula-
tion de la composante affective et
émotionnelle de la douleur.
Kupers et al (2005) 7
L’hypnose est un outil thérapeutique
complémentaire très utile dans le
contexte pathologique de la sclérose en
plaques, et cela à toutes les phases de
la maladie. Dès la phase diagnostique,
l’hypnose peut être utilisée pour
soutenir le patient dans cette épreuve.
En premier lieu, l’hypnose peut
favoriser un vécu de confort lors de
la ponction lombaire en permettant
au patient de s’immerger dans une
activité agréable et de se dissocier de la
sensation douloureuse ou désagréable.
A l’annonce diagnostique, les outils de
communication, à la base de l’hypnose,
peuvent générer un espace et un
temps d’écoute autorisant l’expression
émotionnelle, limitant la sidération
du diagnostic. Cela favorise alors la
projection vers un futur plus agréable
ou acceptable.
L’hypnose appartient au groupe des
thérapies brèves. Elle est en cela un
outil de psychothérapie. Elle peut
être utilisée comme outil de soutien
psychologique quelle que soit la phase
de la maladie. Elle favorise l’activation
de stratégie de « coping », qui permet
une meilleure adaptation du patient
à sa situation. Cela favorise alors une
meilleure intégration sociale, familiale
et/ou professionnelle et limite l’impact
de la maladie ou de son éventuel
handicap. L’hypnose offre au patient
la possibilité d’activer ses propres
ressources. Il subit alors beaucoup
moins les événements, il est acteur
de son propre état de santé et mieux-
être. L’hypnose favorise le processus
d’acceptation. En effet, à l’issue du
diagnostic, le patient traverse plus
aisément la phase de déni et de colère,
Hypnose et sclérose en plaques (SEP)
L’hypnose médicale est très utile
dans le contexte pathologique de
la sclérose en plaques. Dès la phase
diagnostique, elle aide le patient
à mieux accepter sa situation et
à limiter l’impact de la maladie
et de ses symptômes. Elle favorise
un meilleur état psycho-émotionnel
en activant les ressources et les
capacités d’adaptation.
Elle permet une meilleure gestion
des symptômes tels que la fatigue
et la douleur. Elle favorise alors
une meilleure qualité de vie.

14 N°145 NOVEMBRE 2015 LE COURRIER DE LA SEP
pour s’orienter vers le « faire – avec ».
Dans cet objectif, l’hypnose est un outil
qui promulgue la confi ance et l’estime
de soi.
La sclérose en plaques est également
associée à de fréquentes comorbidités
psy ch iat r iq ues , n otam m ent la
dépression qui s’avère plus fréquente
et plus sévère dans la SEP que dans
la population générale. L’hypnose,
associée à d’autres prises en charge
notamment médicamenteuse, peut
favoriser la régression des troubles
dépressifs. La gestion du stress est
facilitée par l’hypnose, les angoisses
réduites.
L’hypnose peut s’avérer très utile
également dans la gestion d’un certain
nombre de symptômes associés à la
sclérose en plaques et qui altèrent la
qualité de vie des patients. En premier
chef, les douleurs aigues ou chroniques
peuvent être mieux appréhendées en
utilisant l’hypnose. Bien sûr, comme
pour l’ensemble des symptômes et
problématique liée à la sclérose en
plaques, l’hypnose ne se substitue pas
à la prise en charge médicale classique,
notamment médicamenteuse. Elle
vient la soutenir, potentialiser son
effet et limiter les effets indésirables
en favorisant l’usage de la plus faible
posologie possible. Dans le domaine
des douleurs, le patient peut faire
l’apprentissage de l’auto-hypnose pour
mieux gérer les crises douloureuses et
améliorer sa qualité de vie.
La fatigue est un autre symptôme
très fréquent et invalidant de la SEP.
L’origine de la fatigue dans la sclérose
en plaques est très certainement
multifactorielle, faisant intervenir des
facteurs immunologiques, lésionnels
et psycho-comportementaux. Parmi
ces facteurs, le déconditionnement
à l’effort participe grandement à
l’émergence et au maintien de la fatigue
chronique ou de la fatigabilité à l’effort.
L’hypnose est un outil intéressant
dans ce contexte. En effet, l’hypnose
par son approche psycho-corporelle
permet de travailler sur les troubles
du schéma corporel. Elle favorise une
réappropriation de ce schéma et lutte
contre la perte de confi ance vis-à-vis
des capacités physiques du patient. Elle
participe alors au maintien des activités
physiques en stimulant l’estime de soi
et en augmentant le ressenti de plaisir.
Elle aide le patient à mieux gérer la
fatigue et éventuellement la diminuer.
D’autres symptômes chroniques ou
récurrents peuvent être atténués ou
soulagés en utilisant l’hypnose et
l’auto-hypnose. Sans les diminuer,
l’hypnose favorise parfois une
meilleure gestion et acceptation
de l’ensemble de ces symptômes.
Parmi ceux-ci, nous pouvons citer
les troubles sensitifs douloureux ou
non comme les picotements, les
fourmillements (appelés paresthésies
par les neurologues), les troubles du
sommeil, les troubles sexuels et vésico
sphinctériens.
L’hypnose est un outil qui facilite la
gestion du traitement médicamenteux
dans la sclérose en plaques. Que
ce soit le traitement de fond ou
symptomatique, l’hypnose peut être
utilisée pour limiter l’incidence et
l’impact des effets indésirables des
médicaments. Par exemple, elle peut
limiter les effets indésirables locaux
des traitements injectables ou atténuer
l’intolérance aux immunosuppresseurs,
notamment digestive.
D’autres symptômes chroniques ou
récurrents peuvent être atténués ou
soulagés en utilisant l’hypnose et
l’auto-hypnose. Sans les diminuer,
l’hypnose favorise parfois une
meilleure gestion et acceptation
de l’ensemble de ces symptômes.
Parmi ceux-ci, nous pouvons citer
les troubles sensitifs douloureux ou
non comme les picotements, les
fourmillements (appelés paresthésies
par les neurologues), les troubles du
sommeil, les troubles sexuels et vésico
sphinctériens.
L’hypnose est un outil qui facilite la
gestion du traitement médicamenteux
dans la sclérose en plaques. Que
ce soit le traitement de fond ou
symptomatique, l’hypnose peut être
utilisée pour limiter l’incidence et
l’impact des effets indésirables des
médicaments. Par exemple, elle peut
limiter les effets indésirables locaux
des traitements injectables ou atténuer
l’intolérance aux immunosuppresseurs,
notamment digestive.
Conclusion
L’hypnose est en plein développement
dans de nombreux domaines de
la médecine. Avec les travaux
d’ERICKSON, nous comprenons
que l’hypnose est un processus
mental tout à fait naturel, simple et
accessible à tous. Le principe général
de l’hypnose est de provoquer un état
de conscience modifi é pour mobiliser
les propres ressources de l’individu.
Elle peut se pratiquer soit sous forme
d’hypnose provoquée, accompagnée
alors par un praticien en hypnose soit
sous forme d’auto-hypnose, après une
phase d’apprentissage. C’est à la fois
un outil de soutien psychologique mais
aussi un outil aux effets corporels et
somatiques.
Dans le domaine de la sclérose en
plaques, l’hypnose a de nombreuses
applications possibles. Associée à la
prise en charge médicale classique,
l’hypnose peut être utilisée dans l’ob-
jectif de maintenir la meilleure qualité
de vie possible en luttant contre les
symptômes aigus ou chroniques et en
favorisant le processus d’acceptation
de la maladie.
Nous connaissons de mieux en mieux
les bases neurophysiologiques du
processus hypnotique. Notamment
dans le contexte de la douleur, une
activité cérébrale spécifi que a bien été
décrite. Cependant très peu d’études
se sont intéressées à l’évaluation de
son effi cacité. Une des explications à
ce manque d’études est probablement
qu’il s’agit d’une thérapie innovante,
dont le regain d’intérêt est fi nalement
assez récent. Une autre explication est
qu’il s’agit d’une pratique thérapeu-
tique totalement personnalisée et qui
ne se prête pas facilement à la mise en
protocole. Il est important de signaler
que l’hypnose est un outil thérapeu-
tique à part entière qui nécessite
d’être pratiqué par des professionnels
de santé convenablement et suffi sam-
ment formés à cette discipline.
Hypnose médicale

D O S S I E R
15
LE COURRIER DE LA SEP NOVEMBRE 2015 N°145
L’hypnose médicale
n!est pas du spectacle """
L’hypnose médicale (hypnose ericksonienne) :
• Le patient est éveillé, conscient.
• Le patient garde le contrôle de tout ce qui se passe.
• Le patient se souvient de tout ce qui se passe.
• Le patient a toute liberté pour arrêter à tout moment le processus hypno-
tique s’il ne se sent pas en sécurité pour quelle raison que ce soit.
• Utilise la permissivité et des suggestions non directives
L’hypnose de spectacle
• Un autre type d’hypnose qui utilise l’hypersug-
gestibilite présente de façon spontanée chez
environ 10 % des personnes.
• Dans ce cadre, la personne hypnotisée accepte
de lâcher prise de façon implicite pour donner
le contrôle à l’hypnotiseur.
• Utilise des suggestions directes et dirigistes.
• Aucune vertu thérapeutique.
Les points forts
L’hypnose médicale est un :
• Etat de veille intense et d’hyperfocalisation
qui mobilise les ressources et potentialités
de l’individu.
• Processus mental naturel accessible à tous
• Outil thérapeutique complémentaire simple,
utile et effi cace
• Outil utile dans toutes les phases de la Sclé-
rose en plaques
• Outil qui sert de soutien psychologique et
favorise les capacités d’adaptation
• Outil qui améliore la qualité de vie en faci-
litant la gestion des symptômes tels que la
fatigue et les douleurs
• Outil qui peut limiter les effets indésirables
des traitements médicamenteux.
• Traitement complémentaire qui en aucun
cas ne se substitue à une prise en charge
médicale classique adaptée notamment
médicamenteuse.
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES :
1. Halley J. Un thérapeute hors du commun:
Milton H Erickson. Ed Desclée de Brouwer
(2007).
2. Varin D et al. Hypnose et neurologie. La
Lettre du Neurologue. N°7. Sept 2013.
199-202.
3. Vanhaudeuhuyse et Al. Pain and
Non-pain processing during hypnosis/a
thullium-YAG event-related fMRI study.
Neuroimage. 2009; 47 (3) 1047-54.
4. Rainville P et al. Hypnosis modulation
activity in brain structures involved in
the regulation of consciousness. J Cogn
Neurosci 2002 (14): 887-901.
5. Crawford Hj. Neuropsychophysiology
of hypnosis :towards an understanding
of how hypnotic interventions work. In:
International handbook of clinical Hypno-
sis. John Wiley and Sons. 2001: 61-82.
6. Demertzi et al. Hypnotic modulation of
resting state fMRI default mode and
extrinsic network connectivity. Prog Brain
Res 2011 (193) 309-22.
7. Kupers et Al. The cognitive modulation
of pain: Hypnosis and placebo induced
analgesia. Prog Brain Res. 2005 ; 150:
251-69.
8. Rainville P et al. Pain affect encoded in
human anterior cingulate but not somo-
tasensory cortex. Science. 1997(277) 968.
9. Faymonville ME, Boly M, Laureys S. Func-
tional neuroanatomy of hypnotic state.
J physiol Paris 2006; 99 (4-6) :463-9.
10. Rainville P et Al. Cerebral mechanisms
of hypnotic induction and suggestion. J
Cogn Neurosci 1999; (11) 110-25.
POUR EN SAVOIR PLUS
Deux sites internet recommandes :
le site de la confédération
francophone d’hypnose et
thérapies brèves
HTTP://WWW.CFHTB.ORG/
Le site de l’institut Emergences,
un des principaux instituts de
formation et de recherche en
hypnose de France.
HTTP://WWW.HYPNOSES.COM/
1
/
5
100%