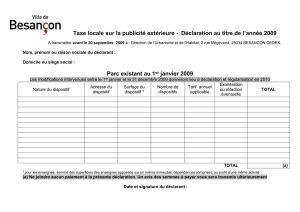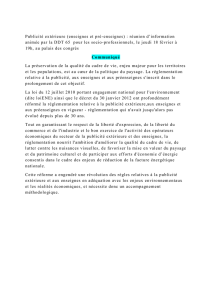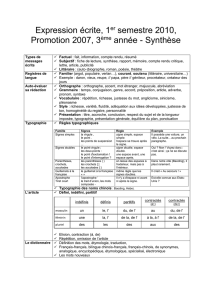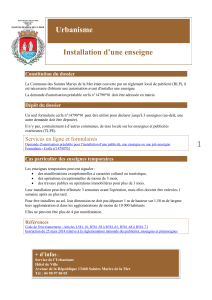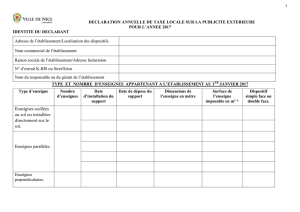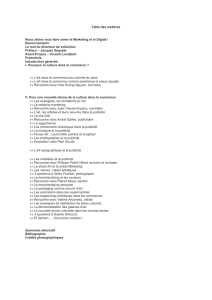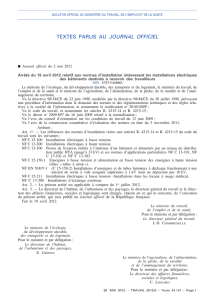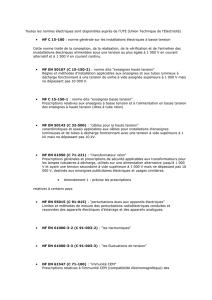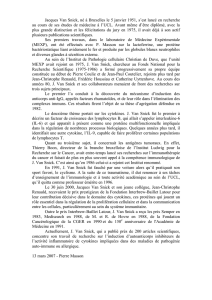les AvAnt-gArdes et lA Métropole

9/82
Architecture et Typographie
Les avant-gardes et lamétropole
Sonia de Puineuf
Lorsque l’historien del’art étudie lapériode desannées 1920 et 1930,
ens’intéressant deprès auxavant-gardes, ilne peut manquer deconstater
uneconfusion permanente entre l’utopie et laréalité, autrement dit entre
leprojet et laréalisation effective d’une œuvre. Cela est particulièrement
vrai dans ledomaine del’architecture oùlediscours critique développé
parl’avant-garde sur ledessin oulamaquette d’architecture tend souvent
àocculter lecaractère virtuel del’objet. Ainsi, leMonument
àlaIIIeInternationale deVladimir Tatline, qui n’a pourtant jamais dépassé
lestade delamaquette, est-il vigoureusement comparé par lesjeunes
Tchèques dugroupe avant-gardiste Devětsil àlatour Eiffel 1 ; demême,
leprojet deLudwig Miesvander Rohe pour ungratte-ciel sur
laFriedrichstrasse àBerlin est-il reproduit dans
denombreuses revues progressistes comme
s’ils’agissait d’uneconstruction qui allait être
réalisée sous peu. Deceva-et-vient permanent
entre l’intention artistique et
sonaccomplissement résulte l’image d’unmonde
dynamique oùleprésent et lefutur seconfondent 2.
Il est particulièrement intéressant d’aborder sous cetangle
les« enseignes » desavant-gardes, c’est-à-dire lesprojets debâtiments et
d’édicules destinés àlasphère commerciale et publique, rêvés ouréalisés
par lesartistes et lesarchitectes progressistes. Cesconstructions ont
laparticularité deprésenter uneapparence formelle complexe qui met
enjeu, mieuxque dans tout autre type d’œuvre, lecroisement deplusieurs
disciplines artistiques (architecture, peinture, typographie). Enoutre,
émergeant simultanément dans plusieurs villes européennes,
ellespermettent delocaliser sans ambiguïté lespoints d’ancrage
del’avant-garde entre lesdeux
guerres.
1. Dans Život. Sborník nové krásy, Prague, Odbor
Umělecké Besedy, 1922.
2. Aujourd’hui, cettemanière deprésenter
destravaux d’architecture est privilégiée par
denombreux architectes, dont Jean Nouvel. Dans
l’exposition qui lui était consacrée auCentre
Pompidou en 2001-2002, lesprojets lauréats et
lesprojets perdants étaient exposés sans
distinction. C’est ainsi que sonprojet deTour sans
fin s’est matérialisé dans l’imaginaire collectif.
LES
AVANT-GARDES
ET LAMÉTROPOLE
Sonia
de Puineuf

10/82
Architecture et Typographie
Les avant-gardes et lamétropole
Sonia de Puineuf
Les enseignes comme expérience
artistique pluridisciplinaire
Pour comprendre lagenèse deceskiosques et autres bâtisses, ilfaut
remonter aux espaces Proun d’ElLissitzky, artiste engagé, plus que tout
autre, dans lapropagation del’art
progressiste russe enEurope
centrale et occidentale. Lesespaces
Proun posent clairement laquestion
fondamentale durapport entre
l’espace (Raum) et letableau / image
(Bild), celui-ci étant
traditionnellement appréhendé
comme unesurface. L’organisation
dynamique del’espace Proun, qui
opère avec desmurs peints et
despanneaux enrelief, permet, selon l’ambition affichée deLissitzky,
d’esquisser latransformation delapeinture enarchitecture : « Prounest
lastation dechangement delapeinture àl’architecture 3. »
C’est précisément celien étroit entre l’image
et l’architecture qui caractérise lespremiers
projets architecturaux deLajos Kassák, artiste
hongrois très tôt informé del’art deLissitzky. Kassák présente sesprojets
sous leterme de« Bildarchitektur » (architecture-image) qu’ilalui-même
forgé en 1921 encommentant unalbum graphique deSándor Bortnyik.
Dans seslithographies, Bortnyik élaborait descompositions deformes
abstraites aux coloris très délicats ponctuées dequelques lettres
del’alphabet. Cesformes élémentaires, préfigurations duvocabulaire
plastique duconstructivisme hongrois, traduisaient l’ambition
de« produire quelque chose àpartir dunéant 4 », defaire apparaître
« l’harmonie existant entre l’homme et l’univers 5 ». En 1922, Kassák semit
luiaussi àproduire desarchitectures-images clairement situées dans
lalignée deProun : « Lesuprématisme amis
“ledernier point sur lalettre i dans lapeinture”.
Etl’architecture-image tente, avec laforce
énergique deProun, sespremiers pas vers
unearchitecture entant qu’art unique, matériel et
spirituel, deconstruction collective. Laforce
del’architecture-image, comme delavie même, est donnée par
lemouvement. Toutefois, elle-même représente déjà lerésultat
dumouvement —lastabilité 6. » Eneffet, laplupart desdessins deKassák
sont descompositions stables dont
leséléments sontorganisés selon
lesaxes horizontal et vertical.
El Lissitzky, Projet pour unespace Proun, 1923
3 El Lissitzky et Hans Arp,
DieIsmen. LesIsmes. TheIsms,
Erlenbach / Zurich / Munich /
Leipzig, Eugen Rentsch Verlag, 1925, p. XI.
4 Lajos Kassák, dans lapréface deSándor
Bortnyik, album 19MA21, 1921 ; cité in
CharlesDautrey et Jean-ClaudeGuerlain,
L’Activisme hongrois, Montrouge, Goutal-Darly,
1979, p. 161.
5 Sándor Bortnyik, Magyar Irás, 1922 ; cité
enfrançais in idem.
6 Lajos Kassák, « Bildarchitektur », Ma, 1922,
VIII, nº 1, non paginé.

11/82
Architecture et Typographie
Les avant-gardes et lamétropole
Sonia de Puineuf
Ladiagonale intervient rarement.
Levocabulaire plastique s’y réduit
aucercle, aucarré, aurectangle,
autriangle et àlaligne droite. Dans
certaines images, Kassák introduit
aussi deslettres dont laprésence
sejustifie demanière très rationnelle
lorsque lescompositions
s’apparentent àdesprojets
architecturaux. Leslettres forment
alors desmots qui s’apparentent
àdesslogans publicitaires. Ilen va
ainsi, par exemple, d’une gouache
de1923 intitulée Architecture-image,
projet dekiosque. Leskiosques
deKassák sont véritablement
unetentative d’interpréter l’espace
Proun envolume, c’est-à-dire
d’imaginer unextérieur qui, par
l’organisation desesdifférents éléments, serait unéquivalent desintérieurs
deLissitzky. Kassák propose unecomposition architecturale faite deboîtes
—quis’apparentent àdesabris— et depanneaux qui n’ont pas d’autre
fonction que d’accueillir lacouleur et l’écriture 7. Del’encastrement
complexe decesdeux types devolumes résulte
unespace dynamique dans lesens oùilne peut
être appréhendé dans satotalité que si levisiteur
enfait letour complet. L’effet final est àcomparer
aux dessins deconstructions fictives que
Lissitzky présente dans sonlivre Histoire suprématiste de deux carrés en six
constructions, publié en 1922 àBerlin 8. Enconstruisant cetteboîte éclatée
et réorganisée, Kassák serapproche également deladémarche
contemporaine desarchitectes dugroupe DeStijl, dont larevue, ilne faut
pas l’oublier, apublié l’intégralité dulivre De deux carrés entraduction
néerlandaise.
Si Kassák choisit deregrouper sesprojets sous
leterme générique d’architecture- image, c’est bien
qu’ils’agit deconfronter l’architecture àlapeinture ;
cettedernière est suggérée par uneforte présence
delacouleur, cequi relie directement leskiosques
deKassák auxthéories architecturales embryonnaires
Lajos Kassák, Architecture-image, projet dekiosque, 1923
7 Cettecomposition rappelle également
unecouverture delarevue Maconçue par
HenrikGlauber en 1922. L’artiste y joue avec
leslettres dutitre enlesrapprochant
d’architectures modernes.
8 El Lissitzky, De deux carrés, Berlin,
Les Seytes, 1922.
Theo Van Doesburg, Construction
des couleurs danslaquatrième
dimension del’espace-temps, 1924

12/82
Architecture et Typographie
Les avant-gardes et lamétropole
Sonia de Puineuf
deTheoVan Doesburg 9. Lechoix même
descouleurs (les trois primaires complétées par
legris, lenoir et leblanc) est largement redevable
auxpeintures néoplastiques dePiet Mondrian,
elles-mêmes àlabase delaréflexion dugroupe
DeStijl sur lacouleur dans l’architecture. Ainsi,
dans leurmanifeste, Vers uneconstruction
collective, lesmembres deDeStijl soutiennent :
« Nousavons donné lavraie place àlacouleur dans l’architecture et nous
déclarons que lapeinture séparée delaconstruction architecturale
(c’est-à-dire letableau) n’a aucune raison d’être 10. » L’insertion delacouleur
dans l’architecture participe donc àrendre caduque l’existence,
sicontestée par lesconstructivistes, dutableau dechevalet. Lesmurs
deviennent lesupport privilégié del’expression plastique, ilssont enmême
temps l’architecture et l’image ; lacouleur devient
alors « matériau deconstruction 11 ».
VanDoesburg endonnera unebrillante
démonstration en 1926-1928 lorsque,
encollaboration avec Hans et Sophie Arp,
ilréalisera ledécor ducinéma-dancing L’Aubette
àStrasbourg, dont lerésultat fut un« espace
oblique sur-matériel et pictural 12 ».
L’apparence formelle deslettres
apparaissant sur lesfaçades
desprojets deKassák est elleaussi
héritée del’enseignement
deVanDoesburg.
Lesarchitectures-images peuvent
être rapprochées d’une carte postale
contemporaine conçue par Farkas
Molnár àl’occasion del’exposition
duBauhaus deWeimar, oùMolnár
était alors étudiant. Latypographie
bien particulière utilisée par lesdeux
artistes est celle que Theo Van
Doesburg préconisait en 1921 lors deses conférences subversives
deWeimar : l’idée était dedessiner deslettres selon unegrille orthogonale
ne reconnaissant que leslignes horizontales et verticales, conformément
aux tableaux deMondrian. Cechoix formel strict, qui sera critiqué dès 1923
par László Moholy-Nagy 13, représente lepremier effort desavant-gardes
13 László Moholy-Nagy, « Dieneue
Typographie », in Staatliches Bauhaus in Weimar
1919-1923, Weimar / Munich, Bauhausverlag,
1923, p. 141.
à gauche : Farkas Molnár, carte postale pour l’exposition du Bauhaus,
Weimar (Bauhausausstellung), 1923
à droite : Theo Van Doesburg, projetd’alphabet, 1919
9 En 1922, larevue Mapublie unnuméro
spécial dédié àDeStijl dans lequel est également
reproduit l’article « L’architecture entant qu’art
synthétique » deTheo Van Doesburg. Voir
Krisztina Passuth, « TheoVanDoesburg et
lemouvement d’avant-garde hongrois »,
inSergeLemoine (dir.), TheoVanDoesburg,
Paris, Philippe Sers, 1990, p. 165. Concernant
lesriches échanges entre lesartistes hongrois
delarevue Maet lesartistes néerlandais
deDeStijl, voir aussi Avant-Garde hongroise
1915-1925, Bruxelles, BBL & Brepols Publishers,
1999.
10 Theo Van Doesburg, Cornelius Van Eesteren
et GerritRietveld, Versuneconstruction collective,
tract distribué àl’exposition «L’Architecture et
lesarts quis’yrattachent», Paris, Écolespéciale
d’architecture, 1924.
11 Theo Van Doesburg, cité par Yve-Alain Bois,
«“L’idée” DeStijl», in DeStijl et l’architecture
enFrance, Liège, Mardaga, 1985.
12 Theo Van Doesburg cité parSergio Polano,
« TheoVanDoesburg, théoricien del’architecture
comme synthèse desarts », inSerge Lemoine
(dir.), Theo Van Doesburg, op.cit., p. 131.

13/82
Architecture et Typographie
Les avant-gardes et lamétropole
Sonia de Puineuf
pour redéfinir, ensimplifiant et enépurant laligne constitutive
descaractères alphabétiques, leslois delatypographie moderne.
Lapolice imaginée par VanDoesburg est exclusivement composée
delettres majuscules. Elletend àunhaut degré d’abstraction et souffre,
dece fait, d’unmanque delisibilité. Sarigidité constructive aboutit,
pourcertaines lettres, àunrésultat peu harmonieux : par exemple, leB et
leR affichent unréel problème deproportion et d’équilibre tandis queleD,
leO et leS perdent leurscourbes caractéristiques 14. Malgré
cesimperfections, onpeut sedemander dans quelle mesure l’apparition
decetteécriture dans lesprojets architecturaux progressistes
aconditionné latypographie desfutures enseignes avant-gardistes.
On connaît lecombat delaNouvelle
Typographie pour uneécriture universelle 15, que
lesartistes cherchent àdéfinir àpartir desformes
minuscules deslettres del’alphabet latin.
Tributaire delarapidité delalecture, lenouvel
imprimé del’ère delacommunication doit offrir
unelisibilité maximale. Ils’agit aussi, grâce
àlaminuscule, deremettre encause lesrègles orthographiques arbitraires
ayant provoqué unéloignement entre l’écriture et lalangue parlée 16.
Toutefois, si l’on observe lesmots affichés sur lesfaçades desédifices
conçus par cettemême avant-garde
internationale, onne peut qu’être
frappé par laprésence quasi
permanente demajuscules.
L’exemple leplus intrigant est
lebâtiment duBauhaus deDessau,
construit par Walter Gropius en
1925-1926. Àcettedate, laréflexion
sur l’écriture universelle est déjà bien
avancée : Herbert Bayer, professeur
auBauhaus, travaille demanière
intense sur lesujet. Pourtant, l’enseigne del’école n’en porte que peu
demarques. Certes, latypographie choisie est unelinéale souple qui
correspond àl’idéal delaGrotesk desannées 1920 enmême temps qu’elle
s’éloigne delarigidité formelle doesburgienne. Mais ils’agit malgré tout
demajuscules, qui sont aumême moment critiquées avec virulence
ausein même del’école 17.
Loin d’être unparadoxe, cechoix délibéré
permet dedistinguer lesupport mural propre
Walter Gropius, bâtiment duBauhaus, Dessau, 1925
14 Àl’occasion deson travail sur L’Aubette,
VanDoesburg conçoit unetable d’orientation
utilisant cetalphabet. Ilen améliorera alors
leslettres « problématiques ».
15 Voir àcepropos notre article
« Aucommencement était l’alphabet.
L’avant-garde internationale enquête delalangue
universelle, 1909-1939 », Cahiers duMNAM
(Paris), nº102, hiver 2007-2008, p. 36-63.
16 Rappelons que, dans l’écriture allemande,
lapremière lettre detous lessubstantifs
secompose encapitale.
17 Gropius exprimait quelques réserves ausujet
duprogramme radical derefonte del’alphabet et
del’écriture : « L’élimination descapitales [initiée
par] desférus desnormes […] ne doit pas être
prise ausérieux », écrivait-il le10 juillet 1926
dansPapierzeitung. Cité par UteBrüning,
« Herbert Bayer », inJeannine Fiedler et
PeterFeierbend (dir.), Bauhaus, Cologne,
Könemann, 2000, p. 336.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
1
/
13
100%