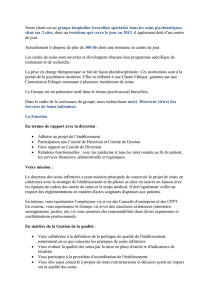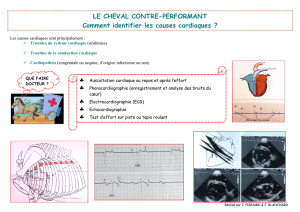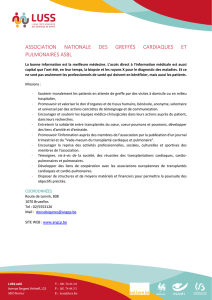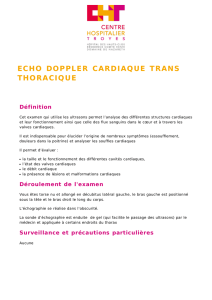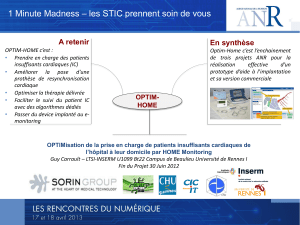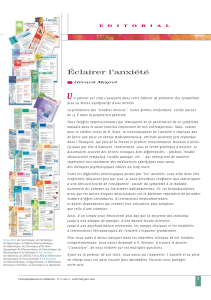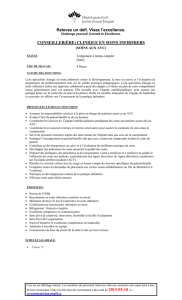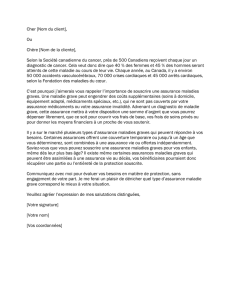l`utilisation de la recherche dans la pratique clinique

Nicole Parent, MSc, Institut de Cardiologie de Montréal
Fabienne Fortin, PhD, Faculté des Sciences Infirmières, Université de Montréal
L’UTILISATION DE LA RECHERCHE DANS LA PRATIQUE CLINIQUE :
PROGRAMME DE PARRAINAGE
À
L’INTENTION DE PATIENTS CARDIAQUES
RÉSUMÉ
l’utilisation de la recherche dans la
pratique clinique :
Programme de parrainage à l’intention
de patients cardiaques
La recherche vise l’acquisition de connaissances et
le transfert de celles-ci dans la pratique. Les
connaissances qui intéressent les infirmières sont
celles qui sont pertinentes à l’amélioration de la
pratique des soins. Avant d’initier un changement
dans la pratique clinique à partir des résultats de
recherche, il importe de considérer certains critères
rigoureux qui servent de guide à une prise de déci-
sion éclairée quant à l’adoption ou non de tels
résultats.
À
l’aide d’un exemple en soins infirmiers,
portant sur une intervention de soutien à l’intention
de patients cardiaques, cet article présente I’appli-
cation
d’un modèle d’utilisation de résultats de
recherche. Le modèle comporte six phases à l’appui
d’un jugement critique sur la valeur d’un travail
scientifique : la préparation, la validation, I’évalua-
tion comparative, la prise de décision,
I’adapta-
tion/application et l’évaluation. Chacune des phases
fait état de l’application des critères du modèle, non
seulement aux résultats, mais à l’ensemble de la
démarche de recherche suivie par l’auteur. Ce
modèle d’utilisation de la recherche peut fournir à
l’infirmière des moyens de proposer des change-
ments dans la pratique, basés sur les connaissances
qui émanent de la recherche.
Mots clés : intervention de soutien
-
recherche
-
uti-
lisation des résultats
-
modèle de STETLER
SUMMARY
Use of research in the clinical
practice support programme for the
benefit of heart patients
The research aims at the acquisition of knowledge
and its application in the practice. The knowledge
which most interests the nurses is the one pertaining
to the improvement of nursing practice. Before ini-
tiating a change in the clinical practice on the basis
of the research results, it is important to consider
some rigorous criteria which
Will
provide
guidance
to an enlightened decision as to whether
such
results should be adopted or not. With the help of
an example of nursing
tare
concerning a support
programme for the
benefit
of heart patients, this
article presents the application of a
mode1
of use of
research results. The
mode1
consists
of six phases in
support of a critical judgement on the value of a
scientific work : preparation, validation, compara-
tive evaluation, decision making, adoption/applica-
tion and evaluation.
Each
of these phases states the
application of the
mode1
criteria, not only to the
results, but to the whole research processes follo-
wed by the author. This
mode1
of research use
cari
provide the nurse with means of proposing changes
in the practice, based on the knowledge issuing
from research.
Key words : support programme
-
research
-
use of
the results
-
STETL ER
mode/
50
Recherche en soins infirmiers N” 57 -Juin 1999

L’UTILISATION DE LA RECHERCHE DANS LA PRATIQUE CLINIQUE :
PROGRAMME DE PARRAINAGE A L’INTENTION DE PATIENTS CARDIAQUES
La recherche dans une discipline professionnelle vise à la
fois le développement des connaissances et le transfert de
celle-ci vers la pratique des soins. Le concept d’utilisation
de la recherche fait référence non seulement à
I’applica-
tion des résultats dans la pratique mais aussi à l’utilisation
de nouvelles connaissances découlant de la recherche. II
s’agit d’un processus complexe qui exige une série d’acti-
vités partant de l’identification de recherches susceptibles
de résoudre des problèmes de soins infirmiers à leur
implantation dans la pratique et à leur évaluation. Ce
pre
cessus
implique la critique de travaux de recherche
publiés portant sur la description, l’explication ou la pré-
diction de phénomènes infirmiers, lequel processus permet
d’apprécier la valeur scientifique et la pertinence clinique
d’implanter un changement dans un milieu de soins.
Avant de considérer tout changement ou innovation
dans la pratique infirmière provenant d’articles de
recherche rapportant des résultats bénéfiques pour les
patients, il importe de considérer, dans le processus
d’utilisation, certains critères d’application en procé-
dant à une analyse critique à l’appui d’une prise de
décision éclairée. II existe un certain nombre de
modèles et de théories susceptibles de faciliter I’éva-
luation rigoureuse d’une recherche et qui proposent
des stratégies de transfert des connaissances à la pra-
tique clinique (Horsley et coll. 1983; Krueger et coll.
1978; Rogers (1983) Stetler et Marram 1976; Stetler,
(1994). Cet article vise à décrire, à l’aide d’un de ces
modèles, celui de Stetler, une démarche d’application
dans la pratique clinique des résultats d’une étude
effectuée auprès de patients cardiaques et portant sur
le soutien vicariant comme intervention de soutien.
Le modèle d’utilisation des résultats de recherche mis au
point par Stetler (1994) fournit un cadre compréhensif
qui met en relief le transfert dans la pratique des résultats
de recherche par les infirmières. Le modèle vise à guider
l’infirmière consommatrice de la recherche à évaluer
dans quelle mesure les recherches publiées possèdent
les critères d’application et comment les résultats
peu-
Phase
I
: Phase II :
Préparotion Volidotion
Énoncé des
résultats Phase Ill
Évolution
-
Figure 1. Adaptation du modèle d’utilisation de la recherche de Stetler
Source : Stetler
C.E.,
Nuning
Outlook,
Jan&$v. 1994
vent être utilisés dans la pratique des soins. Le modèle
proposé comporte six phases à l’appui d’un jugement
critique sur la valeur d’un ouvrage scientifique : (1) la
préparation, (2) la validation, (3) l’évaluation compara-
tive, (4) la prise de décision, (5) I’adaptation/application,
et (6) l’évaluation (figure 1).
Les phases du modèle de Stetler ont servi à examiner
l’application des résultats d’une recherche effectuée
par Parent (1997). L’étude, menée auprès de patients
admis à l’hôpital pour subir une chirurgie de
revascula-
risation coronarienne, avait pour but d’évaluer I’effica-
cité d’une intervention de soutien sur l’anxiété, la per-
ception d’auto-efficacité et la reprise des activités
physiques. L’intervention de soutien était offerte par
d’anciens patients ayant déjà subi une chirurgie de
revascularisation coronarienne lesquels servaient de
modèles aux nouveaux patients. L’intervention de sou-
tien offert par un ancien patient modèle se présentait
sous la forme de visites auprès des nouveaux patients,
soit la veille de la chirurgie, le
5(ième)
jour
post-opéra-
toire et à la 4(ième) semaine post-opératoire. Une
étude expérimentale à deux groupes randomisés avec
mesures avant et après l’intervention a été effectuée
auprès de 55 sujets âgés de 40 à 69 ans. La variable de
l’anxiété situationnelle a été mesurée à l’aide de
l’échelle d’anxiété de Spielberger, Gorsuch et Lushene
(1970). Les perceptions d’auto-efficacité et l’exécution
des activités physiques ont été mesurées respective-
ment par les échelles élaborées par Jenkins (1989).
Des analyses de variante à mesures répétées et des
tests de t de Student ont permis de vérifier l’évolution
des variables dépendantes à l’intérieur des groupes et
entre les deux groupes aux divers temps d’évaluation
(24 heures pré-op, 5 jours et 4 semaines post-op). Les
résultats ont révélé une différence significative
(p
<
O,O5)
en faveur du groupe expérimental pour les
scores de l’anxiété et ce à tous les temps de mesure.
Des analyses réalisées en
post
hoc ont démontré que
seul le groupe expérimental a subi une diminution
Phase IV :
Prise de Phase V
Adoptotion/ Phase VI :
Évoluotion
Décision
Bases pour
\
la pratique
Impact du
changement
et
1
retorder
0
31
l-1
Appiitotion
Recherche en soins infirmiers
No
57. Juin 1999

significative
(p
< 0,02) de l’anxiété au cours de la
période de l’hospitalisation. Quant à la perception
d’auto-efficacité et à l’accomplissement des activités
physiques, les résultats révèlent une différence signifi-
cative
(p
<
0,05) en faveur du groupe expérimental au
niveau de toutes les activités évaluées à 5 jours post-
opératoire, ainsi qu’au niveau des activités générales à
4
semaines post-opératoires. Les résultats de cette
étude suggèrent que ce modèle de soutien, mis au
point par des infirmières, semble bénéfique aux
patients durant la période de réadaptation compte tenu
de la diminution de l’anxiété, de l’augmentation de
l’efficacité perçue et de l’accomplissement des activi-
tés. Des recommandations pour la pratique et la
recherche infirmière ont été présentées.
Le contenu de la recherche doit être évalué selon des
fondements scientifiques et de pertinence. Le modèle
de Stetler situe l’utilisateur des résultats de recherche
dans la pratique dans une démarche consciente d’ana-
lyse critique qu’il atteint à travers les six phases du
modèle décrites ci-après.
PHASE
I
: LA PRÉPARATION
La phase de préparation vise à préciser le but visé par
l’utilisateur qui désire initier une démarche de
recherche d’idées innovatrices et à déterminer le motif
du changement qu’il veut apporter. II peut s’agir, par
exemple de résoudre un problème clinique particulier,
de maintenir un niveau de connaissance de pointe
dans un champ de pratique spécialisé, ou encore de
revoir une procédure ou un programme d’enseigne-
ment en vue d’une application clinique. Peu importe
la raison qui justifie le recours à des écrits scientifiques,
toute recherche, qu’elle soit descriptive, corrélation-
nelle
ou expérimentale peut servir à fournir des
connaissances nouvelles et une direction éclairée pour
la pratique clinique.
L’application de la première phase du modèle de
Stetler au contexte de l’étude portant sur le soutien
vicariant auprès de patients cardiaques, a servi à justi-
fier les raisons motivant la recherche d’un programme
de soutien applicable à une situation spécifique de
soin auprès de patients cardiaques. Un haut niveau
d’anxiété pré et post-opératoire des patients en attente
d’une chirurgie cardiaque avait été observé ainsi
qu’une crainte manifestée envers leur capacité éven-
tuelle de reprise de leurs activités régulières. Le but
visait à faire bénéficier tous les patients cardiaques de
connaissances découlant de cette recherche.
PHASE II : LA VALIDATION
En ce qui a trait à la phase de validation, elle consiste à
évaluer les forces et les faiblesses de l’étude et à déter-
miner si les limites présentes invalident les résultats et
les conclusions de l’étude. Chaque étape du processus
de la recherche est scrutée. Les études comportant
d’importants biais ou encore les études sans appui
théorique ne sont pas à retenir. La décision ici consiste
à accepter ou à rejeter une étude sur la base de critères
rigoureux en regard de la généralisation des résultats.
La phase de validation a permis d’apprécier de façon
critique les forces et les faiblesses de l’étude pour I’en-
semble des étapes suivies dans la réalisation de la
recherche sur l’efficacité d’une intervention de soutien.
De façon spécifique, l’analyse critique a porté sur le
problème et la théorie sous-jacente, les divers éléments
de la méthode, les résultats et leur interprétation selon
des critères d’analyse proposés par Fortin, (1996). Les
bénéfices d’une telle intervention de soutien utilisant
l’expérience vicariante auprès de patients de chirurgie
cardiaque ont été démontrés dans l’étude de Parent
(1997). Aux deux premières phases, il importe de for-
muler une conclusion sous la forme d’un énoncé résu-
mant les résultats de recherche reconnus pour être
bénéfiques aux patients. Les interventions qui condui-
sent à des changements désirés peuvent être mieux
compris s’ils sont expliqués dans le contexte théorique
en regard des changements anticipés.
En appliquant ces principes à la recherche proposée, il
ressort de l’analyse que le problème décrivant les diffi-
cultés pré et post-opératoires des patients cardiaques
était bien cerné et intégré dans un cadre théorique
pouvant expliquer les relations entre la variable
inter-
vention de soutien et les variables dépendantes
anxiété, efficacité perçue et reprise d’activités. Le cadre
théorique de l’étude se situe dans le contexte de la
théorie de l’auto-efficacité de
Bandura
(1977). Selon
cette théorie, la perception qu’a un individu de ses
capacités à exécuter une activité influence et déter-
mine son niveau de motivation et son comportement.
La théorie de l’auto-efficacité permet ainsi de prédire
la manifestation d’un comportement. Bandura postule
que les personnes cherchent à éviter les situations et
les activités qu’ils perçoivent menaçantes, mais s’enga-
gent à exécuter des activités qu’elles se sentent aptes à
accomplir. L’expérience vicariante, ou l’opportunité
d’observer un individu, similaire à soi-même, exécuter
un comportement donné, constitue une source d’infor-
mations importantes influençant la perception d’auto-
efficacité. Si une personne observe qu’un comporte-
ment adopté par d’autres réussit, cette constatation
augmente la tendance de la personne à se comporter
de la même façon. L’intervention de soutien, offerte
par des anciens patients modèles, utilisant l’expérience
vicariante avait ainsi pour objectif d’augmenter la per-
ception d’auto-efficacité des patients, favoriser la
52
Recherche en soins infirmiers
N”
57
-
Juin 1999

L’UTILISATION DE LA RECHERCHE DANS LA PRATIQUE CLINIQUE :
PROGRAMME DE PARRAINAGE A L’INTENTION DE PATIENTS CARDIAQUES
reprise des activités physiques et diminuer l’anxiété
entourant l’expérience d’une première chirurgie car-
diaque. Trois hypothèses relatives aux positions théo-
riques et aux résultats empiriques ont été formulées.
Ces hypothèses ont permis de vérifier l’efficacité de
l’intervention de soutien par un ancien patient modèle
auprès des patients devant subir une chirurgie car-
diaque. Les hypothèses de recherche reflètent les rela-
tions anticipées entre l’intervention de soutien et les
trois variables dépendantes de l’étude soit : l’anxiété,
la perception d’auto-efficacité et la reprise des activités
de réadaptation. Elles sont : HI : les patients qui reçoi-
vent l’intervention de soutien de la part d’un ancien
patient modèle obtiennent des scores plus bas à
l’échelle d’anxiété situationnelle que les patients sou-
mis aux soins usuels; H2 : les patients qui reçoivent
l’intervention de soutien de la part d’un ancien patient
modèle obtiennent des scores plus élevés aux échelles
d’auto-efficacité pour a) les activités de réadaptation,
b)
la marche, et
c)
l’activité de monter les marches
d’un escalier, que les patients soumis aux soins usuels;
H3 : les patients qui reçoivent l’intervention de soutien
de la part d’un ancien patient modèle obtiennent des
scores plus élevés aux échelles d’exécution des activi-
tés physiques pour a) les activités de réadaptation,
b)
la
marche, et
c)
l’activité de monter les marches d’un
escalier, que les patients soumis aux soins usuels.
Les deux phases décrites ci-dessus permettent de for-
muler un énoncé sur les résultats de recherche obtenus
relativement au soutien vicariant. L’énoncé peut se for-
muler comme suit :
«Une intervention de soutien par
un ancien patient modèle a contribué, par l’expérience
vicariante, à diminuer l’anxiété, à augmenter la per-
ception d’auto-efficacité et à favoriser la reprise des
activités physiques au cours de la réadaptation après la
chirurgie cardiaque».
PHASE
Ill
:
1
‘ÉVALUATION COMPARATIVE
La phase d’évaluation comparative comprend les
quatre composantes critiques suivantes : l’adaptabilité
au milieu, la faisabilité, les bases pour la pratique et la
preuve scientifique. L’adaptabilité au milieu consiste à
comparer les caractéristiques de l’échantillon de
l’étude à celles de la population qui bénéficiera de ces
soins. L’environnement est également examiné en rela-
tion avec le milieu, l’organisation et le personnel. La
faisabilité concerne les risques éthiques, les
contraintes, le temps, l’effort et les coûts d’implantation
ou encore les ressources additionnelles nécessaires à
l’application des résultats de la recherche. Par
exemple, devons-nous impliquer différents
interve-
nants dans ce processus d’application
3
Les personnes
concernées sont-elles prêtes à mettre en place un tel
programme de parrainage? Le troisième aspect à consi-
dérer dans l’évaluation comparative a trait aux fonde-
ments pour la pratique, les bases théoriques sur les-
quelles s’appuient l’intervention. II est important de
situer les résultats de l’étude dans le contexte du cadre
théorique dans le nouveau milieu. Le modèle théo-
rique utilisé dans l’étude s’harmonise-t-il avec celui qui
prévaut dans le milieu
?
La preuve scientifique permet
de comparer les résultats obtenus de l’étude avec les
résultats d’autres études empiriques menées dans des
situations similaires. Les résultats obtenus de l’étude
sont-ils supportés par d’autres études?
Dans la phase de l’évaluation comparative sur I’effica-
cité d’une intervention, les caractéristiques de la popu-
lation visée par l’application du changement ont été
analysées. La population visée correspondait exacte-
ment à celle de l’échantillon de l’étude de Parent
(1997). La faisabilité d’application des résultats était
également satisfaite
: l’implantation d’une telle inter-
vention de soutien a nécessité la participation de
quelques bénévoles et la coordination par une infir-
mière responsable du projet. Aucun coût n’y était asso-
cié à l’exclusion de la coordination par l’infirmière. Les
trois ex-patients initialement impliqués dans l’étude
consentirent à offrir bénévolement ce service de sou-
tien. Le cadre théorique de l’apprentissage par I’obser-
vation et de l’expérience vicariante était compatible
avec le modèle conceptuel utilisé dans le milieu de
pratique, soit, celui d’Orem.
Selon Orem
(1991),
les soins infirmiers visent à aider
la personne à surmonter ses limites en regard des
actions d’auto-soins. L’auto-soin est une action entre-
prise par une personne dans le but de maintenir sa vie
et sa santé, de se rétablir d’une maladie ou de blessures
ou de s’adapter aux différentes conséquences reliées à
des problèmes de santé. Le rôle de l’infirmière consiste
à amener la personne à adopter une attitude respon-
sable face à ses actions d’auto-soins selon divers
modes d’assistance : agir, guider, soutenir, procurer un
environnement favorisant le développement de la per-
sonne et enseigner. Une intervention de soutien offerte
par des anciens patients modèles fournit un mode
d’apprentissage par l’observation et constitue en soi
une forme d’auto-prise en charge pour les patients.
L’infirmière qui rend possible cette intervention de sou-
tien contribue à guider et à procurer un environnement
favorable au développement de la personne.
Avant d’apporter des changements dans les méthodes
de pratique, il faut s’assurer que la recherche s’appuie
sur des résultats similaires rapportés dans d’autres
études. C’est ce qui constitue la preuve scientifique.
Ainsi, de nombreux écrits ont souligné l’importance
d’impliquer d’anciens patients comme modèles auprès
53
Recherche en soins infirmiers
N”
57
-
Juin 1999

de leurs pairs, futurs opérés, et la nécessité d’élaborer
des interventions de soutien pour cette période difficile
de la réadaptation (Lepczyk, Raleigh et Rowley, 1990;
Miller et Shada, 1978). Des résultats bénéfiques pour
les patients ont été rapportés dans les écrits à la suite
d’interventions similaires obtenus auprès d’autres
clientèles (Rose, 1992; Vachon et al., 1980).
PHASE IV : LA PRISE DE DÉCISION
La phase de la prise de décision comporte les quatre
options suivantes : utiliser les résultats de recherche,
envisager leur utilisation, retarder leur utilisation ou
rejeter leur utilisation. L’utilisation des résultats de
recherche concerne l’application dans l’immédiat des
résultats dans la pratique clinique. Cette application
peut se réaliser selon trois formes : cognitive, instru-
mentale et symbolique. L’application cognitive, selon
Stetler (1994) est un moyen de modifier une façon de
penser ou d’apprécier une conséquence. Aussi, I’appli-
cation
cognitive peut fournir une meilleure compré-
hension d’un phénomène, permettre l’analyse de pra-
tiques dynamiques ou améliorer les habiletés à
résoudre des problèmes cliniques. L’application instru-
mentale implique l’utilisation directe des connais-
sances pour appuyer le besoin de changement dans les
interventions infirmières. L’application symbolique sur-
vient lorsqu’un résultat de recherche est utilisé dans le
but de légitimer une position ou un changement dans
la politique courante. Ces différentes formes d’applica-
tion peuvent être formelles ou informelles.
Une autre décision serait d’envisager l’utilisation de
résultats disponibles. Parfois de nouvelles informations
s’avèrent nécessaires avant d’appliquer les résultats
d’une recherche dans la pratique, surtout quand le
changement est complexe et implique d’autres disci-
plines de la santé. Plus de temps est alors requis pour
déterminer comment les résultats seront utilisés et qui
coordonnera les diverses activités nécessaires au chan-
gement. L’utilisation des résultats peut aussi être retar-
dée jusqu’à ce que de nouvelles informations viennent
appuyer le changement. II peut être indiqué de retar-
der l’utilisation des résultats de recherche lorsque de
nouvelles études sont requises. Par exemple, lorsqu’il
n’existe pas suffisamment d’études sur un sujet, qu’il y
a présence de conflits ou de contradictions entre les
études, ou encore lorsque les risques liés à
I’applica-
tion sont trop importants. Dans ce cas, la pratique
demeura inchangée jusqu’à la venue de nouvelles
études. L’option finale peut être de rejeter les résultats
de recherche parce que ceux-ci ne sont pas assez évi-
dents pour une application dans le milieu clinique ou
encore parce que les risques ou les coûts d’implanta-
tion semblent trop élevés.
Cette phase de prise de décision a permis de prendre la
décision d’appliquer dans l’immédiat l’intervention de
soutien dans la pratique clinique basée sur la recon-
naissance des bénéfices de l’expérience vicariante
auprès des patients de la chirurgie cardiaque, à savoir
la diminution de l’anxiété, l’augmentation de
I’effica-
cité perçue et la reprise des activités. Cette reconnais-
sance découle de l’application cognitive et instrumen-
tale. Dans l’application cognitive, les infirmières
peuvent modifier leur compréhension du phénomène
d’aide par les pairs, encourager ce type de soutien et
favoriser leur intégration dans une démarche d’aide.
Quant à l’application instrumentale, elle vise la mise
en application de l’expérience vicariante sous la forme
d’un programme de parrainage offert à des patients.
PHASE V :
L’ADAPTATION/L’APPLICATION
La phase d’adaptation/application consiste à général
i-
ser l’énoncé de recherche qui a été spécifié au cours
de la phase II. II s’agit de planifier l’implantation des
résultats de recherche dans la pratique. L’adaptation
vise à déterminer quel type de connaissances sera uti-
lisé et comment ces connaissances seront appliquées
dans la pratique? La phase d’application proprement
dite inclut un certain nombre d’étapes telles que (1) la
connaissance de la situation à changer, (2)
I’élabora-
tion d’un plan de changement, et (3) l’implantation du
plan. C’est au cours de la phase d’application, selon
Stetler (1994) que les politiques et les procédures sont
développées à l’aide des connaissances d’écoulant de
la recherche et sont implantées dans la pratique.
L’application des résultats de l’étude sur le soutien
vicariant concernait tous les patients admis à une
chirurgie cardiaque. L’intervention de soutien était
offerte sous la forme d’un Programme de parrainage.
Les objectifs du programme visaient à favoriser I’en-
traide entre les patients au moment de I’hospitalisa-
tion et à apporter le soutien aux patients cardiaques
et à leur famille. Le Programme de parrainage a
débuté ses activités en janvier 1995. L’intervention
de soutien fut dispensée par les trois bénévoles for-
més initialement en vue de leur implication dans
l’étude. La clientèle visée par le programme était les
patients hospitalisés pour une chirurgie cardiaque.
Les visites de soutien étaient offertes la veille de la
chirurgie et avant le congé de l’hôpital. En mai 1995,
de nouveaux bénévoles furent recrutés. Ces derniers
ont reçu la formation initiale d’une durée de sept
heures sur les principes de la relation d’aide, dont les
notions d’empathie, d’écoute attentive et de respect.
Grâce à ces nouvelles recrues, le service de soutien
fut nouvellement offert aux patients hospitalisés pour
une intervention de dilatation coronarienne. Dès juin
54
Recherche en soins infirmiers
N”
57
-
Juin 1999
 6
6
 7
7
1
/
7
100%