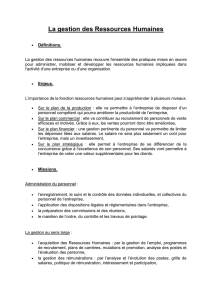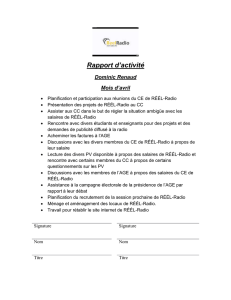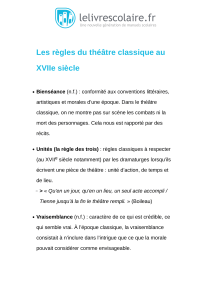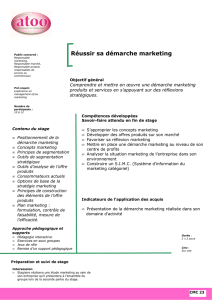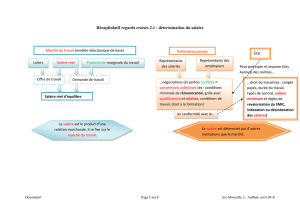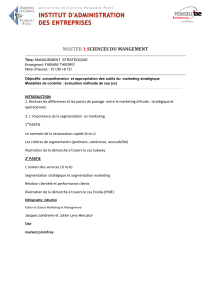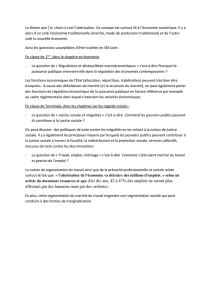bibliographie - Jongkon Kumlai

Séminaire
Mai 2007
Le marché du travail urbain en Thaïlande est-il segmenté ?
Analyse à l’aide du modèle à changement de régime endogène avec règle de séparation inconnue.
Par
KUMLAI Jongkon
ATER, Doctorant- LARefi-Université Montesquieu Bordeaux IV

Sommaire
1. INTRODUCTION .......................................................................................................................................................... 1
2. CONTEXTE MACROECONOMIQUE ET SOCIAL ................................................................................................. 2
1. PROSPERITE ECONOMIQUE DES ANNEES 80 ................................................................................................................. 2
2. CRISE FINANCIERE DES ANNEES 90 ET SES CONSEQUENCES ......................................................................................... 3
3. REPRISE ECONOMIQUE ET RETOUR AU MODELE SOCIAL ............................................................................................. 4
3. REALITE DU MARCHE DU TRAVAIL .................................................................................................................... 5
1. EVOLUTION DE LA STRUCTURE DE L’EMPLOI .............................................................................................................. 5
2. QUALITE ET PRODUCTIVITE DU TRAVAIL .................................................................................................................... 7
3. CHOMAGE, SOUS-EMPLOI ET SECTEUR INFORMEL ...................................................................................................... 7
4. ROLE DES INSTITUTIONS DU MARCHE DU TRAVAIL ...................................................................................................... 8
4. DYNAMIQUE DE L’INEGALITE SALARIALE DANS UN MARCHE DU TRAVAIL URBAIN ....................... 9
1. SOURCES STATISTIQUES. ............................................................................................................................................ 10
2. INEGALITE SALARIALE AGREGEE .............................................................................................................................. 10
5. VERIFICATION EMPIRIQUE DE LA SEGMENTATION DU MARCHE DU TRAVAIL URBAIN ............... 12
1. THEORIE DE LA SEGMENTATION VERSUS THEORIE DU CAPITAL HUMAIN .................................................................. 13
2. DIFFERENTES METHODOLOGIES DU TEST DE LA SEGMENTATION .............................................................................. 15
A. Méthodes de définition a priori ............................................................................................................................. 15
B. Limites des modèles de prédétermination a priori ................................................................................................ 15
C. Méthodes de classification de groupe et d’analyse factorielle .............................................................................. 16
3. DE LA THEORIE A LA PRATIQUE : METHODES EMPIRIQUES APPLIQUEES AU PAYS EN DEVELOPPEMENT. ................... 17
4. TEST DE LA DUALITE PAR UN MODELE A CHANGEMENT DE REGIME .......................................................................... 18
A. Conceptions générales du modèle ......................................................................................................................... 18
a. Formulation du modèle à changement de régime avec règle de séparation inconnue ...................................... 19
b. Logique du test ................................................................................................................................................. 20
B. Sélection des données et des variables .................................................................................................................. 20
C. Résultats des estimations ...................................................................................................................................... 21
a. Existe-il deux fonctions de gains dans un marché du travail urbain en Thaïlande ?......................................... 24
b. Le modèle suit-il la prédiction de la théorie de la segmentation ? .................................................................... 24
D. Répartitions sectorielles selon les caractéristiques individuelles et de catégories professionnelles. .................... 27
a. Répartition sectorielle des individus ................................................................................................................ 27
b. Répartition des individus selon les caractéristiques individuelles et de l’emploi. ............................................ 28
6. CONCLUSION ............................................................................................................................................................. 31
BIBLIOGRAPHIE ............................................................................................................................................................ 32
ANNEXE : .......................................................................................................................................................................... 39

1
1. INTRODUCTION
Durant ces trois décennies, la Thaïlande adopte des stratégies de développement économique
étroitement associées au mode de production capitaliste. La plupart des réformes de politique
économique ont pour objectif de créer un environnement favorable à la croissance économique du
pays, en laissant le progrès social au second plan. Le succès de l’économie thaïlandaise reflète « un
modèle de développement asiatique »
1
par lequel la croissance phénoménale s’est réalisée au rythme
de 7 % et où le nombre de personnes pauvres vivant en dessous d’un dollar par jour a été divisé par
cinq entre 1960 et 1996. Durant les années 1980, l’expansion économique a été menée par une
politique d’orientation à l’exportation en se basant sur l’accumulation massive du capital et
l’industrialisation intensive en main d’œuvre qualifiée.
La crise économique et financière des années 1990 a mis en cause le modèle de développement
économique du pays en raison d’une baisse générale du niveau de vie de la population, notamment par
le biais des dégâts causés dans le marché du travail urbain. En effet, l’impact social de la récession
économique a touché plusieurs milliers de personnes vulnérables parmi lesquels on trouve les
travailleurs peu qualifiés, les jeunes travailleurs, les femmes actives, qui ont dû subir une réduction de
salaires et une perte de leur emploi. Ce phénomène résulte en particulier d’une politique laxiste liée au
marché du travail dont l’objectif est de favoriser la flexibilité de l’emploi au détriment des systèmes de
protection sociale. Par conséquent, le gouvernement thaïlandais, ayant pris conscience des dommages
sociaux dans le modèle de développement, a lancé en 2003 un programme CDP (Country
Developement Partnership) en collaboration avec la Banque mondiale afin de mettre en place des
politiques efficaces de lutte contre la pauvreté. Cependant, il convient de noter que l’objectif des
programmes proposés ne consiste qu’à appréhender les effets liés à la pauvreté et aux inégalités de
revenu sans prendre en compte leurs causes inhérentes au marché du travail, qui sont à la fois
complexes et multidimensionnelles.
Par conséquent, nous sommes amenés à dresser, dans cet exercice, l’hypothèse d’un marché du
travail segmenté en mettant en tête que la paupérisation et la persistance de l’inégalité de revenus
peuvent probablement s’expliquer, non seulement par une différence en termes de capital humain,
mais aussi par un mécanisme de détermination salariale spécifique à chaque segment du marché.
Malgré une montée de l’informatisation du marché du travail urbain dans la plupart des pays en
développement, plusieurs analyses sur ce sujet ont avancé l’existence possible d’un marché du travail
dual au sein d’un secteur formel. A l’aide de l’Enquête de main d’œuvre relative à la période 1985-
2004, nous allons vérifier l’existence de la segmentation du marché du travail urbain par la mise en
œuvre d’un modèle économétrique à changement de régime avec règle de séparation inconnue. Après
avoir abordé les caractéristiques du marché du travail en Thaïlande, les mesures d’inégalité nous
aideront à clarifier l’évolution de la répartition de salaires dans ce marché. Ensuite, le débat théorique
de la détermination salariale entre la théorie du capital humain et la théorie de la segmentation
constituera une hypothèse explicite du marché du travail dual. Enfin le test de la dualité s’effectuera à
l’aide du modèle à changement de régime avec règle de séparation inconnue
1
« Il est frappant de voir combien certains pays tournent le dos à tous les dogmes. Au modèle autocentré, l'expérience
asiatique oppose sa focalisation sur les exportations. Contre la théorie standard, elle présente des excédents commerciaux et
budgétaires en pleine période de décollage économique. A l'orthodoxie libérale, elle répond par l'interventionnisme des
Etats, la relative fermeture aux importations de biens de consommation, le contrôle sévère des investissements étrangers et
des marchés financiers. A tel point, selon certains, que c'est pour avoir trahi cette orientation que l'Asie a subi la crise que
l'on sait.» [Severino (2004) pp.2].

2
2. CONTEXTE MACROECONOMIQUE ET SOCIAL
Entre 1985 et 2005, l’évolution de la structure du marché du travail thaïlandais ne peut être
comprise qu’en relation avec le contexte macroéconomique national caractérisé par l’alternance de
périodes de croissance et de récession. Dans cette optique, nous sommes amenés à nous questionner
sur la relation efficacité économique et équité sociale telle qu’elle apparaît dans ces différents modèles
du développement qu’a connu la Thaïlande au cours de ces 20 dernières années.
1. Prospérité économique des années 80
Durant la dernière moitié des années 1980, les économies du Sud-ouest asiatique ont connu une
phase de croissance économique sans précédent. Entre 1987 et 1990, la Thaïlande faisait partie des
pays dont la croissance du PIB est la plus rapide du monde. Cette performance résulte non seulement
des politiques économiques du gouvernement thaïlandais mais également de l’environnement
favorable de l’économie mondiale à cette époque.
Le premier plan national de développement économique et social a été mis en place en 1961 en
mettant l’accent sur la stratégie des industries de substitution aux importations. Durant les années 70,
le troisième plan national (1972-1976) a eu pour objectif l’orientation à l’exportation et la création des
industries intensives en travail. En réalisant que le protectionnisme élevé due essentiellement au plan
de substitution aux importations durant les années1970 a été néfaste à l’économie [Wisarn (2002)
p.5], le cinquième plan national (1982-1986) a été modifié en s’appuyant notamment sur la
restructuration et l’amélioration de l’efficacité et de la compétivité internationale. Enfin , le septième
plan (1987-1991 et 1992-1996) ont été conçus dans un même ordre d’idée.
Les chocs pétroliers des années 1970 et la récession de l’économie mondiale durant la première
moitié des années 80 ont provoqué une instabilité économique signalée par un déficit de la balance de
paiements important et une montée de la dette extérieure au début des années 80
2
[Charoenseang,
Manakit (2002) p.599]. Ensuite, le gouvernement thaïlandais a demandé une aide financière auprès des
institutions internationales, au premier rang desquelles le FMI et la Banque mondial qui ont imposé
des réformes relevant du programme d’ajustement structurel. Par conséquent, un ensemble de
politiques conservatrices et restrictives ont été mises en place à l’aide de plusieurs instruments tel que
les contrôles fiscaux, les taux d’inflation, de taux de change et la libéralisation des prix agricoles et des
produits énergétiques. Il faut dire que les politiques macroéconomiques conduites par le gouvernement
thaïlandais durant cette période de récession économique ont permis à la Thaïlande de profiter d’un
environnement favorable de l’économie mondiale dès la seconde moitié des années 80. En effet, on
constate une accélération considérable de la croissance économique avec un taux de croissance du PIB
réel de l’ordre de 13,29 % en 1988, 12,19 % en 1989 et 11,17 % en 1990 [Charoenseang, Manakit
(2002) p.600]
3
.
Depuis ces années, la prospérité économique s’est basée sur l’exportation des biens et des services. «
En partie en raison des ajustements de taux de change, en partie en raison du déclin des prix du pétrole
en 1986, et en partie en raison de la transition de pays d’Asie nouvellement industrialisé à des produits
intensifs en main d’œuvre qualifiée et en technologie, la croissance de l'économie thaïlandaise a
accéléré de manière significative à partir de1986. Elle a été principalement conduite par une forte
2
Le déficit de la balance de paiement et le service de la dette extérieur ont atteint de l’ordre de 7 % du PIB et de 18,7 % des
exportations en 1980. [Wisarn (2002) pp.11]
3
Voir également le tableau A-1 en annexe.

3
hausse des exportations manufacturées.»
4
[Sussangkarn (1994) p.589]. L’industrialisation du secteur
manufacturier
5
a été accélérée par une hausse de l’importation des produits intermédiaires en réponse à
l’accroissement des investissements internes. De ce fait, la Thaïlande est devenue l’un des pays
exportateurs de produits hautement technologique dès la fin des années 80, tel que les électroménagers
et de plusieurs produits manufacturiers. Ces épisodes de croissance ont marqué une nouvelle ère du
« miracle asiatique » qui résulte de deux moteurs déterminants, à savoir une accumulation importante
du capital et une croissance de la productivité totale des facteurs (PTF), notamment dans le secteur
manufacturier.
Pendant plusieurs années, l’économie thaïlandaise a eu un système financier largement contrôlé
car les emprunts extérieurs et les entrées des capitaux ont été strictement réglementés. Dès le début des
années 90, l’impact de changement du système financier mondial sur le marché des capitaux
domestique a eu pour conséquence la prise en considération du processus de libéralisation du marché
financier. Ainsi, les autorités thaïlandaises ont été contraintes d’accepter une ouverture du marché
financier imposée par le FMI en 1990. Mais face à l’environnement incertain et complexe des flux de
capitaux étrangers, l’économie thaïlandaise est entrée dans une phase de la crise économique
engendrée par l’effondrement du système financier du pays.
2. Crise financière des années 90 et ses conséquences
La crise de la fin des années 90 s’est manifestée dans le secteur financier avant de s’étendre aux
autres secteurs d’activités économiques. Les conséquences sont à la fois économiques et sociales. Bien
avant l’arrivée de la crise, la Thaïlande a pu profiter de l’environnement favorable de l’économie
mondiale en réalisant un taux de croissance en moyenne de l’ordre de 10 % entre 1986 et 1996. Il
convient de noter que l’expansion économique a été largement dépendante du commerce extérieur. En
effet, la demande interne des biens et services a diminué depuis le début des années 80 et l’épargne
domestique a été limitée par rapport à la montée des investissements. Par conséquent, durant la
première moitié des années 90, les banques commerciales et notamment la facilité bancaire
internationale dirigée « the Bangkok International Banking Facility (BIBF) », libéralisée en 1993, ont
importé progressivement des capitaux étrangers dont la part relative aux autre institutions financières a
été multipliée par dix en 10 ans. Ce phénomène pourrait s’expliquer alors par une hausse des taux
d’intérêt domestiques des emprunts par rapport aux taux d’intérêt de l’étranger, en particulier « the
Federal Funds Rate ». Ce différentiel a donc incité les banques commerciales à emprunter les fonds de
l’étranger pour les ramener en Thaïlande. [Krongkeaw (1999) p.399]. Au même moment, le déficit de
la balance de paiement et les exportations ont fortement diminué en raison de facteurs internes et
externes. Malgré une performance du secteur manufacturier entre 1980 et 1995, l’exportation a été
4
Le texte traduit par l’auteur.
5
De ce fait, la part du secteur manufacturier dans le PIB a augmenté de 21,7 % à 24,7 % entre 1980 et
1990 tandis que celle du secteur agricole a diminué de 20,6 % à 14,4 % durant la même période
[Wisarn (2002) p.6].
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
1
/
50
100%