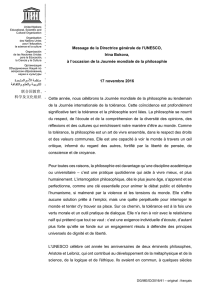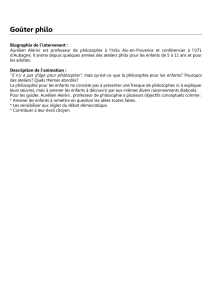Discours de la Directrice générale de l`UNESCO, Irina

DG/2016/181 – original : français
Merci beaucoup, Monsieur Janicot, Président de la Commission nationale française pour
l’UNESCO, cher Daniel,
Je salue la présence parmi nous de Madame Edwige Chirouter, la titulaire de la Chaire
UNESCO, ainsi que celle des représentants de l’Université d’Angers et de l’Université
de Nantes,
Je salue également la présence du représentant de Madame Najat Vallaud-Belkacem,
Ministre de l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur,
Bienvenue à toutes et à tous à la Maison de l’UNESCO pour lancer officiellement la
Chaire UNESCO » Philosopher avec les enfants », une Chaire si originale, comme vous
l’avez-vous-même souligné, Monsieur Janicot.
« J’ai mis toute ma vie à savoir dessiner comme un enfant », disait Pablo Picasso.
Ce matin, pour inaugurer cette belle journée internationale de la philosophie, nous
proposons une ambition du même type, dans l’espoir de philosopher comme les enfants,
et avec les enfants.
Car si le questionnement et l’étonnement sont au fondement de la philosophie, les
enfants sont les plus qualifiés dans l’art de poser des questions tranchantes, qui nous
surprennent et qui nous font redécouvrir notre capacité à nous étonner.
Une question d’enfant est le meilleur antidote à l’académisme, qui guette les disciplines
universitaires, mais qui est particulièrement nuisible à la philosophie.
Discours de la Directrice générale de l’UNESCO
Irina Bokova,
à l’occasion de la table ronde pour le lancement de la Chaire UNESCO sur les
pratiques de la Philosophies avec les enfants
Journée mondiale de la philosophie
UNESCO, 18 novembre 2016

DG/2016/181 - Page 2
L’UNESCO, par ses programmes en sciences humaines, s’efforce de faire tomber les
barrières que l’académisme, et veut maintenir la pratique philosophique vivante.
Nous ne le faisons pas uniquement par amour de la « grande philosophie » ou par
vénération des « grands philosophes ».
L’UNESCO n’est pas un centre de recherche philosophique, nous ne publions pas de
livre de philosophie, nous ne prétendons pas avoir d’expertise dans l’analyse des
œuvres de philosophie.
Si l’UNESCO s’intéresse à la philosophie, c’est d’abord comme l’un des outils
nécessaires à l’accomplissement de sa mission : nourrir le dialogue entre les peuples,
favoriser la compréhension mutuelle, enrichir la connaissance des cultures, pour la paix.
La philosophie est utile à ce projet.
La philosophie ne tient pas en place : elle est un art d’interroger, de bousculer les
évidences, de dialoguer avec les autres pour se remettre en question, à prendre le point
de vue de l’autre, à voir les choses autrement, à créer ces passerelles entre les cultures,
entre les disciplines, et avec les autres.
La célébration de la Journée mondiale de la philosophie 2016, où prend place votre
table-ronde ce matin, est exemplaire de cette volonté d’élargir la philosophie au-delà de
ses limites.
L’une des limites convenues de la philosophie, c’est celle de l’âge. Sans y réfléchir, nous
tendons à faire de la philosophie une discipline « difficile » qui suppose une importante
formation antérieure.
La philosophie n’est généralement enseignée que pendant la dernière année du lycée –
voire pas du tout à l’école secondaire.
Mais pourquoi devrait-il y avoir un âge pour apprendre à philosopher ?
En 2007, le rapport de l’UNESCO consacré à La philosophie : une école de la liberté,
tirait les conclusions de plusieurs années de consultations à travers le monde, et appelait
au développement de l’enseignement de la philosophie dès l’école primaire.

DG/2016/181 - Page 3
Je garde un souvenir ému des jeunes élèves qui, lors de la Journée mondiale de la
philosophie en 2012, avaient rédigé le contenu de deux « capsules temporelles »,
destinées à être ouvertes en 2062, et que nous avons enterrées sous la pelouse de
l’UNESCO.
C’est pourquoi je me réjouis tout particulièrement de la création de la Chaire UNESCO
que nous inaugurons aujourd’hui, sur la pratique de la philosophie avec les enfants.
Son intention est tout simplement remarquable.
Ses modalités me paraissent exemplaires, fondées sur un vrai partenariat solide et
issues d’une longue collaboration, notamment à travers l’organisation des Rencontres
sur les nouvelles pratiques philosophiques, dont la 15e édition vient d’avoir lieu à
l’UNESCO.
Je voudrais rendre hommage à Mme Edwige Chirouter, titulaire de la Chaire à
l’Université de Nantes, dont le dévouement et la persévérance ont été décisifs dans le
passage, forcément complexe, de l’idée à sa mise en œuvre.
Mes remerciements vont également aux Universités des Nantes et d’Angers, ainsi qu’à
la Commission nationale française pour l’UNESCO, pour leur indispensable soutien.
En août prochain, à l’occasion de la Conférence mondiale des humanités, nous avons
l’ambition de définir une nouvelle vision globale pour les sciences humaines : et les
philosophes doivent y prendre toute leur place.
L’enjeu qui préside à toutes ces réflexions, c’est celle de la transformation sociale.
En 2015, l’Assemblée générale des Nations-Unies a adopté un Agenda pour le
développement inclusif et durable à l’horizon 2030, un Agenda ambitieux et global.
Je suis convaincue que cette chaire porte un message vivant, important et novateur pour
la transformation sociale par la formation citoyenne, l’esprit critique, et l’art de se poser
des questions, dès le plus jeune âge.

DG/2016/181 - Page 4
Ce soir, nous allons continuer de bousculer les idées reçues sur l’enseignement de la
philosophie, avec, pour la première fois en Europe, à l’UNESCO, la grande nuit de la
philosophie.
A partir de 19h et jusqu’à 7h samedi matin, l’UNESCO fait sa nuit blanche dédiée à la
philosophie, pour découvrir et pratiquer la philosophie autrement, dans des formats très
divers, en associant les arts visuels et performatifs.
Les enfants, à cette heure, seront probablement couchés, mais nous essaierons, comme
nous pouvons, de nous interroger à leur manière, de voir le monde comme pour la
première fois, de nous libérer des préjugés, à la faveur de la nuit.
C’est un événement exceptionnel, c’est aussi tout un symbole de modernité, d’innovation
pour l’UNESCO, une façon différente de penser, d’interagir, et je félicite d’avance tous
ceux qui travaillent à cette grande fête de la philosophie.
Merci à tous, longue vie à cette nouvelle Chaire, et belle journée internationale de la
philosophie.
1
/
4
100%