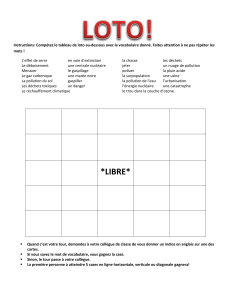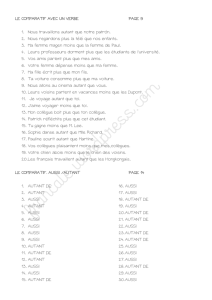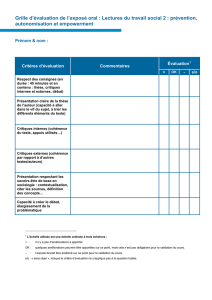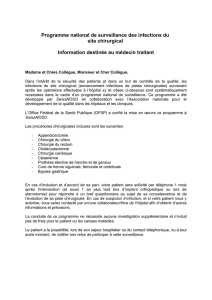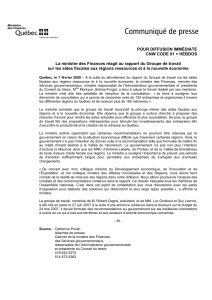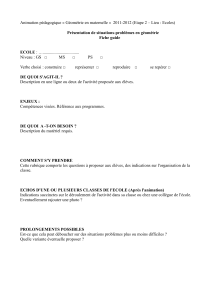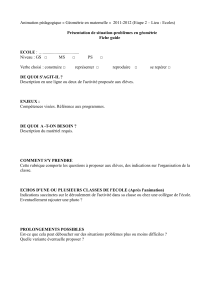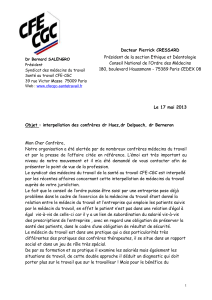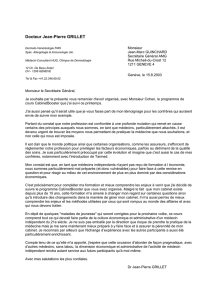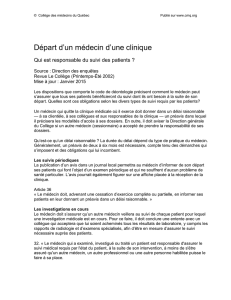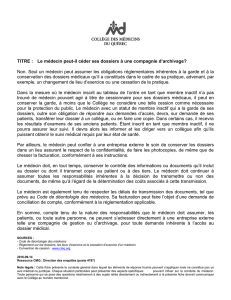Critiques entre confrères : tout le monde en pâtit, et

66
|
LE CONCOURS MéDICAL
tOME 136
|
N° 1
|
JANVIER 2014
PRATIQUES | Gestion des risques au cabinet
{
devoir de confraternité | devoir de transparence | déontologie
Observation
Le Dr C. est médecin en zone semi-rurale.
Ce jeudi, Solange, 57 ans, vient le voir en
urgence pour un traumatisme de l’épaule
après une chute au travail. Devant l’attitude ty-
pique de traumatisée des membres supérieurs,
l’impotence fonctionnelle hyperalgique, le Dr C.
suspecte une fracture de la clavicule, calme la
douleur par une injection d’antalgique, et fait
accompagner Solange séance tenante par le
contremaître de son entreprise jusqu’aux urgen-
ces du centre hospitalier voisin de 20 kilomètres
pour une prise en charge complète. Solange re-
vient quinze jours plus tard pour la gestion admi-
nistrative de son dossier ; elle confirme la frac-
ture de clavicule, porte une contention, mais se
montre réservée, refusant tout examen. Gênée,
elle finit par rapporter les propos plutôt désobli-
geants du chirurgien orthopédiste vu à l’hôpital,
qui a critiqué assez vertement l’injection d’antal-
gique qui gênait les options thérapeutiques, le
trajet réalisé « comme dans la brousse » (sic),
sans médicalisation par les pompiers et, plus
globalement, la petite compétence des généra-
listes en traumatologie.
Critiques entre confrères : tout le monde
en pâtit, et surtout le patient
Pr René Amalberti*
Commentaire
Le trait n’est pas forcé dans ce cas ; les criti-
ques de confrères ne sont pas rares, leur fré-
quence a même tendance à augmenter, au fil
des années et dans des termes toujours plus forts
(encadré 1). Les Américains parlent de disruptive
behavior, de medical bashing, ou de badmou-
thing (encadré 2) pour caractériser ces propos
de professionnels inutilement blessants, vexatoi-
res, peu éthiques, prononcés à l’encontre d’autres
professionnels, qu’il s’agisse de médecins vis-à-vis
de confrères ou de soignants, de soignants entre
eux, le plus souvent devant les patients, ou encore
d’enseignants critiquant ouvertement d’autres spé-
cialités auprès des étudiants.
L’ampleur du phénomène
et ses impacts
Entre médecins en ville et hospitaliers, alors que
seulement 5 % des médecins sont vraiment ca-
talogués comme ayant de façon récurrente des
problèmes de compétence ou de prise de risques
inutiles(1), 95 % des médecins ont, parfois ou
souvent, critiqué leurs confrères auprès de leur
patient(2). Dans bien des cas, le patient finit par
tout rapporter à un autre médecin, ce qui sanc-
tionne ces comportements trop systématiques.
Pire, presque toujours, ces comportements in-
troduisent le doute dans l’esprit des patients et
réduisent leur adhésion aux prescriptions, dont
on sait qu’elle est déjà précaire(3).
Entre médecins et soignants(4), 73 % des soi-
gnants reconnaissent avoir été l’objet parfois ou
souvent d’attitudes et de critiques non éthiques
de la part des médecins avec qui ils travaillent.
67 % de ces comportements ont été associés à
des facteurs de risque pour le patient, 27 % en-
gageant le pronostic du patient par le fait de la
dégradation de la coordination en lien direct avec
l’effet de la critique reçue. Certains soignants fi-
nissent par renoncer à appeler le médecin incri-
miné, ou à dire les choses telles qu’elles sont. Les
conséquences sont particulièrement importantes
pour les erreurs sur le médicament. L’impact sur
le moral et l’équipe est aussi très important, avec
une baisse de la satisfaction, des départs volon-
taires de soignants, des dégradations importan-
tes des communications et coordinations, et une
contamination collatérale à toutes les relations
dans l’équipe de soin(5).
À l’université(6), 87,5 % des étudiants rappor-
tent des critiques vexatoires sur leur spécialité ;
les spécialités les plus concernées sont la mé-
decine générale (72 %), la médecine interne
(40 %) ; la psychiatrie (39 %) et la chirurgie gé-
nérale (36 %). 67 % des étudiants, en particu-
lier en médecine générale, rapportent avoir été
Tous droits reservés - Le Concours médical

tOME 136
|
N° 1
|
JANVIER 2014
LE CONCOURS MéDICAL
|
67
Gestion des risques au cabinet
personnellement l’objet de critiques qui rabais-
sent la compétence nécessaire, l’assimilent à un
choix par défaut. Les réactions des seniors et
de l’administration de l’université sont souvent
décevantes, au mieux neutres. Cette absence
d’attitudes constructives de chaque discipline
pour une solidarité réciproque provoque régu-
lièrement des changements tardifs d’orienta-
tion. Ainsi, des étudiants de médecine générale
optent souvent pour une autre spécialité sous
la pression des critiques excessives ou par dé-
valorisation de leur choix initial ; l’impact est
sérieux, puisque 12 % des étudiants reconnais-
sent avoir réorienté leur carrière de généralistes
à cause de ces critiques, 7 % avoir fui la méde-
cine de ville en zone rurale, 8 % être devenus
spécialistes(7).
Pourquoi ces comportements ?
Parmi les facteurs externes, la fatigue, parti-
culièrement présente en milieu médical, joue à la
fois comme conséquence et accélérateur de ces
comportements délétères. L’effet générationnel :
la génération vétéran (1900-1945), marquée
par la crise de 1929, avait pour logique de tout
accepter pour préserver le travail et la sécurité
de la famille ; la génération des baby boomers
(1946-1964) loyaux à leur organisation, cher-
chait l’ascenseur social par tous les moyens, y
compris l’acceptation d’attitudes déplacées si
c’est le prix à payer ; tandis que les générations X
(1965-1980) puis Yers (1981-1999) misent sur
la technologie, prônent l’équipe, le réseau plutôt
que l’autorité, et sont sensibles à la qualité de
vie, tout en étant plus intolérantes, notamment
à tout ce qui les agresse, et en même temps plus
agressives en retour. Enfin, la mixité des cultu-
res en médecine : aux États-Unis, plus de 50 %
des professionnels de santé ne sont pas nés sur
le territoire.
Parmi les facteurs personnels : la personna-
lité est évidement un élément récurrent, avec de
grandes différences dans la gestion de l’agres-
sion et des stress, et très peu de formations pour
gommer ces différences.
Mais, dans bien des cas, blâmer le collègue per-
met simplement de réduire son propre stress.
Souvent le médecin pense qu’en disant au pa-
tient tout ce qu’il pense, il répond à un objectif
de transparence, mais il ne faut pas confondre
devoir de transparence et autorisation de délation
2. Badmoothing, bashing, disruptive behavior
Quatre-vingt-quinze % des médecins font, rarement ou souvent, des critiques
non éthiques sur leurs confrères, les autres professionnels, ou des critiques plus
générales sur d’autres spécialités que la leur.
Dans une grande majorité de cas, ceux qui critiquent le plus, et le plus inutilement,
sont de bons médecins, bons techniciens, justement avec un (trop) haut niveau
d’attente sur eux-mêmes et sur le système médical.
Le mécanisme psychologique de base le plus fréquent, invoqué pour expliquer ces
critiques inutiles, est la triangulation de la relation : pour gérer ses propres angoisses
et ses propres limitations, un tiers virtuel, objet de la critique, est présenté comme la
cause du problème, et on se place soi-même en observateur transparent, neutre, avec
le beau rôle.
Les critiques sont souvent prononcées devant le patient, ou l’étudiant, avec des
conséquences, importantes et mal estimées par celui qui critique, sur la sécurité du
patient, la conance mutuelle, et les choix de carrière des étudiants.
On peut s’améliorer, en groupe, et par des formations. Le groupe professionnel a tout
intérêt à être solidaire, à adopter une tolérance zéro sur ces pratiques, tout en aidant. Un
rapprochement social, des opportunités pour mieux se connaître et connaître le métier
de l’autre sont souvent sufsants pour réduire considérablement ces comportements.
L’université de Rochester a recruté des acteurs pour jouer les patients standard,
allant consulter 23 oncologues et 23 généralistes qui avaient accepté de participer
à l’expérimentation et de recevoir dans leur consultation normale des patients
cibles (mais sans savoir lesquels) et avaient donné l’autorisation d’enregistrer la
consultation (magnétophone porté par le patient) (chaque médecin payé 300 dollars
la consultation cible). Le patient acteur prenait le rôle d’un patient de la cinquantaine
atteint d’un cancer du poumon avancé, qui venait de déménager à proximité du lieu
de consultation, de sorte qu’il s’agissait de la première visite à ce médecin, mais pas
de la première visite pour la pathologie et le début du suivi médical, effectués dans
l’ancien lieu d’habitation. Tout le dossier avait été préparé par des oncologues pour
avoir un maximum de réalisme, et le patient acteur était bien sûr entraîné.
Sur les 46 visites, 39 ont pu être enregistrées (20 oncologues et 19 généralistes) ;
15 % des médecins ont dit avoir reconnu un patient cible (5 au total), ce qui signie
que 34 visites n’ont pas été détectées par les médecins comme faisant partie de
l’expérimentation : celles-ci ont été étudiées en détail.
Au total, 12 commentaires se sont avérés positifs sur le travail des confrères précédents,
2 neutres et 28 négatifs (14 sur le traitement mis en place, 8 sur les confrères eux-
mêmes, dont 6 nominatifs, et 6 d’ordre plus général sur certaines spécialités médicales).
Les commentaires négatifs parfois violents sont apparus souvent comme des
justications de la propre difculté du médecin à assumer
ses propres hésitations, comme s’il voulait se dédouaner
à l’avance d’un problème qui n’était pas encore arrivé.
Exemple de commentaire positif : « Vous avez eu
une bonne biopsie, c’est un bon docteur. »
Exemple de commentaire négatif : « Il a irradié vos
côtes, pas le poumon… ce gars est vraiment un idiot. »
1. Une expérimentation originale et inquiétante(3)
DR
Tous droits reservés - Le Concours médical

PRATIQUES | Gestion des risques au cabinet
{
68
|
LE CONCOURS MéDICAL
tOME 136
|
N° 1
|
JANVIER 2014
(encadré 3) ; critiquer est souvent aussi une ma-
nière de se dédouaner et de gérer son anxiété
devant un diagnostic difficile. Une des stratégies
les plus connues pour réduire son angoisse et
fuir sa propre responsabilité est de trianguler
la relation avec le patient en réintroduisant la
responsabilité d’un collègue absent, mais l’effet
sur le patient est rarement positif, car il en est
souvent gêné.
Que faire pour corriger(8) ?
Miser sur le leadership organisationnel : impliquer
l’organisation pour que le management s’intéresse
au problème et accepte de valider une politique ac-
tive de non-tolérance à des calomnies inutiles.
Responsabiliser : il faut arriver à mieux respon-
sabiliser chacun dans ses actes. Une enquête d’opi-
nion conduite en interne (par questionnaire ou en-
tretiens) peut aider à débattre de ces problèmes,
Même si un consensus est acquis pour la nécessité d’une transparence accrue vis-à-vis du patient, les médecins peuvent être embarrassés à
révéler les erreurs de confrères. Un des points faibles du consensus actuel sur la transparence est de présupposer qu’elle ne concerne que le
médecin devant le patient. Évidemment, ce n’est nalement que rarement le cas tant le système de prise en charge est complexe, articulé entre
acteurs, bref, en lui-même (le système) cause d’accidents. Parler d’une erreur au patient dont on n’est pas la source directe conduit à plusieurs
difcultés : d’abord en parler correctement (qui, où, quand), ce qui n’est pas simple et relève de l’inférence incertaine, puis en parler tout court avec
éthique. Les meilleurs experts mondiaux ont été réunis pour rééchir à la question. Voici leurs conclusions.
La première difculté est de savoir ce qui s’est réellement passé (mauvaise traçabilité), puis d’estimer en quoi c’est une erreur (de « je n’aurais pas
fait comme ça » à « inadmissible »).
Parler au collègue suspecté du problème avant d’en parler au patient est de loin la meilleure solution, mais cela peut avoir aussi des effets
délétères sur la relation avec ce collègue, et cela prendra du temps. Attention aussi aux clichés des relations entre spécialités, de déconsidération
inutile, etc.
Le fait de ne pas parler au collègue et d’utiliser directement les données disponibles évite les difcultés précédentes, mais reste peu éthique, peu
loyal, et parfois proche de la calomnie, avec une possibilité de cascade d’effets secondaires incontrôlés sur le collègue ou l’institution que l’on
désigne comme coupable, sans parler de l’attitude avec les assureurs qui peut être franchement négative sur cette façon de faire.
Même quand les faits sont simples et portent peu à discussion, il faut faire attention à ne pas casser inutilement la conance du patient dans le
collègue ou l’institution désignée, surtout quand ce
patient n’aura pas d’autre choix que d’y retourner.
Le collège d’experts conseille nalement d’en parler
toujours quand l’impact est réel pour le patient,
car la transparence est un droit pour ce dernier ;
mais d’en parler uniquement après avoir réuni les
éléments clairs sur ce qui s’est passé (jamais de
spéculation, jamais d’accusation sans preuve).
Les inférences doivent être consensuelles dans la
profession, ce qui signie qu’il faut en parler avant
soit au médecin incriminé, soit au moins à d’autres
professionnels pour obtenir un consensus. Il ne faut
jamais se er à sa propre opinion.
Autant que possible, les institutions auxquelles
appartiennent les médecins doivent être informées
et mobilisées pour faire les intermédiaires entre les
médecins concernés. Elles doivent organiser les
rencontres, créer une atmosphère de juste culture
propice à ces échanges et à l’annonce au patient.
Gallagher T, Mello M, Levinson W, et al. Talking with patients
about other clinicians’errors. NEJM 369:18, 2013;1752-6.
3. Ne pas confondre devoir de transparence à propos de l’annonce d’une erreur
avec permission de délation des collègues : une récente mise au point du
NEJM
Tableau. Les différents cas retenus par le collège d’experts
Situation clinique Participants souhaités dans
l’annonce au patient
Quelle logique sous- jacente ?
Erreur d’un proche collègue de vo-
tre institution qui a pris en charge
le patient avec vous
Vous et le collègue Assumer collectivement
Erreur d’un étudiant ou d’un
paramédical sous vos ordres
Vous, et un encouragement à
ce que la personne incriminée
assiste aussi
Assumer votre rôle de leader
Erreur d’un collègue de votre
institution avec lequel vous n’avez
pas de contact direct
Vous et votre collègue, un membre
de la direction de l’institution
Montrer que l’institution assume
sa responsabilité (maison de
santé, hôpital, cabinet de groupe)
Erreur systémique (transmission
d’information entre professionnels
par exemple)
Directeur médical de votre
institution et si possible de l’autre
institution
Un directeur est mieux positionné
pour expliquer un problème de
système
Erreur d’un collègue inconnu, et
sans lien avec vous, ni présent
ni passé
Directeur médical de votre
institution et si possible de l’autre
institution du collègue incriminé
Les directeurs sont mieux posi-
tionnés pour ce type d’annonce.
Un assureur peut être conseil
❑
❑
Offre valable jusqu’au 30/06/2014
www.concoursmedical.fr
❑
❑
❑
❑
❑
❑
J’accepte d’être inscrit au site egora.fr, J’accepte de recevoir
le site des professionnels de santé les newsletters
❑ ❑
chèque à l’ordre de Global Média Santé
carte bancaire (sauf American Express)
N°
Expire fi n :
Merci d’inscrire les 3 derniers
chiffres fi gurant au dos
de votre carte bancaire
Date et signature obligatoires
Spécialité :
Je complète les informations me concernant : M. Mme
Nom : Prénom :
N° : Rue :
Code postal : Ville :
Tél. :
E-mail :
Global Média Santé
Service abonnements
314, Bureaux de la Colline
92213 Saint-Cloud Cedex
À envoyer avec votre règlement à :
Conformément à la loi Informatique et libertés, vous disposez d’un droit d’accès
et de rectifi cation pour les informations vous concernant, que vous pouvez exercer
librement auprès de Global Média Santé- service abonnements - 314, bureaux de
la colline - 92213 Saint-Cloud cedex.
`
124
1 an d’abonnement
Z
les archives de votre revue
de nombreux conseils juridiques
les initiatives de vos confrères
sur le terrain et de nombreux
autres contenus !
www.concoursmedical.fr
les archives de votre revue
de nombreux conseils juridiques
les initiatives de vos confrères
sur le terrain et de nombreux
autres contenus !
NOUVEAU
L’ACCÈS ILLIMITÉ
AU SITE INTERNET
DU CONCOURS MÉDICAL
avec
BULLETIN D’ABONNEMENT
Tous droits reservés - Le Concours médical

tOME 136
|
N° 1
|
JANVIER 2014
LE CONCOURS MéDICAL
|
69
Gestion des risques au cabinet
à condition d’éviter soigneusement toute sanction,
ou attitude assimilée, quand on est à cette étape de
restitution.
Former sur les conséquences de ces comporte-
ments en les évoquant en staff, ou en cours, avec
une approche claire.
Travailler en équipe : les actions doivent se
concentrer sur l’établissement d’un code de condui-
te faisant consensus dans le groupe et recevant un
soutien sans faille de la direction, en fuyant un com-
portement de silence (silence skills) avec des inter-
ventions systématiques convenues dans le groupe
(zéro tolérance) chaque fois que ce code n’est pas
respecté. En fait, il s’agit de se donner la possibi-
lité dans le groupe de réagir tous, vite, en traitant
le fait (du comportement) plutôt que mettant l’op-
probre sur la personne, et en insistant bien sur le
lien entre la sécurité du patient et les conséquences
de ce comportement. Le simple fait d’établir une
communication plus importante et plus fréquente, y
compris sur des sujets non professionnels, avec les
auteurs de ces comportements (souvent en contact
trop ponctuel avec l’équipe) suffit souvent à atté-
nuer les comportements par une meilleure connais-
sance et un respect mutuel.
Souligner les conduites exemplaires : le fait d’avoir
(de préférence) un médecin qui prend la parole sur
ce sujet et s’engage à réagir chaque fois publique-
ment sur les abus commis et à montrer l’exemple
est toujours un plus.
Identifier et aider les professionnels à risque
sur ce domaine est une étape importante, en
les confrontant à leur comportement, et en les
adressant à des formations ad hoc. L’interven-
tion de personnes neutres et externes peut aussi
aider à la résolution du problème. Si aucun résul-
tat n’est obtenu par cette méthode de consensus,
des actions plus autoritaires contre les auteurs
de ces comportements répétés doivent être en-
visagées avec le support de la direction ; il peut
s’agir d’abord de médiations, de formations spé-
cifiques, et, in fine, de sanctions. •
* René Amalberti, professeur de physiologie-physiopathologie au Val-de-
Grâce, ancien titulaire de chaire, spécialiste de la gestion des risques
industriels et médicaux, partage actuellement son activité entre ses rôles
de conseiller sécurité des soins de la HAS-DAQSS et de directeur
scientique de la Prévention médicale, www.prevention-medicale.org.
1. Samenow CP, Spickard Jr A, Swiggart W, et al. Consequences of
Physician Disruptive Behavior. Tenn. Med. 2007; 38–40.
2. Weber D. Poll results: doctors’ disruptive behavior disturbs physician
leaders. Phys Exec. 2004;30:6-14.
3. Daniel S, Morse D, Reis S, et al. Physicians criticizing physicians to
patients, J Gen Intern Med 2013, 28(11):1405-9.
4. Rosenstein AH, O’Daniel M. A survey of the impact of disruptive
behaviors and communication defects on patient safety. The Joint
Commission Journal on Quality and Patient Safety, 2008, 34(8), 464-71.
5. Longo J. Combating Disruptive Behaviors: Strategies to Promote a
Healthy Work Environment. OJIN: The Online Journal of Issues in Nursing
2010, 15, 1 Manuscript
6. Holmes D., Tumiel-Berthalter L. Zayas L., Watkins R., ‘Bashing’of medical
specialties: students’experiences and recommandations, FamMed
2008;40(6) 400-6.
7. Kamien BA, Bassiri M, Kamien M. Doctors badmouthing each other.
Does it Affect medical students’ career choices? Aust Fam P hysician.
1999 Jun;28(6):576-9.
8. Rosenstein A. Managing disruptive behaviors in the health care
setting: process, policy, prevention and intervention. Adv Psychol Res.
2009;72:1-14.
❑
❑
Offre valable jusqu’au 30/06/2014
www.concoursmedical.fr
❑
❑
❑
❑
❑
❑
J’accepte d’être inscrit au site egora.fr, J’accepte de recevoir
le site des professionnels de santé les newsletters
❑ ❑
chèque à l’ordre de Global Média Santé
carte bancaire (sauf American Express)
N°
Expire fi n :
Merci d’inscrire les 3 derniers
chiffres fi gurant au dos
de votre carte bancaire
Date et signature obligatoires
Spécialité :
Je complète les informations me concernant : M. Mme
Nom : Prénom :
N° : Rue :
Code postal : Ville :
Tél. :
E-mail :
Global Média Santé
Service abonnements
314, Bureaux de la Colline
92213 Saint-Cloud Cedex
À envoyer avec votre règlement à :
Conformément à la loi Informatique et libertés, vous disposez d’un droit d’accès
et de rectifi cation pour les informations vous concernant, que vous pouvez exercer
librement auprès de Global Média Santé- service abonnements - 314, bureaux de
la colline - 92213 Saint-Cloud cedex.
`
124
1 an d’abonnement
Z
les archives de votre revue
de nombreux conseils juridiques
les initiatives de vos confrères
sur le terrain et de nombreux
autres contenus !
www.concoursmedical.fr
les archives de votre revue
de nombreux conseils juridiques
les initiatives de vos confrères
sur le terrain et de nombreux
autres contenus !
NOUVEAU
L’ACCÈS ILLIMITÉ
AU SITE INTERNET
DU CONCOURS MÉDICAL
avec
BULLETIN D’ABONNEMENT
Tous droits reservés - Le Concours médical
1
/
4
100%