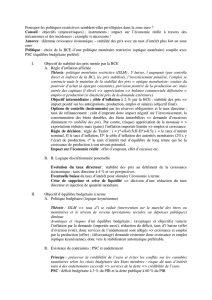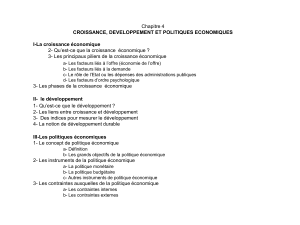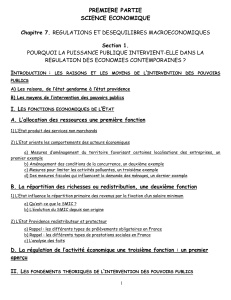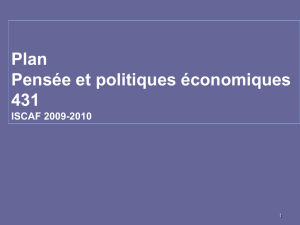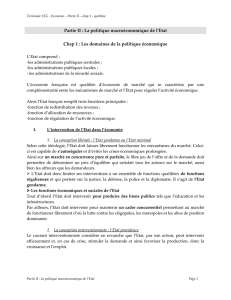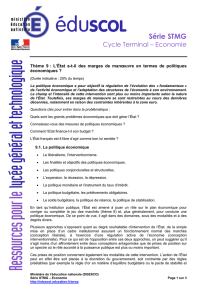L`inflation française de 1922-1926, hasards et coïncidences d`un

1
L’inflation française de 1922-1926, hasards et coïncidences d’un
policy-mix : les enseignements de la FTPL
Jean-Charles Asselain
(Correspondant de l’Institut, Professeur à l’Université Montesquieu-Bordeaux IV,),
Bertrand Blancheton
(Maître de Conférences à l’Université Montesquieu-Bordeaux IV),
Christian Bordes
(Professeur à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne),
Marc-Alexandre Sénégas
(Professeur à l’Université Montesquieu-Bordeaux IV).
La Première Guerre mondiale, au sortir d’un siècle de monnaie stable et d’équilibre
budgétaire, constitue pour tous les pays belligérants un choc macro-économique majeur.
L’après-guerre hérite non seulement d’un endettement d’une intensité sans précédent et d’un
alourdissement durable des charges de l’Etat (Reconstruction, indemnisation des victimes de
guerre : la part des dépenses publiques dans le PIB est passée de 8,8% en 1912 à 27,8% en
1920), mais aussi d’une dynamique de déséquilibres cumulatifs qui, en France, se sont
poursuivis et amplifiés jusqu’en 1926 (stabilisation Poincaré). Les choix des gouvernants, les
décisions des autorités monétaires sont alors soumis à des contraintes qui limitent leur marge
de manoeuvre, mais appelés néanmoins à exercer sur la conjoncture une influence bien plus
directe que par le passé, en raison des responsabilités nouvelles que confère à la politique
monétaire le régime de cours forcé et à la politique budgétaire le poids accru de l’Etat.
Cette phase d’apprentissage de la régulation conjoncturelle est considérée comme un
échec complet. A l’époque, les contemporains déplorent les dérives budgétaires, les crises de
change à répétition et la hausse du coût de la vie du fait d’une inflation manifestement
incontrôlée. Alfred Sauvy (1965) évoque “ l’océan d’erreurs ” qui caractérise la période, il vise
tout à la fois la classe politique et la haute fonction publique incapables l’une comme l’autre de
comprendre des phénomènes économiques nouveaux et de prendre des mesures appropriées.
Dans ce néant, seule la stabilisation Poincaré fait figure d’heureuse décision.
Depuis les années 1980, l’expérience française des années 1920 a fait l’objet d’un
regain d’intérêt. Deux thèmes ont été particulièrement étudiés : d’une part l’analyse des causes
de la dépréciation interne et externe du franc jusqu’en juillet 1926 et d’autre part la
compréhension du “ miracle ” Poincaré. Les deux questions sont bien entendu étroitement liées
puisque le tarissement de la source des dérives monétaires et financières explique - dans une
large mesure - la réussite de la stabilisation. De manière transversale deux types de facteurs

2
explicatifs des événements peuvent être discernés : certains auteurs insistent sur l’influence de
la dynamique budgétaire, d’autres mettent plutôt en avant le rôle de la politique monétaire.
Dans le sillage des analyses d’époque, les contributions jouent abondamment du
contraste entre les dérives et les échecs en tous genres de la période 1919-1926 et
l’extraordinaire succès de la stabilisation Poincaré jusqu’en 1928 voire au delà puisque au
“ miracle Poincaré ” succède l’exception française d’une entrée tardive dans la grande
dépression mondiale de 1929. Les auteurs à l’origine des anticipations rationnelles (Sargent
(1986), Dornbusch (1989)) voient notamment dans l’expérience Poincaré l’illustration de leur
point de vue selon lequel une désinflation est possible sans recul important de l’activité
économique à la condition que le programme de lutte contre l’inflation soit crédible. C’est
l’absence de crédibilité qui est précisément aux sources des dérives antérieures.
Blancheton (2001) invite à nuancer la vision d’un échec complet du diagnostic et de la
conduite de la politique économique française du milieu des années 1920. Dès 1922, les
responsables de la direction du Trésor ont correctement analysé l’incompatibilité entre la
situation des finances publiques et l’objectif de revalorisation du franc, très tôt la nécessité
d’une stabilisation-dévaluation est proclamée au sein de l’administration. De même, au total,
dès 1926 la politique économique française ne fait-elle pas figure de réel succès à mi-chemin
entre l’expérience britannique de retour de la livre à son ancienne parité or coûteuse en matière
de croissance et d’emploi et la faillite monétaire allemande de 1922-23 totalement
déstructurante sur le plan social et pour longtemps traumatisante. En définitive l’inflation
française n’a-t-elle pas permis d’absorber - au moindre coût - le choc financier de la Première
Guerre mondiale ?
Sur la base de cette intuition notre contribution entend d’abord étayer la thèse d’une
certaine réussite de la politique économique française jusqu’en 1926. Elle souhaite aussi
parfaire la connaissance du processus inflationniste français de l’époque en se situant dans un
cadre théorique qui intègre les conséquences des interdépendances entre la politique budgétaire
et la politique monétaire. Nous souhaitons plus particulièrement attirer l’attention sur la
pertinence de la souplesse monétaire alors à l’œuvre dans le contexte budgétaire de l’époque.
Paradoxalement une politique monétaire plus rigoureuse aurait été à l’origine d’une dérive
inflationniste beaucoup plus marquée.
Au total, le succès résiderait plus dans la conduite de la politique économique d’avant
1926 que dans la réalisation technique de la stabilisation et le rôle déterminant du thaumaturge
Poincaré : l’inflation avait alors fait son œuvre en rendant compatible valeur réelle de la dette
publique et retour à une convertibilité or du franc. Le “ miracle ” Poincaré devient alors le
miracle du ‘policy-mix’ à l’œuvre entre 1922 et 1926. Miracle au sens où le succès ne résulte
pas de l’application d’un plan réfléchi mais au contraire d’un enchaînement incontrôlé de chocs
graves et de palliatifs improvisés. Miracle également au sens où d’autres ‘policy mix’ auraient
pu engendrer une dynamique hyperinflationniste.
Pour défendre ces idées, nous allons nous situer dans le cadre théorique de la ‘Fiscal
Theory of The Price Level’ (courant d’analyses macro-économiques qui étudient les
conséquences inflationnistes des interactions entre politiques monétaire et budgétaire), plus
précisément nous proposons une extension du modèle de Loyo (1999) c’est-à-dire un cadre
d’économie ouverte où la dette est susceptible d’être le principal déterminant de la progression
du NGP.
Jusqu'à présent seuls Sargent (1986), Eichengreen et Wyplosz (1988) et Villa (1993)
avaient tenté de modéliser les événements monétaires et financiers français de la période. Par
rapport aux contributions existantes plusieurs “ avancées ” peuvent être mentionnées. Nous
proposons une analyse plus “ intégrée ” sur le plan formel de l’influence de la politique

3
monétaire et de la politique budgétaire sur la dynamique des prix en France, nous proposons
une identification claire des changements de régime à l’œuvre sur la période en attirant
notamment l’attention sur l’importance de la défaillance financière allemande à partir de 1922
qui parce qu’elle modifie la donne en matière financière semble faire basculer la France dans un
régime budgétaire non ricardien.
Notre démarche se déroule en quatre temps, au rythme d’un va et viens entre analyse
historique et théorie économique. Une première section dégage les faits stylisés de la période.
Une deuxième section met en perspective les contributions consacrées à l’analyse économique
de l’histoire française entre la fin de la Grande Guerre et la stabilisation de droit du franc en
juin 1928. La troisième cherche à qualifier les régimes monétaire et budgétaire à l’œuvre en
France à l’époque. La quatrième section expose le cadre théorique retenu dans le prolongement
du modèle de Loyo. Enfin la conclusion souligne les limites de cette modélisation et les progrès
qu’il conviendrait de réaliser pour mieux appréhender les événements français.
.1. Rappel des faits stylisés
La séquence des déséquilibres monétaires d’après-guerre, dont la stabilisation de 1926 (
le “ miracle ” du franc Poincaré) constitue le point d’orgue, peut se découper en trois phases,
de durée inégale et fortement contrastées :
- les déséquilibres et incertitudes de l’immédiat après-guerre (1918-1922)
- la phase de dépréciation cumulative du franc (1922-juillet 1926)
- le dénouement inespéré (juillet-décembre 1926)
.1.1. L'immédiat après-guerre: réalités et illusions (1918-1922)
La fin du conflit, suivie par le démantèlement du contrôle des prix et l'interruption de la
solidarité financière interalliée, révèle l'intensité des pressions inflationnistes. Les dépenses de
guerre (160 milliards de francs, soit plus de trois fois le revenu de 1913) n'ont été financées par
l'impôt qu'à concurrence de 15%, le reste provenant de l'emprunt et de la création monétaire.
En 1918, la circulation fiduciaire a déjà quintuplé par rapport à 1913. Les prix de gros (par
rapport à 1913 = 1) atteignent le coefficient 3,4 (contre 1,9 aux Etats-Unis et 2,3 en Grande
Bretagne). La dépréciation du change s'amorce un peu plus tardivement, mais s'amplifie à
travers l'année 1919, en avril 1920, le franc a perdu les deux tiers de sa valeur vis-à-vis du
dollar par rapport à la parité d'avant-guerre.

4
Circulation fiduciaire et avances directes à l'Etat (1914-1926)
0
10
20
30
40
50
60
janv-14
juin-14
nov-14
avr-15
sept-15
févr-16
juil-16
déc-16
mai-17
oct-17
mars-
18
août-18
janv-19
juin-19
nov-19
avr-20
sept-20
févr-21
juil-21
déc-21
mai-22
oct-22
mars-
23
août-23
janv-24
juin-24
nov-24
avr-25
sept-25
févr-26
juil-26
déc-26
en milliards de francs
Circulation
Avances
Plafond circulation
Plafond avances
Graphique 1. Source, d’après les bilans hebdomadaires de la Banque de France, Statistique Générale de
la France.
L'impact financier de la guerre ne se limite pas à un choc intervenu “ une fois pour
toutes ”. En 1919, le déficit budgétaire atteint encore 26,7% du Revenu National selon Sauvy
(28% du PIB selon Villa) et le montant de la dette s'élève à 2 fois celui du PIB (alors qu'au
lendemain de la défaite de l871, le rapport Dette / PIB était seulement passé de 0,6 en 1869 à
0,95 en 1875). Les dépenses de Reconstruction culminent à 17% du Revenu National en 1921,
et les intérêts de la dette absorbent à eux seuls la même année 45% des recettes budgétaires.

5
Solde budgétaire brut en France (1919-1930)
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930
en milliards de francs
SOLDE BUDGETAIRE
Graphique 2. Source : Statistique Générale de la France.
Dynamique de la dette publique de la France (1919 -1930)
100
150
200
250
300
350
400
1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930
en millards de francs
50
70
90
110
130
150
170
190
210
230
250
DETTE NOMINALE
DETTE/PIB*100
Graphique 3. Source Villa P., Une analyse macro-économique de l’économie française au XXè siècle,
Paris, CNRS Editions, 1993.
Cependant, malgré la violence des ajustements de l'après-guerre, on ne saurait parler
pour cette période de l'amorce d'un processus cumulatif d'inflation, ni a fortiori d'une
évolution vers l'inflation galopante comme en Allemagne.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
1
/
28
100%