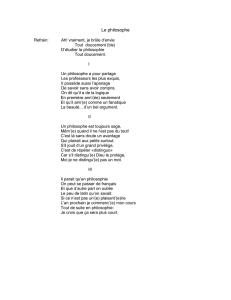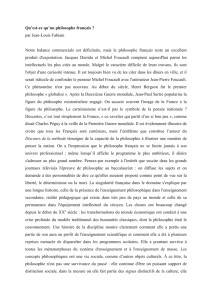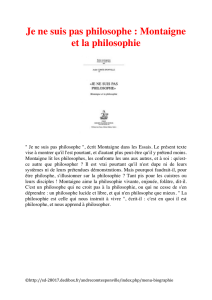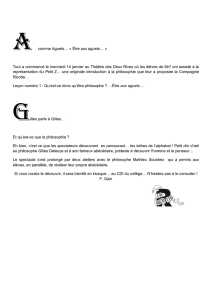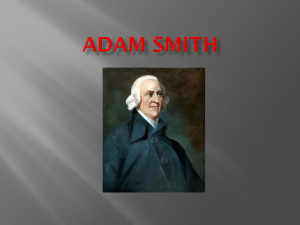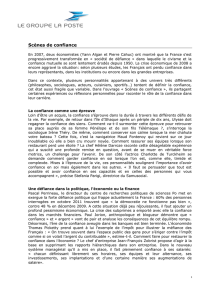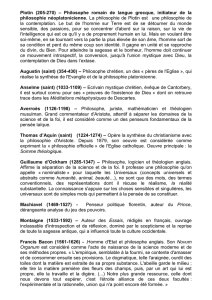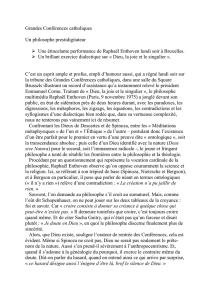Le philosophe a mauvaise réputation

Penser
Le philosophe a mauvaise réputation. On pense à
l’inaccessible vieillard recroquevillé dans une poussiéreuse et
sombre tour d’ivoire. Pire aujourd’hui : on repousse l’image du
vieux beau qui, chemise blanche et cheveux mi-longs, brandit
un air brillant en soufflant le blabla du docteur. Il voudrait se
faire passer pour un médecin de l’âme, mais la lumière est trop
forte pour qu’on ne voie pas qu’il répète ce qu’ont dit les
anciens.
La première impression est-elle la bonne ? S’en tenir au
costume sans prêter attention aux répliques semble hâtif : s’il
occupe parfois le devant de la scène, le philosophe prétend
avoir affaire aux coulisses du paraître, il déclare toucher l’être.
Le problème c’est qu’on ne peut le croire sur parole, et les
preuves sont logées derrière un rideau qu’on redoute de lever.
On aimerait savoir d’avance si ça vaut la peine d’entrer. En
d’autres mots on se demande si la philosophie sert à quelque
chose.
La question est très bonne. La réponse « à rien, comme les
arts », est très mauvaise. On saurait dire que les arts font
advenir le nouveau et la beauté. Certains avancent que c’est la
demande qui est inutile puisque de la même façon on ne
pourrait répondre à la question : « l’amour, à quoi ça sert ? ».
Mais ils n’ont pas remarqué que la seule qui vaille en la matière
c’est : « m’aimes-tu ? ». Par conséquent la question de l’utilité
est bonne, et elle est parfaitement philosophique quand elle se
pose à la philosophie.

Rapportée à nos existences fragiles, les ambitions des
penseurs n’apparaissent pas toujours d’un grand secours, et
empêchent parfois de se nourrir des proches pour tenir le coup.
A ce sujet on bave beaucoup sur les autres, mais on en a besoin.
Du philosophe, moins. Il me faudra donc plusieurs pages pour
faire apparaître l’utilité de sa quête dans les méandres de l’être.
Je veux en dresser un portrait plus sympathique à partir de ce
qu’on imagine. Il gagne en effet à être connu.
●
Je connais le grief : le philosophe est à côté de la plaque. Il
s’occupe de problèmes abstraits et, par là même, n’est d’aucune
utilité quant à la conduite de la vie ordinaire. On aimerait qu’il
intervienne quand on est démuni, là où on ne doit compter que
sur ses propres forces et qu’elles font défaut. On le solliciterait
volontiers quand il y a un nœud, et qu’on est obligé de
s’arrêter : lui qui en a l’habitude, il saura quoi faire. Perdu dans
une impasse où ni nos réflexes vitaux ni la possibilité de
consulter un spécialiste (mécanicien, psychologue) ne sont
efficaces, on pense à celui dont le métier est à l’ordinaire de
résoudre des apories absurdes dans lesquelles il se fourre avec
joie. Les principes pratiques qu’il formulerait n’auraient même
pas à être vrais, seulement à nous faire exister face au destin.
Mais le philosophe ne fait souvent que jouir de nous mettre
encore plus dans le doute. Ses propos dégoulinants sont
inapplicables, il continue de traiter des questions les plus
sérieuses avec un enthousiasme douteux. Et s’il ne fait que
préparer le terrain, ça ne peut pas aller bien longtemps. Que
dirait-on d’un cuisinier qui prétend préparer de bonnes choses
sans jamais faire goûter ses plats ? Il est tout à fait nécessaire de
passer à table. Or le philosophe a la fâcheuse habitude d’arriver
quand la vaisselle est faite.
Le pire c’est qu’après avoir piqué dans nos assiettes, il
continue de donner des leçons obscures sur la façon dont on les
essuie : les repères idéologiques ne sont pas de son goût, le

recours au bon sens déclenche son écoeurement, et il tient à le
partager. C’est celui qui croit tout savoir sur tout et tous, et que
pourtant on n’entend pas. Perdu dans un cosmos où l’on
marche sur la tête il semble s’intéresser à notre vie, mais joue
sur les mots. Il pinaille, il parle pour ne rien faire : quand il
disserte sur le bonheur, il fait la gueule. D’ailleurs à écouter son
blabla à la lettre on en viendrait vite à croire qu’on devrait tous
se taire. On pense illico à une sorte de dédain. On dirait qu’il
veut nous priver de notre liberté de conscience, on le voit
comme geôlier de la pensée.
Le comble c’est qu’il serait bien incapable de vivre dans
notre réalité. Il a beau jeu de se prélasser dans l’inutile : seule
une position privilégiée (poste d’Etat, université populaire,
fauteuil doré chez un ami éditeur …) lui permet de vivre
comme il prétend le faire. Or il en jouit comme si de rien n’était
et signifie sa distance en mimant une posture céleste. Plutôt que
lier, permettre la discussion et la recréation d’une communauté
où chacun pourrait satisfaire le besoin de se situer, le
philosophe chante une vie plus que personnelle, au-delà de la
subjectivité. N’est-ce pas parce qu’il est incapable de supporter
les souffrances qu’elle cause ? D’ailleurs cette existence n’est
pas aussi altruiste qu’il le dit parce qu’avec lui, il n’y a pas de
partage : il propose l’amour verbal, mais l’autre se sent vite
minable, et quand il se dirige vers ses pairs il est dans la lutte.
Alors il paraît loin des gens qui, eux, s’ancrent mutuellement
dans la vie en prenant soin les uns des autres pour un temps. Sa
solitude est affront. Il est ailleurs, au lieu de participer à la vie
commune. Le poète aussi, mais il a l’avantage de faire rêver ; le
philosophe, lui, plombe l’ambiance.
●
Que penser de ce réquisitoire ? Je ne saurais décemment
nier que la posture philosophique est liée à un intérêt de classe.
Mais certains exemples vont contre : si Diogène fait la leçon, il
profite d’un tonneau qui ne doit rien aux inégalités sociales. En

tout cas on ne peut réduire le philosophe à la place qu’on veut
bien lui accorder suivant les époques. Ceci dit clarifier son
rapport aux communautés et à leurs chères représentations
renseigne sur son activité. On pourrait dire avec humour qu’il
sert à rassembler ceux qui le détestent : bouc émissaire, il est
celui qu’on invective parce qu’on ne comprend pas. Il faut
surtout voir qu’il a en propre de se tenir à distance. Il ne
participe pas à la vie commune parce qu’il se retire de la
relation normale au monde, de sa jouissance immédiate, il
suspend les réactions et se désintéresse de ses enjeux ordinaires.
A quoi sert cette distance ? A éviter de se laisser emporter
par le tumulte du monde, à se méfier des représentations
efficaces qui imposent le stable et le même pour forger quelques
repères utiles dans l’instabilité du monde. A force de
fonctionner, l’idéologie et le bon sens nous enferment dans une
vision arrêtée, elles nous font prendre ce qui est pour la seule
chose qui puisse être. S’ensuit la caution de l’ordre établi, les
tendances légitimistes, la nocive fermeture de l’accord à soi-
même. Les conséquences sont parfois fâcheuses, on légitime les
pires injustices au nom de la nécessaire réactivité inhérente à la
vie pratique (la stigmatisation des minorités par exemple). Or la
sagesse du philosophe consiste à dissoudre ces tendances en
amont, au niveau de l’embryon représentationnel. Il sait qu’il y
a une impérieuse nécessité à être actuel, à penser ce qui est en
train de se faire, mais il sait qu’il n’y a pas de philosophie du
direct. Il s’applique donc à décoller nos modes de pensée de
l’urgence.
Le philosophe s’ouvre à une autre façon de voir. Au lieu
de partager les jugements hâtifs, faciles et protecteurs dans
laquelle se précipite parfois la liberté de penser, il se met en
quête d’une altérité que, agrippés au fait d’être ensemble, nous
ne saurions apercevoir. S’il n’est d’aucun secours au moment
où il faut agir sans se poser de questions, c’est en ce sens parce
que dans ce cas on recrute son corps et sa pensée comme outils

alors que lui recrute sa pensée pour comprendre. Il cherche à
mettre vie à l’autre dans son langage, lors que nous le
considérons par le petit bout de la lorgnette. Or en s’attachant
constamment à mettre sens à l’altérité, il la manifeste à nos yeux
et commence à la faire naître dans nos consciences. La sagesse
intervient quand toute cette démarche renvoie à la nécessité de
nous donner à nous-mêmes un sens aussi profond qu’à cet
étranger qu’on accepte enfin. Mais lui n’est pas le sage,
seulement philo-sophos, l’ami du sage. Il ne donne donc pas de
leçons, pas plus qu’il ne livre des choses directement utilisables.
Il indique seulement la voie d’un amour.
●
Il n’y a pas de rupture définitive entre nos représentations
ordinaires et les concepts philosophiques. Se représenter le
monde (construire une image qui subsiste indépendamment de
son objet) est naturel à l’homme. Nous jouons avec le sens, nous
nous faisons des représentations de représentations qui
permettent de mettre en lien des morceaux épars de notre
expérience. Ceci permet de se représenter globalement le
monde ou la vie, chose inexpérimentable, pour tenter de s’y
situer, ou encore de poser des fins ou idéaux pour mettre en
branle une certaine liberté d’agir. Or le philosophe ne fait pas
autre chose. La seule différence, c’est qu’il la pousse à bout : il la
prend au sérieux et veut passer de l’imagination au concept.
Cette aventure doit être explicitée.
Le philosophe commence par décoller les représentations
de ce qu’elles représentent. Il s’y attarde et fait l’effort de ne pas
les plaquer sur le monde pour pouvoir en jouir et y agir. En fait
il refuse de se défausser de leur valeur. Il se propose au
contraire d’en assumer la subjectivité. D’ailleurs si les
représentations permettent en quelque façon de disposer du
réel à sa guise, à y regarder de plus près elles sont structurées
par un ordre qui n’est pas choisi. Plutôt que baigner dans des
représentations apprises sur lesquelles pèse la charge publique,
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%