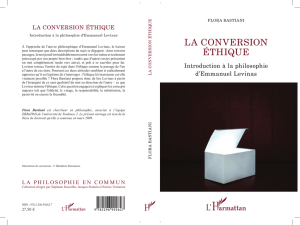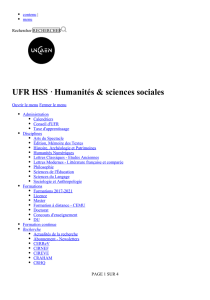Télécharger PDF

COLLECTION
« Philosophie — d’autre part »

© La Phocide, Strasbourg, 2008
ISBN 978-2-917694-00-8

Gérard Bensussan
éditions de
La Phocide
Éthique et expérience
Levinas politique

L’éthique au sens extra-moral
M’aime-t-on, moi… On n’aime jamais personne,
mais seulement des qualités.
Pascal
Présenter d’un seul tenant une pensée aussi forte, aussi origi-
nale, aussi singulière que celle d’Emmanuel Levinas expose à une
difficulté majeure. Comment savoir en effet par où commencer,
depuis quel angle y entrer, par quel bout l’introduire ? Toute dé-
cision risquera de paraître arbitraire, tout choix déterminé exclu-
sif ou forcé. Il y va bien pourtant d’un choix qu’il faut faire, d’une
décision d’exposition qu’il faut prendre. À y réfléchir avec un peu
de conséquence, partir de ce que n’est pas la pensée de Levinas,
et pour quoi bien souvent et faussement on la tient, n’est pas le
moins judicieux. Peut-être cernera-t-on ainsi un paradoxe si sur-
prenant qu’il semble ici ou là conduire à de redoutables mésin-
terprétations. Les prévenir n’est pas la plus mauvaise voie d’accès
à une œuvre chargée de méprises et encombrée de lectures sim-
plifiées mais parfois dominantes.
Le registre où s’inscrit massivement cette pensée, l’espace où
son actualité sans éclipse a paru en imposer les motifs, c’est, comme
chacun sait, « l’éthique ». Or sur ce point, sur ce terme d’éthique
et ses usages extensifs, il convient d’emblée de n’être « pas dupe »
et d’user d’une extrême prudence. Dans la réception de l’œuvre
de Levinas au sens le plus large, c’est-à-dire par un public de non-

6Éthique et expérience
philosophes au sens strict, de non-spécialistes, et alors même
qu’elle convoque par ailleurs une conceptualité si neuve qu’elle
eut et continue d’avoir la réputation d’être difficile, le thème de
l’éthique et le thème, plus ou moins concomittant, de la respon-
sabilité se sont surimposés, comme d’eux-mêmes, et très légiti-
mement. En son temps et dans ses modalités datées, la réception
de Levinas fut en bonne part réactive. La connaissance et la re-
connaissance de l’œuvre ont été relativement tardives. Si l’on de-
vait en restituer l’histoire dans le panorama mouvant des idées
philosophiques, on s’apercevrait que Levinas, pendant une bonne
trentaine d’années, n’a été ni lu ni entendu, sauf par quelques
« amateurs » qui allaient l’écouter au Collège philosophique de
Jean Wahl ou à l’École Normale Israélite Orientale pour ses lec-
tures talmudiques du samedi matin. Marqués par le marxisme et
l’existentialisme, puis par le structuralisme, surdéterminés par la
conjoncture politique (la guerre froide, les guerres coloniales, le
thème mobilisateur du « changer le monde »), les grands débats de
l’après-guerre en France l’ignorent complètement, alors que lui
ne les ignore nullement, certains de ses textes et articles en té-
moignent avec précision. Le recul permet d’aisément comprendre
ce qui s’est passé, du silence fait sur l’œuvre à son accueil œcu-
ménique. Les années soixante et soixante-dix furent très attentives
à l’histoire et à ses vections, soit à ce que Levinas déterminera
comme « totalité ». L’époque était soucieuse d’urgences immé-
diates et collectives où l’individu ne pouvait se donner « sens »
qu’en se subordonnant à un projet qui le dépassait et l’englobait,
à un projet révolutionnaire universel et mondial. Une méditation
comme celle de Levinas, sur ma responsabilité pour un autre sin-
gulier quoi qu’il fasse, au point que je peux être responsable de sa
responsabilité même, et sur l’unicité inentamable de la subjecti-
vité répondante, ne pouvait alors qu’apparaître intempestive, hors-
situation et sans effets d’actualisation. La conjoncture qui permit
ensuite que Levinas soit enfin lu est portée par une récession gé-
nérale des « sciences humaines », surtout du marxisme et du struc-
turalisme dominants dans les années soixante-dix, liée elle-même
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
1
/
105
100%