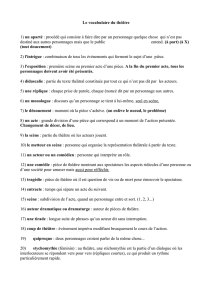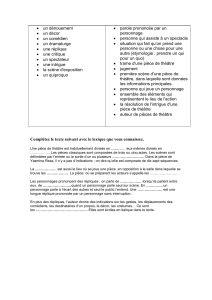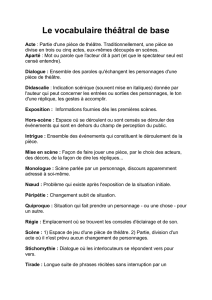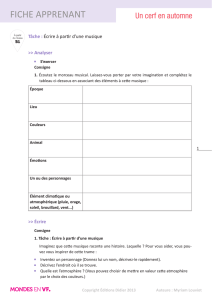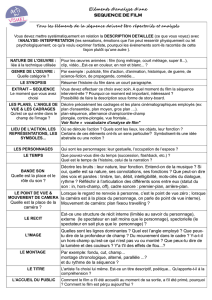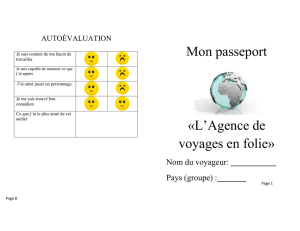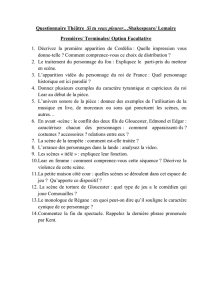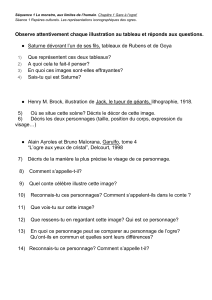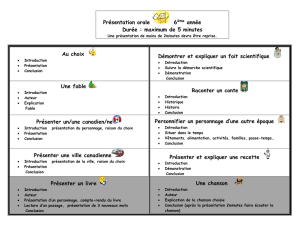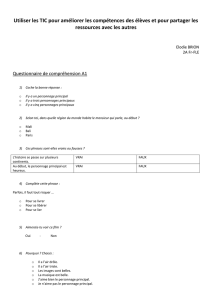Duplicité(s) de l`acteur

Duplicité(s) de l’acteur
Olivier Saccomano
Mon intervention part d’un constat : dans un large courant de l’idéologie théâtrale
contemporaine, la notion de « jeu » n’est plus en vogue. Une raison, pour expliquer cette
disgrâce, serait le lien historique que cette notion entretient avec un régime théâtral précis,
déclaré aujourd’hui périmé, à l’intérieur duquel elle servait à penser un certain rapport de
l’acteur au texte, cadré par la notion de personnage. Or, comme c’était en général sur fond de
ce rapport qu’on se représentait habituellement la duplicité singulière de l’acteur, la saisie
théorique de l’acte de l’acteur s’en trouve aujourd’hui affectée : cet acte, délesté de sa
duplicité « classique », tend désormais à être pensé sur le registre de la performance. Et,
poursuivant ce jeu de dominos, si l’acteur est pensé comme présence performative, c’est l’art
du « théâtre » lui-même qui se trouble : ayant perdu son opérateur « historique » en la
personne de l’acteur duplice, il devient « spectacle vivant », au même titre que la danse, le
cirque, le concert, voire l’exposition, avec lesquels les frontières se brouillent. C’est cette
collusion historique des arts qui se signale à nous sous le terme ministériel – souvent repris la
bouche en cœur par les responsables de structures et les artistes – de « transdisciplinarité »,
par où l’on semble être passé du spectacle total dont rêvait le vieux Wagner à son inversion en
un tout-spectacle homogène à nos sociétés libérales.
Cette tendance idéologique ici rapidement dessinée se mesure concrètement en termes de
production, de diffusion et de formation des acteurs. Nous ne sommes pas encouragés, par les
temps qui courent, à poursuivre dans la voie de ce qu’un dignitaire du régime a une fois
appelé, faute de mieux et pour le mieux distinguer des pratiques en vogue, du « théâtre
théâtre ». En hommage à son désarroi, j’essaierai de dire ici ce que je crois pouvoir être
aujourd’hui ce « théâtre théâtre » qui n’est pour moi ni une continuation aveugle de l’ancien
régime ni une dissolution du théâtre lui-même au profit du spectacle performatif. Or, je crois
que la troisième voie qui se dessine, si elle renvoie dos à dos les positions réactionnaires et les
dernières postures de la mode, doit précisément avoir pour centre une pensée renouvelée de la
duplicité de l’acteur. Aussi je vous proposerai d’analyser attentivement cette notion de
duplicité, à partir de ses mutations théoriques, pratiques, non seulement pour dresser une
histoire du concept, mais aussi et surtout pour soutenir les décisions auxquelles l’histoire de
notre art nous convie aujourd’hui.
Pour éclairer nos lanternes et tracer le schéma de ces mutations, je distinguerai trois types de
duplicité qui nous serviront en quelque sorte de patrons pour penser la duplicité de l’acteur :
la duplicité mimétique, la duplicité imaginaire et la duplicité scénique1. Ces types, que je
propose comme balises théoriques pour nous orienter dans la question, on peut évidemment
les faire correspondre à des périodes historiques, les référer au temps de leur naissance, à des
mutations, à certaines époques, des techniques théâtrales et des modes de constructions
subjectives. Mais on peut, je crois, les entendre aussi bien d’une autre oreille, comme
différentes manières toujours actuelles de penser et de pratiquer l’art du théâtre.
1 Cette séquentialisation de la question en trois temps fait écho à la tripartition historique et théorique proposée
par Denis Guénoun, distinguant pour sa part l’époque de la mimèsis, celle de la représentation, et celle du jeu.
Certains développements ici présentés concernant la notion de duplicité peuvent profitablement s’entendre dans
le cadre d’un dialogue serré avec ses analyses.
Denis Guénoun, Le théâtre est-il nécessaire ?, Circé, 1997, 178 p.

Duplicité mimétique : soi et un autre
Sous le nom de « duplicité mimétique », examinons d’abord une opération qui fut, à son
origine (grecque), pensée à partir d’une dualité bornée par deux termes, deux instances :
« soi » (autos) et « un autre » (allos). Bien sûr, cette dualité n’ouvre à la question de la
duplicité comme telle que si interviennent, dans la relation entre « soi » et « un autre », des
protocoles pratiques qui ne laissent pas ces termes en extériorité l’un à l’autre, mais fassent
passer de la dualité initiale à une unité duplice.
Disons d’abord qu’un des traits généraux de la duplicité mimétique est qu’elle part d’un sujet
(un « je ») mais, si l’on peut dire, le réfère ou l’inféode à un autre sujet (un autre « je »).
J’emploie ici le terme « sujet » à dessein, tout moderne qu’il soit, car il permet de faire
entendre les deux versants travaillés par l’analyse de la duplicité mimétique : un versant
stylistique portant sur le « sujet » de l’énoncé poétique (vidé de toute référence à une
intériorité ou à une identité), et un versant que l’on pourrait qualifier de psychique, portant sur
le « sujet » humain défini dans une relation d’assujettissement à un autre « sujet », devenant
par là le sujet d’un autre sujet, son second, et se retrouvant mené par le premier.
Cette pensée de la duplicité mimétique, on la trouve développée au plus haut point chez un
auteur paradoxal quant à la théorie de l’acteur : Platon. Je dis « paradoxal » non seulement
parce que l’extrême précision et l’infinie richesse de sa pensée sur la mimèsis se déploient
dans le cadre de ce qu’il faut bien appeler un réquisitoire à l’encontre de la pratique du
théâtre, mais surtout parce qu’à l’instar de tous ses camarades grecs, Platon n’aborde jamais
vraiment directement la question de l’acteur (de l’hypokrites). Je pense pourtant que les
analyses platoniciennes, en tant qu’elles portent singulièrement sur ce qui arrive au sujet
miméticien (là où Aristote se concentrera sur l’analyse du poème mimétique), nous permettent
de saisir à partir d’un même schème la pratique du poète et celle de l’acteur : comme si, en
privilégiant sans cesse la disposition subjective, Platon nous forçait à penser ce que l’on
pourrait appeler un sujet théâtral générique, poète-acteur, qui sera pris sous les feux sévères
de son analyse politique2. Sur la question qui nous importe aujourd’hui, il fournit deux
analyses essentielles pour penser la duplicité mimétique : la première concerne le double-je
du poète mimétique (et donc, par la bande, de l’acteur mimétique) ; la seconde concerne
l’assujettissement de l’acteur au poète.
Soi « comme si » un autre : l’imitation
Au livre III de la République, examinant les divers modes du dire poétique et leur convenance
à l’horizon politique de la Cité Juste, on sait que Socrate distingue le mode simple (a-ploos) et
le mode mimétique (auquel recourent intégralement les tragédies et les comédies). Or, nous
dit-il, le premier mode doit sa sim-plicité au fait que le poète y parle lui-même (autos) tandis
que le second mode (dont on pressent déjà qu’il devra bien se soutenir, par contraste, d’une
certaine du-plicité) est ainsi configuré que le poète n’y parle pas « lui-même » (autos) mais
parle « comme si » (hospèr) c’était « un autre » (allos) qui parlait3. Ce faisant, poursuit-il, le
2 Du reste, politiquement, c’est-à-dire dans l’ordre de la Cité qui situe les pratiques sociales, on sait que les deux
activités étaient partiellement confondues, donnant lieu à ce type subjectif qu’on a appelé, depuis, l’auteur-
acteur.
3 Platon, République, 393-c, in Œuvres Complètes, Paris, Flammarion, 2008, p. 1554. Les traductions opposant
le poète qui parle « en son nom » et celui qui parle « sous un autre nom », de même que les traductions

poète fait advenir du semblable, du même (homoiein) entre lui-même et un autre. Et c’est
précisément cette manière de se rendre semblable à un autre que l’on appellera « l’imitation »
(mimèsis).
Pour Platon, il y a au fond deux manières, dans la pratique, de se rendre semblable à un autre :
il y a d’abord, si l’on veut, un protocole technique qui nous rend semblable à un autre dans la
mesure où nous faisons comme lui. C’est ce que l’on pourrait appeler la pratique du « faire
comme » : en forgeant, c’est-à-dire en faisant comme le forgeron, je fais bien advenir du
semblable entre moi et lui, à tel point que je deviens forgeron. Cette pratique se solde donc
par l’acquisition d’une technè, d’un savoir-faire. Au contraire, dans le protocole mimétique
qui règle certaines pratiques poétiques, il ne s’agit pas de « faire comme », mais de parler
« comme si » on était un autre. Ici, l’absence de transmission technique s’accompagne
symétriquement d’une charge d’être supplémentaire, d’un crédit d’être qui présente pour
Platon tous les traits d’une simulation, voire d’une usurpation. Cette distinction entre le
protocole technique (qui, par le faire-comme, conduit à un être-comme) et le protocole
mimétique (qui, par le parler-comme, induit un comme-si-on était) repose et débouche donc,
pour Platon, sur une (d)évaluation ontologique. Mais je crois que cette distinction, si l’on
dépasse l’analyse ontologique du simulacre (ou du semblant), peut aussi bien être ramenée
aux coordonnées strictement pratiques qui règlent les deux protocoles. Apparaît alors que le
protocole mimétique se distingue essentiellement du protocole technique en ce qu’il suppose
un témoin (ters-tis), c’est-à-dire un troisième larron exposé à la supercherie. Autrement dit, le
poète mimétique ne parle « comme si » c’était un autre qui parlait qu’en relation à un
troisième (« nous », dans le texte de Platon) en direction duquel l’opération est menée, et qui
accordera de l’être à tort et à travers. Du reste, ce n’est qu’à cette condition qu’on peut
comprendre pourquoi Socrate dira du poète mimétique qu’il est « caché » : on n’est jamais
caché par un autre qu’à un troisième…
Pour le formuler dans les termes qui nous réunissent : la mimèsis dans le poème a pour
fonction et pour effet de cacher le « je » du poète (appelons-le « je-Homère ») par un autre
« je » (appelons-le « je-Chrysès ») au lecteur/auditeur. Ce mode est alors affecté de duplicité
dans la mesure même où des deux « je » à l’œuvre dans ce protocole, seul le second est
présenté au lecteur/auditeur. Cela ne signifie pas pour autant que le premier soit « absent »,
tout au contraire : il est présent, et bien actif, mais en tant que caché.
En ce point, je ferai deux remarques :
1) On peut sans dommage, conformément à ce que nous disions plus haut des analyses
platoniciennes, remplacer « poète » par « acteur » dans notre développement. Si les situations
sont différentes, l’analyse retombera néanmoins sur ses trois pieds, qui auront seulement
changé de noms : l’acteur (le « je » opérateur), le texte proféré (où le « je » énoncé par
l’acteur est celui d’un autre que lui), le public (comme témoin de l’opération). Bien plus, il
faut se souvenir que, sur la scène grecque (c’est-à-dire dans l’espace de mise-à-vue du
poème), on assistait à la mise en actes de cette métaphore par laquelle Platon désigne
l’opération textuelle, puisque l’acteur cache son visage au public par un masque figurant le
visage de l’autre. On pourrait m’objecter que, dans la situation théâtrale, le public n’est jamais
dupe de la duplicité au même degré qu’on suppose le lecteur dupé dans le poème, puisqu’il
introduisant la notion anachronique de « personnage » auquel le poète mimétique donnerait la parole au lieu de
parler lui-même, doivent être écartées si l’on veut saisir concrètement de quoi il retourne.

verrait toujours le masque en tant que porté par l’acteur quand, pour le lecteur, le « je » du
poète serait intégralement masqué par un autre « je »4… Masque partiel ou masque intégral…
On peut accepter cette objection et reconnaître que le théâtre est toujours le lieu de
monstration de la duplicité comme telle, le lieu où un hiatus subjectif est exposé aux regards.
Mais cela n’annule pourtant pas les ressorts de la duplicité mimétique car, dans le cas du
théâtre de masques, l’expérience pratique nous apprend que c’est bien le masque (c’est-à-dire
le visage de l’autre) qui mène la danse de la visibilité, qui guide le protocole de mise à vue :
c’est en effet une règle essentielle de la pratique du masque que le masque doive toujours être
face au public, faute de quoi le masque meurt comme masque, puisqu’il ne masque plus. Cet
exemple rend finalement bien compte de la logique de la duplicité mimétique : ce qui doit
toujours être visible, c’est ce qui cache. Mais par contrecoup, l’acteur, face cachée par le
masque, s’y révèle aussi comme la face cachée du masque.
2) Le « comme si » qui soutient le protocole mimétique, contrairement à ce qu’une oreille
moderne pourrait y entendre, ne réduit pas cette opération à un innocent jeu de cache-cache.
La mimèsis est, pour Platon, moins l’ouverture vers un conditionnel ludique (« on dirait que
je serais Chrysès », comme disent les enfants) qu’une véritable opération de conditionnement,
entraînant des modifications subjectives tout à fait effectives. Ce n’est justement pas un
« jeu » pourrait nous dire Socrate, quand il s’agit de prévenir les effets de cette pratique chez
celui qui s’y adonne : « N’as-tu pas remarqué que les imitations, si dans la jeunesse on ne
cesse de les développer, se transforment en habitudes et deviennent une autre nature, tant pour
le corps et la voix que pour l’esprit5 ? ». Dira-t-on alors que la pratique du « comme si »
produit des effets comparables à ceux qu’entraîne la pratique du « faire comme », dans la
mesure où le protocole mimétique semble bien ici engager un rapport de conformation
effective entre soi et un autre6 ? Pas tout à fait : on ne devient pas Chrysès comme on devient
forgeron… On n’acquiert nullement, en imitant Chrysès, la compétence technique du prêtre…
Mais il n’en est pas moins vrai qu’on se conforme, en imitant Chrysès, à son caractère. C’est
là que se situe le nœud de l’affaire : le protocole mimétique, s’il ne permet aucune acquisition
technique, n’en engage pas moins une modification éthique. Prenant très au sérieux cette
modification effective, Platon nous invite à penser, en deçà de la du-plicité propre à
l’opération mimétique du poète ou de l’acteur, une sorte de « plicité » anthropologique
constituant, si l’on peut dire, le fond de la mimèsis, et qui nous exposerait toujours,
moyennant répétitions, à prendre le pli de l’autre. Si donc Platon se méfie tellement du poète
ou de l’acteur mimétiques, c’est avant tout parce qu’ils prennent inconsidérément plusieurs
plis, s’engagent dans des opérations de du-plication, de multi-plication, font proliférer les plis
à tort et à travers, et entraînent avec eux leur auditoire, multi-plié en tous sens, ondulant
comme un serpent docile aux sons changeants des flûtes mimétiques. Cette multi-plication
généralisée s’oppose alors à l’ap-plication que Platon exige du sim-ple citoyen, tenu de ne
faire qu’une seule chose. Du reste, et on l’oublie souvent, Socrate recommande la mimèsis au
citoyen pour peu que le seul autre auquel il se conforme soit un modèle de vertu, et de la vertu
éthique particulière que ce citoyen est encouragé à développer conformément à sa classe et
sur les bases de la stricte division du travail que préconise la République. La mimèsis, si elle
est bien une donnée anthropologique, ne saurait donc être exclue de la Cité. Mais elle est une
4 Il s’agit, comme toujours, de distinguer ces duperies selon l’intensité des effets de crédibilité ou d’entraînement
qu’elles produisent. La duperie n’est jamais totale, faute de quoi c’est l’opération mimétique elle-même qui se
dissout dans le canular.
5 Platon, op. cit., 395-d, p. 1557.
6 Rappelons que, pour les grecs, le statut « fictionnel » ne fait nulle part l’objet d’une conceptualisation
particulière : que l’autre, en l’occurrence Chrysès, soit pour nous, modernes, un être de fiction, n’est pas pris en
compte dans l’analyse.

affaire aux conséquences politiques si graves, qu’elle ne saurait être laissée aux poètes et aux
acteurs.
Soi « mû par » un autre : la possession
La seconde analyse que nous livre Platon ne convoque pas directement le concept de mimèsis
et ses soubassements ontologiques. Elle me semble cependant avoir toute sa place dans
l’élaboration de la duplicité mimétique, dès lors qu’elle est envisagée selon ses coordonnées
pratiques, et c’est pourquoi je vous la livre ici. Cette analyse se trouve dans un petit dialogue,
précieux à bien des égards, entre Socrate et Ion, rhapsode de son état7. Au cœur de ce
dialogue, Socrate mythologise une chaîne de possédés : un aimant (la pierre de Magnésie)
figurant la divinité (ou plutôt : une muse singulière) transmet à un premier anneau (tel poète)
la force d’attirer à lui l’anneau suivant (tel rhapsode) qui attire à son tour un troisième anneau
(un public) auquel la chaîne aboutit. Intéressons-nous ici au tronçon de la chaîne qui connecte
le rhapsode au poète : nous pourrions dire, en acceptant le registre métaphorique de la force,
que le rhapsode est déterminé comme possédé (et, sur ce point précis, Socrate dit bien que
l’acteur doit être pensé au même registre8) dans la mesure où il ne produit pas lui-même la
force qui circule en lui, mais où elle lui vient d’un autre, le poète (qui la tient lui-même d’une
autre : la muse). Nous retrouverions donc ici l’autos et l’allos qui nous occupaient
précédemment.
Mais, comme toujours chez Platon, le mythe est là pour nous faire saisir un rapport, dont il me
semble qu’il y a dans ce dialogue une qualification un peu plus précise et, pour tout dire, un
peu plus matérialiste, qui est ainsi formulée : être possédé, c’est entrer dans un rythme et dans
une harmonie9. Sans développer ici autant qu’il serait nécessaire pour comprendre ce que cela
implique au niveau des diverses articulations de la chaîne, nous dirons que le rhapsode est
possédé en tant qu’il entre dans le rythme et dans l’harmonie que propose le poète. Qu’est-ce
que cela signifie ? Avant tout, il faut rappeler la place essentielle qu’occupe le rythme dans la
pensée grecque, et notamment le fait que les dispositions de l’âme y sont communément
envisagées en termes rythmiques. Cela a pour conséquence qu’un rythme extérieur (musical,
au sens large) influence directement le rythme de l’âme qui s’y laisse prendre, comme si cette
dernière se réglait petit à petit sur le rythme entendu, expérience dont la danse ou la transe
fournissent des exemples patents10. Autrement dit, dans la relation de possession, l’âme se
règlerait sur le rythme de l’autre, comme ailleurs le poète mimétique se rendait semblable à
l’autre. De ce point de vue, le lien rythmique unissant le rhapsode au poète est concrètement
pensable, du point de vue de la pratique (de l’acteur et du rhapsode), dans l’acte
d’énonciation.
Dans le curieux dialogue de sourds auquel se livrent Ion et Socrate, la distinction entre
l’énoncé (logos) et l’énonciation (lexis) n’est jamais mise à jour. Socrate essaye de savoir si
les énoncés d’Homère sont justes ou faux (et, sur ce point, le rhapsode concède bien
volontiers n’avoir aucune technè particulière qui lui permettrait de valider les énoncés
7 Platon, Ion, in Œuvres Complètes, Paris, Flammarion, 2008, p. 571-585.
8 Platon, ibid, 535-e, p. 579.
9 Platon, ibid, 534-a, p. 576.
10 C’est ce qui autorisera Aristote à penser les divers rythmes musicaux comme des homoioma (répliques) des
diverses dispositions de l’âme (ces homoioma font d’ailleurs lien avec l’homoiein qui caractérisait l’opération
explicitement mimétique analysée dans La République).
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
1
/
16
100%