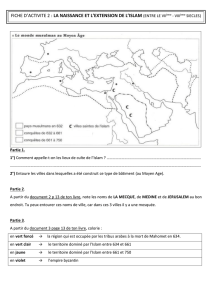Cela n`a rien à voir avec l`islam » par Vincent de Coorebyter

« Cela n’a rien à voir avec l’islam »
par Vincent de Coorebyter, professeur à l’ULB
Depuis les attentats du 13 novembre, la réflexion a été intense sur la dimension religieuse du
terrorisme islamiste. Cela ne signifie pas, pour autant, que nous y voyons clair, et encore
moins qu’un accord se dessine sur le sens du phénomène. Plus que jamais, un fossé se creuse
entre l’analyse spontanée de l’opinion et la parole des experts et des intellectuels.
Une bonne partie de la population est convaincue qu’une guerre de religion est engagée contre
l’Occident, d’autant plus inquiétante qu’elle trouve, parmi les musulmans belges ou français,
des candidats au meurtre et au martyre. Inversement, la plupart des spécialistes refusent
d’imputer le terrorisme à la religion. Les colonnes du Soir en ont témoigné, de tout autres
causes doivent être privilégiées pour expliquer le parcours souvent étonnant des terroristes
actifs en janvier ou en novembre : misère sociale et morale dans des quartiers déshérités,
failles identitaires, discriminations, parcours scolaires ou professionnels chaotiques, sentiment
d’impasse face à l’individualisme ou au consumérisme, passages fréquents par la délinquance
ou la prison… Sans parler, pour plusieurs spécialistes français du djihadisme, d’un point
essentiel dans les mobiles de nombreux terroristes : une volonté inconsciente de suicide, qui
trouve dans le martyre l’occasion de s’accomplir de manière glorieuse.
Le simple fait que l’écrasante majorité des musulmans n’est pas candidate au terrorisme et
condamne les attentats du 13 novembre suffit à prouver, en effet, que l’islam n’est pas la
cause majeure des événements. Par contre, il n’est pas sûr qu’il faille, comme le font certains,
écarter totalement l’islam de notre réflexion sur les causes de l’engagement terroriste. On peut
certes faire la démonstration que Daech constitue une version aberrante, déculturée ou
idéologique de l’islam, un monstre politique qui n’emprunte à l’islam que quelques slogans et
en simplifie grossièrement le message. Mais cela ne suffit pas à prouver, me semble-t-il, que
« tout cela n’a rien à avoir avec l’islam ». Raisonner ainsi, c’est postuler qu’il existe un
véritable islam que l’on pourrait cerner et délimiter et qui n’aurait aucun rapport avec sa
caricature, alors que jamais l’islam ne s’est laissé réduire à une définition ou à un courant que
l’on pourrait tenir pour authentique au détriment des autres. L’islam est la somme des
interprétations et des entreprises qui puisent leur légitimité dans le Coran, lequel permet
presque autant de lectures que la Bible pour les chrétiens.
Un spécialiste français du djihād, Mathieu Guidère, distingue trois types d’apprentis
djihadistes : les utopistes qui veulent changer le monde pour rétablir l’islam des origines, les
haineux qui veulent se venger de ce que la France leur a fait subir, et les psychopathes qui ne
rêvent que d’exterminer les mécréants. Comme la volonté de suicide, ces mobiles rappellent
que la religion n’est qu’un facteur parmi d’autres de l’engagement des djihadistes. Mais le
mal-être que ces derniers ressentent n’aurait pas débouché sur les mêmes actes s’ils n’avaient
pas rencontré sur leur chemin des prédicateurs appartenant à des courants radicaux de l’islam.
S’appuyant sur une lecture orientée des textes sacrés, ces prédicateurs cultivent un état
d’esprit qui, chez les terroristes, semble bien avoir facilité le passage au djihād.
Comme l’écrivait Bernard Lewis dans son grand classique, Le Langage politique de l’Islam,
c’est par excellence à l’incroyant qu’on fait le djihād : « l’incroyant non soumis est par
définition un ennemi ». Cela n’empêche pas que l’on puisse faire la paix (salām) avec lui,
mais cela le désigne comme appartenant à un autre monde, celui des mécréants. De manière
plus large, on peut s’accorder sur le fait que l’islam salafiste, qui est aujourd’hui pointé du

doigt, prône la piété, une vertu ultra-rigoriste et un travail spirituel qui sont l’antithèse de la
logique politique et militaire de Daech. Mais cela n’empêche pas de se demander si une vision
du monde fondée sur le partage entre le licite et l’illicite, le croyant et le mécréant, le
musulman et l’idolâtre, ne favorise pas le passage à l’acte dans le chef de djihadistes prêts à
tuer des occidentaux. Et s’il est clair que dans nombre de cas, l’usage de la drogue facilite le
geste final, ce geste serait-il posé si l’on n’avait pas promis aux djihadistes la félicité éternelle
accordée par Dieu aux martyrs de la foi ?
L’islam, nous l’avons vu, n’est pas la cause du terrorisme islamiste. Mais parce que
l’islamisme radical fait partie du problème, d’autres composantes de l’islam peuvent faire
partie de la solution. Car il ne faut pas s’illusionner : pour des jeunes victimes de
discriminations et d’échecs sociaux multiples, ou pour des convertis qui cherchent dans
l’islam une réponse identitaire, la parole des autorités publiques n’a pas de légitimité. Les
autorités musulmanes n’ont pas à s’excuser pour les attentats de Paris, mais elles peuvent
contribuer – avec d’autres – à prévenir d’autres attentats et une dégradation du climat.
Tout ceci renvoie à deux moyens d’agir qui tentent les gouvernements concernés, et qui
présentent des risques très différents. Les pays visés par les terroristes peuvent-ils interdire
des prédicateurs ou des discours islamistes sur leur territoire, si leur dangerosité était
prouvée ? Et ces mêmes pays doivent-ils s’appuyer sur d’autres courants de l’islam pour
contrebalancer l’influence des branches les plus menaçantes ? La première voie pose de
redoutables problèmes de principe : allons-nous limiter les libertés de religion et d’expression
au nom de la lutte pour la sécurité ? La seconde voie pose de redoutables problèmes
d’efficacité : sur qui s’appuyer, comment et pour quels résultats ?
Ces questions sont d’autant plus difficiles à traiter que certaines branches de l’islam peuvent
être concernées par les deux moyens d’agir. Le gouvernement français veut réprimer des
prédicateurs salafistes très actifs sur le Net et porteurs d’un discours ultraconservateur alors
que certains spécialistes, quant à eux, y voient un rempart contre Daech plus efficace que les
mosquées, ces imams 2.0 parvenant à s’adresser aux jeunes dans leur langage et, disent-ils, à
les engager dans un djihād contre soi-même plutôt que dans un djihād armé.
Qu’en est-il dans la réalité ? Qui représente réellement un danger, et pourquoi ? Pour mettre
en place des réponses pertinentes, il faut étudier de près le parcours des terroristes et l’impact
des différentes formes d’islam sur ce que l’on appelle, de manière beaucoup trop vague, la
« radicalisation ». Sans croire qu’agir sur les mosquées ou avec les imams suffira, mais sans
ignorer non plus la dimension proprement religieuse du problème.
1
/
2
100%