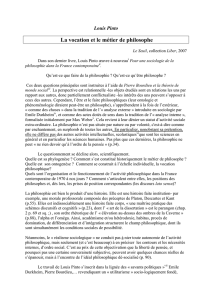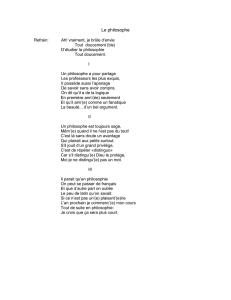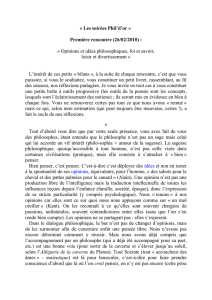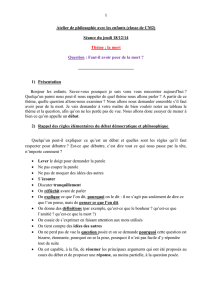pourquoi-philosopher-aujourdhui-jwa

Article Eklosia :
Pourquoi philosopher aujourd’hui ?
On ne saura jamais ce qu’est philosopher et ce qu’est la philosophie, par-delà sa figure
institutionnelle (scolaire, universitaire, éditoriale, médiatique) et l’indétermination qui entoure
les termes presque synonymes auxquels on l’apparente si naturellement (la pensée, la
recherche, le questionnement), on ne le saura jamais si, d’abord, on ne se demande pas
pourquoi, au juste, nous philosophons. Certes, l’on sait, au moins confusément, ce dont il
retourne en philosophie : son histoire nous montre des séries de concepts, parallèles à des
séries de problèmes, son étymologie indique que ces séries sont ou seraient animées par
l’amour (philia) de la sagesse (sophia), du moins par ce que l’on a coutume de traduire ainsi.
Certes, nous ne partons pas désarmés. Néanmoins, ces termes sont autant d’aspects de la
chose, de l’affaire (Sache) philosophique, envisagée comme fait positif, institutionnel,
culturel, déjà déterminé historiquement, dont la positivité même masque l’élan fondamental
qui la suscite. On ne philosophe jamais pour penser, pour questionner, pour chercher, ni pour
exercer une sagesse ou y tendre. Le croire, c’est à la fois sous-déterminer et surdéterminer la
philosophie, lui arroger rien de moins que la pensée ou la sagesse, alors qu’il ne s’agit que de
traits secondaires, non pas seulement parce qu’ils appartiennent à son histoire institutionnelle
– aux significations qui se sont sédimentées et comme agglomérées – mais aussi parce que ces
traits ne la définissent pas en propre, et en dernière instance. La pensée, la recherche, ne sont
pas la seule affaire de la philosophie, mais aussi celle des sciences, de n’importe quel savoir,
et la sagesse, celle des religions, ou celle de la vie – on se souvient de la maxime « Primum
vivere, deinde philosophari » que Blaise Cendrars avait fait sienne. Gilles Deleuze affirmait
que seul le philosophe crée des concepts ; mais il faut s’entendre sur le sens profond du
concept, de telle manière qu’on ne puisse plus appeler « concept » les outils des autres
savoirs. Si c’est le cas, si seul le philosophe crée proprement des concepts, il faut avant tout se
demander ce qui l’anime et le pousse à cette création si spécifique : cette motivation première,
en-deçà du résultat – qu’il soit concept ou sagesse – est ce qu’il s’agit de comprendre pour
pouvoir définir l’activité philosophique.
Posons donc maintenant la question : pourquoi philosopher, c’est-à-dire, que recherche le
philosophe que les autres chercheurs ou penseurs ne cherchent pas ou ne pensent pas ? Et, en
somme, pourquoi le chercher et le penser ?

Pour y répondre, nous ne pouvons évidemment pas faire fi de la dimension positive de
l’institution philosophique, mais au contraire l’expliciter. Ce qui veut dire : montrer, en son
sein, le sens latent qui la soutient, mais qui semble, de ce fait même, caché, comme recouvert
par les réponses qu’il a, en tant que question première, suscité. Il faudra également s’assurer
que ce que nous présenterons à titre de concrétude propre de la philosophie – sa Sache – lui
soit effectivement propre, c’est-à-dire, du même coup, rendre compte des effets de similitude
avec les autres formes de pensée ; rendre compte, enfin, de l’indétermination qui entoure de
prime abord l’activité philosophique, et qui semble participer de sa spécificité. Ce n’est pas
sans raison en effet que le mathématicien, le sociologue, l’historien, sont assurés de l’objet de
leur discipline et de la définition de cette dernière – ce qui ne les empêche pas, bien sûr, de la
discuter, de la raffiner – tandis que le philosophe apparaît toujours pris d’un certain doute, ou
par une certaine gêne lorsqu’un non-philosophe l’interroge sur le sens de sa pratique. Bien
plus, d’une philosophie l’autre, le sens du philosopher ne cesse d’être remis en question, à tel
point qu’une œuvre philosophique se présente toujours, au fond, comme une réponse à la
question : qu’est-ce que la philosophie ? Peut-être même n’est-il pas si exagéré de dire qu’une
philosophie est toujours une justification de la philosophie, comme si le philosophe se
justifiait, lui et sa pratique, à chaque ligne, tentait d’expliquer la pulsion initiale qui le mit, un
jour, lui et ses pairs, sur le chemin d’un tel langage, tout en sachant que jamais son explication
n’épuisera le fond du problème. Heidegger, commentant Hölderlin, soulignait que le Dieu
inconnu, se manifestant en tant que tel, dans sa fuite, est « mesure pour le poète », et, bien
plus « mesure où l’homme se mesure ». Cette présence excessive, cet excès qui transforme la
présence en absence – nous ne savons pas ce que nous cherchons, nous ne pouvons l’identifier
de manière exprimable, mais nous savons que nous le cherchons et que nous devons le
chercher, que quelque chose est là et demande à être exprimé sans que jamais l’expression ne
l’épuise – cette présence/absence, donc, il semble que le philosophe la partage avec le poète,
qu’elle soit sa mesure. Le flou, l’indétermination qui s’attachent, aux yeux du non-philosophe,
à la philosophie, loin de n’être qu’une opinion destinée à être corrigée, dit au contraire
quelque chose du philosopher, et que le philosophe sent en lui-même au fil de ses recherches.
Définir la Sache philosophique équivaut, selon nous, à déterminer l’origine de cette
indétermination : non pas combler cette dernière, lui assigner un objet définitif (ce qui serait
aussi bien surdétermination que sous-détermination), mais expliquer ce phénomène d’excès
dans la présence, sans recourir à quelque Dieu caché (qui servirait, ainsi que le dénonçait
Spinoza à propos de la volonté divine, d’asile à notre ignorance).

Il faudrait, en toute rigueur, partir de la positivité historique de la philosophie, du moins de
certains de ses moments, pour en déduire la définition recherchée, exhiber dans le fait même
de telle ou telle doctrine, le phénomène ou la motivation initiale qui les parcourt toutes : en
d’autres termes, mettre en lumière le trait unique et universel qui signe le caractère
philosophique d’une pensée. Nous disons unique et universel, parce qu’il doit être inclusif, et
être en mesure d’expliquer pourquoi, des présocratiques à aujourd’hui, nous parlons toujours
de la philosophie. Cette démarche est toutefois bien trop ambitieuse pour un article, et
demanderait les développements d’un livre, si ce n’est de plusieurs. C’est pourquoi, et dans le
but de susciter plus aisément la discussion, nous formulerons et expliciterons la définition de
la philosophie de manière à montrer son aspect inclusif et sa capacité à expliquer
l’indétermination évoquée plus haut.
Mais, avant de s’engager véritablement dans cette présentation, quelques mots, pour répondre
à trois objections possibles, et qui touchent à notre projet même : pourquoi vouloir donner une
définition unique et explicite, alors même que la philosophie s’en est depuis toujours passée,
ou du moins que l’absence d’une telle définition n’a jamais empêché la pensée philosophique
de poursuivre sa route ? Et comment s’assurer qu’elle n’emprunte pas sa conceptualité à une
doctrine déjà établie ? Enfin, le projet même de définition n’est-il pas propre à un type
particulier de philosophie, que nous dirons rationaliste, en ce sens qu’elle entend réduire la
pluralité empirique à l’unité d’une raison – dont la définition serait la formule – située hors-
champ, hors du champ de la temporalité empirique ? Nous répondrons d’abord à la troisième
question. Il est évident que même la philosophie la plus empirique, entendant faire droit à
l’immanence et à la pluralité de l’expérience, ne le peut qu’à la condition de dresser une
certaine perspective évaluatrice, de prendre du champ – le pluriel n’est plus si pluriel dès lors
qu’il est saisi par le langage – et, ce faisant, de se décider sur le sens propre à la pratique
philosophique. L’inconvénient majeur est d’adopter une perspective qui annule toutes les
autres, et les rejette dans l’erreur, cette erreur fût-elle expliquée et fondée. Ce défaut est
partagé tant par l’empirisme que par le rationalisme, mutuellement exclusifs, opérant ainsi un
partage, une scission à l’intérieur même de la philosophie. Le but est bien plutôt, en prenant
acte de la fonction unificatrice du langage, en l’assumant, de définir un sens du philosopher
qui soit suffisamment large, qui prenne appui sur un champ suffisamment profond pour
pouvoir expliquer la diversité des doctrines qui parcourent son histoire. Il faut, par
conséquent, que la définition prenne en charge, contienne en elle-même, la pluralité des
doctrines. L’important est de se donner les moyens de formuler ce qui est en jeu quand nous
philosophons. Pourquoi donc ? Pourquoi formuler, une bonne fois pour toutes, cet enjeu ? Et

surtout, qu’est-ce qui nous assure que cette « bonne fois » puisse effectivement valoir « pour
toutes » ?
Il s’agit maintenant de prendre en compte la totalité de la question initiale : pourquoi
philosopher aujourd’hui ? Ce qui signifie tout autant : pourquoi est-il urgent, aujourd’hui, de
s’entendre sur ce qu’est la philosophie, ou plutôt, sur ce qu’elle cherche ?
Nous ne pensons pas exprimer un sentiment isolé en disant que l’époque actuelle est celle
d’un monde à bout de souffle, arrivé au bout de la logique qui le gouverne depuis tant
d’années, de cette logique dont notre jeunesse a hérité : héritage subi et néanmoins contesté
du capitalisme et de la société de consommation, de l’obsession pour une croissance indéfinie,
dont l’effet, peut-être le plus central, est l’arrimage du politique sur l’économique, et qui se
traduit par une expression bien connue : la crise du sens. En quoi quelque chose comme le
« sens » connaît-il une « crise » et en quoi est-ce corrélé avec le primat de l’économique sur le
politique ? Rien de plus indéterminé, semble-t-il, que le « sens »
1
: justement parce qu’il n’est
ni localisable ni déterminable par une signification précise, par une valeur ou par une idée,
mais qu’il désigne le milieu ou le champ qui tient ensemble les significations, les valeurs et
les idées, c’est-à-dire le langage commun qui constitue à chaque fois un monde, totalité
spirituelle ni indépendante de ses parties, ni réductible à celles-ci, mais qui pourtant s’exprime
dans chacune d’elles, s’incarne et est ainsi vécu. Le sens, dirons-nous, est ce qui anime les
significations, les rend à la fois mobiles, c’est-à-dire susceptibles de variations, et partagées,
c’est-à-dire constitutives d’un monde vécu. Or, si le sens est en crise, c’est sous un double
registre : d’abord celui du réseau particulier de significations et de valeurs qui régit le monde
capitaliste, et qui suscite de plus en plus de contestations ; le deuxième registre est celui du
sens vécu en tant que tel, c’est-à-dire de ce qui constitue le caractère partageable et mobile des
significations particulières. Concrètement, la crise propre à ce registre survient quand les
significations sont subies plus que vécues ou assumées, et forment un système figé, sédimenté
et qui apparaît inchangeable, loin, très loin du dynamisme propre au sens. Les crises des deux
registres peuvent sembler contradictoires : si le système est l’objet de contestations, et de
contestations de plus en plus vives, n’est-ce pas le signe que le sens est bel et bien vécu en
1
Notre insistance sur le sens, que cet article tente de justifier, et sa définition ou son approche comme milieu
indéterminé et dynamique, doit beaucoup à l’œuvre de Marc Richir, phénoménologue récemment décédé, duquel
nous nous inspirons. Pour une première approche de cette œuvre, nous renvoyons le lecteur aux Méditations
phénoménologiques – Phénoménologie et phénoménologie du langage, Grenoble, Jérôme Million, 1992, et, pour
une présentation d’ensemble, à celle d’Alexander Schnell, Le sens se faisant – Marc Richir et la refondation de
la phénoménologie transcendantale, Ousia, 2011.

tant que sens en devenir et intersubjectif ? Pourtant, si le système capitaliste est contesté, il
n’en est pas moins toujours efficace : comme une machine laissée à l’abandon, qui continue à
tourner et à produire ses effets. C’est ce qui, à nos yeux, caractérise la situation
contemporaine : les deux registres en crise contribuent au décalage de plus en plus marqué
entre une contestation radicale et l’objet de cette contestation, sorte de grand machin
autonome. La crise ne prendra fin que lorsque les deux registres seront réunis, c’est-à-dire
lorsque le réseau de significations capitalistes sera vécu comme significations en devenir,
comme un moment du sens, et non plus un système déconnecté de l’intersubjectivité, offrant
ainsi une prise à la contestation, une amorce de changement véritable. Et, plus encore, le fait
que la contestation soit, pour le moment, sans prise, que les significations (figées et
indépendantes) soient déconnectées du sens (dynamique et intersubjectif), trouve son corrélat
dans le primat de l’économique sur le politique. Nous ne disons pas que ce primat est la raison
du décalage des deux registres, puisque cela impliquerait que la sphère économique, en tant
que telle, soit responsable du décalage, comme si le politique était, quant à lui, nécessairement
et en tout temps, le « lieu » signifiant où le dynamisme du sens s’exprimerait le mieux. Il est
plus juste, et plus prudent, d’affirmer que le primat de l’économique sur le politique, du
marché où se joue l’ordre machinal et anonyme de la « main invisible » sur l’Etat censé être
l’arbitre et le garant de l’intersubjectivité sociale, que ce primat donc, est la traduction
contemporaine du décalage entre système de significations et sens, son expression concrète.
Si la crise du sens s’énonce aujourd’hui comme crise du politique et, corrélativement, comme
oubli du sens, alors la philosophie a un rôle politique, d’engagement, non pour tel ou tel parti
ou telle cause précise, mais, dans la mesure où il lui incombe de réveiller l’attention au sens,
au dynamisme et à l’intersubjectivité des significations ou, dit autrement, de réfléchir les
significations acquises vers le sens qui les constitue, toute théorie philosophique doit avoir un
horizon pratique, politique au sens large d’un vivre-ensemble à réinventer. Qu’une telle
réflexion caractérise la démarche philosophique, c’est ce qu’il nous faut maintenant justifier et
développer, avant de préciser le rôle politique de la philosophie, de telle sorte que la question
soit maintenant celle-ci : pourquoi philosophons-nous aujourd’hui ?
Nous dirons que le propre de la philosophie est une liberté envers le monde et une
lucidité quant au sens qui s’y déploie, et jamais l’un ou l’autre, ce qui précisément la distingue
des savoirs ou des sciences dirigés vers des significations déterminées, comme la linguistique,
la sémiologie, l’herméneutique (du côté du sens) ou comme la physique, la politique,
l’économie (du côté du monde). Le monde et le sens nous sont donnés au préalable, dans un
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%