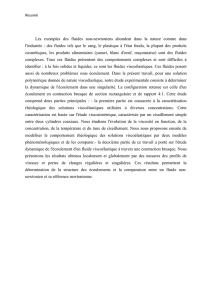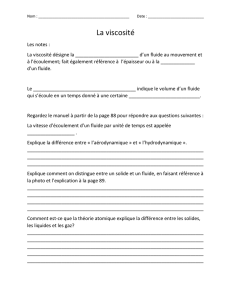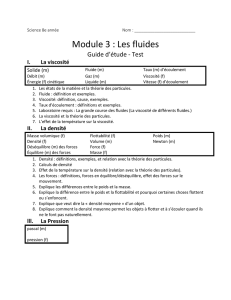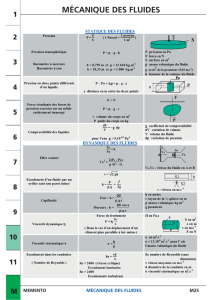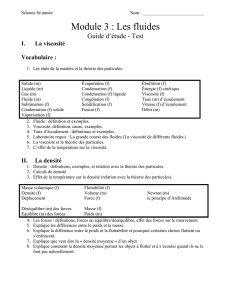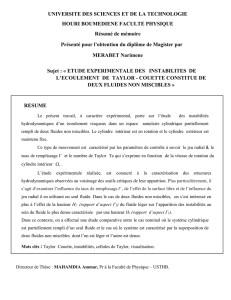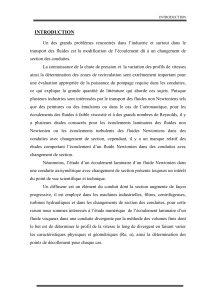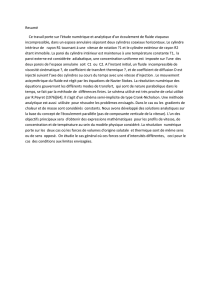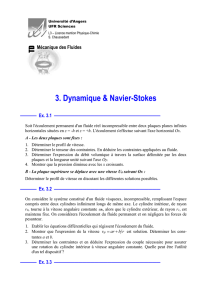TP : Rhéomètre de Couette - Page d`accueil pour l`enseignement du

TP : Rhéomètre de Couette
Le but de cette étude est l’apprentissage de l’analyse rhéologique par la caractérisation du comportement de
quelques fluides complexes de consommation courante comme un liquide vaisselle, un bain moussant, de la
moutarde…
I – Notions générales sur la rhéologie
Pour les fluides newtoniens, il y a proportionnalité à tout instant entre les contraintes et les taux de cisaillement
(ou les gradients de vitesse). Nous allons considérer dans ce TP des fluides non newtoniens pour lesquels cette
relation n’est plus linéaire et peut, de plus, dépendre de l’histoire de l’écoulement. Souvent, ces propriétés
proviennent de la présence dans le fluide d’objets de grande taille par rapport à l’échelle atomique comme les
macromolécules dans les polymères, des particules dans les suspensions ou des gouttelettes dans les émulsions.
Ces objets peuvent eux-mêmes former des structures plus grandes, comme des agrégats de plaquettes dans les
argiles, qui peuvent influencer fortement les propriétés de l’écoulement. Ces fluides sont très répandus dans la
nature (neige, boue, sang, crème…), dans la vie courante (peinture, mousse à raser, mayonnaise, yaourt…) et
dans l’industrie (ciment …). La compréhension de ces caractéristiques d’écoulement nécessite de comprendre la
réponse des fluides à une contrainte imposée. C’est l’objet de la rhéologie, science fondée dans les années 1920
par Bingham et Reiner.
Pour des fluides newtoniens ou des fluides non newtoniens aux caractéristiques indépendantes du temps, il
suffit de mesurer la relation entre le taux de déformation (D) du fluide et la contrainte (τ) à l’origine de la
déformation. Pour un fluide newtonien, un seul point expérimental suffit : le rhéogramme est une droite
τ
=ηD
passant par l’origine (η est la viscosité dynamique du fluide). Au contraire, pour les fluides dépendant du temps
et les fluides viscoélastiques, il faut analyser la réponse temporelle du fluide à une excitation variable en temps.
On peut, par exemple, mesurer l’évolution de la déformation lorsqu’on applique brusquement une contrainte, ou
encore analyser la réponse du fluide à des variations sinusoïdales de la contrainte ou du taux de cisaillement.
I.1 – Fluides indépendants du temps soumis à un cisaillement
On généralise la vitesse de déformation par le taux de cisaillement noté D, qui s’exprime en 1/s. La figure 1
montre en échelle linéaire des relations typiques entre contrainte de cisaillement τ et taux de cisaillement D
observées pour différents types de fluides non newtoniens.
Pour des fluides à seuil (plastiques), il n’y a pas d’écoulement tant que la contrainte appliquée ne dépasse pas
une valeur critique τc. Leur viscosité diminue ensuite si une contrainte supérieure au seuil est appliquée. On peut
citer de nombreuses suspensions concentrées de solides dans un liquide et certaines solutions de polymères mais
aussi le ciment frais, les pâtes dentifrices ou le concentré de tomate. On introduit souvent la notion de « fluide de
Bingham » qui suppose en théorie une variation linéaire de la déformation avec la contrainte au-delà du seuil. La
loi réelle est plus proche en fait d’une loi de puissance. Ce comportement est dû à la destruction des structures
tridimensionnelles internes du fluide qui se forment au repos. Par exemple, certaines argiles ont une structure
microscopique en plaquettes. En l’absence d’écoulement, les plaquettes forment des agrégats rigides, qui
résistent jusqu’à un certain seuil de contrainte. Au-dessus de ce seuil, la structure est en partie détruite, et
l’écoulement est rendu possible : plus la vitesse augmente, plus la structure se détruit, tandis que les plaquettes
s’alignent avec l’écoulement. Il en résulte une augmentation de la contrainte avec la déformation plus lente que
celle que donnerait une relation linéaire. On parle de fluides à seuil rhéofluidifiants dits « fluides de Casson ».
Les boues de forage rentrent dans cette catégorie.
Les fluides rhéofluidifiants (pseudoplastiques) s’écoulent même sous une contrainte faible mais ils ont une
viscosité effective qui diminue lorsque la contrainte croît. De nombreuses solutions de polymères présentent ce
type de comportement qui peut être attribué à des macromolécules entremêlées qui se séparent progressivement
et s’alignent avec l’écoulement. Dans d’autres cas, cela provient de la disparition des structures qui sont formées
par suite de l’attraction entre particules solides. On peut citer également le sang, le shampooing, les concentrés
de jus de fruits, les encres d’imprimerie, la mayonnaise, le yoghourt, les huiles végétales…
Les fluides rhéoépaissisants (dilatants) sont des fluides dont la viscosité augmente avec la contrainte
appliquée. Le sable mouillé en est un exemple : à faible vitesse, les grains glissent les uns par rapport aux autres

en étant lubrifiés par l’eau. Sous une forte contrainte, ils viennent frotter les uns contre les autres. Les
suspensions concentrées d’amidon ou la guimauve ont des propriétés similaires.
I.2 – Fluides non newtoniens dépendants du temps
Les fluides thixotropes ont une viscosité qui diminue avec le temps quand on leur applique une contrainte
constante à condition que le phénomène soit réversible. Après suppression de cette contrainte, on ne retrouve la
viscosité initiale qu’après un certain temps. Les solutions concentrées de polymères et les suspensions en sont
des exemples. De nombreux corps sont à la fois thixotropes, rhéofluidifiants et à seuil. La relation entre
thixotropie et propriétés rhéofluidifiantes dépend du rapport entre les temps caractéristiques de réarrangement Λ
de la structure interne du fluide et de variation de la contrainte appliquée T. Le rapport Λ/T est appelé nombre
de Deborah De. Lorsque De<<1, le fluide a le temps de se réarranger lorsqu’on fait varier la contrainte. Pour un
fluide rhéofluidifiant, la viscosité apparente diminue avec D mais la valeur obtenue est indépendante de la durée
de la mesure T. Si on enchaine des charges (augmentation de la vitesse ou de la contrainte) et des décharges
(diminution), la relation τ=f(D) est toujours la même. Pour De>>1, les propriétés rhéologiques évoluent au cours
du temps au fur et à mesure du changement de structure du fluide. Lorsqu’on décrit une suite de charges et de
décharges, on observe un effet d’hystérésis caractéristique de la thixotropie. Les fluides thixotropes ont de
nombreuses applications pratiques comme les peintures et les boues.
La viscoélasticité correspond à un comportement intermédiaire entre celui d’un solide et celui d’un liquide. Un
exemple est fourni par les boules de certaines pâtes silicone qui rebondissent élastiquement sur le sol comme des
solides mais s’étalent comme des liquides lorsqu’elles sont posées suffisamment longtemps sur un plan.
Produits Viscosité dynamique en Pa .s Viscosité cinématique (m
2
/s)
H2 8,9.10
-6
105.10
-6
air 18,5.10
-6
15,6.10
-6
hexane 0.3. 10
-3
0,46.10
-6
benzène 0,652.10
-3
0,741.10
-6
eau 1,005.10
-3
1,007.10
-6
mercure 1,554.10
-3
0,1147.10
-6
lait 2,0.10
-3
1,93.10
-6
sang de l’homme à 37°C 4,0.10
-3
huile d’olive 84.10
-3
91,5.10
-6
glycérol 1.49 1182.10
-6
gels /crèmes 1 à 100
vernis /peintures 10 à 1000
résines/goudron/bitume 100 à 100 000
glace à 0°C 10
13
granit 10
20
D
τ
Fig.1 : Relation ente le taux de
cisaillement et la contrainte
pour différents fluides.
Tab.1 : Valeurs caractéristiques de viscosités dynamiques et cinématiques à 20°C et 1 bar.

I.3 – Quelques lois rhéologiques
Pour de nombreuses applications pratiques, il faut disposer de lois analytiques approchées reliant la contrainte
et la déformation.
1. Loi d’Ostwald :
1α
DKη
_
= et
α
τ
DK= (K est une constante)
-
α < 1 : fluide rhéofluidifiant.
-
α = 1 : fluide newtonien.
-
α > 1 : fluide rhéoépaississant.
La loi d’Ostwald prédit que η devient infini quand D tend vers 0 pour α < 0. En pratique, η tend vers une valeur
limite finie appelée « palier newtonien ». Pour représenter l’ensemble de la courbe, on utilise des formules plus
complexes du type :
)()()(
0∞∞
−=−
ηηηη
DfD
avec f(D) qui peut être une loi de puissance modifiée du type
« loi de Carreau » :
p
DDf
−
+= )1()(
22
β
.
2. Pour les fluides à seuil, la loi la plus simple est celle de Bingham qui suppose que le taux de cisaillement D
est proportionnel à la différence τ-τ
c
au-dessus de la valeur critique
τ
c.
3. Il existe des lois combinant effet de seuil et loi de puissance comme la loi d’Herschel-Bulkley :
n
c
DK+=
ττ
au-dessus du seuil.
II – Modèle hydrodynamique : écoulement de Couette
De nombreux dispositifs expérimentaux existent : mesure de la vitesse de chute d’une bille dans un fluide,
mesure de débit à travers un tube sous une pression donnée… Cependant, le taux de cisaillement auquel sont
soumis les fluides n’est pas constant dans de tels systèmes et il est souvent complexe à déterminer. Les
rhéomètres les plus utilisés sont le rhéomètre de Couette cylindrique et le rhéomètre cône-plan qui offrent des
géométries où le taux de cisaillement est bien connu. Nous allons utiliser ici le rhéomètre de Couette avec un
cylindre intérieur à forme conique (fig.5) pour éviter tout effet parasite sur le fond horizontal des cylindres. On
peut soit mesurer le couple sur le cylindre intérieur après avoir imposé sa vitesse de rotation (on travaille à
cisaillement imposé) soit imposer le couple et mesurer la vitesse de rotation obtenue (à contrainte imposée).
On considère l’écoulement permanent d’un fluide newtonien incompressible de viscosité η, compris entre
deux cylindres coaxiaux de rayons R1 et R2, le cylindre intérieur tournant à la vitesse angulaire Ω
1
et le cylindre
extérieur étant fixe (fig.2). On suppose qu’aucun gradient de pression n’est appliqué extérieurement et on choisit
le système de coordonnées cylindriques (r,θ,z) et on cherche à déterminer les composantes (U,V,W) de la
vitesse.
On se restreint à l’écoulement le plus simple possible, obtenu aux faibles vitesses : écoulement stationnaire,
axisymétrique et invariant par translation verticale (pas de dépendance en t, θ et en z). Compte tenu de la
symétrie du problème par rapport aux plans perpendiculaires à l’axe de rotation, il n’y a pas de vitesse axiale
(W=0). La vitesse tangentielle est, du fait de l’axisymétrie, indépendante de θ. A partir de l’équation de
conservation de la masse et des conditions aux limites sur les cylindres (vitesse radiale nulle), on montre
facilement que U=0 dans tout le fluide. Les équations de Navier-Stokes ainsi simplifiées donnent : V = a r + b / r,
Fig.2 : Géométrie pour
l’écoulement de Couette.

avec a et b deux constantes déterminées à partir des conditions aux limites : V=0 en R
2
et V=Ω
1
R
1
en
R
1.
On
obtient ainsi :
)(
2
1
2
2
2
1
2
1
2
2
1
rR
rRR
RR
V−
−
Ω
=
On peut en déduire le taux de cisaillement sur le cylindre intérieur (r = R
1
), noté D :
2
1
)R/R(1
2
r
V
r
V
D
21
−
=−
∂
∂
=
Ω
Pour des valeurs de Ω
1
supérieures à une valeur critique Ω
c
, l’écoulement de base est instable et il apparaît
alors un écoulement secondaire sous forme de rouleaux toroïdaux (fig.3a) qui deviennent sinusoïdaux (fig.3b)
pour des taux de rotation plus élevés. Cette instabilité dite de Taylor-Couette est caractéristique de la transition
vers la turbulence de cet écoulement. Le nombre sans dimension qui permet de déterminer l’apparition de ces
structures est le nombre de Taylor Ta : 232
1
/RaTa
νΩ
=
avec a l’intervalle entre les deux cylindres (
12
RRa −=
), R le rayon moyen (
2/)(
12
RRR +=
) et ν la viscosité
cinématique du fluide. L’instabilité primaire apparaît pour Ta=1712. Ces instabilités peuvent modifier les lois de
comportement rhéologique.
Figure 3 : (a) Instabilité primaire en « rouleaux », (b) rouleaux sinusoïdaux. Par Burkhalter et Koschmieder.
On peut également calculer le moment des forces (tangentielles) de viscosité qui s’exercent les cylindres. On
obtient pour la composante croisée rθ du tenseur des contraintes sur le cylindre intérieur:
η
RR
RΩ2
Rττ
2
1
_
2
2
2
21
1θr
=)(=
Le couple de frottement visqueux total Γ qui s’exerce sur le cylindre intérieur par unité de longueur suivant l’axe
de rotation. Γ est égal au produit de τ
rθ
(R
1
) par la surface 2π R
1
sur laquelle est exercée la contrainte et par la
distance
R
1
entre l’axe et le point d’application des forces. Le couple sur le cylindre intérieur vaut donc :
2
1
2
2
2
2
2
11
R
RR
RR
4M
1
−
==
Ω
πηΓ
Il est donc possible de mesurer la viscosité à partir de la mesure du couple résistant exercé par le fluide sur le
cylindre intérieur lorsqu’on impose une rotation relative.
III – Manipulations
III – 1 Précautions particulières
Il faut veiller à ne pas heurter les mobiles, à bien les laver et les sécher.
Prenez le plus grand soin pour les placer sur la tête de mesure, ne jamais forcer, les fixer de bas en haut en
évitant toute contrainte latérale.
Remplissez le cylindre extérieur de fluide jusqu’au trait situé à mi-hauteur du cylindre.
Pour la moutarde, veillez à remplir le cylindre afin qu’il n’y est pas de bulles d’air.
Ne jetez pas les produits, remettez-les dans leur emballage. Seule la moutarde a été dégradée par le
cisaillement et ne peut donc pas être réutilisée, jetez-la.

III – 2 Nomenclature
III – 3 Utilisation du rhéomètre
grandeur notation unité
taux de cisaillement
(sur le cylindre intérieur)
D 1/s
taux de rotation
(du cylindre intérieur)
n tr/min
couple
(sur le cylindre intérieur)
M mN.m
contrainte de cisaillement
(sur le cylindre intérieur)
τ Pa
viscosité dynamique η Pa.s ou Poise
Fig. 4 : exemple de rhéomètre
Fig. 5 : cylindre intérieur tournant
Fig. 6 : cylindre extérieur fixe
Le rhéomètre utilisé est un rhéomètre rotatif de la gamme Physica. Il peut être utilisé en
manuel ou en automatique. On choisit le mode
automatique
. Allumez le rhéomètre et
appuyez sur Remote. piloté par ordinateur via le logiciel Rheostat 2-02 de Physica.
Pour effectuer une mesure, allez dans File puis New.
Interval : vous pouvez programmer plusieurs séries de mesures d’affilée, chacune ayant
des paramètres (pas de temps, valeurs limites…) différents. Il s’agit du numéro de
l’intervalle et non du nombre d’intervalles.
Meas. System : on dispose de deux jeux de cylindres coaxiaux. Celui ayant le plus
grand rayon correspond à MS Z2 DIN et le plus petit à MS Z4 DIN.
Test type : on peut sélectionner des préférences d’essai par pilotage soit en fonction de
la vitesse de rotation n, c’est à dire en fonction du taux de cisaillement D (CSR,
Controlled Shear Rate) ou soit en fonction de la contrainte de cisaillement
τ
(CSS,
Controlled Shear Stress).
Ramp : soit on impose des rampes de vitesse (speed ramp) soit la vitesse est oscillante
(time sweep).
On choisit ensuite les valeurs de départ (n1) et de fin (n2) pour la vitesse de rotation
(rpm, tour/min). Elles correspondent respectivement à des valeurs D1 et D2 du taux de
cisaillement (1/s). Dans la plage de vitesse choisie, on fixe le nombre de points de
mesure. On peut choisir de représenter les résultats en échelle log ou non.
Meas. Time : temps pour un point de mesure. Il faut fixer un temps suffisamment long
pour avoir une valeur moyenne correcte.
Les paramètres equilibre time et set temperature n’interviennent pas ici puisqu’on ne
régule pas en température.
Si on veut créer un second intervalle de mesure, cliquez sur insert puis interval : 2.
Sinon cliquez sur ok. Si on veut afficher le graphique lors de la série de mesure, il faut
cocher Executive presentation.
Allez ensuite dans test pour déclencher la série de mesures. Il faut fixer le type de
cylindre (MS Z2 DIN ou MS Z4 DIN). Dans sample, donnez le type de produit (liquide
vaisselle…). Les résultats sont enregistrés dans un fichier .dat auquel vous devez
donner un nom. Cliquez ensuite sur Start.
Un message d’erreur dû au fait qu’on ne régule pas en température s’affiche. N’en
tenez pas compte et cliquez sur continue always.
Sur le graphique, on obtient
τ
(Pa) et
η
(Pa.s) en fonction de D (1/s). Dans le fichier
.dat, on récupère t (s), n (rpm), M (mNm) et D (1/s). On peut enregistrer plus de
données en allant dans presentation ! et en cliquant sur l’icône tableau. Pour récupérer
le fichier, allez dans sur le bureau puis dans groupe principal / gestionnaire de fichiers.
 6
6
1
/
6
100%