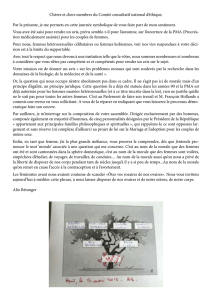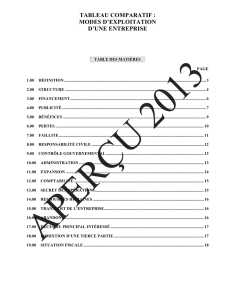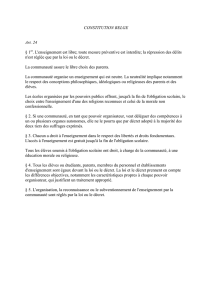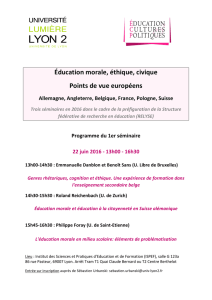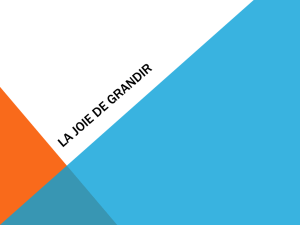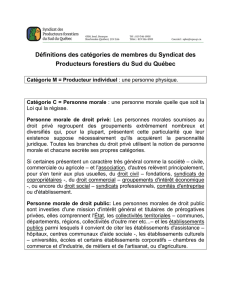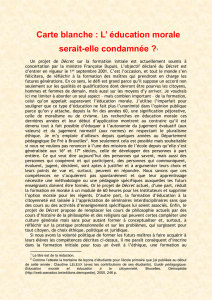Peut-on agir moralement sans s`intéresser à la

France-Examen 2013 Tous droits réservés Reproduction sur support électronique interdite page 1/4
RAPPEL DU SUJET
SUJET N°1 : PEUT-AGIR MORALEMENT SANS S'INTERESSER A LA POLITIQUE ?
France-Examen 2012 Tous droits rerv Reproduction sur support ectronique interdite page 1/4
corrigé bac 2013
Examen : Bac S
Epreuve : Philosophie
France-examen.com

France-Examen 2013 Tous droits réservés Reproduction sur support électronique interdite page 2/4
LE CORRIGÉ
PEUT-ON AGIR MORALEMENT SANS S’INTERESSER A LA POLITIQUE ?
1. Analyse du sujet
Le sujet, qui porte sur les rapports de la morale et la politique, est simple dans sa formulation mais difficile à traiter dans
la mesure où il invite à examiner s’il est possible de concilier les valeurs de ces deux ordres qui ne répondent pas aux
mêmes exigences.
En effet, si la morale renvoie aux règles de conduite et aux valeurs d’une société, la politique désigne quant à elle, l’art
de gouverner la cité ou de diriger un État. S’il y a bien dans chaque domaine des règles, règles pour agir moralement,
règles pour diriger efficacement la cité, il apparaît que celles-ci ne répondent pas aux mêmes critères et n’ont pas la
même fonction.
On comprend ainsi le sens du sujet qui invite à s’interroger sur les conditions de l’action morale. Celle-ci peut-elle être
indifférente à la dimension politique ? Peut-on envisager la moralité d’une action sans prendre en compte la réalité
politique au sein de laquelle elle s’exerce ? Une action peut-elle être morale si elle ignore tout des réalités qui organisent
l’ordre de la politique ? En d’autres termes, le champ de la morale est-il vraiment autonome, indépendant des impératifs
qui sont inhérents à la politique ?
Il importe au préalable de préciser ce qui distingue la morale de la politique.
Si la première concerne des actions individuelles, ce qui les rend vertueuses ou pas et relève ainsi de la liberté de
chacun, la politique concerne, en revanche, les relations entre les libertés individuelles en vue du bien public, de
l’intérêt commun.
Si la morale porte avant tout sur les fins de l’action, sur leur conformité au bien, la politique se doit de viser une certaine
efficacité afin d’assurer les conditions d’une vie harmonieuse au sein de la cité. Dans cette perspective, il lui faut
parfois, peut-être même souvent, passer outre des valeurs morales pour se donner les moyens d’assurer la bonne
conduite de la cité.
Il est important d’examiner ce qu’il faut entendre par « s’intéresser » : s’agit-il de connaître un contexte politique donné
? De savoir si les critères de l’action morale sont relatifs à ce contexte ? Ou bien l’intérêt pour la politique renvoie-t-il à un
ordre idéal auquel l’action morale pourrait contribuer ?
Il s’agirait alors plus que d’adapter l’action morale de façon pragmatique à des circonstances données (une situation
particulière, un régime politique, etc.), de penser les conditions d’une véritable action morale en fonction d’un ordre
politique qui en faciliterait la réalisation.
France-Examen 2012 Tous droits rerv Reproduction sur support ectronique interdite page 2/4
corrigé bac 2013
Examen : Bac S
Epreuve : Philosophie
France-examen.com

France-Examen 2013 Tous droits réservés Reproduction sur support électronique interdite page 3/4
2. La problématique du sujet
Plusieurs axes pouvaient être envisagés :
●Il s’agit d’abord d’interroger les relations entre morale et politique. La morale qui porte sur les actions individuelles
peut-elle s’affranchir des impératifs propres à la politique et des contraintes que font peser les différents types
d’organisation politique sur les membres de la cité ? Peut-on agir moralement dans un régime dictatorial qui impose
aux libertés individuelles des restrictions et des contraintes telles que l’action morale peut devenir un danger pour
son auteur ?
●L’action pour être morale doit-elle être indépendante des facteurs et des paramètres politiques ? Si l’action morale
ne doit pas être évaluée en fonction de son but, et encore moins en fonction de son efficacité, n’est-elle pas alors
par définition indifférente à la politique qui se règle sur des impératifs pragmatiques ? Ces questions engagent
aussi la question du rapport entre la morale que l’on définit universelle et la politique qui est intrinsèquement
relative à des conditions particulières d'une époque et d'un État.
●Est-il possible de concilier morale et politique, de penser un ordre politique qui assure les conditions de la moralité
(qui relève cependant toujours de la liberté de chacun, de la volonté individuelle) ? Ou faut-il distinguer les deux
ordres comme deux réalités radicalement étrangères l’une à l’autre, la morale étant une affaire strictement
personnelle soumise à des impératifs incompatibles avec ceux de la politique ?
3. La Boîte à outils
Pour penser les rapports entre morale et politique :
●Chez Platon, la politique entendue comme art de diriger la cité est subordonnée à la morale. La République établit
ainsi les conditions auxquelles doivent satisfaire ceux qui gouvernent la cité pour établir la justice. La politique est
ainsi soumise à la connaissance du Bien détenue par les philosophes-rois qui veillent au respect de celui-ci dans la
façon d’organiser la cité et de choisir les lois qui permettent d’assurer les conditions adéquates à la mise en oeuvre
de cette valeur fondamentale.
France-Examen 2012 Tous droits rerv Reproduction sur support ectronique interdite page 3/4
corrigé bac 2013
Examen : Bac S
Epreuve : Philosophie
France-examen.com

France-Examen 2013 Tous droits réservés Reproduction sur support électronique interdite page 4/4
●Les analyses de Machiavel défendent au contraire l’idée que morale et politique tendent plus souvent à s’opposer
qu’à se concilier. En effet, l’exercice du pouvoir doit d’abord viser l’efficacité : les hommes n’agissant pas selon les
injonctions de la raison, les gouvernants doivent recourir à la ruse et à la force afin de parvenir à leurs fins. La
vertu politique est indifférente à la morale si elle doit se donner des conditions favorables à la poursuite de ses buts.
Le Prince formule ainsi un certain nombre de préceptes qui assurent la réussite des actions politiques : savoir tirer
parti des circonstances, «bien savoir user de la bête et de l’homme», avoir la force du lion et la ruse du renard,
savoir flatter les passions et utiliser les rivalités. Dans une telle perspective, l’action morale répond à des valeurs
qui sont radicalement étrangères à celle de la politique de sorte qu’il semble difficile, voire impossible de les
concilier.
●Dans une perspective différente, Hegel propose une critique de la «belle âme», cet homme qui ne parvient à
s’inscrire dans l’ordre de la réalité et se révèle impuissant à la transformer, soucieux qu’il est de garder les mains
pures. Ainsi, celui qui veut agir moralement s’expose-t-il à demeurer inefficace dans l’action politique. Le rigorisme
moral n’a d’autre issue que le statu quo politique.
●Comment concilier alors l’action morale et les impératifs propres à la politique ? Est-il possible d’articuler l’efficacité
requise dans l’action politique et la vertu exigée par l’action morale ? Cette articulation ne peut se réaliser, on l’a
compris, dans un partage à part égale des vertus morales et des vertus politiques. Rousseau signalait à juste titre
qu’il ne faut pas traiter séparément morale et politique sous peine de ne comprendre aucune des deux. La vertu
politique peut contribuer à l’établissement d’une cité qui favorise la vertu morale comme le montre Spinoza à
propos de la démocratie (Traité politique).
●Il s’agit donc plutôt de faire des choix pragmatiques, en fonction des situations, de penser les tensions qui existent
entre ce que Weber appelle l’éthique de la responsabilité et l’éthique de la conviction : si les deux éthiques
doivent être distinguées, cela ne signifie pas pour autant que la responsabilité politique exclue la conviction ou que
la conviction morale implique l’absence de responsabilité (Le savant et le politique).
Entre impuissance et cynisme, il y a donc une voie moyenne qui permet de concilier de façon plus ou moins
satisfaisante, et en fonction des circonstances et des contextes, l’action morale et la politique.
France-Examen 2012 Tous droits rerv Reproduction sur support ectronique interdite page 4/4
corrigé bac 2013
Examen : Bac S
Epreuve : Philosophie
France-examen.com
1
/
4
100%