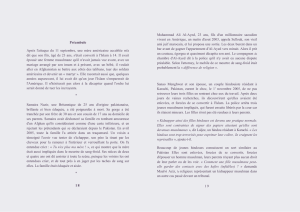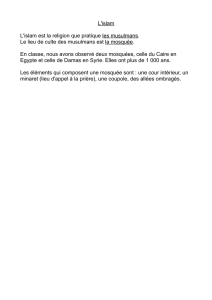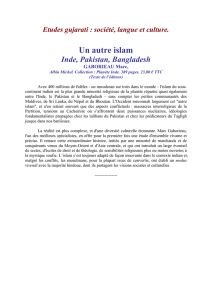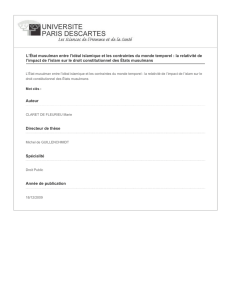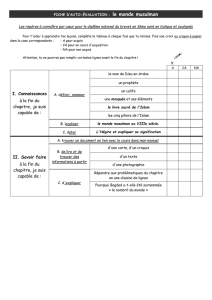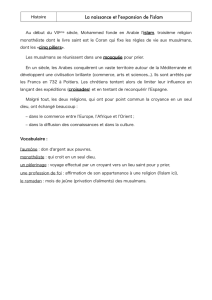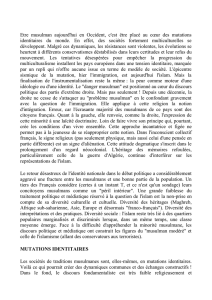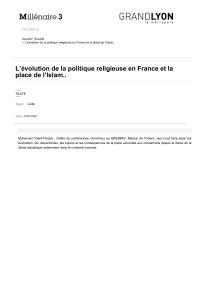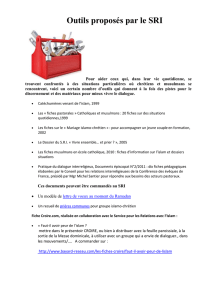Le Pakistan à la recherche d`un nationalisme

Le Pakistan à la recherche
d’un nationalisme religieux
et libéral
ÉMILE PERREAU-SAUSSINE
Les nouvelles du Pakistan sont alarmantes. En premier lieu, le terrorisme semble y
croître régulièrement en importance. L’armée et les services secrets pakistanais ont long-
temps aidé les groupes de militants islamistes qu’ils instrumentalisaient à la fois pour
tenir l’Inde en haleine au Cachemire et pour imposer un gouvernement pro-pakista-
nais en Afghanistan (Shuja Nawaz, Crossed Swords : Pakistan, its Army, and the
War Within, Oxford University Press, 2008). Mais ces groupes de militants tendent à
leur échapper, comme l’ont démontré les attentats de Bombay et de Lahore, sans
compter que de récentes tentatives d’attentats en Grande-Bretagne semblent liées à ces
groupes. En second lieu, on assiste au morcellement du pays. En avril dernier, le gouver-
nement a signé un accord avec les talibans qui, en échange d’un cessez-le-feu, instaure
des tribunaux islamiques dans la vallée de Swat, dans le nord-ouest du pays. Les écoles
mixtes y ont été détruites. Tombée aux mains des islamistes à l’été 2007, la région
échappe au pouvoir central et à l’armée. La souveraineté de l’État pakistanais sur son
propre territoire est de moins en moins assurée. Les militants de ce qu’on appelle « Al-
Qaïda » apparaissent comme les principaux bénéficiaires du chaos. Pendant longtemps,
l’État pakistanais a été aux mains de l’armée, puis aux mains d’un régime théorique-
ment démocratique qui, dans les faits, n’a pas changé grand-chose : dans l’un et l’autre
cas, rien ne semblait devoir gêner le gouvernement dans sa quête d’un pouvoir auto-
ritaire. Aujourd’hui, par contraste, l’État semble menacé de déliquescence. É. P.-S.
CES événements sont si inquiétants qu’on
parle de plus en plus du départ de ceux
qui en ont les moyens financiers : soit
pour la Grande-Bretagne, soit pour d’autres
destinations. Seule « bonne nouvelle », les
États-Unis soutiennent le pays et offrent des
dollars par milliards – mais comment cet
argent va-t-il être utilisé ? Au Pakistan, la
possession de l’arme nucléaire ne sert pas tant
la fierté et la sécurité nationales qu’elle
n’oblige les États-Unis à tenir à bout de bras
l’État menacé.
Pourquoi le Pakistan est-il en si mauvaise
posture ? Le pays est corrompu et mal
COMMENTAIRE, N° 126, ÉTÉ 2009 353
09-PERREAU-SAUSSINE:ARTICLE_gabarit 2/06/09 17:42 Page 353

gouverné. Ni les gouvernements successifs ni
les oligarchies qu’ils servent n’ont œuvré intel-
ligemment à l’intérêt collectif de la nation. À
la décharge de ces gouvernements, il faut dire
qu’il est difficile de mettre en place de bonnes
politiques quand ni l’État ni la nation n’ont
d’identité et de réalité suffisamment fermes.
Oscillant entre gouvernement civil et
gouvernement militaire, entre gouvernement
laïque et gouvernement islamisant, le pays
cherche son assiette et ne la trouve pas. L’in-
stabilité notoire du Pakistan renvoie à des
problèmes qui n’ont toujours pas été réglés :
la guerre au Cachemire indien (dont la popu-
lation est en majorité musulmane) ainsi que
le manque d’unité linguistique, ethnique et
politique du pays. L’État pakistanais s’est
constitué de toutes pièces, avec une popula-
tion mélangée, souvent déracinée, et dans une
région morcelée. D’anciennes rivalités oppo-
sent le Sind et le Penjab tandis que le Bélou-
chistan se sent négligé et que les Pathanes du
Nord-Ouest ont le goût et l’habitude de la
liberté. L’absence d’un véritable combat pour
l’indépendance dans les années 1940 a
empêché la constitution au Pakistan d’un
équivalent du Congrès indien, tout à la fois
parti nationaliste et parlement qui aurait
constitué un noyau démocratique solide.
L’animosité à l’égard de l’Inde, qui a long-
temps servi de ciment au pays, pose des
problèmes : l’Inde est de plus en plus puis-
sante. Malgré la bombe atomique, la partie
devient dangereusement inégale. L’islam, qui
devait réunir les Pakistanais, aplanir les diffé-
rences et constituer le cœur de l’identité
nationale, ne suffit pas à la tâche. L’État,
fondé pour réunir les musulmans du sous-
continent indien, n’arrive pas à se considérer
comme laïque. Mais l’islam est autant un
facteur de division que d’unité.
Le Président Asif Ali Zardari a succédé au
général Pervez Musharraf en septembre 2008
et beaucoup espéraient une ère de stabilité.
Cependant, les événements de ces derniers
mois ont remis en cause cette espérance.
Zardari se donne pour le champion de la lutte
contre les militants islamistes. Il a contre lui
le leader de l’opposition, Nawaz Sharif, qui a
déjà été par deux fois Premier ministre, et qui
est disposé à jouer une carte anti-américaine
et islamiste. Que va faire l’armée face à cette
menace ? On ne sait si cette institution isla-
misée depuis les années 80 va faire cause
commune avec les partis extrémistes et fermer
les yeux sur la constitution de quasi-émirats
islamistes, ou si elle va remettre de l’ordre
comme elle en a l’habitude – comme l’armée
algérienne en 1992.
L’état de crise quasi permanent du pays
oblige à en reprendre l’histoire dans une pers-
pective générale pour comprendre comment
la religion et la politique devaient s’y mêler –
ou ne pas s’y mêler. Le Pakistan est aux prises
avec un problème théologico-politique qu’il
ne sait comment résoudre, et dont je voudrais
reprendre ici les principaux éléments.
Aux racines du Pakistan
Le Pakistan a été fondé en 1947. La mise
en place d’un État musulman dans le sous-
continent indien devait répondre à des préoc-
cupations qui étaient inséparablement poli-
tiques et religieuses. D’un point de vue
politique, il semblait que le principe one man,
one vote ne pouvait aboutir qu’à l’oppression
de la minorité musulmane par la majorité
hindoue. Comme John Stuart Mill l’avait
expliqué dans ses Considérations sur le gouver-
nement représentatif, le régime représentatif
requiert une certaine homogénéité du peuple.
Ce qui est représenté doit former un tout.
Pour fonctionner de manière harmonieuse, la
règle majoritaire suppose un groupe relative-
ment unifié, dans lequel les intérêts de la
minorité et de la majorité se recoupent au
moins partiellement. L’Inde multiple et
segmentée ne répondait apparemment pas à
cette description. Il lui manquait le minimum
d’homogénéité dont Mill avait parlé. Certains
des porte-parole de la minorité musulmane
avaient le sentiment qu’ils risquaient d’être
malmenés par les hindous, qui avaient pour
eux le nombre. Pour que le gouvernement
prenne en compte l’hétérogénéité fondamen-
tale des partis en présence, ils préconisaient
des électorats séparés. En 1909, ces électorats
furent mis en place par le gouvernement
anglais, qui n’était sans doute pas mécontent
de trouver là l’occasion d’appliquer le vieux
principe impérial : diviser pour régner. Mais
le Rapport Nehru de 1928 avait fait partielle-
ment marche arrière, car la logique des élec-
torats séparés relevait davantage d’une
logique impériale que de la logique démocra-
tique à laquelle l’Inde était supposée aspirer
ÉMILE PERREAU-SAUSSINE
354
09-PERREAU-SAUSSINE:ARTICLE_gabarit 2/06/09 17:42 Page 354

dans le long terme. La séparation des électo-
rats s’insérait mal dans la logique démocra-
tique, en vertu de laquelle tous les citoyens
sont égaux et appartiennent au même peuple.
Le Rapport Nehru était une mauvaise nouvelle
pour les musulmans qui craignaient une dicta-
ture hindoue, et qui préféraient maintenir les
électorats séparés. Plus les musulmans étaient
attachés à leur identité musulmane, et moins
ils étaient attirés par l’idée d’un nationalisme
indien qui leur aurait imposé un statut subor-
donné ou qui les aurait regroupés dans un
ensemble hindo-musulman susceptible de leur
faire perdre leur identité. Le corps politique
national auquel l’« auto »-détermination
hindo-musulmane faisait implicitement réfé-
rence leur apparaissait problématique (1).
Dans l’un des discours les plus célèbres de
l’histoire du Pakistan, le poète, philosophe et
homme politique Mohammed Iqbal (1877-
1938) estime que « fonder une constitution
sur l’idée d’une Inde homogène, ou appliquer
à l’Inde des principes dictés par les sentiments
démocratiques britanniques, c’est la préparer
à la guerre civile sans s’en apercevoir (2) ».
Iqbal craint la guerre civile, parce qu’il craint
que l’oppression de la minorité musulmane ne
suscite une révolte.
Puisqu’il semblait difficile d’arrêter les
progrès du nationalisme et de la démocratie,
puisque la logique des électorats séparés
apparaissait comme condamnée, il fallait
trouver une autre solution : un État musul-
man homogène, dans le cadre duquel les
musulmans ne craignent ni le nationalisme
unitaire ni un régime représentatif. La mino-
rité musulmane pouvait aisément éviter le
problème que posait le principe majoritaire.
Il lui suffisait de retracer les frontières de
manière à devenir la majorité dans une zone
géographique redéfinie. Pour justifier leur
projet, les partisans d’un État du Pakistan ont
soutenu que l’unité de l’Inde avait toujours
été artificielle, qu’il y avait toujours eu « deux
nations » et non pas une seule. Il s’ensuivait
que le Congrès ne pouvait pas représenter les
musulmans. Il fallait procéder à une partition
pour qu’à la « nation » musulmane corres-
ponde un « État » musulman, et pour qu’ils
forment un « État-nation » musulman.
À ces considérations politiques de culture
et d’identité « nationales » musulmanes
s’ajoutaient des considérations plus directe-
ment religieuses. On pouvait soutenir qu’une
pratique satisfaisante de l’islam supposait
l’existence d’une communauté unifiée, dans le
cadre de laquelle un consensus (idjma) puisse
se dégager autour de l’interprétation de la loi.
Iqbal considère que cette notion de consen-
sus est « peut-être la notion juridique la plus
importante dans l’Islam (3) ». D’après un
hadith bien connu, il est dit : « mon peuple ne
s’accordera jamais dans l’erreur ». Le consen-
sus est traditionnellement compris comme le
consensus des docteurs de la loi (les oulémas),
mais le sentiment s’était répandu parmi les
élites musulmanes de l’Inde que les oulémas
avaient failli à leurs responsabilités.
Les oulémas étaient pris entre deux
critiques d’autant plus efficaces qu’elles
étaient partiellement contradictoires. D’une
part, on pouvait leur reprocher de n’avoir pas
su s’adapter, alors même que le monde avait
changé autour d’eux. Leur enseignement et
leur travail législatif ne correspondaient pas à
l’esprit du temps. Ils étaient trop attachés à la
stricte observance des autorités anciennes
(taqlid). Ils étaient responsables du caractère
inadéquat du système juridique. D’autre part,
on pouvait leur reprocher de s’être trop bien
adaptés. Depuis la chute de l’Empire moghol
et depuis l’échec de la révolte de 1857, le
gouvernement n’était plus musulman et on ne
pouvait plus espérer qu’il le redevienne rapi-
dement. Dans ce contexte, les oulémas avaient
délaissé la sphère publique. Pour autant qu’il
y avait eu un réel renouveau, notamment
autour de la formation de l’école de
Deobandi, ce renouveau s’était traduit par
une intériorisation et une certaine dépolitisa-
tion de l’islam.
Il s’ensuivait que l’autorité des oulémas
n’avait pas suffisamment de pertinence collec-
tive dans le contexte du Raj britannique.
Parmi les figures tutélaires du Pakistan (Sir
Syed Ahmad Khan, Muhammad Iqbal,
Muhammad Ali Jinnah), on ne trouve aucun
ouléma. Un profond besoin de renouveau se
LE PAKISTAN À LA RECHERCHE D’UN NATIONALISME RELIGIEUX ET LIBÉRAL
355
(1) J. S. Mill, Considerations on Representative Government,
chap. 16. Cf. Farzana Shaikh, « Muslims and political representa-
tion in colonial India : the making of Pakistan », dans Hasan Mushi-
rul (dir.), India’s Partition. Process, Strategy and Mobilization, Oxford
University Press, 1993, p. 81-101.
(2) Iqbal, « Presidential Address delivered at the Annual Session
of the All-India Muslim League, 29 December 1930 », dans Latif
Ahmed Sherwani (dir.), Speeches, Writings and Statements of Iqbal,
Lahore, Iqbal Academy, 1977, p. 22. (3) Iqbal, Six Lectures on the Reconstruction of Religious Thought
in Islam, Lahore, Kapur Art Printing, 1930, p. 240.
09-PERREAU-SAUSSINE:ARTICLE_gabarit 2/06/09 17:42 Page 355

faisait sentir. Une nouvelle source d’autorité
et de consensus s’avérait nécessaire. C’est du
moins ce que semble prouver le formidable
mouvement de mobilisation politique autour
du califat que connaît l’Inde entre 1919
et 1924. Craignant de voir le califat tomber
sous la coupe des Britanniques, des milliers
de musulmans s’agitent sur une échelle sans
précédent. Les musulmans d’Inde, qui
n’avaient pas auparavant prêté la plus grande
attention au calife, se passionnent tout à coup
pour son sort. Tout se passe comme s’ils
avaient éprouvé le besoin de s’en remettre à
une autorité qui comble le vide laissé par la
défaite de l’Empire moghol et par le conser-
vatisme des oulémas. En l’absence d’une orga-
nisation politique musulmane territoriale et
d’un réseau satisfaisant de docteurs de la loi,
ils se tournent vers une institution supra-terri-
toriale pour assurer leur propre identité et
cohésion.
En Turquie, le sultanat est séparé du califat
en 1922. La souveraineté ayant été attribuée
au peuple par la nouvelle Constitution, le
califat perd son pouvoir temporel. L’ancien
calife est déposé, un nouveau calife est élu,
privé du pouvoir de l’épée. Les leaders califa-
tistes indiens demandent alors à l’État turc
d’accroître la dignité du calife, car ils entre-
voient une nouvelle possibilité : celle d’un
calife au pouvoir essentiellement spirituel,
une sorte d’équivalent du pape. La séparation
du califat et du sultanat pourrait faire du
calife une autorité quasi universelle dans le
monde musulman – y compris parmi les
chiites (4). Cependant, l’intention de Mustafa
Kemal était d’affaiblir le calife, non de le
renforcer, et c’était la raison pour laquelle il
avait séparé le sultanat du califat. Kemal
abolit le califat en 1924, réduisant à néant le
mouvement qui s’était réuni derrière sa
bannière.
Le califat aurait pu jouer le rôle d’autorité
religieuse pour les musulmans du monde
entier. Son abolition repousse les musulmans
vers leurs corps politiques particuliers. L’échec
du mouvement califatiste appelle une alter-
native, que l’abolition du califat rend possi-
ble : celle de l’État-nation musulman (5). On
trouve une bonne illustration de ce mouve-
ment dans l’une des plus grandes figures du
mouvement califatiste : Mohammed Ali.
D’abord attaché au Congrès au moment de
l’agitation du début des années 20, Ali s’en
détache progressivement pour se tourner vers
le communalisme et pour revendiquer une
identité musulmane (6).
Le mouvement califatiste a préparé le
terrain pour la mobilisation des musulmans
qui conduira à la mise en place du Pakis-
tan (7). Mais c’est l’échec du mouvement qui
s’avère fondamental. Iqbal témoigne d’une
profonde méfiance à l’égard du califat, au
point d’approuver la politique de Kemal. Pour
Iqbal, un État musulman devrait fournir le
cadre dans lequel forger le consensus requis.
Dans ses Leçons sur la reconstruction de la
pensée religieuse en Islam, Iqbal se propose de
renouveler l’Islam pour l’adapter au monde
moderne en faisant jouer un rôle central à
l’assemblée représentative, dans lequel il voit
le lieu d’un consensus renouvelé et adapté. La
fonction du calife peut être exercée par une
assemblée.
« Le transfert des pouvoirs d’interprétation
(ijtihad) des représentants individuels d’écoles
[les oulémas] à une assemblée législative
musulmane, qui, au vu de la croissance de
sectes opposées, est la seule forme que le
consensus (idjma) puisse prendre dans les
temps modernes, assurera la contribution aux
débats juridiques de laïcs qui se trouvent avoir
un bon sens des affaires humaines. Ce n’est
que de cette manière que nous pouvons
réveiller l’esprit vital endormi de notre
système juridique, et le rendre capable d’évo-
luer. En Inde, cependant, des difficultés ne
manqueront pas de se présenter ; car il est
douteux qu’une assemblée législative non
musulmane puisse exercer le pouvoir d’inter-
prétation (8). »
On retrouve ici la question de l’homogé-
néité. Il s’agit de mettre en place une auto-
rité compétente pour interpréter la loi. Cette
autorité gagnerait à être celle d’une assemblée
législative de type moderne. Mais une assem-
blée législative ne saurait remplir ce rôle
ÉMILE PERREAU-SAUSSINE
356
(4) Bernard Lewis, The Emergence of Modern Turkey, Oxford
University Press, 1968, p. 262-271.
(5) Hamid Enayat, Modern Islamic Political Thought, University
of Texas Press, 1982, p. 53-55.
(6) Hasan Mushirul, Mohamed Ali, Ideology and Politics, New
Delhi, Manohar, 1981, p. 83-109.
(7) Gail Minault, The Khilafat Movement. Religious Symbolism
and Political Mobilization in India, Columbia University Press, 1982.
(8) Iqbal, Six Lectures on the Reconstruction of Religious Thought
in Islam, p. 241.
09-PERREAU-SAUSSINE:ARTICLE_gabarit 2/06/09 17:42 Page 356

qu’en réunissant une majorité significative de
musulmans. D’où le besoin d’un État musul-
man qui permette aux croyants de se réunir
pour délibérer sans que les non-croyants n’in-
terfèrent.
L’idée pakistanaise doit son succès à sa
capacité de fusionner des aspirations poli-
tiques et des aspirations religieuses. Elle
renvoie d’une part à la logique démocratique
du règne de la majorité, contre l’Empire
britannique, et contre la menace d’un Empire
indien dominé par les hindous. Elle renvoie
d’autre part à la logique religieuse du besoin
de consensus sur l’interprétation de la loi,
l’idjma étant une sorte de « vox populi presque
inconsciente (9) ». La Ligue musulmane,
initialement surtout sensible à la logique poli-
tique de l’idée pakistanaise, et relativement
indifférente à la question religieuse, subit une
lourde défaite électorale en 1937. Elle y
répond en intégrant la dimension religieuse,
et en se donnant comme représentative du
consensus musulman. En opérant une
synthèse entre l’idée britannique de la repré-
sentation politique et du besoin musulman
d’un consensus, la Ligue musulmane pose les
bases idéologiques de l’État pakistanais (10).
Pour le Pakistan, la solution la plus simple
était de s’en tenir à la théorie du consensus
telle que la présente Iqbal : « le transfert des
pouvoirs d’interprétation (ijtihad) des repré-
sentants individuels d’écoles à une assemblée
législative musulmane ». Cette solution avait
l’avantage de conduire au recoupement des
perspectives laïques et religieuses. Les uns et
les autres pouvaient ainsi reconnaître la légi-
timité de l’assemblée, même si c’était pour des
raisons différentes. Cette solution réconciliait
la perspective démocratique du règne de la
majorité et la perspective religieuse du règne
de la loi telle qu’interprétée par la majorité
musulmane.
Mais cette solution se heurtait à deux diffi-
cultés fondamentales. En premier lieu, le
consensus démocratique ne se confond pas
nécessairement avec le consensus musulman.
Le consensus est traditionnellement compris
non comme le consensus de tous les musul-
mans, mais comme le consensus des musul-
mans particulièrement qualifiés, c’est-à-dire
pieux et savants (d’où le rôle traditionnel des
oulémas en ce domaine). Si le peuple musul-
man, en tant que peuple, est souverain en
matière politique, il ne l’est pas nécessaire-
ment en matière religieuse, il n’est pas néces-
sairement réputé compétent pour interpréter
la charia. En second lieu, dans l’assemblée
législative du Pakistan, il n’y a pas que des
musulmans et, parmi les musulmans, il en est
qui ne sont pas reconnus comme orthodoxes
par la grande majorité (en particulier les
Ahmadis). S’il y a liberté religieuse, le plus
probable est que le « peuple » ne comptera
pas seulement des croyants officiellement
d’accord sur l’essentiel, il comptera aussi des
croyants hétérodoxes et des non-croyants.
Pour les musulmans, la confusion des dimen-
sions religieuses et politiques au sein de l’as-
semblée législative a l’avantage d’islamiser le
parlementarisme, mais aussi le grave inconvé-
nient de menacer l’intégrité de l’Islam.
Des tensions irréductibles
Les premiers à objecter contre « le transfert
des pouvoirs d’interprétation des représen-
tants individuels d’écoles à une assemblée
législative musulmane » ont évidemment été
ces « représentants individuels », les oulémas,
qui ne tenaient pas à être écartés du pouvoir.
Ils ont été suivis par l’une des grandes figures
de l’islamisme, Maudoudi. Comme les
oulémas, Maudoudi estime que tous les
musulmans ne sont pas également compétents
pour interpréter la charia. Mais Maudoudi
n’éprouve qu’une confiance limitée dans les
oulémas. S’il forme un parti (le Jamaat-i-
Islami, parti de l’Islam), c’est parce qu’il
entend en appeler au peuple et faire jusqu’à
un certain point le jeu de la démocratie et des
élections. Jusqu’à un certain point seulement,
car le modèle dont Maudoudi s’est inspiré
pour la création de son parti est celui du parti
bolchevique. Pour Maudoudi, le critère de la
majorité ne suffit pas : ainsi les Américains
ont-ils fait l’erreur d’abandonner la prohibi-
tion (11). Ce qu’il faut, c’est une « théo-démo-
LE PAKISTAN À LA RECHERCHE D’UN NATIONALISME RELIGIEUX ET LIBÉRAL
357
(9) Ignaz Goldziher, Le Dogme et la loi dans l’Islam, Geuthner,
1920, trad. Arin, p. 45.
(10) Farzana Shaikh, Community and Consensus in Islam. Muslim
Representation in Colonial India (1860-1947), Cambridge University
Press, 1989, p. 209-210. À ma connaissance, c’est Farzana Shaikh
qui a le mieux dépeint la double origine du Pakistan : dans l’idée
représentative et dans l’idée de consensus. Qu’elle trouve ici l’ex-
pression de ma gratitude pour avoir bien voulu corriger certaines
de mes erreurs. (11) Syed Abul ‘Ala Maudoodi, The Political Theory of Islam,
Pathankot, s.d. [1939], p. 34.
09-PERREAU-SAUSSINE:ARTICLE_gabarit 2/06/09 17:42 Page 357
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%