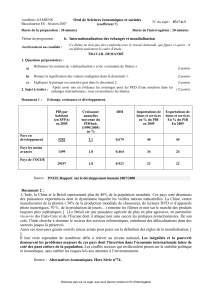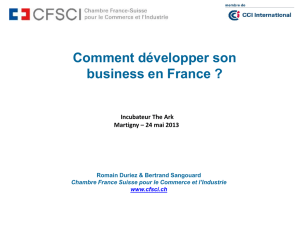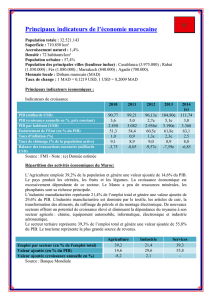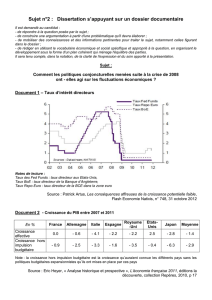L`Amérique latine en 2013 - Credit Agricole, Etudes Economiques

Études Économiques Groupe
http://etudes-economiques.credit-agricole.com
Apériodique – n° 13/03 – Août 2013
L'Amérique latine en 2013
Amérique latine : quelles perspectives à moyen terme ?
1
La croissance moyenne de l'Amérique latine a été de 4% depuis 2003, en nette progression par rapport aux
vingt-cinq ans précédents. Ce rythme est soutenable d'ici la fin de la décennie : les pays andins peuvent
continuer à croître entre 4,5% et 5,5%, l'Argentine et le Venezuela, après un ajustement certainement
douloureux, disposent des ressources pour maintenir une croissance élevée, et le Mexique devrait rebondir.
La plus forte incertitude porte sur le Brésil, qui peut tout aussi bien atteindre un rythme de croisière de 5%
comme s'étioler à 1,5%-2%.
La performance globale de la région dépendra, en effet, largement de celle des deux géants, le Brésil et
le Mexique, qui représentent 62% du PIB régional, et qui pendant la dernière décennie ont enregistré une
croissance inférieure à celle du reste de l'Amérique latine.
La contribution du facteur travail sera un peu moins favorable que pendant la dernière décennie. Il n'y a
cependant pas de contrainte sérieuse sur le travail, car une partie importante des actifs est sous-
employée.
L'épargne et l'investissement peuvent augmenter sensiblement dans la plupart des pays, pour autant que
la confiance des épargnants et des investisseurs soit préservée. Grâce à un environnement économique
plus stable et prévisible, cette confiance se renforce dans les grands pays du versant Pacifique (Chili,
Pérou, Colombie, Mexique) et en Uruguay. Un potentiel évident d'amélioration existe en Argentine et au
Venezuela. Reste le Brésil, pour lequel l'incertitude est forte, car la relance nécessaire de l'épargne et de
l'investissement y exigera une adaptation plus que marginale de la politique économique.
La productivité peut progresser, à deux conditions :
- D'une part, une amélioration significative du fonctionnement des secteurs éducatifs. Le problème
porte plus sur leur "management" (définition des priorités, formation des enseignants, évaluation des
performances…) que sur l'effort financier global. Pour l'heure, l'Amérique latine est loin des autres
pays émergents de niveau de revenu comparable (Turquie, Europe orientale, Asie du Sud-Est) ;
- D'autre part, un rebond des secteurs industriels. L'industrie est le secteur où la "convergence" (avec
les pays avancés) de la productivité peut être la plus rapide, mais elle a partout perdu du poids dans
l'emploi, ce qui compromet le rattrapage au niveau macro-économique. Les pays disposant d'une
base industrielle (Brésil, Mexique, Argentine, Colombie, et dans une moindre mesure Chili, Pérou, et
même Venezuela) devront trouver les moyens (politique industrielle, fiscalité, politique de change…)
de relancer le secteur.
Par ailleurs, la région est loin d'être autonome : une crise prolongée dans les pays avancés ou un fort
ralentissement en Chine auraient pour elle un coût en termes de croissance. Enfin, la "bonanza" des
matières premières dont a bénéficié la région pendant les dix dernières années n'est pas extrapolable, ce
qui se traduira par un resserrement de la contrainte extérieure, mais aussi par des taux de change plus
favorables à l'industrie.
1
Cet article est une version très abrégée d'un travail réalisé pour l'Agence Française de Développement, à paraître début 2014 dans "Les
enjeux du développement en Amérique latine".

Jean-Louis Martin
jean-louis.martin@credit-agricole-sa.fr
N° 13/03 – Août 2013 2
La croissance des économies latino-américaines a été de
4,0% en volume entre 2003 et 2012 contre respectivement
2,6% et 1,6% pendant les périodes 1990-2002 et 1980-
1989. Le PIB par habitant a ainsi pu progresser de 2,8%
par an au cours des dix dernières années, alors qu’il
n’avait crû que de 1,0% par an entre 1990 et 2002, et
reculé de 0,5% par an pendant les années 80.
Croissance du PIB réel en Amérique latine
Cette croissance est-elle soutenable ? Rodrik rappelle
2
que la "convergence" (i.e. le rattrapage des économies
développées par les moins avancées) est loin d'être
automatique. En Amérique latine, sur longue période, il y a
même eu divergence : le PIB par habitant de la région ne
représente (en parité de pouvoir d'achat, PPA) que 30%
du PIB moyen des pays développés, contre 45% en 1950.
Le retournement observé depuis 2004 est très loin de
compenser le recul relatif de la région pendant les
cinquante-cinq années précédentes. Dans le passé, les
périodes de rattrapage (fin des années 1950 et années
1970) ont été suivies par une dégradation très rapide, en
particulier dans les années 1980.
Selon les auteurs d'un Working Paper très récent du FMI
3
,
l'accélération de la croissance pendant la dernière
décennie est principalement due aux augmentations de la
force de travail en activité et du stock de capital, la
seconde résultant elle-même de celle (souvent modeste)
du taux d'investissement dans la plupart des pays. La
contribution de la productivité a été en général positive,
mais limitée. Leurs conclusions sont donc peu encou-
rageantes : la force de travail employée et le stock de
capital vont continuer à augmenter, mais plus lentement,
et ils ne croient guère à la possibilité d'extrapoler les
progrès de productivité des dernières années. Cela les
conduit à anticiper, pour la période 2013-2017, une
croissance qui reviendrait autour de 3,25% pour la région.
2
Rodrik, D., "The Future of Economic Convergence", Harvard
University, 2011.
3
Sosa, S., Tsounta, E., et Kim, H.S., "Is the Growth
Momentum in Latin America Sustainable?", Working Paper
13/109, FMI, 2013. Les données concernent l’Amérique latine
(hors Argentine et Guatemala) et les Caraïbes.
La ressource en travail n'est pas une
contrainte forte
Le facteur travail a participé de manière très significative à
l'accélération de la croissance dans la région, avec une
évolution démographique favorable et une augmentation du
taux d'activité (incluant une plus forte participation féminine
au marché du travail). Ce contexte va perdurer jusqu'à la fin
de la décennie, mais l'amélioration sera nettement plus
modeste que pendant les dix dernières années. Ce n'est
sans doute pas un obstacle insurmontable : la croissance
économique s'est accélérée depuis dix ans, alors que la
croissance de la ressource en travail ralentissait déjà.
Des perspectives démographiques favorables, mais
moins que par le passé
Les taux de dépendance
4
vont décroître d'ici 2020 dans
tous les pays de la région, à l'exception du Chili : selon
l'Organisation internationale du travail et le Programme des
Nations-unies pour le développement, le taux moyen dans
la région est aujourd'hui de 51%, et va revenir à 48,6% en
2020 ; le vieillissement de la population fera ensuite
lentement remonter le taux de dépendance. De ce point de
vue, l'Amérique latine sera, d'ici la fin de la décennie, dans
une situation optimale. Les ratios calculés par tranche d'âge
doivent aussi être corrigés en raison de la participation
croissante des femmes au marché du travail : celle-ci
implique que la contribution du facteur travail à la crois-
sance économique est plus élevée que ne le fait apparaître
la seule évolution de la pyramide des âges.
Toutefois, cette contribution va se réduire : alors que la
population d'âge actif s'accroissait de 1,70% par an entre
2000 et 2010, elle n'augmente plus que de 1,26% par an au
cours de la présente décennie. De même, la participation
féminine au marché du travail va continuer à progresser,
mais plus lentement, et le surplus de croissance qu'elle
apporte à la population active ne va plus être que de 0,19%,
contre 0,46% pendant la décennie précédente.
La baisse des taux de chômage est une conséquence
de l'accélération de la croissance
Depuis dix ans, le taux de chômage a baissé dans tous les
grands pays latino-américains. L'évolution la plus nette est
observée au Brésil, où il est passé de 12% en 2002-2003 à
moins de 6% aujourd'hui. La baisse est également sensible
au Pérou, en Colombie, et au Chili.
La baisse du taux de chômage a contribué à la hausse de la
force de travail effectivement active et, donc, à la croissance
économique. Mais dans une région où le chômage et
surtout le sous-emploi sont élevés, il n'y a pas de rareté
quantitative du facteur travail. S'il y a eu réduction du taux
de chômage, c'est donc parce qu'il y a eu une accélération
de la croissance. De même, la forte hausse de la parti-
cipation féminine au marché du travail s'explique d'abord
par des évolutions sociologiques dans la région, mais aussi
par la croissance, et en particulier celle des services. La
variable significative dans l'explication de l'accélération de la
croissance est donc plutôt l'évolution de la "ressource en
travail" disponible (i.e. en âge de travailler, après ajustement
pour cause de hausse du taux d'activité des femmes) que
celle de la population effectivement employée.
4
Ratio : population totale - population d'"âge actif" (de 15 et
64 ans)/population d'âge actif.
-4
-2
0
2
4
6
8
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
croissance a/a croissance moyenne
%
Source : FMI

Jean-Louis Martin
jean-louis.martin@credit-agricole-sa.fr
N° 13/03 – Août 2013 3
La nature, formelle ou informelle, des emplois, n'est par
ailleurs pas décisive. Si l'origine de l'informalité se trouve
dans la volonté de l'employeur d'éviter certains coûts
associés à la formalisation (cotisations sociales,
impôts…), elle ne modifie alors que la répartition de la
valeur ajoutée entre le travailleur, l'employeur et l'État, et
pas le niveau de cette valeur ajoutée. C'est probablement
la croissance économique qui fait la formalisation, et
assez peu la formalisation qui contribue à la croissance.
Le capital productif : des taux d’épargne et
d’investissement trop bas
L'Amérique latine se caractérise par des taux d'épargne et
d'investissement faibles, très en-deçà par exemple de
ceux de l'Asie à croissance rapide. Ils se sont cependant
améliorés dans certains pays, grâce au rétablissement de
la confiance des entreprises et des ménages. L'expé-
rience d'autres parties du monde montre que des progrès
significatifs sont encore possibles. Les choix de politique
économique joueront ici un rôle décisif.
Taux d'investissement et taux de croissance
Les taux d’épargne et d’investissement : une faiblesse
spécifiquement latino-américaine
L'épargnant latino-américain bénéficie ces dernières an-
nées d'un environnement plus favorable : l'inflation a
reculé presque partout (aux exceptions notables de
l'Argentine et du Venezuela), l'autonomie croissante des
Banques centrales a rétabli la cohérence de la structure
des taux d'intérêt et, peut-être surtout, la confiance des
agents économiques privés dans la soutenabilité des
politiques publiques s'est améliorée. Cette meilleure "pré-
visibilité" a contribué à stabiliser les anticipations, un
développement favorable à l'épargne et à l'investissement.
Les exemples péruvien et colombien illustrent le rôle d'un
autre aspect de l'environnement : les taux d'épargne y ont
fortement augmenté (à partir de 1994 au Pérou et de 2003
en Colombie) grâce à l'amélioration de la situation d'ordre
public (et, au Pérou, aux réformes introduites par Alberto
Fujimori).
En Amérique latine, la "bonne gouvernance" est donc
avant tout la capacité à générer et à entretenir chez les
opérateurs économiques une certaine confiance en l'ave-
nir : il s'agit de les convaincre que leur épargne ne sera
pas engloutie par l'inflation, et que les fruits de leurs
éventuels investissements ne seront pas détruits lors des
troubles, dévorés par un impôt arbitraire ou une confis-
cation, ou réduits à néant par une récession brutale
provoquée par l'éclatement d'une bulle ou l'apurement de
déséquilibres insupportables. Dans beaucoup de pays, les
progrès ont été réels depuis 1995. En fait, l'agrégat régional
est faussé par le poids du Brésil, dont les taux d'épargne et
d'investissement sont les plus bas (17,6% et 18,0% du PIB
sur la période 2003-2012) des grands pays de la région.
À moyen terme, une remontée du taux d'épargne de 3 à
5 points (ce qui conduirait la plupart des pays autour de
25% du PIB) est possible. Trois points paraissent
essentiels :
L'ordre public est un préalable, comme le montrent les
expériences péruvienne et colombienne ; il doit être
préservé, ou rétabli là où il est menacé ;
La confiance des épargnants et des investisseurs est le
principal déterminant ; elle se construit sur le long
terme, via l'amélioration de la gouvernance et de
l'environnement des entreprises ; on en est encore
loin : selon le rapport Latinobarometro 2011, seulement
35% des Latino-américains considèrent que leur pays
est gouverné "pour le bien de tous"
5
;
Au Brésil, les progrès seront plus ardus, car ils
exigeront des choix politiques difficiles
6
(allégement de
l'administration, moindre interventionnisme de l'État); le
besoin de relancer l'épargne et l'investissement y est
pourtant particulièrement aigu.
L'épargne extérieure va aussi continuer à apporter une
capacité supplémentaire d'investissement. Pour les cinq
grands pays "ouverts" de la région (l'Argentine et le
Venezuela sont exclus), Les IDE ont représenté de 1,5%
(Mexique) à 4,2% du PIB (Pérou) entre 2003 et 2012. Avec
les investissements de portefeuille, on atteint un minimum
de 2,9% du PIB au Brésil, et jusqu'à 7% au Chili. Les
déficits courants (chroniques sauf au Venezuela) ont ainsi
été aisément financés
7
. La région va rester attractive, et les
principaux pays peuvent espérer d'ici la fin de la décennie
un apport d'épargne extérieure d'au moins 3 % du PIB, qui
viendra s'ajouter à l'épargne domestique.
Le contenu de l’investissement : biens d’équipement,
infrastructures, immobilier
Au Mexique, le taux d'investissement reste médiocre, mal-
gré des progrès pendant la dernière décennie. En 2012, il
est ainsi de 20,7%, l’un des plus faibles de la région.
Toutefois, l'analyse de l'évolution de l'investissement depuis
dix ans fait apparaître une caractéristique originale : si
l'investissement total a progressé en volume de 46% depuis
2003, celui en construction résidentielle n'a augmenté que
de 8%, contre 85% pour les investissements en biens
d'équipement (hors matériel de transport). Or, l'impact de
l'investissement en biens d'équipement sur la croissance est
différent de celui de la construction résidentielle : il est
moins immédiat (en particulier si les équipements sont
importés), mais il accroît les capacités de production. Au
5
Ce pourcentage est particulièrement faible en Amérique
centrale (Honduras : 7 %, Guatemala : 8 %, Costa Rica : 18 %)
et au Mexique (22 %). Latinobarometro est une ONG chilienne.
6
Les événements de juin 2013 pourraient toutefois accélérer le
processus.
7
Dans la plupart des cas, les seuls IDE excèdent le déficit
courant de la balance des paiements, avant même prise en
compte des investissements de portefeuille.
0
5
10
15
20
25
30
35
Am. latineM.-OrientEur. centr. Asie S-E Afr. SS développés
% PIB
1980-1989 1990-2002 2003-2012
%
6
5
x
4
3
x
x
2
1
0
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
xxxtaux de croissance moyen (éch. dr.)
Source : FMI
7

Jean-Louis Martin
jean-louis.martin@credit-agricole-sa.fr
N° 13/03 – Août 2013 4
Mexique, l'effort d'investissement en biens d'équipement a
effectivement permis une évolution de l'appareil industriel
mexicain, avec par exemple un développement rapide de
la construction de matériel de transport, automobile (et
ses équipementiers) mais aussi ferroviaire et, plus
récemment, aéronautique.
Les besoins en investissement sont, par ailleurs, différents
d'un pays à l'autre. Si les insuffisances des infrastructures
sont générales en Amérique latine, c'est à des degrés très
variés : pour les transports, par exemple, beaucoup plus
au Brésil ou en Colombie qu'au Mexique ou en Uruguay.
La productivité est l'enjeu majeur
Par définition, la croissance de la productivité est un
"résidu" : la part de la croissance du PIB qui ne s'explique
ni par l'évolution de la ressource en travail, ni par celle du
stock de capital. La mesure de son évolution passée est
donc très fragilisée par les incertitudes sur celles du PIB,
du travail et du capital. Mais il est possible d'identifier des
éléments qui pourraient contribuer à la faire progresser :
des systèmes éducatifs plus efficients, un effort de recher-
che et développement (R&D) et, surtout, une évolution de
la structure de l'activité vers des secteurs à plus forte
productivité.
L’éducation : des performances médiocres, sans
exception dans la région
L'illettrisme est en voie de disparition en Amérique latine
et dans les Caraïbes. Dans tous les grands pays, le taux
d'alphabétisation des adultes est supérieur à 90%, et
proche de 100% dans le cône sud, à Cuba, ou à Trinidad.
Partout, les performances du système éducatif sont
cependant très médiocres. Dans les tests Program for
International Student Assessment (PISA) de l'OCDE
8
, tous
les pays latino-américains sont loin du niveau moyen de
l'OCDE. À niveau de développement comparable, l'ensei-
gnement secondaire latino-américain est nettement moins
efficient que ceux de la plupart des pays émergents à forte
croissance. En outre, l'accès à l'enseignement supérieur
est souvent faible ou médiocre : 27% au Mexique, entre
35% et 40%au Brésil et dans les pays andins.
Il existe donc une marge de progression considérable, et
la productivité pourrait à moyen terme bénéficier de
manière significative de l'amélioration des systèmes édu-
catifs. Mais ces progrès exigeront parfois une augmen-
tation des budgets (Uruguay, Pérou, Amérique centrale),
une révision des priorités et un plus grand souci de justice
sociale (Brésil, Chili) et, partout, une réorganisation en
profondeur du fonctionnement du secteur éducatif. Cer-
tains pays ont déjà pris des initiatives. Ainsi, le président
mexicain Enrique Peña Nieto a fait voter une ambitieuse
réforme du secteur, incluant un volet d'évaluation. Sa mise
en œuvre sera toutefois difficile, car elle a suscité une
forte hostilité du puissant syndicat des enseignants, qui
"cogère" le secteur depuis longtemps.
Les performances des systèmes éducatifs vont sans
doute lentement s'améliorer d'ici à 2020, et donc
contribuer à une progression de la productivité du travail,
mais elles resteront moins bonnes que celles des pays de
8
Ces tests évaluent les compétences en lecture, mathé-
matiques et sciences d'élèves de quinze ans.
niveaux de développement comparables en Asie ou en
Europe centrale et orientale. La qualification de la main
d'œuvre va donc être une contrainte à la croissance
9
.
L'industrie, le principal gisement d'amélioration de la
productivité
Rodrik
10
a clairement montré qu'il n'y a pas de convergence
automatique : un pays ayant initialement un bas niveau de
productivité n'est ni plus ni moins susceptible de la voir
augmenter qu'un pays ayant initialement une productivité
élevée
11
. Mais il remarque aussi que dans les pays
émergents, la dispersion de la productivité entre secteurs
est beaucoup plus forte que dans les pays riches. L'exemple
le plus évident et le plus lourd de conséquences de cette
dualité est bien sûr la Chine, où le transfert de centaines de
millions de paysans peu productifs vers l'industrie a été l’un
des facteurs majeurs de l'accélération de la croissance. En
Amérique latine, il n'existe pas de tels gisements de
productivité : à l'exception de l'Amérique centrale, la part de
l'agriculture dans l'emploi est déjà modeste (15,3% au
Brésil, 13,3% au Mexique, 17,7% en Colombie).
Mais Rodrik (ibid.) montre qu'à l'intérieur d'un secteur
industriel, il y a bien une "tendance automatique" de la
productivité à converger vers celle du même secteur dans
les pays les plus avancés. Pour prendre un exemple :
l'industrie mexicaine des pièces détachées automobiles se
rapproche, en termes de productivité et de capacité
d'innovation, de celle des États-Unis. On trouve aussi des
exemples dans l'agriculture, comme la production de fleurs
coupées en Colombie et en Équateur. L'explication est
simple : s'agissant de produits échangés internationalement,
un producteur trop loin des "standards" de productivité est
rapidement sorti du marché.
Le problème est que, comme l'écrit Rodrik, "les activités qui
sont bonnes pour absorber des technologies nouvelles ne
sont pas forcément bonnes pour absorber le travail". La
convergence intra-sectorielle (appelée "interne" par l’auteur)
ne se traduit pas nécessairement en convergence de la
productivité au niveau d'une économie, parce que le poids
des activités les plus productives dans l'emploi global peut
reculer (l'évolution "structurelle"). Et c'est bien le cas en
Amérique latine. À la différence de la Chine, où beaucoup
de paysans peu productifs ont été absorbés par un secteur
industriel où leur production était mieux valorisée (puisqu'en
grande partie exportée), les latino-américains quittant les
campagnes pour la ville se sont tant bien que mal intégrés
dans des services peu productifs, car souvent informels.
Partout, la part de l'industrie (le secteur le plus susceptible
d'une "convergence de productivité") dans l'emploi recule
très nettement pendant les années 1990.
9
On signalera aussi le très faible effort de R&D dans tous les
pays de la région, à l'exception du Brésil.
10
Rodrik, op. cit..
11
Easterly ("National Policies and Economic Growth: A
Reappraisal" in Aghion, P. et Durlauf, S.L., "Handbook of
Economic Growth", vol. 1A, Elsevier North-Holland, 2005) esti-
mait aussi que cette convergence ne peut même pas être
"stimulée" à l'échelle d'un pays par des ajustements de la
politique économique : selon lui la corrélation entre la croissan-
ce et diverses variables de politique économique disparaît si
l'on ne prend pas en compte les observations correspondant à
des "politiques économiques extrêmement mauvaises" (par
exemple, avec un déficit budgétaire supérieur à 12% du PIB).

Jean-Louis Martin
jean-louis.martin@credit-agricole-sa.fr
N° 13/03 – Août 2013 5
Quelles perspectives à l'horizon 2020 ? Concernant la
convergence "interne", il n'y a aucune raison d'imaginer
que les progrès vont s'interrompre; au contraire, certains
facteurs pourraient les soutenir. Ainsi, l’IDE dans les
secteurs industriels latino-américains devrait continuer à
progresser, et en partie se substituer à l'effort local
d'investissement en R&D : l'investisseur apporte aussi des
avancées technologiques. L'amélioration lente des
systèmes éducatifs aura également un impact positif. Des
progrès sont aussi possibles dans les secteurs agro-
industriels, notamment en Colombie, en Argentine et au
Paraguay, comme cela a été le cas au Brésil. Enfin, la faible
productivité des services n'est pas générale. Certains sont à
forte valeur ajoutée, avec un réel potentiel de
développement : le tourisme (particulièrement au Mexique),
les services financiers (la région est globalement sous-
bancarisée), et certains services à la personne à forte
valeur ajoutée (par exemple, les services médicaux).
Encadré – Les ressources naturelles : une chance ou un malheur ?
La majorité des pays latino-américains sont de plus en plus dépendants des matières premières.
Partout, à l’exception de l’Amérique centrale, leur part dans le total des exportations a augmenté. Sur
l'ensemble de la région, elle est ainsi passée de 42% à 61% entre 2000 et 2010. Dans les pays plus
dépendants, cette part dépasse ou s'approche de 90% : Venezuela, mais aussi Chili, Pérou, Bolivie,
Équateur, Colombie. Il s'agit avant tout d'un effet prix : entre 2004 et 2011, l'indice des prix des matières
premières exportées par la région a augmenté de 128%. Les exportations ont beaucoup moins
progressé en volume, à quelques exceptions près.
Cette "bonanza" a eu un impact majeur sur les économies. Elle a d'abord considérablement desserré la
contrainte extérieure, qui était sauf exception (le Venezuela) forte. Ceci a contribué à faciliter l'accès
aux marchés financiers des États (mieux notés) et des entreprises, qui ont ainsi pu accroître leurs
investissements. Cette nouvelle aisance a aussi permis d'augmenter massivement les importations de
biens de consommation, ce qui a amélioré le niveau de vie. Mais cela a aussi contribué à
l'affaiblissement des industries locales, rarement en état de résister à la concurrence des pays avancés
ou de la Chine, d'autant que la progression des recettes d'exportations et l'afflux de capitaux ont provo-
qué une appréciation soutenue des devises sud-américaines, parfois (comme au Brésil) jusqu'à un
niveau à l'évidence insoutenable. Le risque de "maladie hollandaise" est donc patent : appréciation du
taux de change, attrition des secteurs productifs en dehors des activités rentières, vulnérabilité accrue à
la conjoncture mondiale… Certains pays, comme le Chili, ont assez bien réussi à maîtriser ces effets
négatifs. Mais la région compte aussi des cas avérés, voire terminaux (Venezuela), et d'autres pays
sont menacés : Colombie, Argentine, et bien sûr le Brésil.
Cette menace appartient toutefois peut-être au passé. Les prévisions des analystes pointent, en effet,
une probable baisse des prix des matières premières minérales (énergie et métaux) et agricoles à
l'horizon 2020. Au minimum, il est plus que probable que l'augmentation massive depuis dix ans des
prix des matières premières exportées par la région ne peut être extrapolée. Par ailleurs, les
perspectives d'accroissement significatif des volumes exportés sont limitées à quelques pays : au
Venezuela, où la production pétrolière peut être redressée, au Brésil, avec les gisements "pre-sal", et
en Argentine, au Brésil et sans doute en Colombie pour les produits agricoles. Les contraintes
financières (externes et budgétaires) vont se resserrer, mais le risque de "reprimarisation" des
économies latino-américaines va s'atténuer (le Venezuela constituant bien sûr une exception).
Les risques de dérapage
Des "accidents" pourraient cependant perturber le
scénario central. Les deux principaux éventuels facteurs
perturbateurs sont un ralentissement économique global
(et en particulier aux États-Unis et en Chine), et la
matérialisation du risque politique dans la région.
Le risque de ralentissement global : un double impact
sur la région
Une crise économique durable dans les pays développés
affecterait presque certainement les pays latino-
américains. En 2009, le PIB régional a reculé de 1,5% en
volume, alors qu'il avait progressé en moyenne de 5,3%
par an pendant les cinq années précédentes.
Il est clair que si une telle crise devait être durable, le choc
serait cette fois plus violent en Amérique latine. Il n'y a pas
de "découplage" entre la conjoncture régionale et son
environnement global. La contagion d'une crise se ferait
par deux canaux. D’une part, via le commerce extérieur. Les
États-Unis restent de loin le principal client du Mexique, de
la Colombie et du Venezuela, et de tous les pays
d'Amérique centrale et des Caraïbes (sauf Cuba). Et la part
de la Chine dans les exportations latino-américaines a
augmenté partout depuis dix ans, dépassant 20% au Chili et
au Pérou, s'en approchant au Brésil. Une Chine qui ne
croitrait plus qu'à 5% ou moins réduirait fortement sa
consommation de matières premières dont les prix ne
manqueraient alors pas de chuter. D’autre part, via le "canal
financier" : un ralentissement durable dans les pays avan-
cés se traduirait par une montée de l'aversion au risque
émergent. Les entrées d'investissements directs seraient
sans doute assez peu affectées, mais les investissements
de portefeuille et les crédits bancaires pourraient se tarir.
Une forte réduction ou un retournement de ces flux rendrait
plus difficile le financement des déficits des paiements
courants, qui tendraient, en outre, à se creuser en raison de
la chute des prix des matières premières exportées par la
région.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
1
/
15
100%