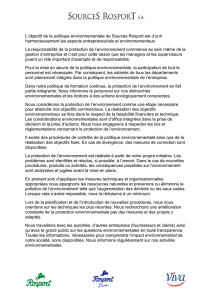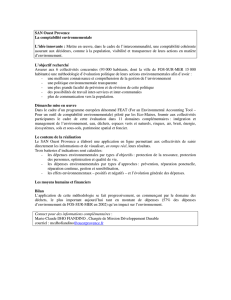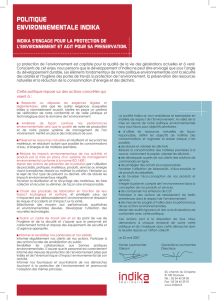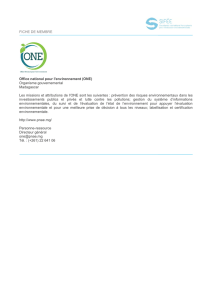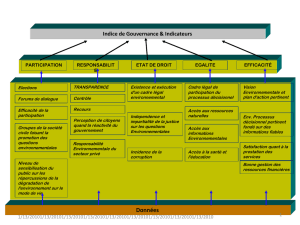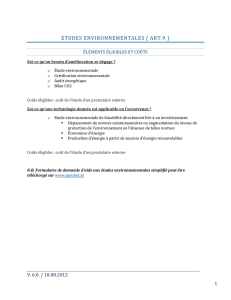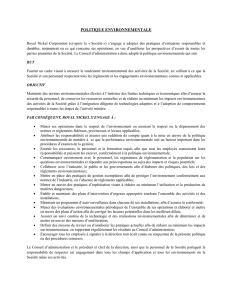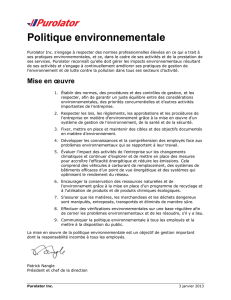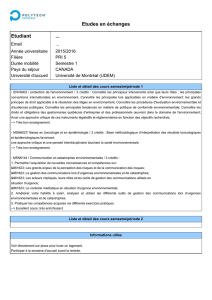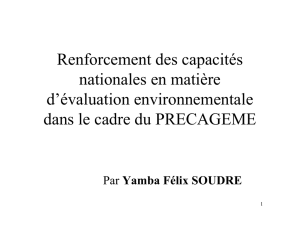intégrer les démarches qualité et environnement

INTÉGRER LES DÉMARCHES QUALITÉ ET
ENVIRONNEMENT
Boiral, O. (1997), «La Qualité au service de l’environnement», L’Expansion Management
Review, no. 86, septembre, p. 41-49.
Les questions environnementales représentent aujourd’hui un enjeu stratégique pour les entreprises
industrielles. Longtemps subordonné aux besoins de l’activité économique et considéré comme un
ensemble de ressources illimitées, l’environnement naturel apparaît aujourd’hui comme une
préoccupation collective qui doit être intégrée aux activités productives. Les pressions réglementaires
et sociétales pour le respect des écosystèmes imposent des contraintes auxquelles les entreprises ne
peuvent se soustraire sans compromettre la légitimité de leurs activités. Dès lors, l’ouverture aux
valeurs environnementales et les investissements dans des équipements de dépollution apparaissent
comme un impératif pour assurer la survie de l’entreprise. Ces investissements se traduisent souvent
par des dépenses très lourdes. En 1991, la société Rhône-Poulenc a par exemple investi près de 200
millions de francs dans la construction d’une usine d’incinération de déchets liquides dans ses
installations de Pont-de-Claix (Viardot, 1993). De façon globale, les dépenses de fonctionnement
pour l’environnement des entreprises industrielles françaises ont augmenté de plus de 75% entre
1984 et 1990 (Perroy et Salamitou, 1992).
Pour de nombreuses entreprises, les investissements environnementaux ne constituent pas seulement
une contrainte ou un coût. Ils peuvent également représenter un moyen pour réaliser certaines
économies de matière et d’énergie, pour améliorer l’image de l’entreprise, ou encore pour développer
un avantage compétitif par rapport à la concurrence. Outre les systèmes de traitement des
contaminants, les changements de procédés et le lancement de «produits verts», la réduction des
impacts environnementaux exige des efforts pour intégrer ces préoccupations dans la gestion
quotidienne et pour responsabiliser l’ensemble des employés à ces questions. Par les remises en
causes globales qu’elle implique et l’importance de la participation du personnel, cette démarche
d’intégration présente de nombreuses affinités avec la gestion de la qualité. Ainsi, les systèmes de
gestion environnementale, qui ne cessent de se développer depuis le début des années 90, font de
plus en plus appel à des concepts et à des méthodes inspirés de la démarche qualité: «amélioration
continue», contrôle des «non-conformités», prévention, réduction des pertes et du gaspillage, «zéro-
pollution»... Jadis considérée comme une «externalité», comme une conséquence indésirable et
inéluctable des activités de production, la pollution fait désormais l’objet d’un contrôle presque aussi
rigoureux que celle des produits finis. L’interdépendance entre la gestion de la qualité et la gestion
environnementale a conduit certaines entreprises, comme Rhône-Poulenc ou encore Procter et
Gamble, à intégrer ces deux préoccupations au sein d’une fonction commune, disposant de
responsabilités et de moyens étendus. D’autres entreprises, comme 3M, Xerox ou DuPont, utilisent
couramment la démarche et les principes de gestion de la qualité pour développer des programmes
environnementaux.
Ce rapprochement entre la qualité et l’environnement suscite de plus en plus d’intérêt auprès des
dirigeants, en raison des efforts importants qui ont été investis, depuis le début des années 80, dans
la mise en oeuvre de programmes d’amélioration de la qualité et de l’expérience des entreprises dans

ce domaine. L’analyse des correspondances entre ces deux préoccupations stratégiques pour
l’entreprise offre ainsi un cadre de référence pour comprendre les tendances et les principes de
management de plus en plus utilisés dans la gestion environnementale.
PRÉVENIR LES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX : UN IMPÉRATIF STRATÉGIQUE
Dans la plupart des entreprises, les actions environnementales ne se sont pas développées de façon
spontanée, en l’absence de toute pression externe du législateur, des groupes écologistes, des
concurrents ou encore du marché. De façon générale, ces pressions peuvent s’exprimer, à l’image
des problèmes d’ordre stratégique, en termes de menaces ou d’opportunités.
En premier lieu, l’engagement environnemental des entreprises est longtemps resté surtout réactif
et motivé par le développement des législations, qui constituent la principale contrainte pouvant
compromettre la pérennité ou la légitimité sociale des activités des entreprises. Ainsi, selon une étude
réalisée au début des années 90 auprès de 250 grandes entreprises européennes, plus de 90% des
dirigeants estiment que la réglementation va devenir plus stricte et 80% pensent que la législation
future aura un impact sur les activités. L’anticipation des pressions réglementaires joue un rôle
fondamental pour assurer la survie à long terme de l’entreprise. La prise en compte des questions
environnementales en amont des processus décisionnels et dans la conception des procédés permet
en effet de réduire le coût et d’améliorer l’efficacité des investissements dans des technologies
«vertes». Cette démarche est particulièrement importante dans les industries où le cycle de
renouvellement des équipements est long et qui sont soumises à une réglementation très stricte. Dans
certaines entreprises, comme la Société d’Électrolyse et de Chimie Alcan, un des leaders mondiaux
dans le secteur de l’aluminium, une des principales responsabilités de la direction environnement est
d’assurer une «veille réglementaire» visant à anticiper les changements dans les normes auxquelles
sont soumises les installations industrielles. Dans d’autres entreprises, c’est la difficulté à trouver des
sites pour l’enfouissement des déchets qui représente la principale menace. Comme l’explique
Gérard Vuillard, directeur qualité-sécurité-environnement du groupe Rhône-Poulenc: «l’élément
moteur fut moins la pression écologique, ou la pression réglementaire, que le sentiment que la
question des déchets risquait de nous empêcher, tout simplement, d’exercer notre métier» (Postel-
Vinay, 1991, p.47). L’image auprès du public, des médias ou des groupes environnementaux peut
également représenter des menaces ou des pressions majeures, en particulier lorsque les risques
technologiques sont importants, comme dans l’industrie chimique et pétrolière. Pour inciter les
entreprises à s’engager davantage dans le domaine de l’environnement, certaines administrations,
comme l’Agence de Protection de l’Environnement américaine, ou le ministère de l’Environnement
de Colombie Britanique, publient régulièrement des listes d’entreprises considérées comme
d’importants pollueurs.
Le second enjeu stratégique pour les entreprises est le développement des opportunités de marché
et des économies associées aux actions environnementales. L'industrie de l'environnement constitue
en effet un secteur en croissance rapide et qui touche de nombreux secteurs d'activités: fournisseurs
d'équipements antipollution, gestion des déchets, produits verts, expertise et conseil en
environnement... Les "écomarchés" au sens strict représentent déjà quelque 200 à 300 milliards de
francs en Europe et auront doublé d'ici la fin du siècle (ministère de l'Environnement français, 1990).

Les enjeux commerciaux de cette croissance ont incité certaines entreprises à faire des questions
environnementales un moyen pour se différencier de la concurrence. Ainsi, pour Porter, la protection
de l'environnement ne doit pas être considérée comme une contrainte économique mais au contraire
comme une arme concurrentielle qui stimule l’innovation et la compétitivité, tant au niveau des
entreprises que des pays en avance dans ce domaine (Porter et Van Der Linde, 1995). Selon Karrh,
vice-président santé, sécurité et environnement de la société Du Pont de Neumours:«l’ultime
avantage compétitif est de rester dans les affaires quand les concurrents disparaissent. Dans la
prochaine décennie, beaucoup d’entreprises qui n’auront pas répondu à l’impératif
environnemental n’auront plus le privilège d’exister» (Karrh, 1990). Outre ces avantages
commerciaux et concurrentiels, les actions environnementales peuvent déboucher sur une
amélioration de la productivité des entreprises : réduction du volume des déchets à traiter, diminution
des pertes de matières et du gaspillage, économies d’énergies... À l’aluminerie québécoise de
Laterrière par exemple, la mise en oeuvre d’un programme de réduction des rebuts provenant du
secteur d’électrolyse et de coulée a permis de réaliser des économies de plus de deux millions de
dollars. Ce programme a principalement reposé sur l’implication des travailleurs de l’usine et n’a pas
exigé d’investissements ou de changements techniques majeurs.
La société électronique américaine Martin Marieta de réaliser en quatre ans, dans ses trois usines de
Floride, des économies plus de 30 millions de dollars grâce à des mesures centrées sur la recherche
du «zéro-déchet» et sur une démarche «d’amélioration continue» inspirées des approches de qualité
(Sammett, 1990).
QUALITÉ ET ENVIRONNEMENT: VERS UNE APPROCHE GLOBALE ET INTÉGRÉE
La plupart du temps, les économies consécutives aux actions environnementales résultent de la mise
en oeuvre de démarches préventives qui reposent sur des principes similaires à ceux utilisés en
gestion de la qualité: élimination des problèmes à la source, intégration des préoccupations
environnementales dans les opérations de production, responsabilisation de l’ensemble du personnel,
implication de la haute direction... Cette symétrie a conduit certaines entreprises à transférer, dans
la gestion environnementale, des approches ayant déjà fait leur preuve dans le domaine de la qualité.
Ainsi, pour réduire les émissions fugitives de composés organiques volatils (COV), qui contribuent
en particulier à la formation de l’ozone au sol, une usine de la division plastique de la société Union
Carbide a développé un programme de prévention basé sur le modèle de gestion de la qualité totale
conçu par le département de la défense américain (Bemowski, 1991). La mise en oeuvre de ce
modèle, qui repose sur une démarche «d’amélioration continue», a permis, dans certaines unités de
cette usine, de réduire les COV par cinq.
Pour comprendre la solidarité entre la gestion de la qualité et la gestion environnementale, il convient
de préciser les grandes étapes de leur développement. La plupart des spécialistes de la qualité
s’accordent en effet pour définir l’évolution des pratiques dans ce domaine comme un processus de
plus en plus global et intégré, dans lequel la participation des employés et la prévention sont
appelées à jouer un rôle prédominant (Kélada, 1991; Stora et Montaigne, 1986; Jouslin de Rosnay,
1989; Teboul, 1990; Hermel, 1989). Autrefois perçue comme une fonction technique, dont la
responsabilité était confiée à des spécialistes, la qualité s’affirme aujourd’hui comme une
préoccupation globale, qui nécessite l’implication de tous et de chacun pour prévenir les non-
conformités à la source, le plus en amont possible des procédés. De façon symétrique, plusieurs

études empiriques sur la gestion environnementale des entreprises (Bara, 1988; Filion, 1988; Allenby,
Richards et al., 1994; Boiral, 1996), montrent que les programmes dans se domaine s’articulent de
plus en plus autour d’une démarche préventive, visant à réduire la pollution à la source. À l’image
de la qualité totale, la promotion de cette approche préventive implique une participation active des
employés. Les initiatives environnementales ne sont plus seulement la responsabilité de services
spécialisés mais celle de chaque fonction, de chaque activité dont les opérations peuvent avoir un
impact sur le milieu naturel.
Comme l’illustre la figure ci-après, ces tendances générales peuvent se résumer comme un processus
à trois étapes, caractérisé par un élargissement et un rapprochement progressifs des préoccupations
pour la qualité et pour l’environnement:
- le contrôle en fin de processus (contrôle de la qualité, actions environnementales de type
palliatives);
- le développement de systèmes de gestion structurés (assurance qualité, systèmes de gestion
environnementale);
- la promotion de la participation et de l’implication de chaque individu («qualité totale
environnementale»).
Les étapes de ce processus ne sont pas mutuellement exclusives. Elles ne correspondent pas à une
L'ÉVOLUTION DE LA GESTION DE LA QUALITÉ ET DE LA GESTION ENVIRONNEMENTALE
Dimension sociale (participation, implication)
Dimension préventive (agir à la source)
Contrôle en fin de processus
(contrôle de la qualité, actions
environnementales palliatives)
Systèmes de gestion intégrés aux activités
(assurance qualité, systèmes
de gestion en environnement)
"Qualité totale environnementale"
(promotion des principes de la qualité totale
dans le management de la qualité et dans la
gestion environnementale)

évolution linéaire et séquentielle, mais plutôt à un élargissement progressif des étapes antérieures.
Par ailleurs, les politiques environnementales sont généralement plus récentes que les programmes
d’amélioration de la qualité, même si les phases de leur développement sont symétriques.
LE CONTRÔLE EN FIN DE PROCESSUS: UNE DÉMARCHE SURTOUT PALLIATIVE
Le développement des mesures pour contrôler la qualité a d’abord reposé sur l’inspection des
travailleurs et sur le contrôle empirique de la qualité des produits (Hermel, 1989; Stora et Montaigne,
1986). Cette logique de contrôle et de surveillance tend à faire de la qualité une fonction séparée des
opérations de production et suscitant la méfiance des travailleurs. Dans les années 30, le
développement des méthodes statistiques va donner au contrôle de la qualité une approche plus
formelle et plus normative. Cependant, par ses aspects techniques, la gestion de ces systèmes de
contrôle de la qualité est longtemps restée le monopole d’ingénieurs et de spécialistes, qui jouaient
alors souvent un rôle de «policiers» dans la recherche des non-conformités aux procédures et aux
spécifications techniques établies (Kélada, 1989).
Ce rapide aperçu sur le contrôle de la qualité montre des correspondances intéressantes avec les
politiques environnementales de type palliatives, qui visent à contrôler les rejets dans le milieu naturel
en fin de processus, en aval des procédés. En premier lieu, le contrôle de la pollution a d’abord
reposé sur une logique très policière, centrée sur le rôle coercitif des règlements environnementaux
et des pressions sociétales. L’objectif des politiques environnementales était avant tout de réagir à
ces pressions afin d’éviter les pénalités ou les incidents pouvant porter préjudice à l’image de
l’entreprise. Les investissements environnementaux portaient davantage sur des équipements de
dépollution situés en aval des procédés que sur des changements dans les méthodes de production
ou dans les installations à l’origine des rejets de contaminants. À l’image du contrôle de la qualité,
cette approche palliative, qui reste indispensable dans les entreprises, est donc réactive. Elle vise à
corriger des nuisances ou des «non-conformités» par rapport aux normes environnementales plutôt
qu’à les prévenir à la source.
En second lieu, les opérations de mesure et d'échantillonnage de la pollution à la sortie des effluents
ou des cheminées d'usines sont similaires, dans leur principe, au contrôle par échantillonnage de la
qualité des produits. Les indicateurs de pollution doivent ainsi être l’objet de mesures régulières, dans
le cadre de campagnes d’échantillonnages réalisées durant des périodes représentatives de l’activité
habituelle des installations. Les normes à respecter ne sont pas ici définies par le client mais plutôt
par le législateur ou encore par des critères internes. À l’instar de la qualité des produits, la "qualité"
des rejets, ou leur "conformité" par rapport aux normes jugées acceptables, n'est pas parfaitement
stable ni prévisible. L'analyse des statistiques environnementales montre que les émissions
atmosphériques et les rejets dans les effluents industriels sont généralement irréguliers, intermittents,
que des "pics" traduisant des fluctuations plus ou moins erratiques de la charge polluante se
manifestent fréquemment. Le contrôle de ces fluctuations est d’autant plus importants que les effets
sur la santé et les dommages causés à l’environnement se manifestent à partir de certains seuils
critiques d’exposition.
Ainsi, depuis 1993, les raffineries Shell et Pétro-Canada de Montréal-Est se sont associées pour
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
1
/
13
100%