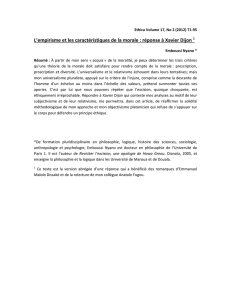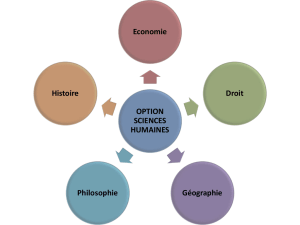Tracés 12 - Tracés. Revue de Sciences humaines

Relativismes et jurisprudence.
Un dialogue entre philosophes
et historiens
AURÉLIEN ROBERT
Parmi les nombreux débats qui ont agité la communauté historienne, celui
sur l’objectivité et sur la vérité des récits historiques est certainement l’un
des plus récurrents¹, avec comme trame de fond le spectre du relativisme. Si
ces questions entraînent une réfl exion méthodologique de la part de l’histo-
rien, elles demandent aussi une réponse d’épistémologue à la question plus
générale du relativisme culturel et conceptuel tant débattue par les philo-
sophes. Y a-t-il, par exemple, une incommensurabilité indépassable entre la
pensée médiévale et la nôtre ? Par-delà la méthode historique, c’est donc la
possibilité même du projet historien qui est passée au crible de l’épistémo-
logie. Dans ce cadre, on pourrait imaginer une coopération idyllique entre
l’historien et le philosophe ; il est pourtant remarquable qu’un tel dialogue
n’a pas toujours été aisé, même sur ces terrains communs. On se souvient
par exemple que Lucien Febvre jugeait le philosopher comme le « crime
capital » pour l’historien (, p. ). En retour, on rencontre chez certains
philosophes une désinvolture affi chée envers l’histoire, y compris celle de
leur propre tradition². Comme le résume parfaitement Roger Chartier :
Le trouble historien naît de l’écart constaté entre deux univers de savoir, large-
ment étrangers l’un à l’autre. L’histoire telle qu’elle se fait n’accorde guère d’im-
portance au questionnaire classique des discours philosophiques produits à son
sujet, dont les thèmes paraissent sans pertinence opératoire pour la pratique
historienne. (, p. )
Le but de cette contribution sera assez modeste. Il s’agira d’éclairer quelques-
unes des raisons de ce dialogue diffi cile à partir d’un débat contemporain qui
On trouvera une présentation des principaux enjeux de ces débats dans Ricœur, ,
p. -.
On cite généralement le cas extrême de Gilbert Harman qui conseillait à ses étudiants de ne
pas lire un livre de plus de dix ans. Voir Engel, , p. .
TRACÉS 12 2007/1 PAGES 167-180

168
divise les historiens de la philosophie médiévale. Cependant, au terme de ce
parcours, nous esquisserons quelques pistes pour renouer ce dia logue.
Un chiasme
L’agacement de l’historien ne se résume pas à une diff érence de pratique ; il
trouve son origine dans un double rejet : celui des philosophies de l’histoire
(Hegel, Marx, Spengler ou Toynbee par exemple) et celui de la méthode en
histoire de la philosophie (c’est-à-dire une histoire décharnée, décontextua-
lisée, qui considère le monde des concepts comme un monde séparé). Lais-
sant de côté les philosophies de l’histoire, c’est sur le second grief que nous
aimerions nous pencher.
Aux yeux des historiens, l’histoire de la philosophie apparaît comme
une des formes de relativisme qu’ils abhorrent, où seul l’intérêt contempo-
rain gouverne l’entreprise, puisqu’on y cherche des réponses à nos propres
problèmes et que la fi délité aux sources semble passer au second plan. Au
contraire, pour la caricature du philosophe ébauchée plus haut, s’attacher
aux conditions matérielles des productions intellectuelles, aux institutions,
aux mœurs ou à l’histoire des corpus pourrait constituer une posture relati-
viste. Analyphron, le personnage inventé par Pascal Engel, ne dit pas autre
chose : « Celui qui refuse la distinction entre philosophie et histoire ne peut
que soutenir une forme, plus ou moins radicale, de relativisme. » (a,
p. ) Car si les pensées antiques, médiévales ou modernes dépendaient à
ce point d’un contexte, d’une rationalité qui leur serait propre, elles devien-
draient d’une certaine manière incommensurables avec nos préoccupations
contemporaines. On aurait donc deux formes antagonistes de relativisme,
l’une concernant la fi délité au passé, l’autre la vérité anhistorique. Pour
mettre en lumière ce chiasme conceptuel, on partira du débat qui oppose
Claude Panaccio et Alain de Libera³.
On lit parfois que le premier incarne la manière « analytique » de faire
de l’histoire de la philosophie, alors que le second représenterait plutôt la
manière « continentale »⁴. Cette distinction s’estompe à la lecture de cer-
tains livres des deux auteurs. Le discours intérieur de Claude Panaccio ()
semble suivre les règles de l’histoire continentale de la philosophie et La
référence vide d’Alain de Libera () emprunte beaucoup à la philosophie
On trouvera une présentation diff érente de la nôtre dans Flasch, , p. -.
Sur cette distinction, voir l’introduction dans Vienne éd., .
AURÉLIEN ROBERT

169
analytique pour comprendre et analyser certaines thèses médiévales sur la
nature des propositions. Malgré ces échanges provisoires d’habits métho-
dologiques, nos deux philosophes ont longuement écrit sur la méthode en
histoire de la philosophie. Ce qui les distingue ne tient pas tant à une prise
de position pour ou contre l’histoire – les deux se disent historiens de la phi-
losophie – qu’à leur opposition théorique sur le relativisme.
Une histoire jurisprudentielle de la philosophie
Dans un de ses livres sur Guillaume d’Ockham, Claude Panaccio explique
clairement son intention :
Mes propres options sont les suivantes. Quant au fond, je m’intéresse aux dis-
cussions de la philosophie analytique contemporaine autour de la question du
nominalisme et je me demande si la pensée d’Ockham, dûment reconstruite, a
quelque chose de positif à y apporter (, p. ).
Au-delà de la compréhension d’Ockham, cette méthode se veut donc
« jurisprudentielle »⁵. Il s’agit de juger la pensée du philosophe anglais pour
renforcer nos propres jugements. Panaccio propose une justifi cation philo-
sophique de sa méthode, fondée sur des arguments anti-relativistes, qui doit
à la fois permettre de conserver une certaine fi délité à l’auteur et rendre pos-
sible un dialogue anachronique entre les médiévaux et les contemporains.
Que faut-il entendre par une pensée « dûment reconstruite » ?
Reprenant la distinction célèbre de Richard Rorty entre quatre manières
de faire de l’histoire de la philosophie (), Claude Panaccio distingue la
reconstruction rationnelle, la reconstruction historique, la Geistesgeschichte et la
doxographie (). Une fois les deux dernières formes d’histoire écartées,
Panaccio ajoute une étape supplémentaire à la reconstruction qu’il propose.
On doit séparer, selon lui, le récit explicatif, dans lequel on replace une idée
ou une doctrine dans une histoire, et la reconstruction doctrinale, qui englobe
la reconstruction rationnelle et la reconstruction historique distinguées par
Rorty. La pars reconstruens doit elle-même obéir, de manière non exclusive,
à deux contraintes : fi délité et pertinence. Selon que l’on accentue l’une ou
l’autre, on pourra distinguer plusieurs types de reconstructions sur l’échelle
qui va de la reconstruction purement historique – où le récit explicatif peut
même prendre le pas sur la reconstruction proprement dite – à la recons-
truction purement rationnelle, qui tiendra principalement compte de la
L’expression vient de Ishiguro, .
RELATIVISMES ET JURISPRUDENCE

170
pertinence des idées et non du contexte. Soucieux d’une certaine fi délité au
texte, les livres de Panaccio tendent cependant à favoriser la pertinence. On
se demandera donc si la fi délité – ce que les historiens subsument en fait
sous leur concept de vérité historique – n’est pas tout simplement incom-
patible avec le critère de pertinence ici en jeu.
Reconstruire pertinemment une pensée requiert l’application de quatre
grands principes qui ont été résumés par Pascal Engel (). Il faut accep-
ter un principe d’atomicité, selon lequel on peut toujours isoler des thèses et
des arguments de leur contexte ; un principe de traductibilité, par lequel on
pose la possibilité de traduire les propos du passé dans notre propre idiome
philosophique contemporain ; un principe d’argumentativité, qui affi rme
que les thèses et les arguments du passé sont discutables, voire révisables par
nos soins en cas de manque de cohérence interne ; un principe de référence,
plus fl ou, selon lequel « la philosophie porte sur une réalité indépendante,
qu’elle peut décrire plus ou moins correctement » (ibid., p. ). Dans un
tel programme, il s’agit d’examiner une vérité philosophique, atemporelle,
celle des thèses ou des arguments considérés en dehors de leur contexte
d’origine. Comme l’écrit Jonathan Barnes (), « c’est l’espoir et le but de
la méthode analytique de dévoiler la pensée pour mieux y révéler la vérité
toute nue ».
On pourrait discuter chacun de ces principes dans son opposition à la
fi délité si chère aux historiens. De quel droit peut-on corriger ou réécrire
ce qu’a écrit un auteur du passé sous prétexte de dévoiler « la vérité toute
nue » (principe d’argumentativité) ? Isoler des problèmes, des thèses ou des
arguments (principe d’atomicité) a une portée pratique indéniable pour celui
qui cherche à dégager les traits les plus pertinents aujourd’hui d’une pensée
du passé. Mais sur quoi repose ce choix, sinon sur nos propres intérêts ? De
manière générale, peut-on prétendre comprendre une thèse hors contexte ?
Le principe de référentialité paraîtrait tout aussi obscur aux yeux d’un his-
torien. En quoi consiste cette « réalité indépendante » qui constituerait le
domaine exclusif du philosopher ? Les philosophes médiévaux, par exemple,
ne faisaient-ils pas partie d’institutions ? Leurs productions n’étaient-elles
pas réglées par la nature même des exercices exégétiques de l’université ?
L’Église n’exerçait-elle pas une certaine infl uence sur leur façon de penser ?
Au total, il semble que l’on ne puisse pas déplacer aussi librement le curseur
méthodologique sur le segment formé par la fi délité et la pertinence. Être
fi dèle, c’est parfois refuser la pertinence (certaines théories du passé sont
simplement fausses ou incohérentes) et être pertinent, c’est presque tou-
jours être infi dèle, si l’on suit les préceptes exposés ci-dessus.
AURÉLIEN ROBERT

171
Il est diffi cile de comprendre comment ces principes – ou une partie
d’entre eux au moins⁶ – peuvent être pensés à la fois comme condition de
la compréhension des textes anciens et comme justifi cation de la méthode
(ce qui en ferait une méthode naturelle). C’est parce que la pensée médié-
vale n’est pas sans commune mesure avec la nôtre que nous la comprenons ;
c’est aussi la raison pour laquelle nous pouvons la reformuler et la discuter.
Attachons-nous de plus près au principe de traductibilité, point central dans
le débat entre relativisme et absolutisme⁷, repris ici par Panaccio et appliqué
au champ de l’histoire.
Dans un article célèbre sur lequel Panaccio et Engel s’appuient, Donald
Davidson () s’attaque vigoureusement au relativisme conceptuel,
incarné notamment par omas Kuhn et Paul Feyerabend. Ce relativisme
conceptuel affi rme l’existence de schèmes conceptuels incommensurables
et intraduisibles entre eux (comme la physique newtonienne et la phy sique
relativiste). Ce relativisme des schèmes inquiète, car il pourrait impliquer
un relativisme de la vérité. Le vrai lui-même serait relatif à un système
conceptuel, à une culture ou à une langue, comme ont essayé de le montrer
Edward Sapir et Benjamin L. Whorf, par exemple. Contre cela, Davidson
oppose une série d’arguments dont le cœur est l’affi rmation de la nécessaire
unité de la raison et des croyances. Lorsque j’interprète un texte ancien ou
une parole d’un habitant de Nouvelle-Guinée, je ne peux faire autrement
que de lui attribuer certaines croyances et certains principes minimaux de
rationalité identiques aux miens, en suivant un principe de charité. C’est
une condition sine qua non de la compréhension et de l’interprétation. L’an-
thropologue serait dans cette situation face à une population indigène⁸,
comme l’historien de la philosophie médiévale face à un texte d’Ockham⁹.
L’idée est la suivante : si je veux comprendre un texte ou une pensée
étrangère, je dois comprendre son langage et être capable de le traduire
dans mon propre idiolecte. S’il existait des schèmes conceptuels entière-
ment diff érents, on ne pourrait ni les comprendre, ni les traduire. Or, selon
Davidson, une telle traduction est toujours possible. On ne peut pas même
imaginer une intraduisibilité partielle entre deux modes de pensée, car cela
demanderait de renoncer à comprendre l’interprétation comme l’attribution
Panaccio ne retient pas le principe de référentialité.
Sur ces étiquettes, voir Nef, .
Sperber, , p. : « [l’anthropologue] essaie d’accorder ce qu’il pense que les gens pensent
avec ce qu’il pense que lui-même penserait s’il était vraiment l’un d’eux ».
Engel, b, p. - : « La reconstruction rationnelle […] s’appuie sur l’idée que l’auteur
étudié suit certains principes minimaux de rationalité que nous partageons avec lui. »
RELATIVISMES ET JURISPRUDENCE
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
1
/
14
100%