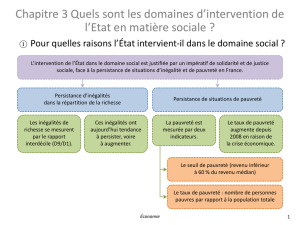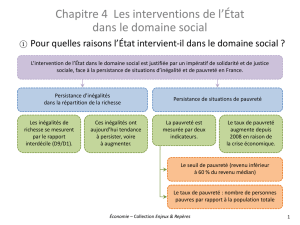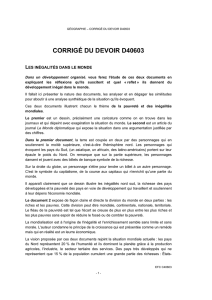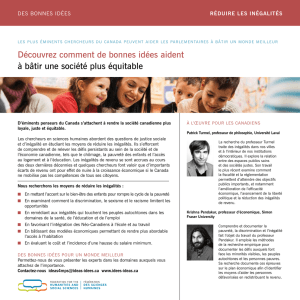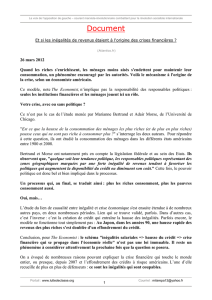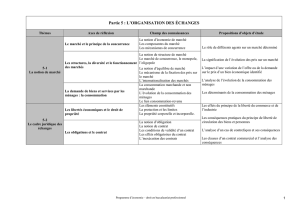Population et emploi, les nouveaux enjeux Inégalités économiques

Vingt ans
de transformations
de l'économie
française
Cahiers français
n° 311
Population
et emploi,
les nouveaux enjeux
88
Population et emploi,
les nouveaux enjeux
Inégalités
économiques,
état des lieux
Les inégalités économiques ont cessé de
se réduire depuis vingt ans, après
plusieurs décennies de resserrement des
écarts de niveau de vie. Outre la
dégradation de la situation des ménages
à faible revenu en raison de la montée du
chômage et des emplois précaires, c’est
l’accroissement des revenus du
patrimoine qui a empêché que le
mouvement séculaire se poursuive. Si le
filet de sécurité public a notamment
contribué à limiter le creusement des
écarts de revenus disponibles, ses
récentes inflexions remettent en question
sa progressivité, indispensable pourtant
pour influencer positivement l’évolution
des inégalités.
C. F.
par unité de consommation (uc) inférieur à 3 900
francs en 1970 contre moins de 20 % en 1997, ce qui
dénote une progression manifeste du niveau de vie
moyen des ménages. Toutefois, le constat d’un
approfondissement des inégalités repose sur des
phénomènes qui ont affecté le revenu des Français,
telles que la montée du chômage, la précarisation
d’une partie des emplois ou encore l’augmentation
du rendement du patrimoine, et ce de façon très
différente selon les catégories sociales.
Malgré le caractère profondément multidimensionnel
des inégalités, les disparités sociales étant par nature
interdépendantes des inégalités économiques, nous
ne traiterons ici que de l’aspect économique de la
question.
Les inégalités de revenus
face aux transformations
du travail
Stabilité de l’éventail des salaires
Après une forte réduction durant les années 70, le
rapport interdécile (2) a connu une relative
stabilisation depuis vingt ans (voir le graphique 1 ci-
contre). Ainsi, le dixième des salariés les mieux
rémunérés a un salaire moyen 3,2 fois supérieur à
celui du dixième le moins bien rémunéré. Si la
hiérarchie des salaires s’est faiblement accrue à la
fin des années 80, elle s’est stabilisée lors de la
décennie suivante, et a, il est vrai, connu une faible
réduction sur les dernières années de l’observation.
Le rapport interdécile a donc cessé de diminuer après
plusieurs décennies de baisse continue. Toutefois,
cette stagnation s’est produite dans un contexte
économique beaucoup moins favorable que ne l’ont
été les « Trente Glorieuses ». De plus, cette évolution
s’inscrit à rebours de la tendance à l’élargissement
de l’éventail des salaires dans les autres pays
industrialisés ces vingt dernières années, en
particulier au Royaume-Uni et aux États-Unis où le
rapport interdécile est passé de 3,5 en 1982 à 4,3 en
1995.
L’explication majeure réside dans le rôle de rempart
contre le creusement des écarts avec les bas salaires
joué par le SMIC. En effet, celui-ci a progressé au
même rythme que la moyenne des rémunérations
horaires, ce qui a évité un décrochage des bas salaires.
Cette influence du SMIC n’est pas nouvelle puisque
la hausse de l’inégalité salariale de 1950 à 1967 tenait
au fait que le SMIG (3) était indexé sur l’inflation,
laquelle progressait moins vite que le salaire moyen.
(1) Les données plus récentes manquent encore pour le moment pour
pouvoir les inclure dans notre analyse.
(2) Il s’agit du rapport entre le revenu au-dessus duquel se situent les
10 % de ménages les plus riches et du revenu en-dessous duquel se
situent les 10 % les plus pauvres.
(3) Le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) a rem-
placé le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) en 1970.
Les inégalités économiques, problème
fondamental pour la cohésion sociale,
se sont sensiblement réduites au cours du XXe
siècle sous l’effet conjugué de la croissance
économique et d’une redistribution des fruits de cette
croissance via les prestations sociales. La France
d’aujourd’hui apparaît ainsi beaucoup moins
inégalitaire que celle des années 60 ou du début du
XXe siècle. En ce sens, les deux dernières décennies
marquent une rupture dans le mouvement de
resserrement de l’éventail des revenus.
Sur la période allant de 1970 à 1997 (1), les inégalités
de revenu ont certes baissé rapidement dans les années
70, puis plus lentement durant les années 80, mais
elles ont stagné au cours de la dernière décennie.
Le pouvoir d’achat de l’ensemble des ménages a
pourtant progressé de 38 % entre 1985 et 2000, alors
même que le sentiment général est plutôt celui d’une
dégradation des conditions de vie. De même, en francs
de 1998, la moitié des ménages disposait d’un revenu

Vingt ans
de transformations
de l'économie
française
Cahiers français
n° 311
Population
et emploi,
les nouveaux enjeux
89
L’impact du SMIC dans la détermination des
salaires s’est accru car il représente une fraction
croissante des salaires du secteur privé (de 11 %
en 1987 à 14 % en 2000).
De plus, les pouvoirs publics ont mené une
politique de réduction des charges sociales pesant
sur les bas salaires et ont donc limité dans la
deuxième partie des années 90 la baisse de la
demande d’emplois peu ou non qualifiés. Cette
politique a certes augmenté l’éventail des coûts
salariaux totaux, mais elle a maintenu le salaire net
perçu.
Toutefois, si l’écart ne s’est pas accru par le bas, il
aurait tendance à s’élargir par le haut à partir de la
fin des années 90, avec la forte croissance des très
hauts salaires. Ainsi, entre 1998 et 1999, le rapport
du dernier centile au salaire médian est passé de
4,59 à 4,67. La concurrence internationale n’amène
donc pas une égalisation des salaires vers le bas,
mais plutôt une harmonisation des salaires élevés,
ce que ne reflète pas nécessairement l’écart
interdécile qui reste un niveau trop agrégé pour
faire apparaître ce type d’évolution.
De manière plus générale, la stabilité à long terme
des écarts de salaires interdéciles pourrait être
menacée par la diversification des modes de
rémunération dont la fixation est devenue
progressivement plus aléatoire. Si
l’individualisation a peu progressé (CERC, 2002),
de plus en plus d’entreprises pratiquent la
participation et l’intéressement des salariés aux
résultats de l’entreprise. Le développement des
plans d’épargne entreprise et des stock-options en
sont l’illustration, tout comme la multiplication des
primes. Or, non seulement ces modes de
rémunération sont le plus souvent réservés aux
salariés les plus qualifiés, mais ils sont plus
importants dans les grandes entreprises que dans
les petites, et inexistants dans la fonction publique
(à l'exception des primes). Ces transformations qui
touchent très inégalement les salariés, risquent
donc de peser sur l’éventail des revenus d’activité.
La fragilisation de la relation
à l’emploi a creusé les écarts
Si l’éventail des salaires ne s’est pas creusé ces vingt
dernières années, les transformations qu’a connues
le marché du travail ont contribué à accroître les
inégalités de revenus d’activité. De 1970 à 1984, les
revenus déclarés avaient augmenté pour tous les
déciles. Par la suite et jusqu’en 1990, on avait assisté
à une stabilisation, mais à partir de cette date, les
déciles les plus bas ont connu une baisse de leur
revenu déclaré tandis que les déciles en haut de
l’échelle ont fortement augmenté.
Le développement continu du chômage a
mécaniquement réduit le revenu d’activité des
ménages dont au moins l’un des membres est touché.
Au-delà, l’augmentation de la durée moyenne du
chômage, et la baisse de l’employabilité qui en
résulte, réduisent les niveaux de vie de manière très
importante. À cela s’ajoute le durcissement de
l’indemnisation du chômage dans les années 90. Face
à la dégradation des comptes de l’assurance-chômage,
la part des chômeurs indemnisés a été fortement
réduite, passant de 63,4 % en 1993 à 52,4 % en 1999.
Dans le même temps, la proportion de chômeurs
faiblement indemnisés n’a cessé de croître (40 % des
chômeurs indemnisés touchent moins d’un demi-
SMIC en 1998 contre 12 % en 1992). Au final, le
RMI s’est substitué à l’assurance-chômage pour 10
% des chômeurs (Atkinson et alii, 2001).
La précarisation d’une partie des emplois a joué dans
le même sens. Le développement de l’intérim, des
contrats à durée déterminée, mais plus encore celui
du temps partiel, dont la part dans l’emploi total est
passé de 5,8 % en 1970 à 16,9 % en 2000, ont
fortement réduit le revenu d’activité d’un nombre
croissant de ménages. Outre que ce temps partiel est
plus souvent subi par les bas salaires (le temps partiel
non désiré représente le tiers des temps partiels du
premier décile et seulement 10 % au niveau de la
médiane), le rapport interdécile des seuls temps
partiels est de 5 contre 3,1 pour les seuls temps
complets (CERC, 2002). Cette inégale exposition au
chômage et à la précarité de l’emploi a en définitive
creusé les écarts entre les différentes catégories
d’actifs.
Autre fait marquant, la polarisation de l’emploi entre
les ménages a participé au creusement des inégalités
de revenus déclarés. On a ainsi constaté une
augmentation du nombre de ménages où les deux
conjoints ont un emploi (à plein temps ou à temps
partiel) et celui où aucun ne travaille.
Parmi les changements structurels qui ont touché
l’économie française et qui ont certainement affecté
l’évolution des inégalités, la mondialisation et la
concurrence internationale ont principalement joué
en faveur d’une augmentation des hauts salaires. De
même, l’avènement des nouvelles technologies de
l’information a constitué un changement conséquent,
mais pour autant il ne semble avoir suscité le
creusement des écarts de salaires, notamment aux
États-Unis où les inégalités salariales ont augmenté
avant tout durant les années 80. En revanche, la
1. Évolution du rapport interdécile
des salaires
Source : Picketty, 2001.

Vingt ans
de transformations
de l'économie
française
Cahiers français
n° 311
Population
et emploi,
les nouveaux enjeux
90
nouvelle organisation du travail qui a accompagné la
diffusion de ce changement technologique a
certainement contribué à remettre en cause l’évolution
relativement homogène des revenus, comme l’ont
démontré Lindbeck et Snower pour les États-Unis (4).
Les nouvelles pratiques organisationnelles qui se
développent en France ont donc pu jouer un rôle dans
l’accroissement des inégalités de revenu.
Le creusement des inégalités de marché a toutefois été
atténué pour les déciles les plus bas grâce à la montée
en charge des prestations sous conditions de ressources
versées par les pouvoirs publics. La forte croissance
du nombre d’allocataires du RMI depuis sa création
en 1988 jusqu’à la fin de l’année 1999 traduit cette
relégation d’une partie de plus en plus importante des
actifs vers les minimas sociaux.
Le rattrapage des retraités
Les retraités constituent une exception notable puisque,
grâce à une forte augmentation de leur revenu tout au
long de la période, ils ont vécu une réduction
substantielle des inégalités au sein de la catégorie, mais
aussi par rapport aux ménages d’actifs. Si leur niveau
de vie correspondait il y a vingt ans à 80 % de celui des
actifs, il est aujourd’hui compris entre 90 et
95 % (5).
Les principales raisons de cette réduction notable des
inégalités sont à chercher dans l’arrivée à maturité du
système de retraites mis en place progressivement durant
les « Trente Glorieuses ». Les classes d’âge arrivant à
l’âge de la retraite depuis vingt ans bénéficient en effet
la plupart du temps d’une retraite à taux plein, la forte
revalorisation du minimum vieillesse entre 1975 et 1984
ayant permis auparavant de réduire la pauvreté chez les
retraités. En outre, le remplacement des anciennes
générations plus inégalitaires par des nouvelles
générations dont l’éventail des salaires était plus étroit
amène mécaniquement une réduction des inégalités
entre retraités.
Ce rattrapage des retraités ne doit cependant pas occulter
que les inégalités générationnelles ont, en contrepartie,
changé de visage. En effet, si les générations nées avant
1945 ont toujours eu, à âge égal, un niveau de revenu
supérieur aux générations qui les précédaient, cette
tendance a été stoppée pour les générations récentes. Si
les retraités ont vu leur situation nettement s’améliorer,
les jeunes ont connu le mouvement inverse.
Le patrimoine au cœur
des inégalités
Une distribution particulièrement
inégalitaire
Puissant facteur d’inégalités, la concentration des
patrimoines reste très élevée en France, comme l’indique
l’indice de Gini (6) du patrimoine qui est compris selon
les générations entre 0,5 et 0,65, alors que la moyenne
de cet indice pour les revenus avoisine 0,3. Les 10 %
des ménages les plus riches possèdent plus de 40 % du
patrimoine total, la moitié la moins fortunée des ménages
n’en possédant que 10 %, ce qui se traduit par un rapport
interdécile de l’ordre de 75 (Atkinson et alii., 2001).
Cette répartition particulièrement inégalitaire du
patrimoine découle d'abord de la transmission d’une
partie de ce patrimoine par héritage ou donation.
La deuxième grande raison de cette concentration
réside dans le fait que le niveau d’épargne progresse
selon le revenu : le taux d’épargne est nul voire
négatif pour le premier quart des ménages tandis
qu’il est proche de 20 % dans le dernier quartile.
Ces dernières années ont cependant marqué une
relative baisse des inégalités de patrimoine. Ainsi,
toutes les générations ont vu le montant de leur
patrimoine médian augmenter entre 1986 et 1998.
La hausse du taux d’épargne, passé de 13,8 % à 15,9
% entre 1985 et 2000, en partie due à la constitution
d’une épargne de précaution, et le développement
de l’offre de produits financiers sont à l’origine de
la progression de la détention d’actifs patrimoniaux
(notamment financiers) au sein de l’ensemble des
ménages (voir le graphique 2 et le tableau 3).
Source : INSEE.
Note : de haut en bas : prestations sociales, salaires nets, revenus bruts de
la propriété, excédent brut d’exploitation.
(5) En incluant dans cette comparaison les revenus du patrimoine, qui
constituent environ 25 % du revenu des retraités contre 10 % pour les
actifs, leur niveau de vie dépasse désormais celui des ménages d’actifs.
(6) L’indice de Gini désigne un indicateur d’inégalité. Voir l’encadré
« La courbe de Lorenz : un indicateur de la concentration des reve-
nus », in Mondialisation et inégalités, Cahiers français, n°305,
novembre-décembre 2001, p. 9.
(7) Pour avoir une vision aussi claire que possible des inégalités, il
conviendrait d’ailleurs de tenir compte des loyers fictifs que se versent
à eux-mêmes les propriétaires, mais une telle estimation est trop déli-
cate à mettre en place pour que nous ayons une image statistique satis-
faisante.
Le problème fondamental de l’inégale répartition du
patrimoine est qu’il s’agit d’un phénomène auto-
cumulatif en raison des revenus tirés du patrimoine. A
l’exception du logement dans lequel les ménages
résident (7), le reste du patrimoine peut donner lieu à
des revenus réguliers, comme l’immobilier de rapport
2. Évolution de la composition du revenu
disponible des ménages

Vingt ans
de transformations
de l'économie
française
Cahiers français
n° 311
Population
et emploi,
les nouveaux enjeux
91
ou les valeurs mobilières (obligations, SICAV, actions,
etc.). Or, le patrimoine de rapport prend une importance
croissante au fur et à mesure que l’on s’élève dans
l’échelle des revenus et des patrimoines. De 1984 à
1994, la part du patrimoine perçue par le quart des
ménages les plus aisés serait ainsi passée de 58 % à
62 %, les plus-values et placements financiers
procurant l’essentiel des ressources des grandes
fortunes.
L’augmentation du rendement
du patrimoine
Depuis le début des années 80, la détention de
patrimoine est devenue un facteur d’autant plus
discriminant que le rendement des valeurs mobilières
s’est fortement accru tout au long de la période. Alors
que le revenu des ménages progressait en moyenne de
1 % par an entre 1984 et 1997, le patrimoine augmentait
quant à lui de 3 % et le patrimoine de rapport de 5 %.
Plus particulièrement, la détention d’actifs financiers
est devenue beaucoup plus rémunératrice que par le
passé, même en tenant compte de la forte dévalorisation
boursière depuis 2000. Il en résulte que le rendement
annuel moyen du patrimoine entre 1991 et 1999 a été
de 8 % (5 % en francs constants). Au total, le patrimoine
des ménages a été multiplié par 2,7 entre 1985 et 2000
(en euros courants) contre 1,9 pour le revenu disponible
(CERC, 2002) et la part des revenus courants du
patrimoine financier dans le revenu déclaré est passée
de 10 % en 1980 à près de 14 % en 2000.
Cette progression des revenus issus du patrimoine a
en retour généré un accroissement des écarts
interdéciles de revenus déclarés, dans la proportion des
patrimoines détenus par chacun. L’évolution du
nombre de redevables à l’impôt de solidarité sur la
fortune illustre ce changement favorable aux ménages
aisés puisque 266 000 ménages y étaient assujettis en
2001 contre 128 000 en 1990. Dès lors, sans
intervention publique, tout porte à croire que les
inégalités économiques, si elles suivaient la tendance
des inégalités de marché, seraient en forte croissance
sur les vingt dernières années.
Le rôle-clé
de la redistribution
Une réduction mécanique
des inégalités
En prélevant une partie des richesses via l’impôt et les
différents prélèvements sociaux, l’État ne vise pas
seulement à financer ses dépenses, mais il cherche à
rééquilibrer une distribution inégale des richesses et
des revenus d’activité. La redistribution, par le biais
de l’impôt sur le revenu et des prestations sociales
versées, entraîne une réduction de plus de 50 % des
inégalités au sein des ménages d’actifs entre les revenus
déclarés et les revenus disponibles. Par ce moyen,
l’indice de Gini pour 1997 est réduit de 0,34 à 0,27
(voir le graphique 4). Durant les années 70 et 80, le
système redistributif a d’ailleurs largement
accompagné le mouvement de réduction des inégalités
de revenus initiaux. La paupérisation des ménages les
3. Compte de patrimoine des ménages
(en milliards de francs courants)
Source : INSEE, Comptes nationaux.
0791 0891 0991 5991 7991
sreicnanifnonsfitcA 5461 8136 20021 25631 68441
tnod
tnemegol 428 3014 9119 06111 94021
sreicnanifsfitcA 908 6092 5419 35721 89851
tnod
tesnoitca snoitapicitrapsertua 461 354 7463 8754 3436
sfitcasedelbmesnE 4542 4229 74112 50462 48303
sreicnanifsfissaP 923 1321 0963 1463 3493
elabolgettenruelaV 5212 3997 75471 46722 14462
Source : INSEE.
Note : plus l’indice de Gini se rapproche de 0, plus la répartition est
égalitaire.
4. Indice de Gini sur le revenu disponible
et le revenu déclaré

Vingt ans
de transformations
de l'économie
française
Cahiers français
n° 311
Population
et emploi,
les nouveaux enjeux
92
plus défavorisés a ensuite été évitée en grande partie
par l’action des pouvoirs publics car, si les différentes
prestations sociales ont augmenté le niveau de vie du
premier décile de près de 50 % dans les années 70,
elles ont contribué par la suite à une augmentation de
70 % en 1990 et même de 90 % en 1996.
Cet impact de la redistribution sur les inégalités s’est
renforcé par la mise en place et la montée en charge
des minima sociaux. Le relèvement de l’allocation de
solidarité spécifique, l’extension du système d’aide au
logement, la création de l’allocation de parent isolé,
du RMI et de la CMU, tous ces filets de sécurité sociaux
ont pallié l’aggravation des inégalités de marché. Leur
effet est tel que les revenus d’activité, même s’ils restent
largement majoritaires, représentent une part
décroissante du revenu disponible des ménages (voir
le tableau 5).
L’efficacité redistributive du système français a par
ailleurs augmenté ces dernières années par la mise en
place de prestations plus ciblées envers les populations
en difficulté, notamment pour le logement, la famille
ou les prestations sous conditions de ressources (RMI,
CMU). De ce fait, le système redistributif français
réduit en 1996 la moitié de l’écart interdécile contre le
tiers en 1975.
A la base de ce système qui permet la réduction des
inégalités se trouve la progressivité du système fiscal
et plus généralement des prélèvements sociaux. En
cela, l’impôt sur le revenu joue un rôle essentiel
puisqu’il prélève chaque année une partie plus
importante des revenus des ménages imposables des
derniers déciles. Créé en 1914, soit treize ans après
l’impôt sur les successions, l’impôt sur le revenu a sans
doute été l’élément déterminant pour empêcher que
les très grandes fortunes ne puissent réapparaître après
1945 en France et par là même il a contribué au premier
chef à la réduction des inégalités (Picketty, 2001).
L’effet progressif de l’impôt sur le revenu est renforcé
par le développement aujourd’hui de prestations non
contributives sous condition de ressources dans une
logique d’assistance sociale.
5. Le revenu des ménages depuis 1970
(en milliers de francs courants)
Source : INSEE.
0791 0891 0991 7991
tnatibahrapstôpmitnavaturbelbinopsiduneveR 61811 00204 58648 249701
tnatibahrapstôpmisèrpaturbelbinopsiduneveR 18011 65073 18777 21079
éiralasraptenerialaS 77661 50955 010201 888421
tnatibahrapselaicossnoitatserP 7452 31801 39262 36943
ruetlucirgarapelocirgaIEBE 04712 72676 454581 395952
elocirganonéiralasnonfitcarapelocirganonIEBE 37414 419121 749082 559053
.leudividniruenerpertne’dnoitatiolpxe’dturbtnedécxe: IEBE: etoN
L’apport de la redistribution ne se limite pas à la
réduction des inégalités. En effet, son impact
dynamique sur l’accumulation du patrimoine évite que
la société française ne redevienne une société de
rentiers, à l’instar de celle du début du XXe siècle.
Comme le souligne Th. Picketty : « l’impôt progressif
limite les capacités d’accumulation du capital des
personnes les plus fortunées, et il réduit ainsi la
concentration future du patrimoine, et par là même la
concentration future des revenus du capital » (Atkinson
et alii, 2001). Enfin, en redistribuant régulièrement les
richesses, l’impôt facilite la fluidité sociale et permet
le renouvellement des élites économiques.
La baisse des impôts au péril
de la solidarité ?
Les évolutions récentes du système fiscal laissent à
penser que le rôle joué par la progressivité pour la
réduction des inégalités pourrait à terme être remis
en question. Parmi ces tendances, notons la baisse
du nombre de foyers fiscaux imposables (voir le
graphique 6) depuis vingt ans. Selon le Conseil de
l’impôt, seuls 42 % des revenus monétaires seraient
aujourd’hui taxés. L’impôt sur le revenu en France
apparaît certes comme fortement progressif par
rapport aux autres pays industrialisés, mais sa
concentration sur une part limitée de la population
diminue son poids, ce qui nuit à ses vertus
redistributives.
Par ailleurs, les réformes qui se sont succédé depuis
les années 80 ont réduit la progressivité de l’impôt.
Ainsi, le taux marginal supérieur d’imposition est
passé de 75 % en 1980 à 54 % en 1998 (Picketty,
2001). Cette baisse apparaît d’autant plus inquiétante
pour l’évolution des inégalités que les taux marginaux
d’imposition actuels sont les plus bas appliqués en
France depuis les années 20. En outre, l’allégement
du poids des impôts directs bénéficie davantage aux
ménages les plus aisés.
Le système fiscal français a par ailleurs connu une
véritable inflexion avec la mise en place, puis
l’extension, de la contribution sociale généralisée
(CSG) en 1991 et la création de la contribution au
remboursement de la dette sociale (CRDS) en 1996.
Ces impôts ont pour base l’ensemble des revenus et
sont donc proportionnels, c’est-à-dire que tout le
monde, quel que soit son niveau de vie, paye le même
pourcentage de son revenu. Or, leur rendement et leur
taux de prélèvement n’ont cessé de croître au point
que l’impôt sur le revenu procure désormais moins de
recettes que la CSG. Il en résulte une baisse de la
progressivité du prélèvement global.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%