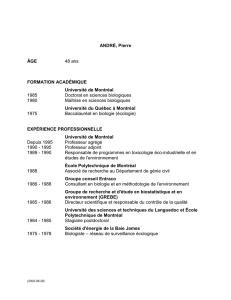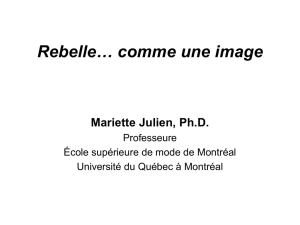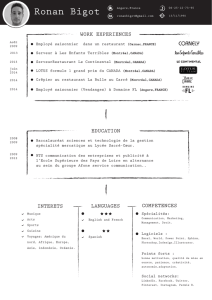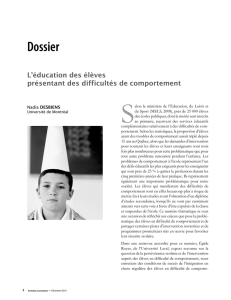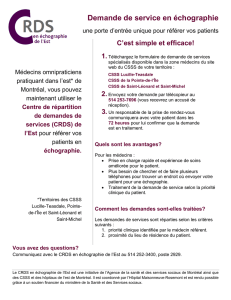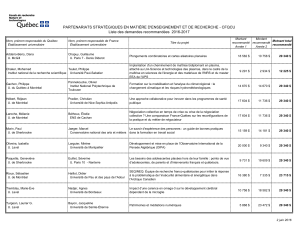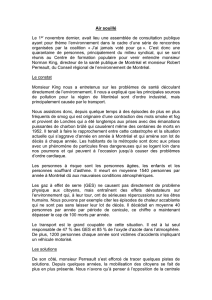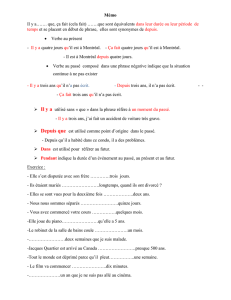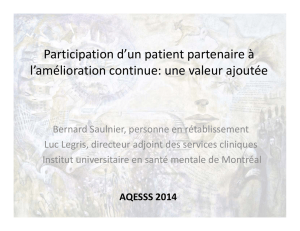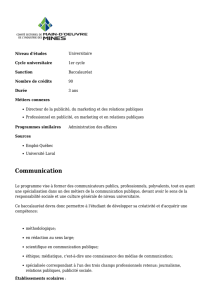L`ÉTÉ AUX URGENCES:

Dans ce numéro
VOLUME 5, NUMÉRO 1
11 SEPTEMBRE 2008
www.santemontreal.qc.ca
1L’été aux urgences:
la crise qui n’a pas
eu lieu
3Le milieu de vie
comme lieu de
traitement
4Projet de
réorganisation
novateur au CSSS du
Sud-Ouest–Verdun
5Listériose et autres
toxi-infections
alimentaires
7Coup d’œil sur
la population –
Le tabagisme
8Nouvelles du réseau
10 À vos agendas « Ça déborde de partout », titre
Le Journal de
Montréal
le 24 juin. Selon le quotidien, l’engorge-
ment des salles d’urgence montréalaises allait
prendre des «proportions alarmantes » au cours de
l’été, faute de personnel. Le 8 juillet, c’est au tour
de
La Presse
de redouter «un été infernal », consé-
quence du ralentissement de service à l’urgence de
l’Hôtel-Dieu (par manque d’urgentologues), qui
allait nécessairement entraîner des débordements
ailleurs. Deux jours plus tard, souhaitant peut-être
confirmer son pronostic,
La Presse
fait état d’un
taux d’occupation de 177% à l’Hôpital Notre-
Dame et de 163 % à l’Hôpital Royal Victoria. Du
point de vue médiatique, la crise semble bien réelle.
Maintien complet des services
pendant l’été
« Les médias ont été le reflet d’une crainte qui se
vivait sur le terrain depuis le printemps. Nous
étions déjà au fait du problème», explique la
Dre Louise Ayotte, directrice des Affaires médicales
et universitaires à l’Agence de Montréal. « Nous
avons travaillé en équipe avec le Ministère et la
direction du CHUM, nous avons questionné le
cloisonnement des trois sites relativement aux
gardes médicales et nous avons trouvé des solu-
tions à l’interne. Aussi, des médecins ont accepté
de faire des quarts de travail supplémentaires.»
L’urgence de l’Hôtel-Dieu est donc demeurée
ouverte et l’ensemble des services ont été mainte-
nus dans les urgences de Montréal. Le 22 juillet, au
cœur des vacances de la construction,
Le Journal
de Montréal
en vient même à rapporter une
« accalmie parfaite pour aller consulter un urgento-
logue sans attendre pendant des heures». En effet,
du 20 juillet au 16 août, le taux moyen d’occupa-
tion des urgences de Montréal était de 104 %, un
taux plus faible qu’à la normale. C’est donc dire
que les établissements de la métropole ont réussi à
répondre aux besoins de la population.
L’ÉTÉ AUX URGENCES :
LA CRISE QUI N’A PAS
EU LIEU
On redoutait le pire pour les urgences de la métropole au début de l’été :
pénurie de main-d’œuvre, vacances du personnel, bris de service à l’urgence
de l’Hôtel-Dieu, débordement sur les autres hôpitaux, attente interminable, etc.
Pourtant, au sortir de la saison estivale, on constate que la crise annoncée n’a pas
eu lieu ; malgré un achalandage supérieur à l’année dernière, les patients ont été
moins nombreux à attendre plus de 48 heures aux urgences.
SUITE À LA PAGE SUIVANTE

Tout comme les administrateurs, qui ont fait
des pieds et des mains pour assurer la couverture
médicale estivale, les employés du réseau ont été
fortement sollicités. Le maintien complet des ser-
vices dans tous les établissements de la métropole
ne s’est toutefois pas fait sans quelques remous.
Certains ont notamment protesté contre le temps
supplémentaire imposé aux infirmières.
Travailler pour l’avenir
« Malheureusement, nous n’avons pas encore
effacé le spectre du temps supplémentaire obliga-
toire», explique Mme Carolle Turcotte, directrice
associée – Ressources humaines, relations avec
la population et Affaires juridiques à l’Agence de
Montréal. Selon elle, le fait d’avoir réussi à
assurer la présence d’effectifs infirmiers en nombre
suffisant pendant tout l’été est le fruit d’efforts
soutenus de la part des établissements et de
l’Agence, et non seulement la conséquence de l’impo-
sition du temps supplémentaire: «Les établissements
revoient l’organisation du travail et investissent énor-
mément dans l’accompagnement des jeunes infir-
mières, ce qui fait que les taux de rétention sont
meilleurs. Nous sommes à réexaminer tout ce qui a
fait fuir les infirmières pendant des années et nous
commençons déjà à voir des résultats.»
Avec la fin de l’été, le retour au travail et la ren-
trée scolaire, on peut s’attendre à une recrudes-
cence de l’activité aux urgences. Les initiatives en
vue de favoriser la disponibilité du personnel doi-
vent donc se poursuivre. L’Agence de Montréal
déposera d’ailleurs cet automne un ambitieux plan
d’action sur cette question si importante qu’est la
disponibilité de la main-d’œuvre, un plan qui fera
l’objet d’un prochain article.
M.L.
DR
VOLUME 5, NUMÉRO 1, 11 SEPTEMBRE 2008 2
SUITE DE LA PAGE 1 L’ÉTÉ AUX URGENCES : LA CRISE QUI N’A PAS EU LIEU
Brèves
Les aidants naturels: un apport inestimable
En 2001, les 1034 230 proches aidants québécois ont consacré
au moins 3,6 millions d’heures par semaine en soins et en aide,
soit 70 à 85% de toute l’aide que requièrent les personnes
âgées en perte d’autonomie. C’est ce que nous apprend le
Conseil des aînés du Québec dans son
Avis sur l’état de
situation des proches aidants auprès des personnes âgées en
perte d’autonomie.
Selon l’organisme, la valeur monétaire de
cette contribution peut facilement être estimée à 5 milliards
de dollars par année.
Renseignements: www.conseil-des-aines.qc.ca
Sondage national des médecins
Dans le
Sondage national des médecins 2007,
80% des médecins affirment que les besoins
croissants en matière de soins aux patients chroniques prennent la plus grande partie de leur
temps. Les médecins signalent également que les besoins en soins d’urgence dépassent les
capacités du système. Alors que 65% des médecins de famille peuvent voir d’urgence un
patient dans un délai d’une journée, seulement 37% des médecins spécialistes peuvent
accorder une consultation dans ce délai. Une situation qui exacerbe la pression sur les salles
d’urgence déjà débordées. Ce sondage est mené par le Collège des médecins de famille du Canada, l’Association médicale canadienne
et le Collège Royal des médecins et chirurgiens du Canada.
Source: www.sondagenationaldesmedecins.ca
FAITS SAILLANTS
• Les proches aidants sont le plus
souvent âgés de 52 à 84 ans.
• 60% des proches aidants sont
des femmes, comparativement
à 40% d’hommes.
• À elles seules les femmes donnent
80 à 90% des soins et de l’aide
apportés aux personnes en perte
d’autonomie.

VOLUME 5, NUMÉRO 1, 11 SEPTEMBRE 2008 3
Transformation des services de santé mentale
Le témoignage de Lorna Knight, elle-même
atteinte de troubles de santé mentale, illustre bien
les grands bénéfices que ces personnes peuvent
tirer de la vie dans la communauté:
Mon plus long
séjour a duré dix ans. J’étais tellement habituée de
vivre à l’hôpital que, lorsque j’avais la chance de
sortir pour passer quelques heures à l’extérieur,
je me ruais rapidement dans l’unité. (…) J’ai obtenu
mon congé du Douglas en mars 1998. Depuis,
je n’ai été traitée qu’à titre de patiente externe. (…)
J’habite aujourd’hui dans la communauté dans la
meilleure résidence au monde. Je travaille à temps
partiel. Je n’ai pas honte d’avoir un problème de
santé mentale. C’est comme si j’avais reçu de
mauvaises cartes dans le jeu de la vie. Mais qui
sait, si je les joue prudemment, (…) je pourrais
peut-être gagner la partie1.
Grâce à la désinstitutionalisation et malgré
ses problèmes de santé mentale, Lorna est
aujourd’hui en mesure de vivre une vie normale…
ou presque. Et c’est là l’objectif visé ! En effet, on
sait, depuis les années 1960, que la vie en établis-
sement ne permet pas aux gens d’atteindre leur
plein potentiel. La désinstitutionalisation, qui
consiste à privilégier la vie en communauté plutôt
qu’à l’hôpital, a permis d’importantes avancées
en ce sens, et les avantages sont nombreux. Ainsi,
les personnes « désintitutionalisées » ne voient
pas leurs symptômes se détériorer, jouissent
d’une plus grande autonomie, requièrent moins
de soins psychiatriques et sont moins souvent
hospitalisées, montre une étude effectuée à
l’Hôpital Louis-H.-Lafontaine2. En outre, cette
approche est plus respectueuse des droits de la
personne.
Cependant, vivre dans la communauté n’est
pas en soi garant du rétablissement. Pour y parve-
nir, les personnes atteintes de problèmes de santé
mentale doivent pouvoir bénéficier de services
adaptés à leur situation et à leurs besoins. Ces ser-
vices sont peu connus et peu répandus à Montréal.
Un des objectifs du plan de transformation est
d’ailleurs de les développer davantage.
C.D.
1.
Traduit de l’ouvrage
Le Douglas en 125 histoires et dessins,
publié
par l’Hôpital Douglas à l’occasion de son 125eanniversaire.
2.
Lesage, Alain,
La désinstitutionalisation dans un grand
hôpital psychiatrique québécois depuis 1989: analyse des
besoins de soins, des coûts et des aspects organisationnels,
Centre de recherche Fernand-Séguin, Hôpital Louis-H.
Lafontaine, juillet 1999, 32 pages. Pour consulter l’étude:
www.hlhl.qc.ca/pdf/desinstitutionnalisation.pdf
Dans les prochains numéros: les divers types de soutien
offerts dans la communauté.
DR
LE MILIEU DE VIE COMME
LIEU DE TRAITEMENT
Le plan de transformation des services de santé mentale donne une large place aux services
de première ligne et au maintien dans la communauté. De fait, le maintien dans la communauté –
soutenu par des services adéquats et suffisants – est reconnu comme un élément clé du rétablissement
des personnes aux prises avec un problème de santé mentale.
Désinstitutionalisation et
maintien dans la communauté
n’égalent pas itinérance
S’il est vrai que les personnes itinérantes sont souvent atteintes de pro-
blèmes de santé mentale ou de dépendance, il est faux de prétendre que
désinstitutionalisation égale itinérance. En effet, selon l’étude d’Alain
Lesage, qui a suivi une centaine de patients désinstitutionnalisés1pendant
dix ans, 90 % d’entre eux vivaient alors en appartement supervisé, 8 % en
logement autonome, et seulement 2 % n’avaient pu être retracés et pour-
raient donc être déménagés ou seraient devenus itinérants.
1. Ces patients avaient tous connu de longs séjours en hôpital psychiatrique (au moins 10 ans),
et la plupart étaient atteints de schizophrénie.
Lors de sa rencontre,
le 17 juin dernier, le conseil
d’administration de
l’Agence de Montréal
a adopté les
recommandations
contenant le plan de mise
en œuvre de la phase 2
du PASM à Montréal.
À consulter
www.santemontreal.qc.ca,
sous Plans régionaux

Le plan d’action mis de l’avant par le CSSS du Sud-
Ouest–Verdun vise à revoir l’organisation des
soins infirmiers afin d’introduire l’infirmière auxi-
liaire en tant que membre de l’équipe de soins, tout
en tenant compte des niveaux de responsabilités
de chacun des professionnels.
Ce projet est notamment rendu possible avec
l’entrée en vigueur de la Loi modifiant le Code des
professions grâce auquel le CSSS peut désormais
considérer la contribution de l’infirmière auxiliaire
dans la prestation des soins infirmiers à la
Direction du programme Service pour les per-
sonnes en perte d’autonomie – volet soutien à
domicile.
Le choix de cibler d’abord cette direction s’est
fait en tenant compte d’un contexte marqué par le
vieillissement de la population, l’alourdissement de
la clientèle et l’ajout de mandats. Il résulte de cette
nouvelle réalité une augmentation des demandes,
un accroissement des effectifs infirmiers ainsi
qu’une intensification des soins dans les services
de soutien à domicile.
Or, le CSSS éprouve de la difficulté à répondre
à tous ces besoins avec le personnel déjà en place
de l’équipe de soutien à domicile où la pénurie en
soins infirmiers se fait sentir, comme en témoi-
gnent les statistiques suivantes: 45 infirmières y
travaillent, 5 postes étaient vacants en début du
projet et plusieurs autres postes sont dépourvus
de leurs titulaires.
Malgré les tentatives régulières et intensives
de recrutement, le recours aux agences de person-
nel infirmier pour combler ces postes ainsi que les
congés sans solde, les pré-retraites, les fériés et les
vacances, est pratique courante. En moyenne, le
CSSS compte l’équivalent de 14 infirmières
d’agence par jour au soutien à domicile. Le recours
à la main-d’œuvre indépendante a toutefois des
conséquences non souhaitables tel que des bris
dans la continuité des soins et une perte d’effi-
cience entraînant des coûts plus élevés.
L’introduction de l’infirmière auxiliaire, recon-
nue par sa nouvelle capacité légale comme étant
apte à contribuer à l’évaluation des besoins du
client et au suivi du plan thérapeutique, apparaît
comme une avenue des plus prometteuses. Le
CSSS s’assurera toutefois de maintenir, dans la
nouvelle organisation de travail, les actes confiés
aux auxiliaires familiales et sociales déjà en
vigueur depuis quelques années.
Précisons enfin que la phase d’implantation
du projet est prévue au cours de l’automne 2008.
Reproduit intégralement avec la permission du CSSS du Sud-
Ouest-Verdun (Le Canal du Sud-Ouest–Verdun, juin 2008, p. 4).
DR
UN PROJET DE RÉORGANISATION
NOVATEUR AU CSSS DU
SUD-OUEST–VERDUN
Choisi par le ministère de la Santé et des Services sociaux pour la mise en place d’un projet pilote
visant à soutenir les efforts déjà déployés par l’établissement dans le cadre de la réorganisation du
travail en soins infirmiers, le CSSS du Sud-Ouest–Verdun répond avec un plan d’action novateur sur
lequel travaillent la direction et le Syndicat de professionnel(le)s en soins de santé du Sud-Ouest
et de Verdun.
VOLUME 5, NUMÉRO 1, 11 SEPTEMBRE 2008 4
Les objectifs
en bref
• Diminuer l’utilisation
de la main-d’œuvre
indépendante infirmière;
• Augmenter la continuité
des services;
• Augmenter la stabilité
des équipes ;
• Réviser le mode de
distribution des soins
infirmiers ;
• Implanter le PTI (plan
thérapeutique infirmier);
• Utiliser les compétences
de façon optimale
(infirmière clinicienne,
infirmière, infirmière
auxiliaire) ;
• Intégrer les infirmières
auxiliaires ;
• Augmenter le nombre
d’infirmières sur l’équipe
volante.

Les toxi-infections alimentaires, de même que plu-
sieurs infections transmises par des aliments
contaminés, sont à déclaration obligatoire, c’est-
à-dire qu’elles doivent être déclarées par les méde-
cins ou les laboratoires à leur Direction régionale
de santé publique. En ce qui concerne la listériose,
seuls les laboratoires peuvent en faire la décla-
ration puisqu’un test de laboratoire est requis
dans l’identification de la bactérie
Listeria mono-
cytogenes
qui en est la cause.
C’est lorsqu’un laboratoire déclare à la
Direction de santé publique de l’Agence de la
santé et des services sociaux la découverte de la
bactérie lors d’un test prescrit par un médecin
que le branle-bas de combat commence. Une infir-
mière du secteur Vigie et protection, dirigé par le
DrTerry Nan Tannenbaum, communique alors
rapidement avec le patient afin de chercher à iden-
tifier les produits consommés pouvant être à la
source de l’infection, de retracer les autres per-
sonnes qui auraient pu consommer ces produits, et
de rappeler les consignes relatives à la prévention
et à la surveillance des symptômes.
Lorsque l’enquête permet de suspecter
qu’un produit ou un établissement (marché
d’alimentation, restaurant) sont susceptibles
d’être à la source de l’infection, la DSP avise la
Direction de l’inspection des aliments (DIA) de la
Ville de Montréal. Mandatée par le ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
(MAPAQ), la DIA recherche, sur le territoire de
l’agglomération de Montréal, des produits ali-
mentaires dont la consommation pourrait être
dangereuse. Lorsqu’ils en trouvent, les inspecteurs
de la DIA vont récupérer, chez les patients ou dans
les établissements concernés, les produits poten-
tiellement contaminés pour les faire analyser en
laboratoire.
LISTÉRIOSE ET AUTRES
TOXI-INFECTIONS ALIMENTAIRES
COMMENT LA TRAQUE ET
LA RIPOSTE S’ORGANISENT
Les instances chargées de s’assurer que les produits alimentaires mis sur le marché ne présentent
aucun risque pour la santé ainsi que les instances de santé publique se partagent la responsabilité
de la prévention des toxi-infections alimentaires. Ainsi, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries
et de l’Alimentation du Québec et le ministère de la Santé et des Services sociaux sont chargés de
surveiller conjointement la survenue de cas de toxi-infection et d’en identifier l’agent pathogène.
VOLUME 5, NUMÉRO 1, 11 SEPTEMBRE 2008 5
SUITE À LA PAGE SUIVANTE
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%