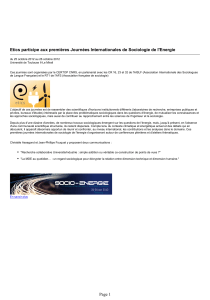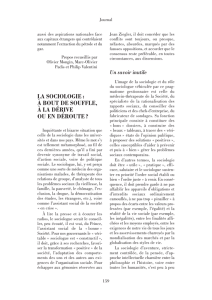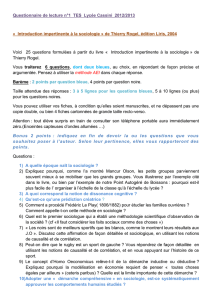La liberté comme une couleur de la société idéale Entretien avec

Aspects Sociologiques, volume 9, n
o
1, août 2002
La liberté comme une couleur de la société idéale
Entretien avec Nicole Gagnon
Chizu Ito
Nicole Gagnon est professeur de sociologie à l'Université Laval. Ses
champs d'intérêt sont la méthodologie, les récits de vie, l'histoire du
Québec (XX
e
siècle), l'histoire de la sociologie et l'éducation. Elle détient
une maîtrise ès arts (1961) et une maîtrise en sciences sociales (1962) de
l'Université Laval. Elle est diplômée de l'Institut de psychologie de la
Sorbonne (1966). Elle a pris sa retraite à l'été 1999.
Comme mon sujet de mémoire porte sur la condition féminine, le
livre de Nicole Gagnon intitulé L'antiféministe a éveillé ma curiosité. Je
lui ai demandé un entretien, qu'elle m'a accordé avec plaisir.
Notre entretien s'est déroulé chez elle, par un bel après-midi de
juillet 1999. Nous avons causé pendant à peu près deux heures. Les
questions que j'avais préparées portaient sur sa carrière de professeur à
l'Université Laval, sur l'éducation au Québec, sur la société et sur la
question féministe.
***
A.S. Pourquoi avez-vous choisi le métier de sociologue?
N.G. Je l’ai choisi justement parce que ça ne menait à rien. Quand j’ai
fini mes études, j’ai pensé étudier en sciences exactes. J’avais été bonne
en chimie : j'avais eu vingt sur vingt, première de tous les collèges. Je me
suis dit : je suis bonne en chimie, je vais aller en chimie. Et tout à coup,
je me suis imaginée avec une grande veste blanche devant une
éprouvette, jusqu’à la fin de mes jours. Tandis qu'en sociologie, il n’y
avait pas d’image comme celle-là. La seule image liée au métier de
sociologue, c’était celle de monsieur Fernand Dumont, qui enseignait.
Évidemment, je n’aurais jamais eu l’idée de me voir à la place de

Entrevues
82
Fernand Dumont. Jamais je n’aurais pensé à ça. Pour moi, la sociologie,
c’était être à l’école tout à fait gratuitement, sans être engagée dans quoi
que ce soit, et sans que ça nous mène à quelque chose de précis. C’était
l’indétermination, la liberté qu'il y avait là-dedans qui m'intéressait. Ce
n’est pas tout à fait orthodoxe comme choix. Souvent les gens vont en
sociologie parce qu’ils veulent changer la société, ou ils veulent la
comprendre. Moi, pas du tout. La société, je n'avais même aucune idée de
ce que ça pouvait être. J’étais rendue en deuxième année, et je n’avais
pas compris non plus ce que pouvait être la sociologie. Je n’en n’avais
même aucune image. Et encore moins de la société. Je ne m’engageais
pas dans un métier, mais j’allais à l’école, je continuais à apprendre pour
le plaisir de savoir des choses.
A.S. Et puis, vous êtes toujours satisfaite de votre choix?
N.G. Je ne me suis pas posée la question. Sauf que je me suis dit:
«qu’est-ce que je vais faire ?» C'est Gérald Fortin qui m’a « ramassée » :
il m’a donné un avenir en me recrutant comme professionnel de
recherche et ensuite il m’a recrutée comme professeur. Autrement, je ne
sais vraiment pas ce que j’aurais fait. La petite chose que je sais faire
vient du fait que j’ai la tête assez claire : je suis capable de démêler les
choses. C’est le talent que j’ai, je n’en avais pas d’autre.
A.S. Dans votre carrière de professeur de sociologie, quel est
l’événement qui vous a le plus marqué?
N.G. Ça, c'est bien compliqué comme question, parce que, d’abord, il
faut distinguer les événements mémorables et les événements
déterminants : mémorables, c’est ce dont on se souvient ; déterminants,
c’est ce qui change le cours de la vie. D'ailleurs, j’ai écrit une histoire du
département de sociologie. Elle s'arrête en 1970, parce qu’à partir de là,
j’aurais été un peu embêtée : est-ce que ça aurait été une histoire du
département ou bien mon histoire à moi ? Tu sais, je n’aurais pas été
capable de démêler ça très bien.
A.S. Dans quel livre?
N.G. Dans un chapitre d’un ouvrage collectif, qui s’appelle Cinquante
ans de sciences sociales à l'Université Laval, sous la direction d’Albert
Faucher. Pour les étudiants, il y a donc une histoire du département qui

A
SPECTS
S
OCIOLOGIQUES
83
existe. Elle arrête en 1970, mais quand même, cette partie-là est écrite. Et
après ça, ce qui était important pour moi ou pour le département était lié,
et la différence n’était pas toujours facile à faire.
Parmi les événements mémorables, il y a eu les grèves étudiantes des
années 68-72, à peu près. Ils m’ont « étrennée » un peu durement à ce
moment-là. Je pense que ça m’a marquée, parce que je suis restée un peu
fragile devant les étudiants à cause de cela. Puis il y a eu la grève des
professeurs de 1976. Ça a été une grande grève mythique, la chose la plus
extraordinaire. Comme disait Monsieur Hamelin, qui a écrit là-dessus : «
c'est le moment où on a pu entendre battre le cœur de l’université ».
Toutes sortes de liens de solidarité se sont tissés. Maintenant, on est
chacun dans son coin et on ne se voit pas. La grève a transformé
l’université en système de relations employeurs-employés, ce qui est
complètement contraire à l’idée même d’université. L’Université, c’est
des professeurs et des étudiants. Les personnes qui administrent, c’est
l’Administration. C’est eux qui font fonctionner et pour le reste, ils n'ont
pas d'importance. Cette attitude a changé un peu avec la grève des
professeurs quand le syndicat s’est mis à les considérer comme des
employés, donc à traiter les administrateurs comme des patrons.
A.S. Quel est votre engagement vis-à-vis de la société?
N.G. Jusqu’à ce que j’agisse comme un professeur, je ne parlais pas. J’ai
parlé une fois dans un séminaire à Paris pour défendre mon mémoire de
maîtrise. Quand on m'a engagée comme professeur, j’ai parlé.
Maintenant, beaucoup de gens de ma génération sont morts. Je suis une
survivante. Ce que j’appelle ma génération, ce sont tous les gens qui sont
nés entre 1918 et 1940 à peu près, entre les deux guerres. Moi, je suis née
dans les toutes dernières vagues, en 1938. Dumont est mort, il faut que je
parle parce qu’il n’est plus là pour parler. Je pense donc que j’ai un
certain devoir de rappeler des choses que les générations plus jeunes ne
voient pas, parce qu’il faut être de ma génération pour les voir.
L'engagement, ce serait d’écrire des articles, ce qu’on appelle « faire
l’intellectuel de place publique » - ce que j’ai très peu fait dans ma
carrière. Mon engagement était de faire de la bonne science et du bon
enseignement, d’élever du monde correctement. J’ai donc commencé à
écrire mais je n’aurais pas écrit de moi-même si un historien ne m'avait
pas demandé d’écrire un livre avec lui. Je n’ai pas l’esprit d’entreprise.

Entrevues
84
Mais maintenant, je sens que j’ai un certain devoir, parce que je suis une
vieille sage.
A.S. Que pensez-vous du retour, depuis quelques années, de la
philosophie dans la sociologie québécoise?
N.G. Je ne suis pas contre ça. D’abord, elle a toujours eu une certaine
présence, dès mon époque. Dumont était, comme il dit, «sociologue par
métier, philosophe par vocation». Déjà, on avait un grand philosophe qui
était Dumont. La différence c'est que son enseignement était distinct de
son écriture. Quand il nous donnait des cours, évidemment, c’était
structuré par un regard philosophique, mais il nous a enseigné une
sociologie un peu positive, je dirais. Quand il a publié son livre de
sociologie intitulé Les idéologies, ce que je considère comme son livre où
toute sa pensée sociologique est rassemblée, j'ai été un peu estomaquée.
Il m’avait montré son manuscrit pour savoir ce que j’en pensais et c’était
des choses qu’il n’avait pas dites. Je ne reconnaissais pas dans le livre ce
qu’il enseignait dans ses cours sur l’idéologie. Ce n’était pas le contraire,
mais c’était différent. Maintenant, a posteriori, je conseille de lire ce
livre-là, car c’est là que se trouve la sociologie de Dumont.
Deuxièmement, je crois que Freitag par exemple, comme Dumont,
est un philosophe qui a fait de la belle sociologie. Dans ce qu’il enseigne,
moi j’ai retenu sa belle typologie des trois modes de reproduction.
Cependant, je n’aime pas tellement quand les étudiants se mettent à
raisonner avec des concepts philosophiques. Quand on parle d'ontologie,
par exemple, je suis obligé de traduire dans des concepts plus
positivistes. Par ailleurs, j’ai aussi pour principe que la sociologie est
œcuménique. Il y a des étudiants qui font des thèses philosophiques,
d'autres qui font des thèses gestionnaires, d'autres qui font des thèses
psychologiques... on prend tout, on n’est pas regardant, on accepte tout.
A.S. Pensez-vous que la philosophie découle de la sociologie?
N.G. Non. Il y a une belle phrase – que disait Dumont – selon laquelle le
philosophe, parce qu’il a un regard singulier, voit les choses avant le
sociologue dans la réalité. Après, il abandonne ces thèmes à la science.
La sociologie, si l’on veut faire la distinction avec la philosophie, c'est un
savoir plus objectif et plus positif que la philosophie. C’est le métier du
sociologue que d’apporter certaines raisons objectives plutôt que

A
SPECTS
S
OCIOLOGIQUES
85
d’exprimer ses idées. L’essentiel, c’est de ne pas dire n’importe quoi.
C'est de savoir ce qu’on dit et de garantir une certaine objectivité dans
nos propos. Mon métier consiste à enseigner à ne pas dire n’importe quoi
et à savoir de quoi on parle. Alors que la philosophie, c’est le plus beau
métier si l'on veut se mettre à réfléchir. Le sociologue, lui, il commence
par aller voir, il essaie de se décentrer. Il essaie de sortir de son propre
nombril pour avoir un discours plus collectif. Je ne me plains pas du tout
de la philosophie, sauf qu’il ne faut pas mêler les choses. Je ne veux pas
que les étudiants me parlent de l’ontologie.
A.S. Que pensez-vous du système d’enseignement au Québec?
N.G. Le système d’éducation n’est pas très bon. Si je m'interroge sur
l’avenir de l’éducation au Québec, je dirais qu'elle a un grand avenir
parce que ce qui se fait est tellement mauvais que c’est un des rares
domaines où il y aurait moyen de changer quelque chose. Le changement
serait abstrait seulement. En pratique, étant donné l’état de la société,
c’est difficilement envisageable. Je suis également assez sceptique sur
toutes les tentatives d’amélioration de l’éducation qu’on a faites pendant
la Révolution tranquille. Il y avait des bonnes écoles normales, des
bonnes écoles de métier, de bons collèges classiques. Et on a construit
des polyvalentes. Évidemment, idéologiquement, c'était justifié, mais
c’était surtout justifié par le fait de récupérer l’argent du fédéral. Alors
pour récupérer cet argent-là, et pour pouvoir financer la réforme de
l’éducation, on a mis l’enseignement technique et l’enseignement général
dans les mêmes classes. Cela a été une grosse erreur. Toute l’éducation,
en réalité, s’était modernisée dans les années 50. La réforme était en
cours déjà. On l'a effacée et on en a refait une autre. Je ne suis pas très
fière des réformes de l’éducation qui ont eu lieu pendant la Révolution
tranquille.
A.S. Que pensez-vous de la séparation entre la religion et l’éducation
qui a eu lieu à cette époque-là?
N.G. On ne les a pas séparées vraiment, les écoles sont encore
catholiques. On vient tout juste de faire des changements. Avant, on avait
des commissions scolaires selon la religion : catholique ou protestante.
On vient tout juste de changer pour francophone/anglophone. Mais on
enseigne encore la religion dans les écoles. On commence seulement à
dire qu’on ne l’enseignera plus.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
1
/
17
100%